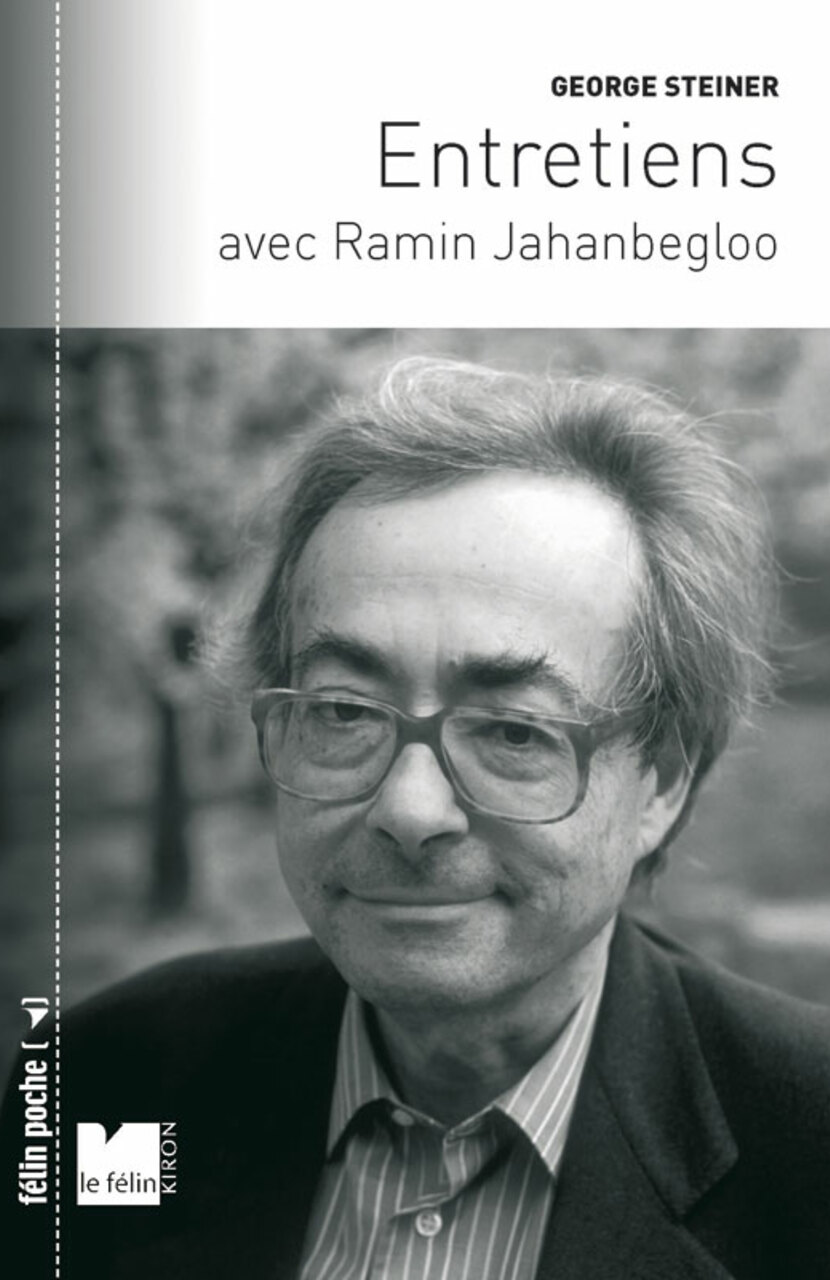
George Steiner
RAMIN JAHANBEGLOO. – Vous êtes né à Paris en 1929 ; comment s’est déroulée votre enfance ?
GEORGE STEINER. – La question que vous me posez n’est pas si simple. Une divergence est née d’emblée entre d’excellentes, voire idéales, conditions de vie bourgeoise et un accès aisé à la culture – notre appartement était situé dans le XVIe arrondissement, ce qui ressort d’ailleurs d’une appartenance à un certain milieu parisien – et un contrepoint immédiat qui jaillit du poids terrifiant de la montée du nazisme et de la menace hitlérienne. Mon père, d’ascendance tchécoslovaque, a immigré très jeune à Vienne et a rencontré dans cet Empire austro-hongrois une véritable tolérance pour tout ce qui pouvait contribuer à l’épanouissement des talents propres à chacun. De nos jours, l’humanité tragique des pays de l’Est donnerait beaucoup pour que ressurgisse cet empire défunt dont l’ombre commence de nouveau à luire. Mon père, dont la situation matérielle était extrêmement précaire, a pu connaître une ascension fulgurante au lycée. De fait, l’Empire austro-hongrois lui a ouvert les portes du succès, grâce à son intelligence et à son seul mérite. C’est ainsi que Akademisches Gymnasium lui a offert d’apprendre le grec et le latin au meilleur niveau qui soit. Puis une grande carrière à l’université de Vienne s’est dessinée car il étudiait à la fois le droit civique et l’économie politique sous l’égide de la célèbre école viennoise dont Hayek serait aujourd’hui le principal représentant. Juif d’origine tchèque, mon père est devenu à vingt-quatre ans, alors qu’il ne jouissait d’aucun appui financier, secrétaire juridique à la Banque centrale d’Autriche. C’est là un exemple caractéristique de carrière éblouissante au cœur de la judaïté de l’Europe centrale. J’essaie de comprendre, à travers la lecture des journaux de l’époque, la mort de mon père en 1968, le jour de l’invasion soviétique à Prague, convaincu que cette mort n’était pas une coïncidence. Ce fut la dernière épreuve de sa vie à laquelle il n’a pas voulu survivre. Lorsque je pense à lui, il me vient à l’esprit ce mot d’intuition quasi surnaturelle, de flair, qui lui faisait présager de l’avenir. Alors qu’il avait mené une carrière brillante en Autriche – un fiacre mené par deux chevaux étant le symbole de sa réussite – il a senti la montée de l’hitlérisme dès la fin de la Première Guerre mondiale, saisissant que la survie matérielle de ce pays ainsi que son génie culturel n’avaient plus d’assise réelle. La peur de la guerre allait engendrer de violents bouleversements, les boucs émissaires étaient tout trouvés. La menace laissait entendre que des événements dramatiques surviendraient.
Mon arrière-grand-père avait découvert par hasard, dans une pharmacie de la ville galicienne de Landberg, le drame de Büchner intitulé Woyzeck. Tandis que personne ne connaissait la valeur de ce texte, fort de son jugement d’écrivain, il l’a édité en sachant qu’il avait en main un chef-d’œuvre. Aujourd’hui encore, je considère qu’avoir ainsi sauvé de l’oubli ce manuscrit est un titre de noblesse pour notre famille.
Ma mère était originaire d’une vieille famille viennoise de confession juive. Son éducation, propre à celle de la haute bourgeoisie de l’époque, a été cosmopolite et polyglotte, ce qui lui a permis d’apprécier tout à la fois les cultures française, italienne et anglaise. Sa destinée est aussi frappée du sceau de l’exceptionnel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’est rendue à plusieurs reprises à Budapest et, fait caractéristique, elle s’y est trouvée alors que la révolution de Béla Kun s’amorçait. Son rôle consistait à procurer à l’armée autrichienne cuirs et peaux que la Hongrie lui fournissait. Elle a été l’une des premières femmes à occuper un poste au ministère de la Guerre. Son mariage lui a offert, outre un avenir radieux, un train de vie dont le luxe s’exprimait par une maison à Vienne, demeure natale de ma sœur aînée. C’est pourquoi elle a été vivement ulcérée par la décision de mon père de quitter cette ville. Elle ne le comprenait pas puisque la famille avait survécu à la Grande guerre et à la révolution de Béla Kun. Son argumentation tenait aussi au fait que la situation économique s’améliorait, en dépit d’une inflation galopante. Pour ma part, je considère que cette décision paternelle a été le premier acte d’une clairvoyance dont la puissance approchait la force profonde du Unheimliche, de l’inquiétante étrangeté.
Mais que s’est-il passé après que votre famille ait quitté Vienne en 1924 et se soit installée à Paris ?
Mon père a dû repartir à zéro. La situation économique des années trente était très difficile. Mais il sut lutter et écrire des articles d’économie précisément, publiés dans le Manchester Guardian, ce qui a représenté l’un de ses premiers contacts avec l’Angleterre. Il a réussi ensuite à trouver un travail dans une grande firme américaine mais de nouveau il s’est heurté à l’antisémitisme des patriciens américains de Wall Street qui appartenaient à une autre génération. Ce n’était plus la même forme de haine raciale, mais les antécédents de mon père, juif et natif d’Europe centrale, n’ont pas favorisé son intégration dans cette nouvelle patrie.
Quels sont vos souvenirs de Paris, à cette époque ?
J’ai tout d’abord habité rue Paul-Doumer, à proximité de la rue de la Pompe, où j’ai rencontré une colonie de juifs immigrés d’Europe centrale. Le lycée Jeanson-de-Sailly était quelque peu le noyau de notre rayonnement intellectuel. Chose curieuse, mes parents m’ont donné une éducation telle que, dès ma naissance, j’ai parlé sans aucune distinction l’allemand, l’anglais et le français. J’en rends grâce a mon père car, comme je l’ai écrit dans l’Après Babel, il a su deviner qu’une langue qui s’apprend est une nouvelle liberté, une langue nouvelle, un cosmos et un monde à elle seule, enfin une chance de survie inestimable. Mener de front l’étude de ces trois langues ne m’étonnait nullement, j’en venais même à penser que c’était quelque chose de tout à fait naturel. J’avais sous mes yeux l’exemple de mon père qui me racontait sans relâche qu’à Prague, on parlait spontanément le yiddish, l’allemand, l’hébreu et le tchèque. Issu d’une famille cultivée, sa première gouvernante lui a également enseigné le français. Cela me fait songer à l’univers de Nabokov qui parle anglais avant d’apprendre le russe, alors qu’il vit à Saint-Pétersbourg. De nos jours, je suis attristé par cette crainte typiquement américaine d’effrayer les enfants en leur donnant une éducation multilingue. Mon père était différent: désireux de me voir ouvrir les portes d’autres modes de connaissance, il m’a inscrit à l’école américaine de Paris, rue Théophile-Gauthier. Son geste, pour original qu’il fût, n’en a pas moins soulevé des critiques parmi ses amis français qui jugeaient que l’on devait avant tout s’intégrer à la culture française. Mon père n’a jamais cru véritablement à cette idée d’assimilation. Certes, il adorait la France, mais ayant vécu l’affaire Dreyfus, il ne lui a pas accordé sa confiance. Il était convaincu corps et âme que les juifs devaient avoir sous la main leurs bagages préparés de telle sorte qu’ils puissent s’enfuir rapidement; son dicton préféré étant d’ailleurs «les grosses malles sont toujours faites, les titres peuvent être remis à demain». Il était passionné par les faits, les événements qui se déroulaient et cet intérêt majeur constitue étrangement le premier de mes souvenirs. C’était en 1934, j’avais cinq ans. Paris vivait de sales moments. Le mouvement d’extrême droite des Croix-de-Feu que l’on pourrait comparer à une partie du mouvement actuel de Le Pen, remontait la rue de la Pompe, dûment escorté par les Camelots du Roi et la jeunesse franquiste. Ils hurlaient «mort aux Juifs». Ma nourrice allemande qui parlait le haut-allemand puisqu’elle était originaire de Potsdam a couru pour venir me chercher au jardin d’enfants et me ramener le plus vite possible à la maison. Je me souviens aujourd’hui encore qu’ils scandaient de leurs pas «Plutôt Hitler que Blum». Lorsque nous fûmes de retour chez nous, ma mère ferma les volets, tandis que mon père rentré aussi vite était d’un calme absolu. Or, je voulais voir ce qui se passait dehors et demandais à maman d’ouvrir les volets. Je regardais cette foule qui passait dans la rue, brisant les vitrines et hurlant des slogans. À ce moment précis, mon père est venu vers moi et m’a dit de son ton si calme: «Tu vois petit, c’est ça l’Histoire.» Jamais je n’oublierai ce mot de mon père. Sur le coup, je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire, mais cette parole m’a immédiatement apaisé. Et puis, j’ai vu le monde sous un jour nouveau et j’ai répondu à mon père: «D’accord papa, ça s’appelle l’Histoire» ; et depuis, face aux crises les plus graves qui soient, je sais que « ça s’appelle l’Histoire». Pour l’enfant que j’étais, cette phrase a été décisive, déterminante.
À ce propos, vous est-il possible de parler plus en détail de l’éducation que vos parents vous ont donnée ?
Comme je vous l’ai déjà expliqué, je fis mes premières classes à l’école américaine de Paris. L’enseignement y était donné en anglais tandis qu ’à la maison, des leçons particulières me permettaient de parfaire mon français. Mon père, dont les journées de bureau étaient extrêmement longues – la peur de la montée du fascisme nourrissait des craintes vivaces pour l’avenir de sa famille, craintes que je ne peux comprendre qu’aujourd’hui – se libérait plusieurs soirées par semaine pour s’assoir à mes côtés. Son enseignement était multiple. Sa méthode, tout d’abord, consistait à me donner de plus en plus envie de lire. Il lisait Homère dans une très belle version du xviiie siècle que j’ai d’ailleurs conservée dans ma bibliothèque. Mon père m’expliquait, en allemand, les ressorts de l’histoire et d’un seul coup s’arrêtait net pour commencer à me traduire l’Odyssée en grec. Et c’est ainsi que je fis mes débuts dans l’apprentissage du grec. Ce fut une révélation de la sérieuse leçon de psychologie que me donnait mon père. J’ai alors compris que pour approcher un texte, connaître la langue me dispensait d’avoir recours aux traducteurs. Par ailleurs, ma curiosité de lecteur était aiguisée de livre en livre, mais je n’avais droit de lire l’ouvrage suivant qu’à condition d’avoir résumé celui que j’avais terminé. Mon père m’achetait des livres, mais il me donnait également un cahier relié de cuir sur lequel je devais écrire ma note de lecture. Tout résidait dans l’explication que je donnais à mon peu d’enthousiasme face à un livre que je n’avais pas aimé; je pouvais le dire, à condition d’argumenter. Mon père ne faisait aucune critique de mes goûts livresques, il étudiait ce que j’avais noté et j’avais droit au prochain objet de ma convoitise littéraire. Il fallait que je résume ce que j’avais lu, au besoin que je l’apprenne par cœur et je rencontrai dans cet exercice ce qui allait me permettre d’avoir le sens des langues. Ce que je dois à cet homme sévère et sombre, hanté par la menace hitlérienne, c’est cette éducation qui touche à la grâce. Lorsque j’eus sept ans, je lui posai des questions sur le sens de l’éducation qu’il me donnait. Il refusait de me répondre et se contentait de me dire: «Tout ce que je fais, c’est pour que tu ne saches jamais ce qu’est une action ou une valeur bancaire. Tout ce que je fais c’est pour que tu sois un jour un savant… » Cela tenait bien sûr au grand rêve judaïque. Les générations antérieures souffrent et, le père se sacrifie – si sa situation le lui permet – il veut que son fils devienne une personnalité marquante dans le domaine des sciences. Je crois profondément que mon père me destinait au professorat plus qu’à tout autre chose. Certes, il adorait la littérature et la connaissait merveilleusement, mais il avait ancrée en lui l’image de celui qui transmet la connaissance et l’amour des textes. Il avait publié trois monographies sur la pensée économique de Saint-Simon, socialiste réformateur français, ce qui lui a valu d’être sollicité par l’université de Vienne qui lui proposait de devenir assistant. Comme il devait subvenir au besoin de ses parents, il a refusé ce poste mais j’ai compris plus tard qu’il désirait que je sois ce que lui-même n’a pû être et cela est demeuré en moi comme une parole donnée à ne jamais rétracter un pacte sacré. Je garde un souvenir fabuleux des étés que nous passions sur la côte normande, des étés où mon père me faisait travailler les classiques. Il aimait la Manche alors que ma mère et ma sœur pleuraient à longueur de temps parce que même en juillet, il pleuvait sans arrêt. La maison que nous prenions en location était fort belle. Une bibliothèque dûment fournie m’entourait et je passais des journées entières à lire.
Mais il y a un autre point qui me frappe d’emblée lorsque je pense à cette enfance. Je suis né avec un grave handicap du bras et de la main droite, handicap que ma mère a refusé d’accepter et contre lequel elle a lutté toute sa vie. De nos jours, on permet à l’enfant d’être gaucher. Le traitement que l’on m’a réservé était sans commune mesure avec les pratiques actuelles. J’avais la main gauche ligotée dans le dos et j’ai appris à écrire et à peindre avec ma main droite, qui était pratiquement paralysée. J’ai mis six mois à apprendre à lacer mes chaussures, ce qui désolait ma mère au plus haut point. On ne se rend pas compte que pour faire un nœud, il faut pouvoir se servir de ses deux mains. J’ai finalement réussi à vaincre cette difficulté et sais gré à ma mère de m’avoir insufflé tout ce qui est en moi de volonté et d’autorité. Je lui dois également mon hésitation devant toutes les thérapies dites modernes. Ce handicap m’a au contraire porté bonheur. Grâce à lui, j’ai échappé à l’armée et ai donc pu achever mon cursus universitaire rapidement. Enfant, on me disait : «Quelle chance tu as d’être gaucher, c’est un titre de noblesse, tu n’es pas comme les autres», et bien que j’aie méconnu la valeur de cette prophétie, elle s’est révélée exacte. C’est le contraire même de la psychologie collectiviste américaine ou de la psychanalyse freudienne qui demande à un individu d’être semblable aux autres. L’idée même d’être « comme les autres » me semble une aberration. Si jamais je suis en accord avec quelqu’un alors que je me trouve dans le même endroit que lui, je me traite immédiatement d’imbécile. C’est le fruit de l’éducation que j’ai reçue de mon père qui me répétait que j’étais différent des autres et que je jouissais d’un grand privilège. J’ai pu bénéficier de cette aisance matérielle, de ces voyages et de cette ambiance à la maison où j’ai rencontré des gens dont les conversations me semblaient passionnantes alors que j’ignorais qu’ils étaient des réfugiés. Par exemple, des concerts se donnaient chez mes parents pour aider des musiciens chassés de Vienne ou d’Allemagne. Pendant cette terrible décennie des années trente, les gens partaient en laissant derrière eux toute leur vie. Je me souviens d’un cadeau que l’on m’avait fait: un petit éperon pour enfant dont je ne pouvais pas me servir à la maison parce qu’il déchirait la moquette. Un soir, alors que je revenais du parc de la Muette où j’avais coutume de jouer, je suis entré en courant dans le salon, muni de ces dits éperons. Mon père s’est levé de son siège pour me punir et j’eus l’impression de me trouver face à une forme gigantesque qui me faisait penser – sans raison sinon la peur – à une asperge blanche. Et puis, j’entends une voix très douce chuchoter « ça ne fait rien». Cette voix était celle de James Joyce qui participait, cet après-midi-là, à une réunion qu’organisaient mes parents, réunion où l’on préparait lectures et contributions pour des revues d’avant-garde. Ce furent des moments de mon enfance on ne peut plus privilégiés.
Un autre souvenir me revient: je revois mes parents qui s’étaient installés autour du poste de radio pour écouter Hitler donnant un discours proche de la démence à Berlin. Mon père nous prédisait: «Cet homme va faire ce qu’il dit.» Alors que tous les gens qu’il connaissait ne voyaient en Hitler qu’un clown hystérique et présageaient la fin rapide de cette affreuse histoire, il savait lui que ce cauchemar n’allait pas tourner court et commençait à lutter en préparant notre départ vers des lieux plus sûrs. Il n’avait aucune illusion sur la politique française, ayant étudié ces choses de près; il nous disait pour nous convaincre: «C’est merveilleux la France, mais ailleurs, c’est aussi merveilleux.» C’est à la fois très simple et très compliqué. Si je répète dans chacun de mes livres – bien que cela mette en colère un bon nombre de lecteurs – que l’arbre a des racines, l’homme des jambes, et que c’est là un progrès immense, je suis ainsi le droit chemin que m’a tracé mon père. Jamais il ne se contentait de dire: «N’est-ce pas que ce que l’on a est magnifique», sans ajouter immédiatement: «Tu vas voir, ce qui se passe ailleurs est aussi passionnant.» C’est aussi mon credo. Pour donner un exemple, imaginons que je doive aller demain à Djakarta. J’espère que j’apprendrais l’indonésien, ce qui troublerait la paresse qui me guette. En deuxième lieu, il est probable que je ne trouverais pas un travail palpitant mais il serait intéressant d’envisager autre chose. Enfin, je ne crois pas que je reprocherais à Dieu, à qui je parle trop, de me punir de telle sorte. Au contraire, je le louerais de m’avoir envoyé dans un univers aussi différent. J’ai la certitude qu’il ne faut pas se plaindre de la complexité du monde et des traces de l’histoire. Être né au xxe siècle est une sorte de privilège. Mais pour revenir a notre sujet, la pression de la montée du fascisme était considérable à un point tel que ma famille était inquiète du sort de mes grand-parents, qui heureusement si je puis dire, sont morts avant que la guerre n’éclate, et de celui de mes cousins, malheureusement exterminés dans les camps. Mes parents ont senti venir l’holocauste et à ma manière, j’ai également pressenti qu’une tragédie s’amorçait, en m’entendant demander de quitter la pièce où les adultes commençaient à parler d’une voix différente. Reste qu’avant toute chose, j’ai senti la tristesse et l’ironie de mon père face à ses amis français lorsqu’ils lui disaient: «Jamais on ne vous touchera, ici.» À partir de ce moment, j’ai connu les angoisses de la guerre et comme tous les enfants, je portais mon masque à gaz. Je pris pour une idée stupide d’être envoyé à Saint-Nazaire, mais en fait c’était une idée de génie que d’être aussi loin du Rhin que possible et ce fut pourtant le premier point de bombardement. J’ai ainsi reçu une première leçon sur l’illogisme de l’histoire qui ruse avec la vie. La vie et l’histoire ont un humour noir beaucoup plus développé que celui du cerveau humain qui, soupesant une carte du monde, expédie ses enfants le plus loin possible du danger. Kafka avait démonté les rouages de cet univers et il disait vrai.
George Steiner, écrivain et philosophe, professeur à Genève et Cambridge est l’auteur d’une œuvre considérable qui tourne autour du langage, de son sens et de ses conséquences morales et religieuses. De Tolstoï ou Dostoïevski jusqu’au Réelles Présences, en passant par Langage et Silence et Les Antigones, Steiner, au moyen d’un style très clair et vigoureux où l’érudition n’est jamais inutile, analyse les menace qui pèsent sur le langage, sur la position du poète face à la barbarie, sur la survie d’un sens lié à la culture occidentale. Dans ces entretiens avec Ramin Jahanbegloo, George Steiner nous dessine, pour la première fois, les moments charnières de son itinéraire. Il y dégage les lignes de force de sa pensée à l’écart de toutes les modes et de toutes les tendances et pourtant toujours attentive à ce qu’il y a de plus contemporain.
George Steiner s’affirme ainsi encore une fois, à travers ce face-à-face, comme un « survivant » et un « maître à lire ».
Philosophe iranien, Ramin Jahanbegloo vit actuellement au Canada après avoir séjourné en France de longues années. Journaliste, il collabore à Esprit et Études, il a déjà publié aux éditions du Félin les Entretiens avec Isaiah Berlin, 1990 ; les Entretiens avec Daryush Shayegan, 1992 et Gandhi aux sources de la non violence, 1998.