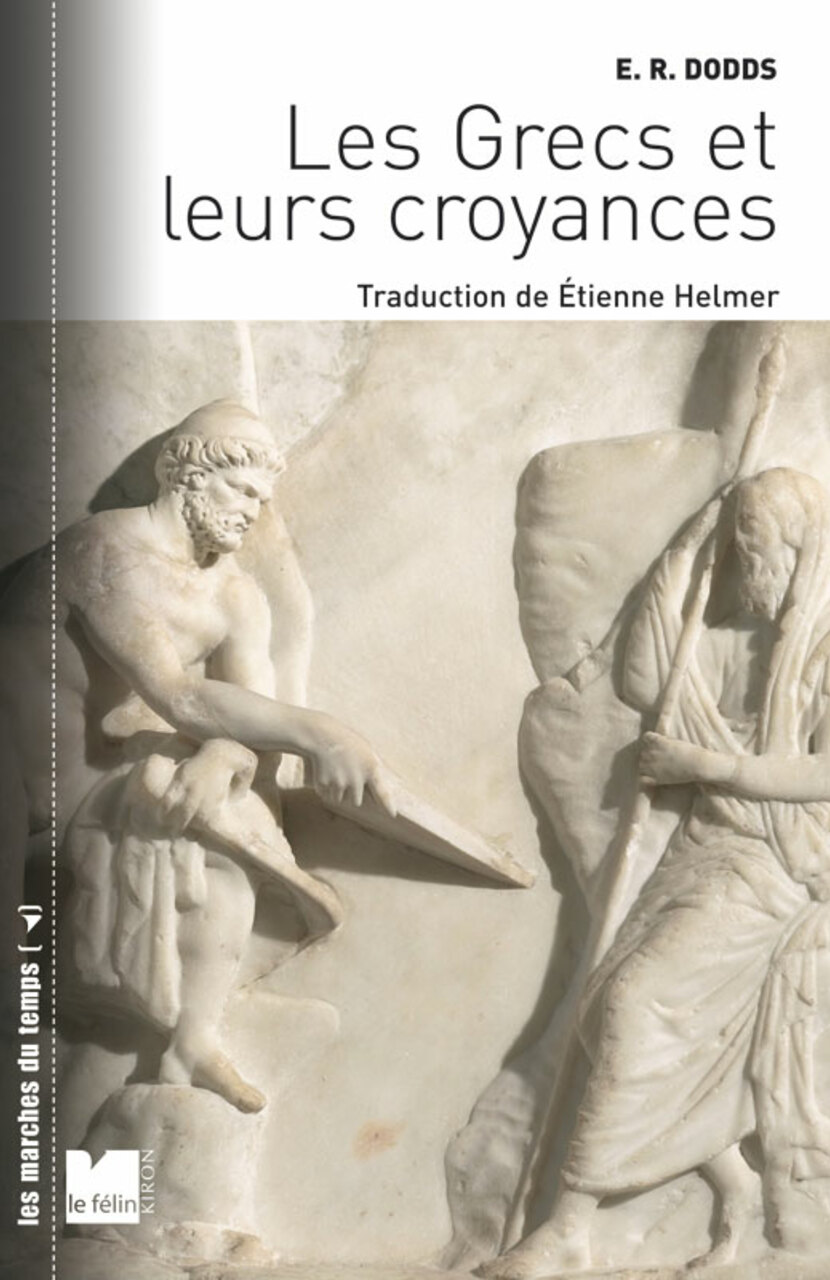
Les Grecs et leurs croyances
Le concept de progrès
dans l’Antiquité1
Le titre de cet article part d’une question qu’il tient pour résolue. «Les Anciens n’avaient aucune conception du progrès. Ce n’est pas qu’ils en rejetaient l’idée: ils n’y pensaient même pas.» Voilà ce qu’écrivait Walter Bagehot en 1872, et son affirmation a eu depuis un long écho. Mais quelques années plus tard, sir Henry Maine déclarait que c’étaient précisément les Grecs qui «avaient créé le principe du progrès»; et dans son livre posthume, The Idea of Progress in Classical Antiquity (1967), feu Ludwig Edelstein affirmait que «les Anciens avaient formulé l’essentiel des pensées et des sentiments que les générations ultérieures, jusqu’au dix-neuvième siècle, ont pris l’habitude d’associer à ce terme béni ou maudit: le progrès2 ». Comment donc expliquer une contradiction aussi marquée?
À mon sens, la réponse se trouve en partie dans le vocabulaire et les habitudes de pensée grecs, en partie dans le caractère fuyant du concept. Il faut accorder à Bagehot que les Grecs de la période classique n’avaient pas vraiment de mot pour désigner le progrès. Le candidat proposé par Edelstein, epidosis, ne convient pas vraiment: c’est un terme trop général qui désigne seulement une «augmentation», en bien ou en mal, sous l’effet de l’action humaine ou d’une autre force. Prokopè est un équivalent plus proche: il veut dire «poussée en avant», et Cicéron le traduit par progressus ou progressio. Mais ce terme semble avoir été forgé à l’époque hellénistique, même si le verbe prokoptein est plus ancien. Ce fait linguistique semble à son tour être le reflet d’une attitude psychologique. L’idée de progrès implique une vue spéculative qui porte autant sur l’avenir que sur le passé; or, à l’époque classique, comme van Groningen l’a montré, si les spéculations sur le passé sont légion, les déclarations explicites sur l’avenir sont, elles, singulièrement rares1. Beaucoup semblent avoir suivi le conseil du poète Simonide: «Nous ne sommes qu’hommes: ne cherchons pas à dire de quoi demain sera fait.» Les principales exceptions sont à chercher chez les scientifiques, dont les prévisions se limitent en général à leur domaine de compétence. Pour les autres, la seule règle que nous puissions adopter consiste à déduire leurs attentes à l’égard du futur de leur position à l’égard du passé et du présent; et si cette démarche est légitime dans une certaine mesure, elle est rarement fiable.
L’ambiguïté inhérente au concept de progrès apporte une difficulté supplémentaire. Le progrès implique un but, ou du moins une direction, et un but ou une direction supposent un jugement de valeur. À quelle échelle de valeur faut-il donc mesurer le progrès? L’étalon en est-il le bonheur, le pouvoir sur la nature, ou le Produit National Brut? Le critère véritable réside-t-il dans l’avancée morale ou dans l’avancée des connaissances? Les Anciens n’étaient pas plus d’accord que nous ne le sommes aujourd’hui sur cette question, et les différents critères qu’ils retenaient menaient à des conclusions antagonistes. À cette époque, c’était, comme aujourd’hui, dans le domaine des techniques que les progrès passés apparaissaient avec le plus d’évidence. Mais l’idée que les avancées techniques s’accompagnaient d’un échec ou d’une régression sur le plan moral était, on le verra, au moins aussi largement partagée dans l’Antiquité que de nos jours. Certains allèrent plus loin en établissant une relation causale directe entre les deux: pour eux, les avancées techniques avaient entraîné un déclin moral et n’étaient donc pas une bénédiction mais une malédiction. Ce raisonnement conduisit logiquement à un primitivisme radical.
L’idée de progrès, même au sens restreint de progrès technique, n’est en tout cas pas de celles qui viennent aux hommes rapidement et facilement. Dans les sociétés primitives, qui sont liées à la coutume et ne disposent pas de témoignages historiques, la notion de progrès a du mal à prendre un sens général. Ces sociétés peuvent bien attribuer des inventions ou des découvertes particulières à des héros ou des dieux fondateurs particuliers, comme c’était le cas dans la croyance grecque populaire depuis l’époque archaïque; mais ces sociétés ne voient pas en eux une chaîne continue d’ascendants, et elles s’imaginent encore moins qu’une telle chaîne puisse s’étendre jusqu’au présent et à l’avenir. Il n’est donc pas surprenant que l’idée de progrès soit absente de la littérature grecque des premiers temps. Et quand elle commença à faire son apparition, la place était déjà occupée par deux grands mythes antiprogressistes qui la menaçaient dans l’œuf: le mythe du Paradis perdu, que les Grecs appellent «la vie à l’époque de Cronos» et les Romains le Saturnia Regna ou l’Âge d’or; et le mythe de l’Éternel Retour. La large diffusion de ces deux mythes bien au-delà des frontières du monde gréco-romain, et leur étonnante persistance tout au long de l’Antiquité, même jusqu’à nos jours – songeons à la fascination qu’ils exercèrent sur Yeats –, laissent supposer que leurs racines inconscientes plongent au plus profond de l’expérience humaine: dans un cas, il s’agit peut-être de l’expérience individuelle de la prime enfance, de cette période où la vie était facile, où la nature nous procurait de quoi nous nourrir et d’où le conflit était absent; dans l’autre, de cette pièce éternellement rejouée qu’est le retour des saisons, dont dépend toute la vie agricole.
Le premier de ces mythes, et probablement aussi le second, étaient déjà connus d’Hésiode vers 700 av. J.-C. La légende des Cinq Races, qui a donné lieu à d’innombrables analyses, raconte l’histoire d’une dégénérescence croissante mais pas ininterrompue, qui part du Paradis perdu, «à l’époque de Cronos», et s’étend jusqu’au présent et au futur1. Le mythe des quatre métaux – l’or, l’argent, le bronze et le fer –, qui en forme la colonne vertébrale, symbolise les quatre étapes du déclin matériel et moral. Hésiode l’aurait emprunté à une source orientale2. Il l’a mêlé à la fois à une tradition historique du monde héroïque tel que le décrivent les premières épopées grecques, ce qui interrompt le schéma du déclin continu, et (comme l’a souligné Goldschmidt) à une étiologie portant sur des êtres semi-divins nés de la race d’or pour les uns, de la race d’argent ou de la race héroïque pour les autres3. Son histoire s’achève sur une sombre prévision, celle d’un futur toujours plus corrompu et plus dur, tout à fait dans le style d’une apocalypse orientale. Mais le fait que le poète eût aimé soit mourir avant l’époque actuelle, celle de la race d’argent, soit être né plus tard semble laisser entendre que le mythe oriental était cyclique, qu’il se finissait par l’achèvement d’une Grande Année et un brusque retour au Paradis perdu4. Ce n’est toutefois pas l’interprétation cyclique de l’histoire humaine qui intéressait Hésiode. Son but était de mettre l’accent sur la dégénérescence toujours plus grande de sa propre époque. Un poète qui menait la vie misérable d’un paysan de Béotie mais qui avait en son esprit les images glorieuses d’un passé héroïque pouvait difficilement voir les choses autrement. Et ceux des poètes ultérieurs qui envisagèrent l’histoire en termes cycliques eurent tendance à suivre l’exemple d’Hésiode: s’ils eurent beaucoup à dire sur le Paradis perdu, ils furent en revanche beaucoup moins diserts, jusqu’à Virgile, sur le Paradis retrouvé. La théorie cyclique est le plus souvent au service du pessimisme.
Il nous est difficile de savoir jusqu’à quel point les contemporains d’Hésiode acceptaient son désespérant pronostic. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la première déclaration explicite en sens contraire apparaît à la fin de la période archaïque, dans deux vers célèbres du poète et philosophe Xénophane:
Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes dès le début.
Mais au cours du temps, à force de recherches, les hommes ont fait des progrès1.
Voilà une authentique affirmation de l’existence du progrès: l’auteur le conçoit comme un processus graduel qui s’étend jusqu’au présent et sans doute aussi au futur, et qui dépend des efforts de l’homme et non du don contingent d’un dieu civilisateur. Le premier vers fait plutôt écho à celui où Hésiode déclare: «Les dieux ont dissimulé aux hommes leurs moyens de vivre2.» Le second semble être une réponse à Hésiode. Nous ne savons pas si ce distique formait un obiter dictum familier ou s’il faisait partie de considérations historiques plus vastes. Il peut très bien avoir été inspiré à Xénophane par les avancées récentes qu’il avait observées sur le plan de la civilisation: nous savons que cet auteur évoquait la récente invention de la monnaie par les Lydiens, et qu’il avait une grande admiration pour les découvertes de Thalès en astronomie. Et peut-être est-il bon de rappeler que c’était un grand voyageur, qui s’intéressait aux dieux à la chevelure rouge des Thraces et aux dieux au nez retroussé des Éthiopiens. Nous savons que ces comparaisons entre différentes cultures l’amenèrent à l’idée que les croyances religieuses sont relatives à ceux qui y croient; peut-être l’ont-elles aussi conduit à concevoir un lent et irrégulier mouvement ascendant par lequel l’homme passerait de la barbarie à la civilisation.
La fierté suscitée par le développement humain que nous pouvons percevoir dans ces quelques mots de Xénophane s’exprima de façon plus intense à la génération suivante, dans le grand discours qu’Eschyle place dans la bouche de Prométhée1. Certes, ce n’est pas aux hommes que Prométhée attribue le mérite de ce développement mais à lui-même: c’est implicite dans la situation dramatique. Mais le contraste entre l’homme de jadis et l’homme contemporain n’avait jamais été exprimé avec autant d’éloquence. L’homme n’est pas un exilé du Paradis perdu. Au contraire, il est sorti d’un état où il n’était pas encore capable de former une pensée cohérente, où il menait son existence sans but, à la dérive, «pareil aux formes qui peuplent les songes», où il était incapable d’interpréter les messages délivrés par ses yeux et ses oreilles, et où il n’avait que des cavernes pour tout abri. Et voyez ce qu’il est aujourd’hui! Il a non seulement mis les animaux à son service, conquis les mers, découvert les ressources minières cachées dans la terre, mais il a aussi appris à conserver la trace de ses propres réalisations, il est parvenu à la maîtrise de sciences difficiles – l’astronomie, l’arithmétique, la médecine, la divination.
Ce passage a surpris certains critiques, et l’on en a même fait un argument contre l’authenticité de la pièce au motif qu’il trahissait une influence sophistique2. Mais cette manière de voir repose sur une méprise, comme Reinhardt et d’autres l’ont montré3. Envisagé comme un passage anthropologique, ce discours est résolument archaïque et, de toute évidence, antérieur à la sophistique. On n’y décèle aucune volonté de marquer les différents stades de l’évolution, l’influence décisive des techniques qui permettent de produire la nourriture (l’élevage et l’agriculture) n’y est pas reconnue, et il ne comporte aucune référence aux origines de la vie en communauté. Les techniques n’occupent qu’une place mineure: même le tour du potier, que la tradition attique associe notamment à Prométhée, est passé sous silence, comme s’il était trop banal ou pas assez important pour être mentionné. C’est que le poète a choisi de mettre l’accent sur les progrès intellectuels de l’homme: Eschyle n’insiste pas sur l’aiguillon de la nécessité économique, qui occupe une place prédominante dans les récits grecs ultérieurs. Son héros entreprend de raconter plutôt «comment il a rendu les hommes rationnels et capables de réflexion, alors qu’ils n’étaient jusqu’alors que des enfants». Et la science sur laquelle il s’étend le plus est la divination, dont il décrit admirablement toutes les branches. Il serait très surprenant que tous ces éléments, qui concordent avec ce que nous pouvons savoir d’Eschyle par ailleurs, soient le fait d’un élève de Protagoras.
Mais au moins Eschyle admettait-il que l’homme s’était élevé, non qu’il avait décliné. Avait-t-il trouvé cette idée chez Xénophane? C’est possible: les deux poètes se sont peut-être rencontrés en Sicile alors que Xénophane était déjà âgé. Mais si tel est le cas, Eschyle n’a donc pas du tout suivi sa «source» de près: la divination, que Xénophane condamne comme une supercherie, est pour Eschyle le couronnement du développement scientifique humain1. Mais avons-nous besoin de supposer qu’Eschyle a puisé cette idée à une source? La liste des sciences était facile à dresser, et rien dans la description du malheur originel de l’homme n’indique la présence d’une connaissance particulière. Si nous nous demandons comment le poète en est venu à substituer l’idée de progrès à celle de la régression hésiodique, la réponse doit sûrement se trouver, pour partie au moins, dans l’expérience triomphante du progrès que connurent Eschyle et sa génération. L’influence de cette expérience apparaît aussi dans les Euménides, où le don de la loi par Athéna est la contrepartie et le complément du don de la raison par Prométhée. Dans cette pièce, Eschyle tourne son regard vers le passé de son pays mais regarde aussi avec confiance en direction de son présent et de son futur. Il disposait à titre de comparaison des récits sur les peuples barbares que des voyageurs grecs comme Aristée et Hécatée avaient rapportés, et plusieurs passages de son œuvre montrent qu’il en fait libre usage. L’anthropologie comparée était déjà dans l’air.
Reste une question difficile: Eschyle croyait-il vraiment que les arts de la civilisation avaient été enseignés aux hommes par un être divin nommé Prométhée? Ou son Prométhée n’est-il que le symbole de la raison humaine? La question pourrait paraître illégitime: dans la mesure où la production de mythes est un mode vivant de pensée, la soumettre à une alternative du type «ou bien… ou bien…» revient à la contraindre à un choix qui en détruit la substance même. Mais l’Antiquité tardive n’avait aucun doute sur la réponse. Pour tous les auteurs grecs après Eschyle, Prométhée est le pur symbole de l’infatigable intelligence humaine qu’il faut, selon le point de vue de chaque auteur, admirer ou condamner. La première formulation explicite d’une telle opinion semble se trouver dans un vers du poète comique Platon, où Prométhée est assimilé à «l’intellect humain1 ». Mais il est significatif que ce vers ait figuré dans une pièce intitulée Les Sophistes. Il est fort possible que ce soit un sophiste, peut-être Protagoras, qui le premier ait explicité le symbolisme de cette référence. On peut toutefois soutenir qu’il est déjà présent implicitement chez Eschyle. Pour autant que nous le sachions, il fut le premier à rendre possible cette interprétation en attribuant à Prométhée le mérite de nous avoir fait don du feu mais aussi de tous les arts de la civilisation, y compris certains que d’autres auteurs, et Eschyle lui-même dans d’autres pièces, prêtent à d’autres héros civilisateurs2. En transfigurant de la sorte le filou mi-sérieux mi-comique dont Hésiode avait fait le portrait, il créa l’une des plus grandes figures symboliques de la littérature européenne3. Mais pour lui, contrairement à Protagoras, le symbolisme n’était pas un élément dont on pouvait se débarrasser sans perdre une grande part de sens. La croyance que les réalisations de l’homme ne viennent pas totalement de lui mais sont le résultat et l’expression d’une intention divine était pour Eschyle, selon moi du moins, un postulat religieux élémentaire.
Après Eschyle, la littérature emprunte deux voies opposées. L’interprétation religieuse du progrès comme manifestation de la providence divine apparaît dans un discours qu’Euripide fait tenir à Thésée, et qui est typique de l’orthodoxie conservatrice athénienne1. Pour réfuter l’idée de certains que la vie humaine comporte plus de bien que de mal, Thésée énumère les qualités et les réalisations humaines les plus évidentes, et demande si nous ne devrions pas être reconnaissants au dieu qui sut, de la sorte, introduire de l’ordre dans la vie humaine et l’arracher à l’incohérence et à la bestialité. Il s’en prend alors à ceux qui, s’enorgueillissant de l’intelligence humaine, «s’imaginent être plus sages que les dieux», c’est-à-dire mieux savoir que les dieux ce qui est bon pour eux. C’est là très certainement le reflet d’une controverse contemporaine et non le point de vue personnel du poète. Les opinions qui sont ici critiquées pourraient être celles du sophiste Prodicos; le point de vue de celui qui parle est celui de la piété orthodoxe. Ce n’est pas un authentique progressiste: il ne reconnaît les progrès passés que pour raffermir cette vieille leçon selon laquelle l’homme devrait accepter sa condition et s’en satisfaire. Le développement de cette vision des choses donna lieu à l’argument du dessein, que Xénophon prêtait à Socrate, et aboutit finalement à la conceptions stoïcienne et chrétienne selon laquelle l’histoire est guidée par la Providence2.
Pour trouver la première formulation détaillée du point de vue opposé, il faut se tourner, non sans surprise, vers Sophocle. Dans l’ode célèbre que forment les vers 332-375 d’Antigone, il expose la conquête par l’homme de la terre et de la mer, des bêtes sauvages, des oiseaux et des poissons, de la parole et de la pensée, des arts de la vie en commun, et il présente tout cela non comme un don providentiel mais comme le résultat des efforts de l’homme. C’est ce qui a conduit certains savants à parler de la «philosophie humaniste» de Sophocle et à conclure que «le rationalisme de son temps avait déteint sur lui»1. Mais tirer cette conclusion, c’est ne tenir compte ni de la portée de l’ensemble des chants, ni de celle de l’ensemble de la pièce. L’éloge par le poète de «l’ingéniosité» humaine (deinotès, terme moralement ambigu) aboutit à une mise en garde: cette ingéniosité peut apporter tout aussi facilement la destruction que la réussite. L’ode suivante renforce la mise en garde quand, au tableau du développement humain, répond celui du complet dénuement où l’homme est plongé lorsque ses desseins entrent en conflit avec les desseins impénétrables de Dieu. Sophocle n’était pas un humaniste, et Antigone n’est pas un traité protagoréen à l’usage de son temps. Il est cependant légitime de déduire qu’à la date de la pièce (441), l’interprétation humaniste du progrès était déjà répandue à Athènes. Et l’on peut voir chez les dramaturges postérieurs des échos plus directs à cette interprétation. Dans un fragment célèbre du poète et homme politique Critias (mort en 403), un homme explique, à la manière d’un philosophe du xixe siècle, comment «un homme sage» inventa les dieux pour renforcer la moralité publique2. Plus tard encore, Chérémon répète, presque dans les mêmes termes, le sentiment exprimé par Xénophane; et dans sa description de l’évolution humaine depuis le stade du cannibalisme jusqu’à la civilisation, Moschion voit en Prométhée l’équivalent mythologique de la «nécessité» ou de «l’expérience», qu’on considérait alors comme les deux sources du progrès3.
À ceux qui considèrent que la pensée grecque est aussi inerte que les marbres des musées, E.R. Dodds oppose le principe suivant : « Ce qu’on découvre dans n’importe quel document dépend de ce qu’on y cherche, et ce qu’on y cherche dépend de nos propres intérêts qui, à leur tour, sont déterminés, en partie du moins, par le climat intellectuel de notre temps. » Dans les dix essais qui composent Les Grecs et leurs croyances, l’éminent helléniste d’Oxford nous montre combien les Anciens sont modernes et vivants. Le progrès, l’irrationnel et ses mystères, la place de la croyance religieuse dans la vie quotidienne, les rapports de la politique et de la morale : autant de questions qui, à la lueur d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide, de Platon et de Plotin, éclairent à la fois le passé et le présent.
D’origine irlandaise, E. R. Dodds (1893-1979) fut professeur de littérature grecque à Oxford. Deux autres essais ont été traduits en français : Les Grecs et l’irrationnel (trad. de Michael Gibson, Flammarion, 1977), et Païens et chrétiens dans un âge d’angoisse : aspects de l’expérience religieuse, de Marc-Aurèle à Constantin (trad. de Henri-Dominique Saffrey, La Pensée sauvage, 1979).
Étienne Helmer enseigne la philosophie. Ses travaux portent principalement sur la pensée de Platon. Il est aussi le traducteur de l’essai d’Allan Bloom sur la République de Platon, publié aux Éditions du Félin sous le titre La Cité et son ombre (2006).
Traduction de Étienne Helmer