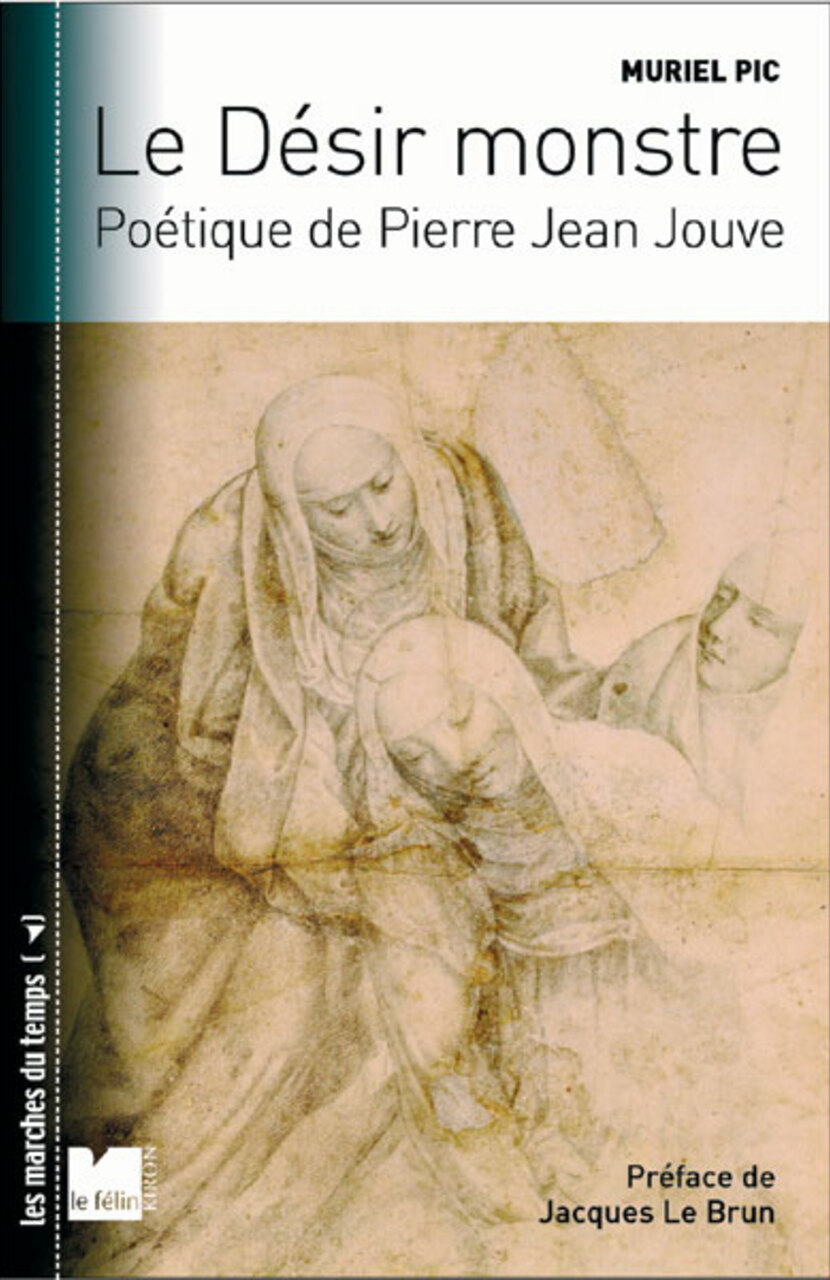
Le Désir monstre
LE SECRET DE LA CONVERSION
Jouve et la figure du converti
En 1928, dans la « Postface » du recueil Noces, Pierre Jean Jouve rend publique une « conversion » qui entraîne le reniement de toute son œuvre antérieure à 1925. À quarante et un ans, « le poète déchu […] déchir[e] son livre imprimé au milieu des villes humaines1 » :
Cet ouvrage [Noces] porte l’épigraphe Vita Nuova parce qu’il témoigne d’une conversion à l’Idée religieuse la plus inconnue, la plus haute et la plus humble et tremblante, celle que nous pouvons à peine concevoir en ce temps-ci, mais hors laquelle notre vie n’a point d’existence. La conversion porte pour moi la date de 1924. Si, comme je le crois, la plus grande poésie et la véritable est celle que le rayon de la Révélation est venu toucher, on me laissera le droit, au moment où je livre au public le poème de Noces, de dire que l’esprit comme la source des livres que j’avais écrits antérieurement me paraissent à présent « manqués »… Pour le principe de la poésie, le poète est obligé de renier son premier ouvrage2.
Avec cette conversion, datée de 1924, le poète revendique désormais « des valeurs spirituelles de poésie3 ». Jouve semble alors trouver sa place parmi les nombreux écrivains et intellectuels qui, entre 1885 et 1935, se convertissent ou plutôt se reconvertissent au catholicisme1, et dont la voix littéraire – plutôt que politique – est Paul Claudel. Cette vague de retour à la foi répond à une crise de la croyance marquée par de violents mouvements anticléricaux, qui, de la Révolution à la séparation des Églises et de l’État en 19052, n’ont cessé de croître. Or, contrairement aux écrivains convertis de son époque, Jouve ne montre aucune volonté à proprement parler apologétique. La restauration de la croyance de l’Église catholique n’est pas l’affaire du poète et la lecture de quelques lignes d’un poème de Noces suffirait pour s’en convaincre : dans ce recueil comme dans toute l’œuvre de Jouve, l’indécence est la signature de l’inspiré3. Sans oublier que, dans En Miroir. Journal sans date, le poète refuse clairement l’interprétation de sa conversion comme un retour au catholicisme : « Il était inévitable que “conversion” fût interprété abusivement. C’est ce qui fait dire à des commentateurs anglais que je me suis converti au catholicisme en 1924. Élevé dans la religion catholique, je n’avais aucune conversion à faire pour y demeurer ; par contre les séparations qui s’étaient creusées entre le dogme et ma conscience, au commencement de ma vie adulte, n’étaient pas modifiées par mon élan religieux de 19244. » Si la conversion entraîne pour Jouve, à l’instar de nombreux autres écrivains, un reniement de l’œuvre passée, elle marque surtout une orientation nouvelle et définitive de l’écriture qui ne s’inscrit en aucun cas dans une morale de vie ou une transformation de ses mœurs. Comment Jouve, dont la conversion entraîne un divorce et dont le discours est déjà d’obédience freudienne, aurait-il pu adhérer au puritanisme des convertis dont l’engagement est celui d’un mode de vie, avec au centre la question du mariage envisagé alors comme mode mineur de l’engagement religieux ? Jouve est d’ailleurs tout à fait lucide sur ce qui le sépare de Paul Claudel, affirmant dans une de ses lectures radiophoniques de 1947 publiées en 1950 sous le titre Six lectures de radio : « Claudel exprime deux forces gravitantes : la terre, la foi. Dans son catholicisme, aucune mystique. Dans son sentiment du sol, aucun doute, aucun trouble, peu de mystère. […] Paul Claudel est une église fruste, haut placée, sur un pays de force et d’angoisse1. »
Et, en effet, lors de sa conversion de 1924, le poète est depuis quelque temps déjà en retrait, voire en situation de rupture vis-à-vis des écrivains catholiques. Paul Claudel, converti en 1898, travaille à une littérature apologétique à laquelle Joris-Karl Huysmans, modèle incontesté des convertis, a redonné ses lettres de noblesse avec Là-Bas (1891), En route (1895) et L’Oblat (1903), ouvrages marquant la seconde partie de son œuvre et qui prennent acte de sa conversion en 1892. Avec Huysmans, il s’agit d’offrir un art nouveau à l’Église, susceptible d’être cet « aimant2 » attirant les âmes perdues vers Dieu. Celui qui fut l’auteur d’À Rebours rappelle ainsi que l’art « a été le fils aîné de l’Église, son truchement, celui qu’elle chargeait d’exprimer ses pensées3 ». Or, ce fils a négligé de servir sa mère durant un siècle de réalisme et de naturalisme, causant ainsi son déclin. Les nouveaux écrivains et poètes chrétiens ont alors pour charge de mettre leur art à son service en renouvelant son message, vocation à laquelle l’œuvre de Jouve est largement étrangère, et déjà avant 1924. Lorsque Jouve fait ses débuts littéraires dans la revue qu’il a créée avec Paul Castiaux, Les Bandeaux d’or, il cherche sa vocation dans « les influences symbolistes », et devient, pour une brève période, le disciple de Jules Romains, père de « l’unanimisme » : « C’est ainsi que je rencontrai le groupe beaucoup plus décidé des écrivains de l’Abbaye. Il y avait alors un besoin de protester par une littérature de participation humaine, contre de nombreuses déliquescences ; je tombai rapidement dans ce panneau1. » Le recueil Présences, fruit de cette fréquentation est, en 1913, violemment attaqué dans La NRF par Henri Ghéon2, appartenant au clan des convertis. Attaque tardive car, depuis la lettre du 29 octobre 1912 à Jules Romains, Jouve a rompu avec ce dernier. La suite de la carrière littéraire de Jouve ne va pas davantage le rapprocher du mouvement des convertis. Sa rencontre avec Romain Rolland le conduit à épouser un idéal pacifiste3 qui, durant la Première Guerre, est interprété par les écrivains catholiques comme une trahison à l’égard du pays. L’élan patriotique, l’attachement au sol et à la famille sont les valeurs favorites des convertis qui, pour la plupart, sont engagés auprès de l’Action française. À n’en point douter, cette orientation idéologique fortement marquée alimente la polémique ouverte en 1925, à la mort de Jacques Rivière – converti par Claudel en 1913 – entre les écrivains catholiques et la revue La NRF. Outre la résistance de Gide, principal fondateur de la revue, à l’égard de l’engagement religieux, lorsque Jean Paulhan prend officieusement les rênes de La NRF, dont il ne sera officiellement le directeur que dix ans plus tard, il se brouille avec Isabelle Rivière qui annexe la mémoire du défunt au catholicisme engagé. La même année, Jouve entre chez Gallimard, grâce à Paulhan, avec la publication du roman Paulina 1880. Dans la polémique avec l’épouse de Rivière, Jouve prend le parti de Paulhan. Il semble alors s’entendre avec ce dernier sur une approche mystique et poétique du spirituel, éloignée du dogme de l’Église, et qu’illustre parfaitement ce premier roman chez Gallimard ou le « poème dramatique » Le Paradis perdu – dont l’écriture sera suivie de près par Paulhan. Roman d’une conversion, Paulina 1880 se déroule dans un paysage mystique par excellence, l’Italie de la fin du XIXe siècle, et met en scène une expérience de Dieu qui dépasse largement le cadre de l’institution catholique. Alors que Paulina, l’héroïne du roman, connaît l’extase, elle est chassée du couvent où elle est entrée pour échapper au démon de son désir1. La conversion n’est alors en aucun cas un retour à la foi, mais un cheminement vers Dieu qui passe par le sacrifice de l’objet du désir : Paulina ne prononce pas ses vœux et assassine son amant adultère, le comte Michele Cantarini. La conversion finale de l’héroïne en Marietta – paysanne en état de grâce et d’abandon –, si elle résout le paradoxe d’un « appétit mystique » la déchirant entre l’amour charnel et l’amour spirituel, ne peut pas davantage être envisagée que l’événement de 1924 dans le cadre strict d’un retour à la foi catholique. En effet, dans En Miroir, Jouve réfute une interprétation univoque de sa conversion de 1924 comme une conversion religieuse et propose à « l’observateur de bonne foi » d’envisager sa conversion comme ce « qui [le] “tournait vers” des valeurs spirituelles de poésie, valeurs dont [il] reconnaissai[t] l’essence chrétienne1 ». Le retour à l’étymologie conduit à prendre en considération la définition psychanalytique du terme, comme le remarque Pierre Hadot :
Selon sa signification étymologique, conversion (du latin, conversio) signifie « retournement », « changement de direction ». Le mot sert donc à désigner toute espèce de retournement ou de transposition. C’est ainsi qu’en logique le mot est employé pour désigner l’opération par laquelle on inverse les termes d’une proposition. En psychanalyse, ce mot a été utilisé pour désigner « la transposition d’un conflit psychique et la tentative de résolution de celui-ci dans des symptômes somatiques, moteurs ou sensitifs » (Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse)2.
Si la conversion de Jouve est le résultat d’une longue crise amorcée par la rencontre avec Blanche en Italie (« C’est à Florence, où j’étais de retour en 1921, que je sentis pour la première fois le sol trembler sous moi »), elle marque surtout la découverte de la psychanalyse, à laquelle Jouve s’initie lorsqu’il participe, en 1923, à la première traduction de l’essai de Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité, dont se charge Blanche.
Avec la psychanalyse, Jouve découvre un nouveau point de vue sur l’expérience religieuse, radicalement opposé au mysticisme de Romain Rolland dont l’influence3 sur le poète marque les dernières années de la période antérieure à 1925 : « Là où Romain Rolland décrit, à la manière de Bergson, une donnée de l’expérience, – “quelque chose d’illimité, d’infini, en un mot d’océanique” – Freud décèle seulement une production psychique due à la combinaison d’une représentation et d’un élément affectif, lui-même susceptible d’être interprété comme une “dérivation génétique”1. » Jouve ne tranche pas ce débat, dont il ne fait pas mention. Comme déjà vis-à-vis des convertis, il trace sa propre voie qui n’est ni celle du mysticisme ni celle du scientisme, mais celle d’une poétique, ainsi qu’il y insiste dans En Miroir au moment de décrire son « retournement intérieur2 » :
En prêtant quelque indulgence à la hauteur sibylline du ton : ce texte est encore valable. Il faut seulement y mettre l’accent sur le terme « Révélation ». Conversion est moins important que révélation. Révélation voulait dire que je voyais (au sens quasiment apocalyptique, inconscient) le système d’image nécessaire ; mais que l’objet de vision était inconscient, je ne pouvais m’en expliquer davantage. Cette vision obscure, impérative, et parvenant au clair, paraissait effectivement ; elle paraissait, dans une poésie nouvelle armée de pied en cap, différant complètement de l’écriture passée – comme après métamorphose, Les Mystérieuses Noces de 1925 ; elle produisait presque en même temps, le roman Paulina 1880 et les ébauches du Paradis perdu3.
Si Jouve utilise ici le registre du religieux, sa vision est avant tout celle d’une personnification de la poésie, « armée de pied en cap », et évoquant quelque déesse combative, Diane ou Hécate. Conjugué à cette vision, le terme « métamorphose », équivalent païen de « conversion », remet en cause « la bonne foi » chrétienne du poète. Et ce dernier, quelques pages plus haut, a déjà expliqué que, « enfant prodigue », il revenait alors à ses « initiateurs », les textes : « Les Fleurs du mal, Une saison en enfer, Aurélia, Mon cœur mis à nu4. »
L’homme spirituel et la modernité
Indéniablement, Jouve cultive autour de sa conversion une équivoque qui prend, dès les premières pages du Journal sans date, les allures de la révélation d’un secret :
On me demande de dire un secret. On me presse. « Dites votre secret, puisque vous êtes un personnage secret. » Il faudrait distinguer entre beaucoup de choses. J’ai parlé du secret d’un grand artiste à propos de Delacroix. En ce sens le secret est intime à l’œuvre, car il n’y a pas une œuvre de quelque importance qui veuille vraiment livrer son fond, et expliquer son but avec son origine. Dans mon cas, il s’agit d’un autre sens, plus bénin. Mon ouvrage passe généralement pour hermétique et difficile, et ma vie est exclusivement dévouée à cet ouvrage. En un temps vulgaire, où toute activité est objet de publicité. Voilà le secret1.
Le secret qu’En Miroir a pour charge de révéler est moins celui attendu dans une autobiographie littéraire (récit d’enfance et découverte de la vocation) que celui du sens mystique de l’œuvre. « Mystique », on s’en souvient, signifie « secret », comme si le spirituel ne pouvait être que caché, à découvrir : « Devient mystique tout objet – réel ou idéel – dont l’existence ou la signification échappe à la connaissance immédiate2. » Cet objet, pour Jouve, est la « Poésie ». Elle détient un secret qui peut se retourner contre elle : « Depuis trente ans – depuis toujours – je suis soumis à la torture du silence. Ceci commande une attitude particulière. L’histoire de l’œuvre est assez longue, et la résistance qui lui fut opposée par le silence est assez exceptionnelle, je dirai exceptionnelle dans toute l’histoire des lettres, pour que l’on puisse en un certain sens parler de situation secrète. J’avoue un état de secret. Il faut entendre par là que je reconnais le lieu profond de l’œuvre faite, l’endroit où elle s’alimente et vit, qui n’est à aucun degré un “lieu commun”1. » Le secret est donc à double tranchant : gage d’une charge spirituelle, il fait courir le risque d’une accusation d’hermétisme en suscitant ce que le poète pointe comme une « résistance ». Jouve emprunte en effet à Freud l’argument selon lequel « les fortes résistances à la psychanalyse n’étaient pas d’ordre intellectuel mais d’origine affective2 ». Selon Jouve, « l’homme moderne a découvert l’inconscient et sa structure3 », ce qui a bouleversé les « bases de la culture humaine », c’est-à-dire selon Freud, « la maîtrise des forces naturelles et la répression des instincts4 ». S’il est un message apologétique chez Jouve, il est donc inspiré par la psychanalyse : « Le trône de la souveraine est supporté par des esclaves enchaînés : parmi ces éléments instinctifs domestiqués, les pulsions sexuelles, au sens étroit, dominent par force et par violence. Qu’on leur ôte leur chaîne et le trône est renversé, la souveraine foulée aux pieds. La société le sait et ne veut pas qu’on en parle5. » Freud a ici recours à l’image de la prostituée empruntée à l’Apocalypse, le texte biblique favori de Jouve, qui la reprend à son tour dans « L’Avant-propos dialectique » à Sueur de Sang, « Inconscient, Spiritualité et Catastrophe » de 1933 :
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui les instruments de la Destruction nous encombrent ; les iniquités pourrissantes des nations font de l’Europe « la grande prostituée… assise sur une bête écarlate couverte de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes… » « Quoi ! la grande ville vêtue d’écarlate, et de pourpre et de beau lin, parée d’or et de pierres précieuses et de perles ! En une heure ont péri tant de richesses ! » Nous sentons bien que ce n’est pas tant de révolution que de destruction pure, de recherche d’un coupable objet de haine, et de régression1.
Mais plus qu’au texte de Freud de 1925 sur les motifs de la résistance à la psychanalyse, cet « Avant-propos », qui annonce la catastrophe à venir, doit à « Pourquoi la guerre ? » publié lui aussi en 1933. Durant l’hiver de cette année, Jouve s’est passionné pour ce texte qui a accompagné la rédaction de « Inconscient, Spiritualité et Catastrophe », comme nous l’apprend la lettre à Paulhan2 du 6 mai 1933. Freud y explicite « l’enthousiasme guerrier » de l’homme à l’aune de la « doctrine mythologique des pulsions3 ». L’homme est d’autant plus disposé à l’affrontement que le développement de la civilisation a rendu les armes de la destruction plus puissantes, mais aussi que « les abus d’autorité » se sont aggravés : « L’ingérence des pouvoirs publics et l’interdit de penser édicté par l’église4. » Or dans ce texte de 1933, lettre ouverte de Freud à Albert Einstein, ce dernier lui ayant proposé de répondre à la question qui donne son titre au propos, le docteur viennois ne doute pas d’une « guerre future » qui, « par suite du perfectionnement des moyens de destruction, signifierait l’extermination de l’un ou peut-être des deux adversaires5 ». À cela il adjoint un éloge du pacifisme et souligne que « tout ce qui établit des liens affectifs entre les hommes ne peut que s’opposer à la guerre6 ». Aux yeux de Jouve, la poésie est l’un de ces liens car elle est « un véhicule intérieur de l’amour7 ».
La poésie seule peut sauver l’homme moderne qui, pris dans une escalade au progrès comme dans un « continuum d’impressions artistiques », ne connaît plus « l’émerveillement » :
Le poète connaît une permanence, celle de l’émotion positive, de l’émerveillement. S’il la perd, il est perdu, comme un nageur épuisé disparaît à la surface des flots. Or l’émerveillement n’est pas le seul don du poète ; et sans doute n’y a-t-il que l’émerveillement pour sauver la vie de l’homme ordinaire de l’écrabouillement total. L’émerveillement est la science de l’enfance1.
Cet émerveillement, le poète doit le communiquer car il n’y a « qu’un émerveillement propre, mais communicable qui compte2 ». Il s’agit de lutter contre l’« écrabouillement » du spirituel sous une masse d’informations que les progrès de la modernisation favorisent, et de sauver l’art de la vulgarisation et du nivellement par le bas : « Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l’homme spirituel la violence d’une passion », déclarait déjà Baudelaire dans un projet de préface aux Fleurs du mal de 1861 que Jouve reprend à son compte en 19673. Il y a même une certaine urgence à ce que l’art, « science de l’enfance », soit communicable à l’heure où l’homme moderne est dépossédé de l’expérience par la cata-strophe. Sur ce point, Jouve s’inscrit dans une modernité littéraire qui ne cesse de prévenir de la dépossession de l’expérience, de la perte de la transmission. Un autre lecteur de Baudelaire et de Freud, Walter Benjamin, affirme, dans un texte intitulé « Expérience (Erfahrung) et pauvreté » datant de la même année que « Pourquoi la guerre ? » et « Inconscient, Spiritualité et Catastrophe », que l’expérience, « jusqu’au milieu du XIXe siècle, on savait exactement ce que c’était : toujours les anciens l’avaient apportée aux plus jeunes », toujours, elle avait été communiquée. Mais après la Première Guerre mondiale, « le cours de l’expérience a chuté, et ce dans une génération qui fit en 1914-1918 l’une des expériences les plus effroyables de l’histoire universelle. […] N’a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets des champs de bataille ? […] Pauvres en expérience communicable, voilà ce que nous sommes1 ». À la veille de la Seconde Guerre mondiale, durant cette fameuse année 1933, année des Massacres de Masson et d’Alice de Balthus également, où Hitler devient chancelier de l’Allemagne, Jouve comprend lui aussi que « la catastrophe la pire de la civilisation est à cette heure possible ». Texte prophétique pour le poète, « Inconscient, Spiritualité et Catastrophe » s’inscrit dans un contexte intellectuel pour lequel la dépossession de l’expérience est la conséquence terrible de la modernisation, de son progrès comme de ses guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les premières lignes d’un texte intitulé « Gratias » du recueil Ode, Jouve témoigne du choc vécu par l’Europe en peignant l’expérience sous les traits d’une allégorie de la souffrance : « Terrible (mon Amour-Trésor) terrible fut l’expérience, et chargée de larmes séchées : l’expérience qui fut réelle, l’expérience qui saigne encore et erre au milieu d’expériences. Arrachant le cuir et la chair, flagellant le poil avec sa vêture, ah ! l’expérience fut cruelle, dévêtant le temps de sa terre et la terre de son trésor2. » Si le rôle du poète est de communiquer l’émerveillement, c’est en communiquant l’expérience, en cherchant à retrouver les moyens d’une « science de l’enfance ». Selon Giorgio Agamben, lisant le texte de 1933 de Benjamin, « à l’expropriation de l’expérience, la poésie répond en faisant de cette expropriation une raison de survivre3 ». Si, désormais, « les expériences les plus importantes sont celles qui appartiennent non au sujet mais au “ça”4 », la poésie qui tend à « la survivance de l’Éros » ne peut que prendre en compte ce que Jouve nomme « l’inconscient poétique1 ». Il est impossible pour le poète de nier cette nouvelle source d’inspiration et de ne pas l’intégrer à sa « recherche mystique de la poésie ».
La dialectique de la lecture et de l’écriture
En 1954, dans son Journal sans date, Jouve explique comment, « lorsque nous sommes faibles », il est possible de « nous accrocher aux merveilles antérieures » en fréquentant, « comme [il l’a] fait, les mystiques chrétiens ou les spéléologues de l’esprit ». Mais, ajoute-t-il, on « découvr[e] ensuite que les appuis étaient nuls2 ». À plusieurs reprises en effet, le poète remarque une « antinomie entre l’art et la mystique » :
La mystique commence par nier ce qui est le plus important pour l’art : l’ordre suprêmement sensuel qui revêt la chose de la beauté. Et cependant tout « grand » art doit par paradoxe contenir une fin mystique. Les œuvres dont nous vivons – le chant grégorien, la cathédrale, la statuaire française du XIIIe siècle, le choral de Bach, la symphonie de Mozart, le tableau de Goya, et la poésie de Shakespeare ou Baudelaire – prouvent cet appétit mystique complètement inassouvissable vu qu’il est au sein de la sensualité la plus forte, d’aucuns diront la plus infernale3.
Le désir, composante infernale, érotique, absolument nécessaire à l’art, le mystique y renonce, quand bien même un « certain érotisme, on ne cessera de le remarquer, imprègne les actes sublimes des saints4 ». Le désir, le poète l’appréhende comme une « force sacrée » dont il faut « canaliser » la puissance et la convertir, par le poème, à une fin mystique. Maître dans l’inconscient, ce désir auquel la psychanalyse donne un droit de cité dans la civilisation, Jouve le présente comme satanique lorsqu’il est aliéné à la recherche d’un objet : « Quand le sang presse sur le corps et lui enlève sa mollesse, c’est le désir. Quand le désir apparaît au milieu du corps et nous durcit et nous allume, aussi bien qu’une pierre ou un monde doivent se poser quelque part, le sang doit tomber en avant sur un autre sang, l’autre corps de sang car il n’y a qu’un sang ; l’agiter, le troubler, le titiller et le forcer ; être le sang du sang par le plaisir1. » Si le désir est nécessaire au poète pour communiquer l’émerveillement, c’est à la condition que l’écriture le transforme, le convertisse, le désentrave de sa finalité strictement charnelle : « La révolution comme l’acte religieux ont besoin d’amour. La poésie est un véhicule intérieur de l’amour. Nous devons donc, poètes, produire cette “sueur de sang” qu’est l’élévation à des substances si profondes, ou si élevées, qui dérivent de la pauvre, de la belle puissance érotique humaine2. » Par cette démarche ascétique, en laquelle s’inscrit sa conversion, Jouve ne cherche pas à ce « que l’expérience de sainteté se transpose dans la Poésie3 ». Il faut, au contraire, mesurer les ressemblances et les différences entre l’expérience religieuse et l’expérience littéraire, comme il l’explique encore en vue de « dégager quelques idées autour d’une notion mystique appliquée à la Poésie » :
Le verbe est d’une telle importance dans l’ordre des volontés créantes (« Au commencement était le Verbe… ») qu’il détermine un être, je le crois, un être de communication avec Dieu, ineffable, selon la foi même qui le porte. À ce moment, l’œuvre mystique du poète et l’acte mystique de la conscience religieuse se ressemblent pour un instant, mais de loin, et sans jamais s’identifier. Le saint est engagé comme âme totale et dans la profondeur et dans le silence de l’âme, il est l’homme seul devant Dieu, et seule sa communion aux autres saints peut atténuer sa solitude infinie. Le poète est uniquement engagé comme porte-verbe, mais dans toute la responsabilité et l’étendue du verbe. Il doit bien dire, à l’extrémité suprême du verbe1.
Jouve ne doute pas que l’expérience de jouir du verbe ne peut être dite que par celui qui l’a vécue. Mais parce que cette expérience du corps et de l’âme est ineffable, elle est aussi une expérience de langage. Si, pour le poète comme pour le mystique, l’expérience vive, « l’Erleben se trouve non pas derrière mais dans l’écriture2 », leur engagement dans l’acte poétique comme communication de l’expérience (Erfahrung3) diffère radicalement. L’ineffable pour le mystique est une injonction au silence, un partage du secret avec Dieu : « Taisez / Ce que Dieu pourrait vous donner / Et rappelez-vous / Ce mot de l’Épouse : / Mon secret pour moi4. » Pour le poète, l’expérience vive de Dieu, quel que soit son lieu, la réalité de la foi ou le texte, doit être avant tout partagée. Il n’est d’expérience poétique sans expérience transmise, et, lorsque Jouve est questionné sur le rôle de l’expérience spirituelle dans son œuvre, en 1967, à près de quatre-vingts ans, il répond se méfier des mots et, par conséquent, de l’expérience :
À mon âge, après avoir écrit pendant toute une vie, on se méfie des mots. Expérience est un mot ; spirituel est un autre mot. Poésie aussi est un mot, qui me paraît signifier bien davantage. J’ai écrit de nombreux ouvrages poétiques mais aussi quatre livres de romans et nouvelles. Dirais-je que j’estime avoir fait plus d’expérience en vers ou en prose ? On se méfie de l’expérience même, après avoir vécu en expérience5.
La sagesse de Jouve à l’égard d’une revendication claire de l’expérience spirituelle dans son œuvre n’est pas seulement le fait de l’âge : constamment, le poète a établi une distinction entre mystique et poésie. Jouve ne prétend à aucun moment avoir connu un transport divin ; en revanche, il affirme avoir fait une autre expérience tout aussi éprouvante, une « expérience d’héritage » à travers sa lecture des textes mystiques, comme il l’explique dans son Journal sans date :
Je lisais François d’Assise dans le Speculum perfectionis ; je traduisais Le cantique du soleil, et plus tard Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila ; un peu plus tard je m’approchais avec respect de saint Jean de la Croix, qui ne se peut traduire. Ces lectures me firent aspirer à des contacts essentiels. Avec une extrême timidité, je désirai ressentir des états où la foi intense – même dans l’esprit le plus indigne d’être visité – peut tarir, absorber, brûler, « anéantir » la conscience ordinaire. Peut-être (me gardant de tout double jeu) approchai-je de tels états ; en tout cas je vis le poème m’en commander le langage, et je me décidai à obéir. Le poème y porta mon âme, comme si, par une expérience d’héritage, il connaissait bien toutes les voies1.
La découverte de la littérature mystique dépasse largement le cadre d’une simple lecture : il s’agit d’une expérience littéraire qui conduit à un « acte poétique2 » efficace : « Dans l’acte des mots du poète est sa mystique3. » Cette dialectique de l’écriture et de la lecture est centrale dans la question de l’expérience spirituelle chez Jouve non pas vécue comme expérience religieuse de Dieu, mais comme expérience vive de la transmission d’une tradition textuelle. À de nombreuses reprises, Jouve se donne dans la posture de l’écrivain qui « à sa table en noyer connaît la vieille angoisse4 », et du lecteur qui lit « telle page ouverte des Fleurs5 », ou relit un texte (« Je lus le sens que je ne lisais pas au temps / De mes amours1 »). Comme le note Kierkegaard, philosophe qui préside aux Histoires sanglantes de 1932, « c’est un art d’être un bon lecteur2 ». Cet art, Jouve le revendique et le maîtrise ; grâce à lui, il découvre le langage de l’expérience mystique par la médiation des textes. Et Jouve ne se contente pas de lire les mystiques, il les traduit également. La traduction des mystiques3 chez Jouve est concrétisée par deux éditions, la première du Cantique du Soleil de 1926, dont le mode de publication montre le processus d’appropriation qui s’opère, pour le poète, dans la traduction. En effet, le texte de François d’Assise forme jusqu’en 1931 la dernière partie des recueils Nouvelles Noces de 1926 et Noces de 1928, et sera finalement l’objet d’une republication à part chez GLM en 1954. Jusqu’à l’édition de 1931 des Noces, on trouvait également dans ce recueil un poème, qui fut l’objet de plusieurs variantes, intitulé « Sancta Teresa4 ». C’est un éloge à la sainte espagnole dont Jouve finira par consacrer l’influence dans son œuvre grâce à sa traduction de la Glose, réalisée en 1939 avec l’hispaniste Rolland-Simon, publiée chez GLM, puis dans la revue La NRF en 1940. Ce qui est en jeu dans ces traductions est une expérience d’héritage qui dépasse et ainsi déplace la question de l’exacte réciprocité entre les langues nationales. Le poète se soucie avant tout de la langue spirituelle et poétique, Jouve traduisant aussi bien des auteurs italien, espagnol, anglais et allemand. La traduction, et le cas des mystiques le rend plus manifeste, n’est pas un exercice linguistique – pas plus que la citation ne relève de l’érudition, nous en reparlerons – mais un exercice spirituel. Ce dont il s’agit, surtout à l’heure de la conversion, c’est d’apprendre à parler « la langue de cet Espace1 », comme le déclare l’héroïne de Paulina 1880.
L’« expérience d’héritage » par la lecture et la traduction est donc une expérience spirituelle à part entière qui, chez Jouve, se fonde sur un processus d’appropriation poussé jusqu’à l’empathie : « Je lus et je relus ; et bientôt tout me fut familier comme ma propre histoire2 », affirme Jouve dans En Miroir. Journal sans date. Paulina, de son côté, « avait trouvé dans un livre cette page d’un vieil auteur mystique allemand », avec lequel, à travers le texte, elle dialogue : « “Mais si la volonté de Dieu était de te jeter en enfer ?” – Me jeter en enfer ? Que sa bonté m’en préserve. Mais si vraiment il me jetait en enfer, j’aurais deux bras pour l’entourer. Un bras est la véritable humilité que je passerais en dessous de Lui pour m’unir à sa sainte humilité. Et avec le bras droit de l’amour, qui unit à sa Sainte divinité, je l’embrasserais si bien qu’il lui faudrait venir avec moi en enfer3. » La lecture de ce texte conduit Paulina à converser avec Dieu, tout comme la lecture de saints ouvrages amène Pierre Indemini à écrire de la poésie dans Hécate : « Afin de diriger comme je puis cet étrange navire de nouvelle croyance, je lis les Pères chrétiens ; entre tous le pur et pathétique Augustin. Je t’envoie les livres avec des marques. Je médite aussi la parole de Michel Le Tellier : “Je ne désire point la fin de mes peines, mais je désire de voir Dieu.” J’écris des poésies. Je suis en pleine confiance4. » La référence à Augustin, dont la conversion s’opère grâce à la lecture d’un passage de l’Écriture, durant le fameux épisode de l’injonction divine : « tolle, lege ; tolle, lege5 ! », et la fréquentation assidue d’auteurs mystiques confinent l’art de lire à une pratique monacale que parfait l’oraison. La conversion, expérience littéraire par excellence chez Jouve, relève donc d’un véritable processus d’empathie qui commande un langage, notamment dans Paulina 1880.
Avec ce roman, Jouve conduit son héroïne à l’union avec Dieu au fil d’une ascension qui débute durant la nuit de la « natale » : « Notre-Seigneur naît cette nuit dans ma misère. Je suis au couvent depuis une année. » Ce transport est rapporté dans le journal de la jeune femme, tenu lors de son séjour au couvent de la Visitation. Elle est alors sœur Blandine, et note les progrès et les reculs de son cheminement vers Dieu : « Je me suis perdue plusieurs fois. D’abord je l’ai fait doucement, ensuite je l’ai fait follement et j’ai tout, tout oublié. Me perdre était nécessaire. Aujourd’hui je suis au-delà1. » La situation de l’héroïne est celle d’un oubli complet de toute son expérience, de tout ce qu’elle a été. L’inexpérience de Paulina face à Dieu est l’apprentissage d’une science de l’enfance, la connaissance d’un état de dépossession nécessaire à son union à lui. Au fil de sept textes, au présent et de facture radicalement poétique, qui font littéralement craquer « l’édifice » romanesque, l’héroïne s’avance jusque vers Dieu. Comme dans Les Dits de lumière et d’amour de saint Jean de la Croix, traité « dont l’ordonnance obéit à un modèle ascétique traditionnel », arrive donc un moment où le « bel édifice craque […] secoué par le lyrisme d’une prière née de l’amour ». Le journal de Paulina est un « espace désordonné où surgissent les voix du désir2 ». La prose poétique devient partition de l’amoureuse science : les mots se déploient librement sur la page, comme en un « emploi à nu de la pensée, avec retraits, prolongements, fuites, ou son dessin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition3 ». Dans son texte sur la Musique pour instruments à cordes, percussion et celesta de Béla Bartok, Jouve note justement que l’on peut en arriver « à penser que les états supérieurs de la Musique ont une parenté, ou au moins une ressemblance avec les états de seconde vie de l’âme où celle-ci obtient, par refus et anéantissement d’elle-même et par absorption dans la Substance divine réelle, les connaissances et les joies que l’on a désignées sous le terme “extase”1 ». Cette conception de l’extase, dans la comparaison avec le transport musical, justifie l’écriture poétique du journal de Paulina dans le chapitre intitulé « Visitation». Mais pour que son désir de Dieu devienne chant, l’héroïne doit apprendre à parler la « langue de cet Espace » que, dans la page de la « natale », elle dit à peine savoir parler, à l’instar de Jouve qui, en 1925, vient juste d’en faire l’« expérience d’héritage » : « Je sais à peine parler la langue de cet Espace. Comment me ferais-je comprendre ? » Le dernier de la série des sept textes qui ménagent la progressive ascension de Paulina vers l’extase tente de saisir cette langue de l’expérience sur le vif :
Te voici mon Époux de Douleur, mon Agneau.
Christ au cœur transparent
Époux à ma rencontre
que tu es
proche et doux malgré l’effroyable déchirure et
l’impureté et la fatigue et la misère de la pénitente
embrasée.
Oh j’ai gravi, gravi l’échelon
pendant des éternités avant d’arriver.
Paix joie effroi.
Mon père veille sur moi.
Paix joie effroi.
Un rayon plus lointain
de paix va s’avancer et me blesser.
C’est de ton cœur
rouge, il m’a dévorée. Il grandit, il grandit.
Il m’ouvre. Il n’y a plus d’agneau, il n’y a plus de
Dieu, il y a
Délices !
Il m’a, il m’a.
Il m’a, plongée dans l’Amour profondément,
il m’a immergée dans l’Amour amoureusement2.
Ce texte constitue le point d’orgue de l’expérience de Dieu et achève le journal proprement dit, le chapitre « Visitation » prenant fin sur un moment de narration omnisciente qui apprend au lecteur que Paulina est renvoyée du couvent et ne prononcera pas ses vœux. Dans ce poème, dont le défi est de narrer l’extase, l’ellipse et la répétition trahissent l’impossibilité de communiquer ce qui est vécu. Or, si l’expérience dans le texte mystique est celle de l’ineffable, c’est en référant ce dernier à un vécu antécédent et hors de l’écrit. Ici, la situation est différente, le récit poétique de l’extase n’est pas postérieur à celle-ci mais concomitant, la fiction de l’expérience de Dieu est véritablement expérience du langage et de ses limites. Avec le poète, l’ineffable est à l’intérieur du langage et non hors de lui : il contient sa propre mort, et c’est vers l’expérience de cette mort que le poète conduit l’extase du poème dans le roman. Ainsi le texte s’ouvre sur une désignation, coïncidant avec la vision de l’Époux. Depuis ce présent et face à cette présence, la remémoration de l’ascension est brutalement interrompue par la description d’un état complexe de sensation, non sans évoquer le Mémorial de Pascal : « Paix joie effroi. » L’allitération des nasales « ai », « oi » donne à l’ensemble, répété deux fois, la gravité d’un rythme rituel. L’exclamation « Délices ! » vient recouvrir immédiatement l’ellipse qui a rompu le discours essayant de décrire et de raisonner. Avec ce texte, le poème est « un double rapt, un double coup de griffe posé sur le rêve intérieur et sur la langue1 ». Jouve y interprète poétiquement les descriptions de l’extase, faites par les mystiques, avec le double mouvement de la sortie hors de soi et de la pénétration en l’Autre ; puis l’union du sujet à son Dieu est donnée à travers de longs adverbes : « profondément », « amoureusement ». L’immersion en l’être divin suggère le mouvement d’une vague, d’un océan, métaphore fréquente chez Catherine de Sienne, sainte « que Jouve vénère le plus fréquemment dans ses écrits2 », selon Klossowski. Ici, en vertu d’un principe que de Certeau a bien analysé comme modus loquendi des mystiques, l’énonciation est habitée par un autre – Dieu parle dans les pages du cahier de l’héroïne comme dans Le Livre des dialogues1 : « Dieu Sauveur dit : j’ai dans mon paradis d’humbles âmes comme la tienne. Espère. Regarde. Puisque tu me regardes si bien le visage de ton âme change complètement. Tes yeux sont deux lanternes de vertu, deux phares de perfection2. » Un autre parle dans le moment d’une inspiration : « l’Esprit, “celui qui parle” – el que habla, dit Jean de la Croix ; c’est le locuteur, ou “ce qui parle”3. » Une dépossession s’opère, le sujet se perd, s’égare dans le texte. Cette présence autorise de multiples conversions de l’énonciation, visibles dans les échanges de genre dont Jouve est coutumier avec ses poèmes comme ses romans où les héroïnes sont féminines. Jean de la Croix, dans La Nuit obscure, se donne, sur le modèle du Cantique spirituel, au féminin, parlant à la place de l’âme. Jouve, dans un bref poème de Sueur de Sang intitulé « De deo », imite ce procédé : « Ô mon bien-aimé je / Consens pour ton amour / De ne voir ici-bas la douceur de ton regard / De ne sentir l’inexprimable ardeur du baiser / De ta bouche ; mais je / Te supplie de m’embraser de ton amour4. »
Le poème de l’extase n’est donc pas la forme vide qu’aurait désertée une croyance ou une pure et simple fantaisie romanesque, mais le lieu d’une « expérience d’héritage » : si la poétique de Jouve est mystique, c’est justement en vertu d’une conversio de la lecture par l’écriture qui est aussi un conversar5 : « Je suis résonateur de voix hétérogènes6 », disait déjà Jouve dans son œuvre antérieure à 1925. Dans Paulina 1880, le poète met immédiatement à profit son « expérience d’héritage » avec les textes de la tradition mystique comme en témoigne un intertexte qui compte les noms de François d’Assise, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, François de Sales1. Et si par la suite Jouve affirme qu’il « ne poursuivi[t] pas dans la ligne séduisante de Paulina2 », l’ouvrage qui lui assure pourtant son entrée chez Gallimard, c’est dans la mesure où il va tenter de faire coïncider, en vertu d’une conviction profonde, l’amour à mort des mystiques avec la réalité des pulsions de vie et mort. Après ce roman, sur lequel nous reviendrons, Jouve va approfondir l’expression d’un thème qu’il redécouvre à l’aune de la psychanalyse : le drame de l’Éros et de la mort – relevant tout autant de la tradition mystique que du paganisme – que l’écriture va décliner selon les différentes modalités de la variation, et cela, jusqu’à l’inventer comme un thème propre à l’œuvre.
Poète de la catastrophe et de l’extase, Pierre Jean Jouve (1887-1976) nous laisse une œuvre poétique, romanesque et critique qui fait coïncider, au prisme de la psychanalyse, le mobile archaïque de la déchirure religieuse et les données d’une modernité proclamant la mort de Dieu. Lorsque Jouve renie ses écrits antérieurs à 1925, dont il juge l’esprit « manqué », il découvre la doctrine des pulsions et se convertit à une spiritualité du pur amour. À l’écart du monde littéraire, malgré son entrée dans la maison Gallimard grâce à Jean Paulhan, le poète de Sueur de Sang et Aventure de Catherine Crachat explore les vestiges du rêve et les marges de la mémoire collective jusque dans les « détritus du plaisir ». Il place le lecteur sur la scène intemporelle de son propre désir : « Monstre dont riront dans les fauteuils stupides / Ces messieurs-dames qui ne veulent rien savoir » (Moires). Le public ne peut alors qu’opposer une « résistance affective » à cette entreprise littéraire qui refuse toute complaisance. En 1936, l’auteur de Paulina 1880 renonce au roman et se consacre à la poésie (Matière céleste) et à la critique musicale (Don Juan de Mozart, Wozzeck de Berg). Pour faire aimer à l’homme la dissonance qui lui est propre entre le viscéral et le céleste, il radicalise sa volonté de désir et approfondit son abnégation. Le désir est alors monstre d’accepter la perte de ce qui le fait exister : « L’objet n’est rien et le désir est tout, même pas le désir, mais la phrase du désir » (Proses). À cette phrase anonyme du monde, cette prière sans nom, l’œuvre de Jouve se dévoue, car il n’est de salut que dans la transmission du désir.
Née en 1974, Muriel Pic est docteur de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) où elle enseigne. Elle travaille sur les littératures française et allemande du XXe siècle et collabore régulièrement depuis deux ans avec la Freie Universität de Berlin. Elle publie parallèlement, aux Éditions Claire Paulhan, les Lettres 1925-1961 à Jean Paulhan, de Pierre Jean Jouve.
Préface de Jacques Le Brun