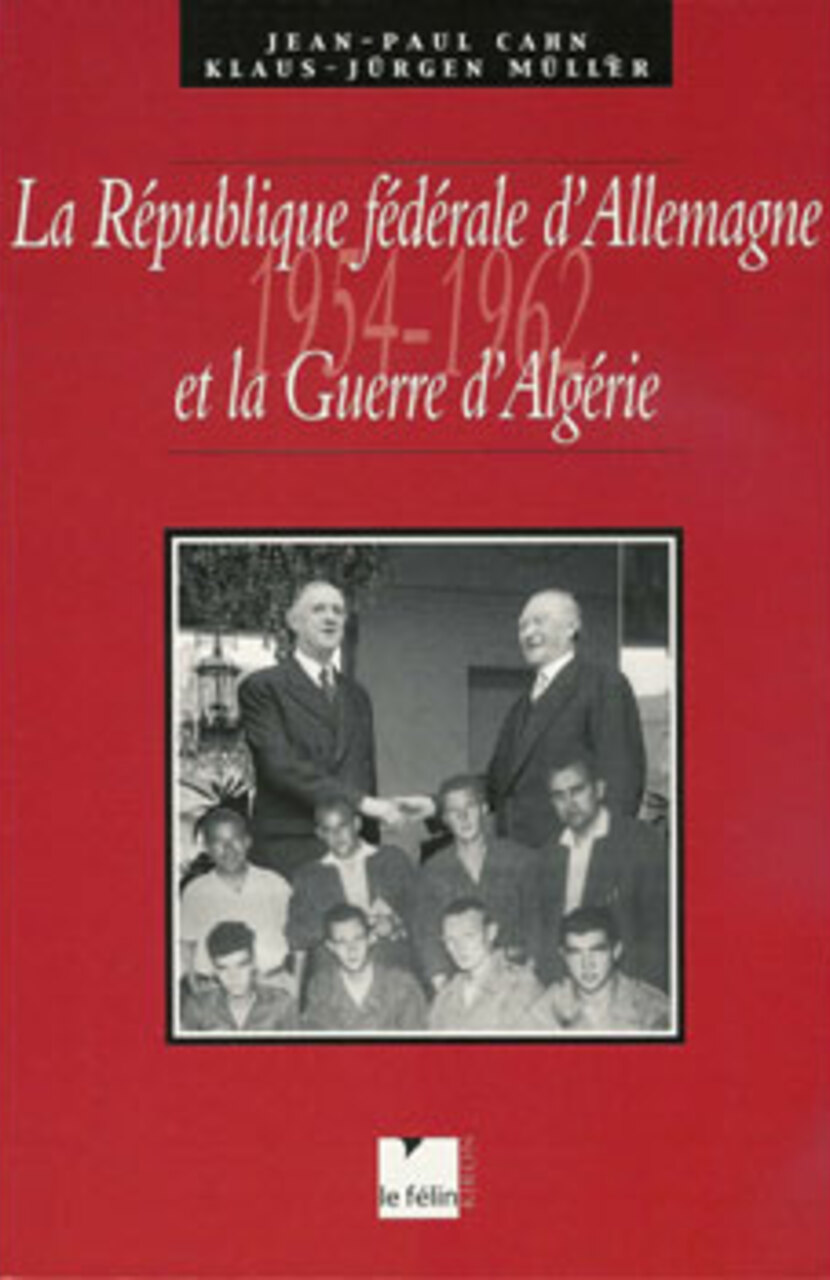
La république fédérale d'Allemagne et la guerre d'Algérie
ET LE DEBUT DE L’INSURRECTION ALGERIENNE
LA PRISE DE CONSCIENCE (1954-1955)
Depuis l’échec du projet de Communauté européenne de défense, le 30 août 1954, qui avait entraîné dans son naufrage le projet de Communauté politique, la construction d’une Europe à dimension supranationale était en panne quand commença la guerre d’Algérie1. Les espoirs de paix que l’opinion avait liés au plan Schuman ou à la CPE paraissaient devoir s’évanouir: l’Europe ne semblait plus à même de proposer un idéal mobilisateur. Inversement, bien que les accords de Paris d’octobre fussent signés, la République fédérale n’avait pas encore retrouvé sa souveraineté et sa liberté d’action internationale était très limitée. Cette coïncidence chronologique incita néanmoins l’organe de la RDA Neues Deutschland à interpréter les attentats du 1er novembre comme la réponse d’Algériens qui ne voulaient être «les esclaves coloniaux ni de la France, ni des USA, encore moins des revanchards de Bonn» à l’offre faite par Paris aux «fascistes et militaristes de Bonn» d’une «collaboration économique en Afrique du Nord 2». Cette démarche n’influa pas sur la RFA; elle indiquait cependant d’entrée la volonté de l’Allemagne orientale d’exploiter la situation, créant une pression sur le gouvernement et sur l’opinion ouest-allemands: par propagande interposée, Bonn et Berlin-Est allaient s’affronter également sur le terrain algérien.
Bien que le nationalisme n’eût jamais renoncé à obtenir son indépendance, au besoin par la guerre, depuis l’échec de l’insurrection spontanée de 1945 («émeutes de Constantine»), rares furent ceux qui mesurèrent immédiatement la portée des attentats. En cet automne 1954 les troupes françaises, dont les unités combattantes étaient encore majoritairement en Indochine ou en cours de rapatriement, étaient plus nombreuses en Tunisie et au Maroc qu’en Algérie. Paris avait tardé à trouver des remèdes à l’agitation qui s’était développée dans les protectorats depuis les décisions funestes de décembre 1951, l’arrêt des négociations et des réformes3, et le caractère spectaculaire des événements qui s’y étaient déroulés avait détourné l’attention des médias de l’oasis de calme que semblait être le centre du Maghreb4.
Dans la ligne des plans Labonne (1948 et 1951), dont l’objectif était de développer l’Afrique française en favorisant l’investissement de capitaux privés étrangers et, en se fondant sur la notion de «communauté de destin franco-allemand» née du plan Schuman5, Bonn avait accordé à l’Afrique du Nord un intérêt surtout économique; mais l’intensification des troubles mit en sommeil, en 1954-1955, les projets de coopération franco-allemande.
Les échanges commerciaux germano-algériens étaient déficitaires pour la République fédérale au début de la guerre; le déséquilibre tendait cependant à se réduire: les achats allemands régressaient (en 1955 les importations allemandes en provenance d’Algérie se montaient à 5261510000 francs, en 1956 à 3995588000 francs, en 1957 à 3828013000 francs), alors que les exportations progressaient (pour 1955, 1610103000, pour 1956, 2131593000 francs, pour atteindre en 1957 une valeur de 2762273000 francs). Le bilan aurait même pu être plus favorable si les importations algériennes de République fédérale n’avaient pas été ralenties au second semestre de l’année 1957 par des mesures de restriction: l’ensemble de ces importations atteignait 2,3 milliards de francs à la fin du mois de septembre, si bien que les achats algériens étaient tombés à quelque cinq cents millions de francs au dernier trimestre. Par ordre décroissant, toujours en valeur francs, les principaux secteurs allemands d’exportation étaient les machines, les acides gras, les automobiles et pièces de rechange, tracteurs, moteurs, textiles, optique, etc., c’est-à-dire prioritairement des produits à haute valeur technologique ajoutée; l’Allemagne importait des minerais de fer, des phosphates, des peaux, du papier, ainsi que des produits agricoles, etc., c’est-à-dire des produits qui ne faisaient l’objet avant exportation de transformations que faibles, voire nulles6.
I.LA PERIODE PIERRE MENDES FRANCE
L’ouverture des archives a montré que, quand éclata l’insurrection, ni Pierre Mendès France ni François Mitterrand n’avaient «une connaissance exacte de la situation» car, «en butte à des luttes intestines, les services de renseignements civils et militaires n’[avaient] pas été en état de présenter une analyse consensuelle et crédible 7 » du contexte. Le 12 novembre pourtant, devant l’Assemblée nationale, le président du Conseil réagit :
«[…] il n’y aura de la part du gouvernement ni hésitations, ni atermoiements, ni demi-mesures dans les dispositions à prendre pour assurer la sécurité et le respect de la loi. Il n’y aura aucun ménagement contre la sédition, aucun compromis avec elle. On ne transige pas lorsqu’il s’agit de défendre la paix intérieure de la Nation, l’unité et l’intégrité de la République – les départements français d’Algérie font partie de la République française. Cela doit être clair pour tout le monde en Algérie, dans la métropole et aussi à l’étranger8.»
La fermeté du propos, qui annonçait «une répression sans faiblesse car elle est sans injustice», reflétait le consensus qui existait autour de l’appartenance de l’Algérie à la France. La presse banalisait l’événement. Ignorant dans l’approbation générale la proclamation par laquelle le Front de libération nationale exigeait que soit «restauré» l’État algérien «souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques 9 », Paris s’engagea dans le rétablissement de l’ordre «pour que la force de la Nation l’emporte 10» et dans une politique d’intégration. Le PCF, plus préoccupé par le réarmement allemand que par l’Algérie, adopta dans un communiqué tardif une position ambiguë qu’il devait maintenir, au point que Hans-Jürgen Wischnewski, qui s’engagea en qualité de député fédéral aux côtés du FLN dans les années 1950-1960, écrira dans ses mémoires que les communistes français «n’ont pas joué un rôle très glorieux dans l’affaire de l’indépendance algérienne 11» et qu’en 1968 Jakob Moneta, responsable des questions sociales à l’ambassade fédérale à Paris dans les années de la guerre d’Algérie, leur consacrera un livre sous le titre Die Kolonialpolitik der französischen KP, dans lequel il impute la lenteur des réactions communistes à l’attachement du parti à l’Union française.
La seule définition du mouvement algérien posait problème. Neuf mois après les premiers attentats les représentants allemands à Paris sacrifiaient encore à des formulations prudentes:
«L’organe central de la Rébellion serait un certain “Comité révolutionnaire d’unité d’action pour l’Algérie” (CRUA) qui entretiendrait vraisemblablement des relations avec les deux mouvements autonomistes notoires UDMA (“Union pour la Défense du Manifeste Algérien”) et MTLD (“Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques”). Que certains Ulemas (enseignants dans des écoles de mosquées) sympathisent avec les Rebelles conférerait aux troubles l’aspect d’une sorte de guerre sainte12.»
Les archives de l’Auswärtiges Amt montrent cependant que, dès la fin de 1954, la centrale diplomatique allemande disposait des éléments nécessaires pour mesurer la gravité de la situation; ses représentants à Paris ne cachaient pas leur «scepticisme dans l’appréciation des chances de succès des réformes et des mesures de répression engagées par la France contre les Rebelles 13 ».
–Ni Wilhelm Hausenstein ni ses collaborateurs parisiens ne souscrivaient à la thèse française d’une Algérie partie intégrante de la France; ils la voyaient d’abord membre «de l’Afrique du Nord arabe et musulmane, du Maghreb 14». Certains Français, parfois inattendus, confirmaient cette lecture: le 1er décembre 1954, la représentation allemande à Paris faisait état d’un entretien avec le chef d’état-major du maréchal Juin, le commandant de Torquat, lequel estimait qu’il faudrait à la longue traiter les Algériens comme les autres peuples musulmans «car ils ne sont ni plus ni moins français15».
–Ils doutaient de l’efficacité des mesures militaires: la paix ne reviendrait que si une partie au moins des attentes des musulmans, les neuf dixièmes de la population, était satisfaite par des réformes fondamentales16.
–Enfin ils estimèrent dès janvier 1955 que les projets de réforme se heurteraient à des lobbies, celui de l’alcool ou celui des maires d’Algérie, qui craignaient pour leurs privilèges. Le 19, ils interprétèrent les critiques de L’Express et de France-Observateur (journaux proches de la politique algérienne du gouvernement) à l’encontre de la répression comme le signe annonciateur de réformes auxquelles il fallait préparer l’opinion.
Occasionnellement, tel titre de journal allemand reflétait une dramatisation: le 11 novembre 1954 le quotidien Hessische Nachrichten demanda «une action immédiate ou bien la tragédie indochinoise se répétera17». Mais Bonn ne considérait pas encore l’Algérie comme une donnée importante de ses relations politiques avec Paris. Elle s’en tenait au plan économique, renforcée dans cette approche par les récents accords de Londres et de Paris ainsi que par une disposition accrue de l’industrie allemande à s’engager18. Le directeur des Affaires économiques et commerciales de l’Auswärtiges Amt, Vollrath Freiherr von Maltzan, se dit favorable à un engagement en Afrique19, mais le gouvernement restait prudent en ce qui concernait l’Afrique du Nord : une collaboration étroite avec la France exposant la République fédérale au reproche de néo-colonialisme dans les régions arabes, Bonn aurait préféré s’engager dans le cadre d’une implication européenne20. Lors de leur rencontre de Baden-Baden, le 14 janvier 1955, Konrad Adenauer et Pierre Mendès France évoquèrent l’Algérie dans le contexte de la stabilisation économique de l’implantation française dans les territoires d’outre-mer – aspect des relations franco-allemandes dont ils n’avaient pas vraiment discuté en octobre, à La Celle-Saint-Cloud, bien qu’il fût évoqué dans le communiqué final21. Il est particulièrement révélateur qu’en avril 1955 les instructions du premier ambassadeur à Paris, ce même von Maltzan, ne fissent pas mention de l’Algérie et qu’en août lui-même tut cette question dans un rapport sur les relations franco-allemandes22.
II. LA PRISE DE CONSCIENCE A BONN
1.Le gouvernement fédéral
Les difficultés politiques et économiques auxquelles la République fédérale avait été confrontée dans les premières années de son existence, ajoutées au fait que l’Allemagne n’avait plus de colonies, avaient eu pour effet que de telles régions n’étaient pas au nombre des priorités de Bonn, bien que la RFA se préoccupât d’affirmer sa place dans le Bassin méditerranéen – au sens large du terme. Dans un premier temps, entre 1949 et 1955, on s’était limité à offrir des crédits à l’exportation (par l’intermédiaire de la Hermes-Kreditversicherungs A.G.) et à apporter des garanties aux entreprises allemandes qui exportaient, garanties limitées généralement aux deux tiers de la valeur marchande des exportations, l’objectif avoué étant d’aider aux exportations allemandes et à la reconquête de marchés et non de participer à une quelconque forme d’aide au développement. Il avait fallu attendre 1954 pour que le ministère de l’Économie élabore, en vue de l’utilisation d’un crédit spécifique de 500000 marks voté l’année précédente par le Bundestag, des dispositions concernant «l’encouragement à l’aide technique à des régions de moindre développement23». Il était donc surtout tenu compte des phénomènes de décolonisation à Bonn dans la mesure de leur incidence sur le contexte politique et économique international. Il est vrai que, sous l’influence en particulier du ministre de l’Économie Ludwig Erhard, la politique allemande d’aide au développement était d’abord l’affaire du secteur privé dont on attendait une plus grande efficacité et auquel on offrait simultanément l’occasion de s’implanter dans des régions que leur émancipation politique obligeait à diversifier leurs partenariats économiques. À côté de cet objectif majeur de développement de son économie, le but permanent et avoué24 du ministère de l’Économie était de convaincre les pays bénéficiaires des vertus de l’économie sociale de marché. En ce sens, cette manière de procéder servait la lutte contre le communisme à double titre: matériel, en combattant la pauvreté, et idéologique, par la propagande implicite qui devait accompagner l’aide.
A.Nouvelle manifestation de la menace communiste.
Le député Karl Mommer appartenait à cette minorité de l’opposition sociale-démocrate qui s’interrogeait sur la crise de la puissance française. Dans Neuer Vorwärts du 8 février 1952, il avait comparé Londres (vainqueur à part entière de la Deuxième Guerre mondiale qui avait su transformer dans les régions colonisées un rapport de force en une relation d’amitié) à Paris que son besoin d’affirmation incitait à n’accorder des concessions à l’Union française qu’avec un retard et une parcimonie qui en annihilaient d’entrée les effets. Il avait estimé que cette attitude incitait les mouvements de libération nationale à des formes de lutte qui les rapprochaient du communisme et que cette proximité suscitait à son tour la méfiance des peuples libres. S’appuyant sur l’exemple des États-Unis, réservés à l’égard de la politique de Paris et partisans déclarés de la libération des peuples d’Afrique et d’Asie, il avait dénoncé un mécanisme qui faisait que les manquements de la France face à ses colonies poussaient l’Occident à prendre le parti de l’oppresseur pour s’opposer au communisme.
Telle n’était pas la lecture du gouvernement. Adenauer craignait de voir l’Union soviétique prendre le contrôle de la Méditerranée, conforté en cela par l’attitude ouvertement polémique de la RDA et par les thèses françaises qui voyaient dans le combat en Algérie le prolongement de la lutte contre les aspirations hégémoniques de l’Est. La thèse du soutien de Moscou à la rébellion algérienne fut un temps reprise en bloc par certains Allemands: le ministre chrétien-démocrate des Affaires étrangères, Heinrich von Brentano, déclara le 27 octobre 1955 que l’aide du Kremlin au Maroc et à l’Algérie via l’Égypte était un secret de Polichinelle, ajoutant que l’URSS pouvait ainsi se débarrasser d’armes dépassées qui, en outre, lui étaient payées25. Ce péril communiste fut un argument dont l’ambassade de France à Bonn allait user et abuser, avec des fortunes diverses, car tout indique que Konrad Adenauer, qui inscrivait le soulèvement algérien dans le cadre plus vaste de la menace que l’URSS faisait peser sur l’Ouest, ne fut que modérément sensible à cette thèse; en fait, il refusa d’entrer dans le jeu de l’évaluation du degré de marxisation du FLN, bien qu’il interrogeât une fois l’Auswärtiges Amt à ce propos; il craignait davantage qu’une instrumentalisation du mouvement algérien par les capitales communistes, par l’URSS en particulier, fît de l’Algérie à la fois un point d’implantation et de diffusion de la puissance communiste.
B. L’installation d’un consulat général d’Allemagne à Alger
Si Bonn, accaparée par les conséquences des accords de Paris du 23 octobre 1954, la fin du statut d’occupation et le réarmement allemand en particulier26, ne s’était préoccupée que modérément de l’affaire algérienne à la fin de l’année 1954, le Chancelier qui venait de procéder au remplacement de son représentant à Paris27, obtint de Pierre Mendès France, lors des entretiens de Baden-Baden, un accord pour l’installation d’une représentation consulaire allemande à Alger et l’ouverture d’une mission commerciale à Casablanca; il s’agissait avant tout d’assurer la présence d’observateurs économiques. Ce projet allemand n’était pas vraiment contextuel: la note du 7 septembre 1955 par laquelle la représentation diplomatique allemande à Paris signalait une radicalisation du MTLD de Messali Hadj ne fut suivie d’aucune réflexion sur l’opportunité d’accélérer cette entreprise. On s’inscrivait plutôt dans le cadre de l’intérêt commercial que présentait pour Bonn la mise en valeur des possessions françaises d’outre-mer que soulignait, le 18 novembre 1954, von Maltzan, alors directeur des Accords commerciaux de l’Auswärtiges Amt :
«Comme il est clair que l’économie française ne peut, à elle seule, assurer la mise en valeur des possessions françaises d’outre-mer, et comme il existe, par ailleurs, du côté allemand, une expérience appropriée, des possibilités de livraison, du personnel qualifié et d’autres moyens disponibles, un vaste champ d’activité s’ouvre là28.»
Des firmes telles que Krupp, Stahlunion, etc. avaient manifesté quelque intérêt pour projet29.
Il fallut attendre une note urgente du 19 juillet 1955 à la sous-direction 110 (Referat Organisation) du représentant provisoire de Bonn à Alger, Marchtaler, pour que soit établie expressément une corrélation entre l’évolution de la situation et l’urgence de l’installation d’un consulat30. Le 1er août, Helmut Kraetzer était muté d’Anvers à Alger pour prendre en charge les Affaires à titre transitoire31. Le 24, depuis Paris, Maltzan demandait à Bonn de freiner le processus, estimant que l’introduction d’une demande administrative après quinze jours d’événements sanglants pouvait paraître cavalière. La France, qui essayait à cette époque de se positionner sur le marché de l’équipement de la future armée allemande32, aurait pu trouver là l’occasion de faire un geste, un moyen de s’attirer les bonnes grâces de Bonn. Mais la réalisation du projet traîna avant tout parce que les autorités françaises compétentes étaient accaparées par le problème algérien. En janvier 1956, le représentant de la RFA à Paris demanda à Roland de Margerie d’accélérer le dossier et, le 10 février, il put informer l’Auswärtiges Amt que le Quai d’Orsay approuvait la nomination de Siegfried Hendus aux fonctions de consul général à Alger33.
2.Prise de conscience tardive de l’opposition sociale-démocrate.
Très tôt, Rolf Reventlow avait remis en question le mythe de l’Algérie française. S’appuyant sur les événements de l’après-guerre et sur les théories d’Otto Bauer sur le «réveil des nations dénuées d’histoire», il avait annoncé en 1952 l’émergence inévitable d’une conscience nationale algérienne34. Il est vrai qu’il avait de l’Afrique du Nord et de la France une connaissance peu répandue dans son parti: après avoir combattu en Espagne il avait fui en Algérie, y avait adhéré à la SFIO en 1943 et collaboré à Alger Républicain puis, de 1945 à 1947, à Alger Soir35.
Son parti avait alors une appréhension globale de la politique coloniale française dont le facteur déterminant était l’Indochine; les temps forts de crise dans d’autres parties de l’Empire y étaient intégrés contextuellement, sans en modifier l’ossature. L’épine dorsale en était l’image anachronique d’une France qui surestimait son pouvoir et cherchait à préserver des structures et à entretenir des relations que les transformations du monde avaient rendu irréalistes. Le 21 mai 1954, Heinz Abosch écrivait dans Neuer Vorwärts:
«L’expédition [française en Indochine] fut entreprise au mépris de l’importance de la France, à la fin de la Guerre, dans une surévaluation funeste des forces en présence et des possibilités. De Gaulle poursuivait de grands desseins empruntés à Richelieu, soutenu par des Français enthousiastes mais myopes. L’exagération du rôle de la France dans la guerre contre l’Allemagne hitlérienne conduisit tout droit à la campagne d’Indochine que la France, ivre de victoire, espérait bientôt mener à bien.»
Deux facteurs retardèrent la prise de conscience par l’opposition de la portée des événements algériens: elle ne bénéficiait pas des mêmes sources d’information que l’exécutif et Erich Ollenhauer et ses proches faisaient confiance à Mendès France, l’homme de la paix en Indochine et du discours de Carthage. Le président du Conseil n’avait-il pas sauvé à Genève ce qui pouvait l’être et obtenu la libération des légionnaires allemands du bourbier indochinois? N’avait-il pas accordé à Habib Bourguiba une liberté accrue, rencontré le porte-parole du Néo-Destour en France, Mohammed Masmoudi, et imposé au résident général à Tunis, Boyer de Latour, l’application des directives de Paris? Bref, n’avait-il pas manifesté sa volonté, contre les colonialistes, de renoncer à la force et à l’intrigue au bénéfice de la recherche, avec des interlocuteurs modérés, de solutions libérales adossées à des décisions économiques à dimension sociale? La presse sociale-démocrate avait soutenu la politique tunisienne de Pierre Mendès France contre ceux qui l’avaient menacée et, le 25 novembre 1954 encore, on pouvait lire dans le SPD-Pressedienst :
«Le “protectorat” français semblait condamné à la guerre civile et à une lutte sanglante entre les troupes françaises et le mouvement nationaliste Néo-Destour quand Mendès-France décida, après avoir apprécié la situation avec justesse, de mettre fin aux hésitations et aux graves erreurs de ses prédécesseurs et promit lui-même […] aux nationalistes ce qu’ils exigent – pour l’instant – l’“autonomie interne”, c’est-à-dire l’administration effective de leurs propres Affaires.»
Pierre Mendès France semblait donc être l’homme capable de gérer au mieux la crise algérienne.
Les 5 et 6 novembre, lors de la réunion de son comité directeur, le Parteivorstand, le problème algérien ne fut pas mentionné36. La presse du parti hésitait entre la lecture religieuse de l’insurrection algérienne («l’armée d’Allah37») et le parallèle avec l’Indochine; elle mettait en cause tantôt le mouvement panarabe et l’influence du colonel Nasser, tantôt un complot communiste, et elle évoquait des aides étrangères – tunisiennes en particulier38. Simultanément, elle mentionnait les problèmes structurels, le retard chronique dont souffrait l’Afrique du Nord dans les domaines politique, économique, social ou judiciaire, l’inféodation de la bureaucratie locale aux intérêts particuliers ou le déficit de démocratie qui faisaient des Algériens des Français de second ordre. Face à cette situation qu’elle analysait, de manière très théorique et sans la dénoncer, comme un état de fait colonial, et tout en craignant les entraves que pouvait susciter le lobby des possédants (comme il l’avait déjà fait au Maroc et en Tunisie), l’opposition allemande approuvait la volonté de Paris de doubler sa réponse militaire immédiate d’une action économique et sociale en profondeur. Convaincue cependant que les effets n’en seraient pas immédiats et que le terrorisme ne serait pas jugulé par la seule force, elle préconisait une action politique en faveur de la démocratie et de la dignité humaine (fin du système électoral à l’algérienne par exemple). Elle saluait la partie administrative des propositions du ministre de l’Intérieur François Mitterrand. En revanche, elle s’interrogeait sur l’effet des dispositions prises pour combattre les inégalités, Carlo Schmid estimant devant son groupe parlementaire qu’elles constituaient «une révolution pour cette région préagraire 39».
III. LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LE GOUVERNEMENT EDGAR FAURE
ET LA QUESTION D’AFRIQUE DU NORD (1955)
À bien des égards, dix ans après la fin de la guerre, le bilan des relations franco-allemandes était positif. Aucune zone n’était exempte d’ombres, mais la coopération européenne, économique, commerciale, culturelle, évoluait favorablement. S’il était audacieux de parler avec Antoine Pinay d’«ère nouvelle d’amitié et d’entente 40» en raison de l’évolution plus lente des mentalités, cette expression devait se révéler plutôt pertinente sur le plan des relations bilatérales. Comme le note Ulrich Lappenküper, si l’«hypothèque de la méfiance41» n’était pas levée, elle pesait d’un moindre poids.
À plusieurs reprises la représentation allemande à Paris souligna que le gouvernement de Pierre Mendès France n’était pas tombé sur sa politique nord-africaine, que celle-ci avait seulement servi de prétexte à ses adversaires42. Au moins jusqu’aux initiatives de Paul-Henri Spaak, Jean Monnet et Johan Willem Beyen, et au mémorandum du Benelux (du 18 mai 1955), voire jusqu’à la conférence de Messine du début de juin, l’enseignement essentiel de son passage à Matignon était à n’en pas douter pour Bonn, avec l’échec de la CED, la fin possible d’une conception intégrée de l’Europe. C’était là un facteur d’autant plus important que 1955 fut riche en événements internationaux, les conférences de Genève étant conçues par la diplomatie allemande comme autant de chausse-trapes, celle de Messine apportant des espoirs tempérés par les déconvenues récentes. Les réticences n’étaient d’ailleurs pas négligeables outre-Rhin: le nouveau ministre des questions atomiques, Franz Josef Strauss, était aussi hostile à une communauté nucléaire que son collègue de l’Économie, Ludwig Erhard, à une intégration sectorielle ou à une union douanière43. Intégrationniste convaincu, le secrétaire d’État Walter Hallstein en concevait quelque dépit. Il fallait prévoir des tensions franco-allemandes autour de la construction de l’Europe au moment même où le remplacement de Gheorghi Maximilianovitch Malenkov par Nikolaï Aleksandrovitch Boulganine à la tête du Conseil des ministres soviétique annonçait le retour du Kremlin à une diplomatie de mouvement après six mois d’inertie: «La nouvelle équipe au pouvoir à Moscou voulait avant tout sauver son emprise sur l’Europe orientale et développer l’influence soviétique dans la nouvelle zone de compétition Est-Ouest, le tiers-monde, en particulier le Moyen-Orient44.»
Le successeur de Pierre Mendès France à Matignon, Edgar Faure, accorda davantage d’attention au Maroc et à la Tunisie qu’à l’Algérie45. Il y avait à cela une raison structurelle: département, celle-ci dépendait du ministre de l’Intérieur Maurice Bourgès-Maunoury et du gouverneur général Jacques Soustelle, nommé peu avant sa chute par PMF mais confirmé par Edgar Faure; de par son statut elle requérait une solution spécifique; Matignon déléguait. D’un point de vue contextuel, à l’est et à l’ouest de l’Afrique du Nord les problèmes avaient atteint un meilleur degré de maturation.
La préparation du référendum qui devait avoir lieu en Sarre (23 octobre 1955) montra cependant combien l’Algérie s’était immiscée dans les esprits. Le bruit courut à l’instigation des partis irrédentistes qu’en cas d’adoption du statut «européen» les jeunes Sarrois seraient appelés à combattre au Maghreb, dans les rangs français. Cette rumeur était infondée. Sa vigueur témoigne de la part d’irrationnel qui marqua cette campagne, mais aussi d’un terrain favorable, d’une crainte sous-jacente. Le départ pour le Maroc de l’ambassadeur de France à Sarrebruck Gilbert Grandval, en juillet 1955, ne l’apaisa pas. Les analyses du vote s’accordent à lui reconnaître un impact sur le résultat final.
1. L’attitude du gouvernement et de la majorité allemands.
Après la chute de Mendès France, les interrogations allemandes sur la capacité de la Quatrième République à sortir du dédale politique crurent. Son successeur fut confronté tout au long de l’année 1955 à des tensions sociales et les solutions envisagées pour se rendre maître des problèmes du Maghreb ne convainquaient guère. Le 28 août, l’ambassadeur à Paris notait: «Un coup d’œil rapide aux derniers développements marocains montre combien peu les moyens de la politique du gouvernement français sont adaptés à l’ampleur du problème de l’Afrique du Nord46.» Ces propos se plaçaient dans la ligne de ceux du 25 février dans lesquels la représentation diplomatique allemande avait exprimé sa crainte de voir le gouvernement français «retomber […] dans le traditionnel “immobilisme47”». Le 1er mars 1955, l’ambassadeur Hausenstein estimait que les réformes proposées par Jacques Soustelle, inspirées des propositions Mitterrand de janvier mais plus vagues, se heurteraient à l’opposition des groupes de pression. Des incidents en métropole ne tardèrent pas à mettre en évidence les limites de la loi sur l’état d’urgence d’avril, notamment les réticences des réservistes: en septembre l’ambassadeur allemand à Paris marquait sa vive inquiétude face aux incidents de la gare de Lyon, le 14 octobre à propos de ceux de l’église Saint-Séverin, de Tulle, de Rouen, ou encore des manifestations d’étudiants du Quartier latin48. Ces incidents étaient décrits comme le fruit de manipulations communistes, mais on notait qu’elles trouvaient dans l’opinion un terrain fertile49. Or Maltzan avait déjà signalé en août qu’en dépit des forces engagées la France ne parvenait pas à prendre le contrôle de la situation, tandis que la résistance des rebelles renforçait leur prestige50.
Le second semestre de l’année 1955 vit Bonn prendre davantage conscience de l’importance de la question algérienne, de sa dimension mondiale et, plus encore que par le passé, de sa portée géostratégique. Le contexte international avait changé depuis avril. Marque de l’attention avec laquelle l’Auswärtiges Amt suivait le déroulement des événements: on transmit in extenso à son directeur du département Ouest, Wolfgang Freiherr von Welck, le rapport parisien du 1er juin sur les mesures militaires décidées pour l’Algérie, dans lequel le représentant allemand disait son scepticisme sur l’efficacité d’une politique qui balançait entre engagement total et mesures de réforme51.
La capitale fédérale se gardait de toute ingérence; l’Auswärtiges Amt rappelait en décembre 1955 à son représentant à Casablanca, Franz Obermaier, que
«la République fédérale se devait par principe de s’en tenir à la plus extrême réserve face à la politique nord-africaine de la France et que, eu égard aux relations franco-allemandes et à ses rapports avec les États arabes, il lui était impossible de prendre position sous quelque forme que ce fût […]52.»
L’année qui s’achevait avait montré combien Bonn restait tributaire de Paris : tandis qu’en avril la conférence de Bandoeng avait marqué la montée d’un mouvement non engagé, le traité d’État autrichien avait été paraphé le lendemain de la signature du traité de coopération et d’assistance mutuelle des États de l’Est, en juin Moscou avait invité l’Allemagne désormais souveraine à l’établissement de relations diplomatiques, «succès considérable pour la République fédérale» selon les termes du ministre français des Affaires étrangères53. L’URSS, profitant de la conférence afro-asiatique, avait décidé d’apporter son soutien à un mouvement plus nationaliste qu’idéologiquement proche d’elle, mais susceptible d’endiguer l’influence de l’Occident. La République fédérale avait pu constater sa dépendance vis-à-vis des Trois lors de l’échec des conférences de Genève, et elle savait que l’affaire sarroise ne trouverait pas de solution sans la bonne volonté de Paris. La «relance de Messine54» autorisait des espoirs européens prudents. Ces questions mettaient en jeu des intérêts allemands prioritaires et plaidaient pour la prudence face à la France qui considérait les questions coloniales comme majeures, le départ de sa délégation de l’ONU le 30 septembre 1955 pour marquer sa désapprobation face au vote sur l’inscription de l’affaire algérienne à l’ordre du jour l’avait montré. Dans des registres différents, la démission des ministres fédéraux du Bloc des réfugiés, la brève mais vive agitation qui avait ponctué la participation au gouvernement de Basse-Saxe du néo-nazi Léonard Schlüter ou encore le retour après un passage à l’Est d’Otto John, ancien chef de ses services de sécurité, avaient rappelé à Bonn, si besoin était, les impératifs de la circonspection.
En dépit des accords de Londres et de Paris (1954) ou des entretiens de Baden-Baden (janvier 1955), divers projets de collaboration franco-allemande en Afrique avaient du plomb dans l’aile ou avaient d’ores et déjà échoué55. En outre l’affaire algérienne brouillait désormais les distinctions et marquait la fin du manichéisme: alors que le Viêt-minh s’était clairement inscrit dans le camp communiste, les attaches idéologiques du FLN étaient floues; tandis qu’en Indochine la France avait disposé du soutien occidental, l’Ouest affichait une moindre homogénéité à propos de l’Algérie56: les États-Unis, qui avaient soutenu l’engagement en Asie, adoptaient une position ambiguë sur le Maghreb. Washington ne souscrivait pas à la thèse de la défense d’intérêts communs en Afrique du Nord mais se montrait sensible à l’affaiblissement que constituait pour le Pacte atlantique l’engagement de contingents français importants en Algérie. Pour autant le State Department ne réprouvait pas encore la politique algérienne de la France. Le changement de perception ne devait intervenir qu’en 195557.
Le gouvernement fédéral manifestait ponctuellement le souci de ne pas être directement associé à l’image colonialiste, préjudiciable dans l’ensemble du monde arabe, que suscitait l’action de la France dans cette région: l’évolution des rapports anglo-égyptiens à la suite du traité d’octobre assurant le départ des troupes britanniques et les perspectives d’amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et l’Irak ou la Jordanie faisaient que la Ligue arabe considérait moins que par le passé les États-Unis ou les Britanniques comme des puissances colonialistes. L’ambassade allemande au Caire notait à propos d’un projet franco-allemand de construction en commun d’avions de combat dans le Maroc méridional, le 3 novembre 1954, que la France était présentée par la presse arabe comme la «dernière “puissance impérialiste”58» et Maltzan affirmait le lendemain que l’appui allemand à la France pour lequel il plaidait «[…] n’impliqu[ait] pas que l’Allemagne soutienne un colonialisme français dépassé et étroit59». Afin de se démarquer, Bonn fit savoir en avril qu’elle ne souhaitait pas pousser plus avant les projets de construction aéronautique d’Agadir. Plus généralement, dans un entretien avec André François-Poncet, le conseiller d’Adenauer Herbert Blankenhorn argua de menaces arabes sur les échanges économiques avec la République fédérale pour justifier le désintérêt de la capitale allemande60.
Pour autant, Bonn n’entendait pas être tenue à l’écart quand des incertitudes planaient sur les relations franco-allemandes: la France allait-elle faire de la RFA son principal partenaire en Europe ou allait-elle se rapprocher de Moscou? La prudence était de mise, et la chancellerie ne voulait pas que la question algérienne pesât sur l’évolution de la situation. Or les nouvelles étaient alarmantes: la représentation parisienne notait que la «fiction fatale» de l’Algérie – partie intégrante de la patrie, à laquelle Paris ne pouvait renoncer pour des raisons de politique intérieure, rendait toute solution à court terme et toute réorientation de la politique française impossibles61.
En Afrique du Nord le contexte paraissait alarmant. Une collaboratrice de l’ambassade fédérale à Paris obtint confirmation de ce qui avait été rapporté à Bonn en juin à propos d’un voyage de cinq députés français en Algérie: la rébellion était puissante et menaçante moins par le nombre de ses membres actifs que par l’adhésion populaire dont elle bénéficiait62, ce qui incita l’ambassade à parler de «popularité croissante des rebelles algériens63» – allusion indirecte à ce que le théoricien de la révolution Frantz Fanon appelait le «point de non-retour». Elle acquit la conviction lors d’un voyage d’étude en Algérie que la population musulmane était solidaire dans son ensemble de la rébellion et que même les arabes modérés hésitaient à prendre leurs distances. Inversement, seule une minorité d’Européens prenait conscience de l’ampleur du phénomène tandis que la majorité, et surtout les puissants propriétaires terriens et industriels, se contentait d’exiger une répression renforcée64.
En été et en automne 1955, les ambassades durcirent le ton. Alors que le consulat général allemand de Marseille estimait que l’image globale de l’Allemagne allait s’améliorant en France65, l’ambassade de France à Bonn analysait les réactions de l’opinion allemande en des termes vifs, parlant de «joie maligne» d’Allemands qui voyaient dans les problèmes de la décolonisation «une revanche éclatante sur les puissances qui, en 1918, les ont dépossédés de leur empire colonial», ajoutant que ces mêmes Allemands espéraient prendre la place des Britanniques et des Français une fois le processus achevé66; devant la commission des Affaires étrangères du Bundestag, Heinrich von Brentano – qui avait accédé à des responsabilités ministérielles après l’obtention par la République fédérale d’une plus large souveraineté – faisait siennes certaines réserves d’André François-Poncet à propos du Maroc, estimant affligeants les comptes rendus de presse allemands au vu de la communauté des intérêts français et allemands au Maghreb: «chaque mètre carré que la France perd au Maroc est finalement perdu pour l’Occident67.» Vollrath von Maltzan et son conseiller politique Paul Frank, s’appuyant implicitement sur l’absence d’issue immédiate qu’ils avaient déjà mentionnée, estimaient que l’Europe pouvait apporter des solutions. En novembre, l’ambassade parisienne revenait à la charge: elle constatait que les transformations qu’avait connues le contexte géopolitique avaient entraîné la perte pour la France de ses appuis traditionnels à l’Est et, partant, la fin de sa position d’intermédiaire entre l’Est et l’Ouest; cet affaiblissement était accru par les problèmes nord-africains qui opposaient Paris à l’opinion mondiale et par le stationnement d’importants contingents militaires en Algérie. Les Anglo-Saxons n’apportant pas le soutien escompté, une prise de conscience de l’isolement de la France se précisait, accentuée par la décision de l’Assemblée plénière de l’ONU d’inscrire l’affaire algérienne à son ordre du jour – ce qui avait suscité chez les Français, selon Maltzan, le sentiment «qu’ils [avaient] été abandonnés par une partie de leurs amis traditionnels et que d’autres puissances, susceptibles de les soutenir, n’[étaient] pas représentées à l’ONU.68». Cette situation pouvait se révéler favorable à des relations franco-allemandes d’un nouveau type: déjà le Quai d’Orsay ne considérait plus l’Allemagne comme un ennemi potentiel. Bonn devait tenir compte du besoin de Paris de se rapprocher de ses voisins pour institutionnaliser de nouvelles formes de coopération susceptibles de faire de ces deux capitales un noyau européen. Il s’agissait in fine d’instrumentaliser le problème colonial: pour la première fois, un projet visait à établir une corrélation concrète entre la situation douloureuse de la France et la construction d’une Europe trop embryonnaire pour offrir une assistance effective à la France69.
Cette prise de position suscita un débat à l’Auswärtiges Amt. Face à l’aspiration à faire du problème de la décolonisation une composante de la collaboration européenne franco-allemande, et sans nier la dimension européenne du problème algérien, d’autres, plus influents, autour de Herbert Blankenhorn, engagèrent Bonn pour de nombreux mois dans une politique du grand écart asymétrique dans laquelle la solidarité (prioritaire) avec Paris allait de pair avec le souci de ménager les capitales arabes. Cette approche qui visait à ménager inégalement mais simultanément la chèvre et le chou s’appuyait sur trois considérations pessimistes: la conviction de l’incapacité de la France à résoudre le problème algérien de manière constructive, la difficulté de préserver des intérêts économiques allemands, la conviction que les pressions soviétiques sur l’Europe pouvaient séduire Paris et qu’elles imposaient l’affirmation de la fidélité de Bonn à ses engagements occidentaux70. Cette coïncidence d’impératifs dissonants – prise en compte des exigences du tiers-monde, souci de ne pas nuire à la France – devait conduire Bonn à des concessions à la France dans les négociations européennes, de Messine au traité de Rome. La chancellerie opta pour cette ligne; les déclarations d’Eisenhower sur la neutralité dans le tiers-monde ou le mémorandum Kennan en faveur d’un désengagement (1956) incitaient d’ailleurs à soutenir les efforts de Paris pour se maintenir autour de la Méditerranée71.
2. L’opposition sociale-démocrate.
La perception sociale-démocrate du gouvernement Edgar Faure n’était pas exempte de préjugés. L’opposition allemande avait soutenu Mendès France. Avec l’investiture de son successeur, elle estima qu’elle assistait au retour des grands prêtres de l’économie de marché et à la victoire de la réaction sur la volonté populaire qui avait soutenu PMF. Elle notait que Pierre July, chargé des Affaires marocaines et tunisiennes, avait combattu les mesures de progrès du Cabinet précédent au Maghreb, et vit surtout dans l’entrée d’Antoine Pinay au Quai d’Orsay un contre-emploi pour un homme dont, en outre, elle évoquait le combat contre le Front populaire et le vote des pleins pouvoirs à Pétain. À son propos, le parti d’Ollenhauer rappelait que, si l’Allemagne gardait dans l’ombre quelques fantômes du passé, la France, elle, les mettait en pleine lumière. Jusqu’en août 1955, les journaux proches du SPD se plurent à imputer à Edgar Faure les difficultés de la France tout en attribuant aux initiatives de son prédécesseur le mérite de ses succès72.
Sous Mendès France, le parti social-démocrate analysait la conjoncture nord-africaine comme une situation coloniale, jusques et y compris dans son appréhension de la présence d’Algériens en métropole73, mais sans pour autant la dénoncer comme telle et en l’inscrivant ouvertement dans la tradition d’une présence française plus que centenaire; lorsque le Pressedienst du 18 novembre 1954 attribuait les événements algériens à l’absence de démocratie, il prenait soin d’inscrire cet état de fait dans la tradition algérienne. Cette approche était empreinte de manichéisme, notamment lorsque la presse sociale-démocrate rappelait les efforts positifs de la gauche française, évoquant par exemple le statut de 1947 à l’initiative du gouverneur général socialiste Yves Chataigneau. Le SPD se départit de cette retenue sous Edgar Faure, l’accusant de pratiquer une politique anachronique à un moment où l’ensemble des peuples dominés s’émancipaient et déplorant que, par attachement à la centralisation, Paris laissât police et autorités au Maghreb se faire jusqu’au crime les complices des contre-terroristes. La centralisation de la France apparaissait comme un obstacle structurel majeur au dénouement d’inspiration fédéraliste que préconisait l’opposition allemande pour les problèmes coloniaux français74.
Ce mode de décolonisation, inspiré du modèle britannique mis en place par le Labour, avait séduit le SPD dès l’après-guerre. Dans Jenseits des Kapitalismus qu’il avait publié en 1947 sous le pseudonyme de Paul Sering, Richard Löwenthal avait plaidé pour une troisième force entre dirigisme soviétique et capitalisme américain, estimant toutefois que l’Europe ne pourrait assumer ce rôle qu’à la condition de s’appuyer sur ses anciens empires coloniaux. En 1954 encore, jugeant trop tardive la décision conservatrice de retrait britannique de Suez, SPD-Pressedienst du 30 août rappelait la manière exemplaire dont le British Labour Party avait accordé la souveraineté à l’Inde en 1947 ou, l’année suivante, à Ceylan et à la Birmanie, et l’organe social-démocrate estimait qu’une décolonisation fondée sur «l’établissement de gouvernements autochtones responsables» et sur une «égalité de droits» était chose réalisable; Walter Blasig notait qu’il valait mieux accorder l’indépendance qu’administrer des massacres75. Sur ce point de l’exemplarité de la décolonisation en Inde, chrétiens et socialistes se rejoignaient, puisque le journal chrétien Christ und Welt du 6 octobre 1955 écrivait que la Grande-Bretagne s’était retirée, bien qu’en dix ans le nombre des victimes fût inférieur à ce qu’il était mensuellement en Algérie.
Au début des années cinquante, le SPD avait toutefois apporté à l’émancipation des peuples colonisés un soutien ambigu. Bien qu’ils eussent pris conscience assez tôt de la modification des rapports de puissance dans le monde et des évolutions qui résultaient de la substitution de relations de coopération entre pays coloniaux et colonies à des liens de domination, les partis majeurs allemands avaient négligé d’intégrer véritablement ce facteur à leur conception des relations internationales. Le parti social-démocrate n’avait pas échappé à la règle. En 1950 son chef avait dit sa sympathie pour leurs aspirations à la reconnaissance de leurs droits. Lors du congrès de Francfort qui avait vu la naissance de l’Internationale socialiste, Kurt Schumacher avait déclaré que l’internationalisme aspirait à la libération de l’individu et des peuples mais son parti avait revendiqué le droit à l’autodétermination pour les régions sous-développées sans prononcer les mots ni de souveraineté, ni d’indépendance. De fait, dans les années suivantes, la méfiance envers les mouvements panarabes l’avait emporté, au point que la Friedrich-Ebert-Stiftung allait voir dans la confédération syndicale arabe internationale de Damas (1956) «une organisation essentiellement politique76». Cette hésitation concernait plus généralement les mouvements d’émancipation que le SPD jugeait souvent prématurés et il suspectait des arrière-plans douteux: l’Istiqlal marocain lui paraissait par exemple être aux mains de la haute finance.
Comme Adenauer et les libéraux, Ollenhauer estimait qu’il n’appartenait pas à Bonn de conseiller le gouvernement français sur la gestion du conflit algérien: en la privant de ses colonies, l’histoire avait épargné à l’Allemagne le fardeau de la décolonisation ; il fallait s’en réjouir sans arrogance. La bonne foi de cette thèse ne fait aucun doute. Dès lors que le SPD appréhendait l’Algérie comme une affaire intérieure française, retenue et non-ingérence étaient de mise.
Il n’en demeure pas moins que l’argument apparaissait finalement comme un moyen de cultiver une ambiguïté chargée d’histoire face à un problème pourtant particulièrement favorable au combat social-démocrate contre les thèses libérales: une prise de position en faveur de la décolonisation s’inscrivait à plusieurs titres dans la logique de la pensée socialiste allemande de la fin des années cinquante. Historiquement, le colonialisme en tant qu’extension de la sphère d’influence européenne à d’autres parties du monde avait reposé essentiellement sur des données économiques et militaires dans le but avoué d’accroître la richesse des pays colonisateurs aux dépens des régions colonisées; en ce sens, le Marché triangulaire constituait une illustration extrême de ce système de profits unilatéraux fondés en partie sur le mythe d’une inégalité anthropologique et d’une infériorité des peuples exploités qui avait justifié simultanément, à travers un enthousiasme missionnaire, la substitution de critères européens aux identités locales. Au début du XIXe siècle, les thèses de David Ricardos sur les coûts comparés avaient donné un fondement théorique au confinement des pays du tiers-monde dans la production de matières premières ou de produits finis simples, tandis que la confection de produits finis élaborés, et partant plus coûteux, devait rester l’apanage des pays développés. Le libéralisme avait fait sienne cette approche des rapports interrégionaux et repris ces méthodes sous une forme humanisée, mais identique dans son principe, empêchant de fait la naissance d’industries autochtones et confinant l’économie de ces pays à des secteurs peu rentables. Dans certains cas, ce procédé était allé jusqu’à la contradiction avec la civilisation locale: dans les années cinquante-soixante, les journaux proches du SPD se plaisaient à souligner que l’Algérie, région musulmane et donc abstinente, était l’un des premiers producteurs de vin au monde. Avec les doctrines impérialistes la domination sur les territoires était devenue l’objectif majeur à côté de la maîtrise des marchés; en 1914, plus de la moitié de la population mondiale se trouvait dans une situation de dépendance, sans compter la Chine, la Perse et la Turquie dont la souveraineté n’était qu’apparente. Une telle situation n’était guère compatible avec l’internationalisme prolétarien qui proclamait la cohésion des travailleurs de tous les pays contre les capitalistes. L’échec du libéralisme qu’avait constitué aux yeux de certains sociaux-démocrates la Deuxième Guerre mondiale offrait l’occasion, dans l’après-guerre, d’une «réorganisation économique et sociale dans un sens socialiste»; le problème était de savoir quelles devaient en être les limites géographiques.
Concernant la France, la perception de l’accélération du phénomène de décolonisation après 1945 se greffa sur un passif qui remontait à l’entre-deux-guerres, lorsqu’en 1936 le Parlement français avait refusé de ratifier les accords signés par le gouvernement en vue de la levée du mandat que la SDN avait accordé à la France sur le Levant, la Syrie et le Liban; on sait que cette indépendance ne fut accordée par la France que le 8 juillet 1945 sous la pression britannique, ce qui fit peser d’emblée sur la France une image de mauvais décolonisateur. Cette réputation s’accrut en particulier aux yeux des sociaux-démocrates allemands avec les difficultés rencontrées en Indochine ou en Afrique en raison de la parcimonie avec laquelle Paris faisait droit aux aspirations locales et, au moins autant, en raison d’événements violents qui jalonnèrent les années d’après-guerre. Au nombre des réponses inadéquates apportées par la Quatrième République aux mouvements indépendantistes, rappelons par exemple le viol des accords du 6 mars 1946 (signés avec la République démocratique du Viêt Nam nouvellement proclamée par Hô Chi Minh), la répression de la révolte malgache en 1947 ou, plus généralement, le faux-semblant de fédéralisme qu’impliquait l’Union française; parmi les événements sanglants, souvenons-nous de la répression de mai 1945 après les soulèvements de Bône, Guelma et Sétif. Ces événements ne marquèrent certes que modérément les esprits en République fédérale dans un premier temps, mais une partie de la presse proche du SPD et des «porteurs de valises» allemands s’empressèrent de les rappeler au milieu des années cinquante, inscrivant la répression française en Algérie dans une longue tradition et lui déniant ainsi, contrairement à ce qu’avait permis le même argument à propos de Mendès France, tout caractère contextuel.
Depuis le tournant du XXe siècle, les ambiguïtés coloniales du SPD s’inscrivaient dans le flou de conceptions de politique étrangère qui oscillaient entre le pacifisme antimilitariste de Wilhelm Liebknecht et la séduction des idées expansionnistes à laquelle succombaient le marxiste orthodoxe Heinrich Cunow, rédacteur à la Neue Zeit puis au Vorwärts, ou le révisionniste Max Schippel; des revers tels que celui des élections de 1907, au lendemain du soulèvement du sud-ouest africain, ne l’avaient pas incité à définir des positions univoques. Dès 1895, August Bebel n’avait pu imposer un débat de fond et arrêter une ligne hostile à la colonisation qu’à la faveur des excès de fonctionnaires allemands en Afrique. On n’avait pas échappé aux équivoques lors des débats sur les crédits de la marine à vapeur ou sur les troubles d’Herrero, à l’occasion desquels les avantages possibles pour la classe ouvrière allemande l’avaient emporté sur les préoccupations philanthropiques: la lutte des peuples colonisés n’était pas assimilée à celle du prolétariat européen. Le groupe parlementaire n’avait pu se résigner à faire siennes les idées du Français Paul Louis (fin du XIXe siècle) en faveur d’une solidarité de tous les opprimés indépendamment de leur race, à plaider le droit des peuples colonisés à l’autodétermination, ni à condamner unanimement le droit des colons à l’autodéfense77. Lors de la crise d’Agadir, en 1911, Hermann Molkenbuhr avait rejeté la proposition de l’Internationale de réunir une conférence sociale-démocrate et Bebel l’avait couvert lors du congrès d’Iéna, face à Rosa Luxemburg. En dépit de ces flottements, jusqu’en 1914, le parti avait adopté au Reichstag une position d’hostilité au colonialisme. Ses représentants avaient même été les seuls adversaires de l’entreprise coloniale allemande après la mort du créateur de la Freisinnige Zeitung, Eugen Richter, en 1907 et le revirement des libéraux de gauche de la Freisinnige Partei.
À diverses reprises, sous Weimar, dans le cadre de la contestation du traité de Versailles, le SPD avait réclamé la restitution à l’Allemagne de ses colonies. Des figures de proue du parti telles que le chancelier Hermann Müller avaient adopté une attitude qui portait à faux par rapport à la générosité de leur idéologie, estimant que, dès lors que l’Allemagne n’était pas en mesure de procéder aux investissements susceptibles de rentabiliser ses possessions coloniales, mieux valait soutenir les peuples colonisés au sein de la SDN dans l’espoir d’en tirer quelque bénéfice commercial. Seule l’USPD s’était montrée fidèle aux principes du socialisme. Les soubresauts du colonialisme qui avaient suivi la Deuxième Guerre mondiale n’avaient pas provoqué de réflexion idéologique approfondie; le parti avait privilégié les réactions contextuelles, ce qui le conduisit à prendre position sur les symptômes, pas sur le mal, comme allait encore le montrer sa réaction au revirement de Guy Mollet en février 1956.
L’ordre du jour du congrès de l’Internationale socialiste de Milan d’octobre 1952 («socialist policy for the underdeveloped areas in the world») aurait dû l’amener à préciser ses vues; Julius Braunthal, secrétaire de l’Internationale, lui adressa une demande de contribution – à laquelle le Parteivorstand renonça à donner suite, arguant de son incapacité à produire un tel document, et il fallut attendre 1955 pour observer la première initiative parlementaire sociale-démocrate en vue d’inciter la République fédérale à élaborer une politique d’aide aux régions sous-développées78. Bien que se situant par nature en marge de la question de la décolonisation, a fortiori de l’affaire d’une Algérie département français, ces éléments montrent à quel point les problèmes du colonialisme et du sous-développement restaient étrangers au SPD, l’importance des réparations que Bonn s’était engagée à verser à Israël – et le poids dont celles-ci pesaient sur le budget fédéral – ne suffisant pas à justifier son peu d’empressement. La situation n’évolua guère jusqu’au milieu des années cinquante: le tiers-monde n’appartenait pas à l’univers conceptuel d’un parti social-démocrate dont l’approche – spécialement en matière économique – demeurait largement germanocentrique. Les prises de position en faveur d’une solidarité internationale effective restaient en matière coloniale soit le fait de francs-tireurs (Willi Eichler, par exemple), soit pure gesticulation verbale. La guerre d’Algérie n’incita le SPD à réagir que parce qu’elle avait un caractère spectaculaire. Cet arrière-plan historique et idéologique, qui explique le ton souvent superficiel de ses analyses, devait sous-tendre quelques années plus tard l’engagement de membres du SPD et du DGB aux côtés du FLN.
Dans l’immédiat d’ailleurs, et dans la continuité de son attitude face à la question indochinoise, une partie du SPD s’en tenait au soutien à Paris; le Pressedienst du 14 octobre 1955 marqua ses distances par rapport à l’autonomie: «Le détachement de la France créerait-il des emplois? Le riche sol produirait-il davantage de minerai de fer, voire du pétrole? La misère sociale disparaîtrait-elle?»
Plus rares étaient les voix qui soulignaient les manquements français, celui en particulier de n’avoir su tirer les leçons ni de son propre passé colonial, ni du modèle britannique. Quelles qu’en fussent les faiblesses, celui-ci apparaissait généralement d’autant plus adapté à la recherche d’une solution aux problèmes que soulevait l’aspiration à l’autonomie, depuis l’indépendance de l’Inde en 1947, que la perte de sa puissance était ressentie en France comme un affront politique – sentiment qui suscita des réflexes nationalistes jugés inquiétants par la sociale-démocratie allemande. Rolf Reventlow relativisait toutefois ce jugement: alors que la présence économique britannique s’appuyait sur quelques autochtones et un nombre restreint de représentants de la puissance coloniale, l’essentiel des fonctions subalternes étant assumé par des autochtones, le système français était fondé sur la répartition des responsabilités entre un nombre important d’Européens, ce qui faisait de 10% de la population les détenteurs de la quasi-totalité du pouvoir et privait le territoire de ces élites indispensables à la recherche d’une issue au conflit. Qui plus est, ces mêmes Européens étaient très majoritairement enclins à mépriser les mouvements politiques locaux, soutenus en cela sur place par une législation et des pratiques politiques à deux vitesses, et en métropole par une soixantaine de députés intransigeants qui n’avaient pour souci que d’empêcher la prise de décisions opportunes à Paris: «Il y a cinq ou six ans, Hô Chi Minh lui aussi aurait approuvé une autonomie au sein de l’Union française. Les kadis des communes algériennes ni les cheiks berbères ne sauveront davantage la France en Afrique du Nord que ne l’a fait Bao Daï en Indochine79.» Aussi Reventlow préconisait-il l’ouverture de négociations avec le nationalisme algérien tout en reconnaissant la difficulté qu’il y avait à trouver des interlocuteurs représentatifs en l’absence d’un mouvement national moderne comparable à celui que connaissait la Tunisie et qui y avait largement contribué à l’élaboration d’un compromis; il jugeait les partisans de Ferhat Abbas trop peu nombreux et les messalistes, qui étaient en relation avec les rebelles, inacceptables pour Paris, leur leader étant emprisonné en métropole80.
Ce point faisait l’objet d’un certain consensus au SPD, Walter Blasig recommandant dans Vorwärts du 25 septembre d’accorder l’autogestion aux peuples coloniaux même quand les représentants de l’autonomisme n’étaient pas des plus recommandables, par exemple lorsque leurs sentiments démocratiques étaient douteux.
L’Afrique du Nord participa à la conférence de Bandoeng d’avril 1955 en qualité d’observatrice, représentée par une délégation conduite par Salah Ben Youssef dont la présence marquait une internationalisation du conflit. Celle-ci se confirma lorsque, le 29 juillet, les délégués de treize pays d’Afrique et d’Asie demandèrent l’inscription de la question algérienne à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies. Le Comité de l’ONU se prononça défavorablement le 22 septembre, mais l’Assemblée elle-même opta de justesse pour un débat; ce même jour, le 30 septembre, le ministre français des Affaires étrangères, Antoine Pinay, quitta la salle: l’Algérie était une affaire intérieure pour la France qui resta éloignée de l’ONU jusqu’au 24 novembre. Cet épisode ouvrit un débat international vigoureux, dans lequel le socialiste français Jules Moch lança un argument qui fut largement repris le 5 octobre, tant par le New York Times que par la National-Zeitung de Bâle et, en Allemagne, par la Süddeutsche Zeitung ou par l’essentiel des médias proches du SPD: la décision de l’ONU était le fait d’États dont certains connaissaient encore l’esclavage. Pour la presse occidentale qui dénonçait largement le vote du 30 septembre, cet argument permettait de convertir en mise en accusation le coup médiatique qu’avaient tenté les États afro-asiatiques. Toutefois, alors que le gouvernement fédéral interprétait l’attitude des non-alignés comme un danger pour la France, le vote de septembre assit au SPD la conviction naissante que le poids des États de Bandoeng pourrait s’avérer décisif si l’ONU devait être appelée à se prononcer sur la question de l’unité allemande; en arrière-plan de l’appréhension de l’affaire algérienne, on trouve trace occasionnellement de cette conception qui devait prendre corps peu à peu. Le tiers-monde était considéré par les sociaux-démocrates comme un ensemble de «nations prolétaires81» en devenir et comme un groupe de pression émergeant mais déjà efficace; s’il ne voyait guère dans le thème du neutralisme une quête d’identité d’États en construction, il plaçait quelque espoir dans le refus qu’impliquait le non-alignement de la suprématie des deux blocs et de l’option en faveur de l’un ou de l’autre. Qu’il en résultât quelques inconvénients pour la France était le prix des espoirs que cette nouvelle donnée internationale autorisait pour une solution du problème allemand.
Si la Neue Rhein Zeitung avait souligné la propension de la droite et de la gauche françaises à se rassembler dès qu’une vexation atteignait le pays, le SPD-Pressedienst prit position le 14: rappelant que le coup entrepris à l’ONU par l’Égypte et les pays arabes avait réussi avec l’aide de l’URSS, l’organe socialiste invita les États qui avaient voté favorablement à balayer devant leur porte :
«L’enjeu est-il vraiment les droits de l’Homme pour les États arabes qui ont porté plainte auprès de l’ONU? […] Ne s’agit-il pas plutôt pour eux d’exprimer une aspiration à un pouvoir qui, en l’occurrence, n’est même pas identifiable à une lutte acceptable contre un colonialisme dépassé?»
Le soutien que le parti social-démocrate apportait à la France montrait donc qu’il souscrivait à la
"Entre 1954 et 1963 la République fédérale d’Allemagne a connu une période de mutations importantes sur fond de tensions internationales. La guerre d’Algérie y fut perçue comme une menace pour ses relations avec la France: alors que Paris exerçait de fortes pressions afin d’obtenir une solidarité sans faille, Bonn se trouva progressivement exposée à celles des États arabes, éléments de sa politique et de son commerce extérieurs. La marge de manœuvre de Konrad Adenauer était d’autant plus étroite que la RFA ne pouvait apparaître comme un suppôt du colonialisme quand la RDA apportait aux Algériens un soutien spectaculaire apprécié du tiers-monde.
L’arrivée d’Algériens sur son territoire multiplia les problèmes: des Allemands s’engagèrent en faveur de l’indépendance, des incidents se produisirent, le territoire devint une plaque tournante du trafic d’armes à destination de l’ALN, le nombre important d’Allemands dans la Légion étrangère créait une insatisfaction chronique…
Largement répercutés par les médias, divers incidents, dont les agissements de Main Rouge, les arraisonnements répétés de navires allemands par la Royale, perçus comme un terrorisme d’État et une atteinte à la souveraineté, finirent par discréditer la cause française dans l’opinion, situation que n’améliora pas l’arrivée de membres de l’OAS.
Adenauer se trouva contraint de louvoyer. En dépit de la crise de Berlin, Bonn évolua d’une priorité française évidente vers une position plus équilibrée – ce qui ne fut possible qu’à travers une répartition des tâches entre gouvernement et parlementaires, y compris de l’opposition.
Jean-Paul Cahn est professeur à l’université de Paris XII. Klaus-Jürgen Müller, docteur honoris causa, ancien président du Comité des historiens franco-allemands, est professeur émérite des universités de Hambourg et de la Bundeswehr.