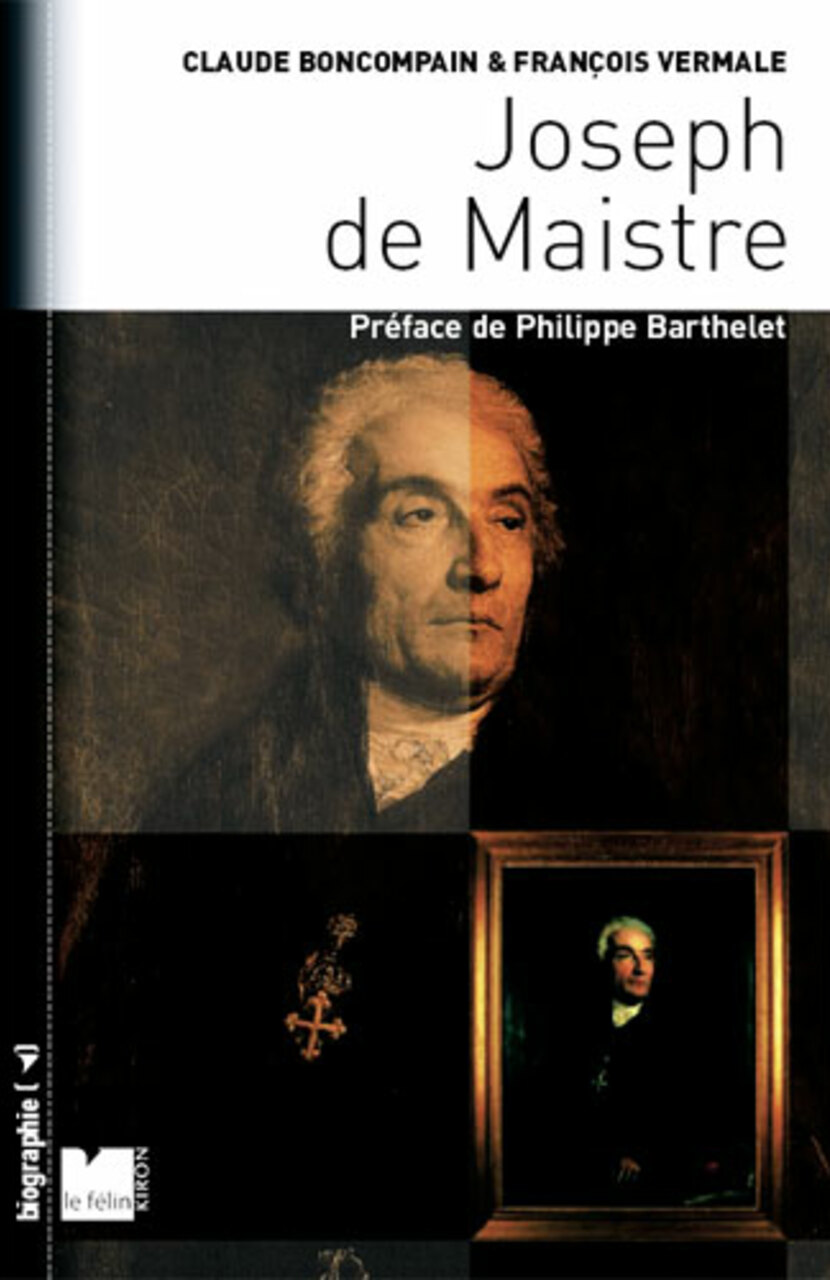
Joseph de Maistre
Un Allobroge né en 1753
Les origines savoisiennes
Du temps que Jean-Jacques Rousseau menait aux Charmettes une vie délicieuse mais obscure, en la compagnie de sa chère « maman », Mme de Warens, un tout petit événement se produisit dans la ville voisine, Chambéry. S’il suscita un peu de curiosité, ce ne fut que dans quelques austères salons de hauts fonctionnaires : on accueillait un nouveau sénateur, François Xavier Maistre.
Voici ce que purent avancer les mieux informés : il était célibataire et d’ascendance bourgeoise. Sa famille résidait à Nice depuis des lustres et s’y livrait au commerce des draps, ayant même fourni un syndic en 1708, dans la personne d’André Maistre, lequel amassa d’assez grands biens tout en se plaignant que ses clients le payassent mal. Le fonds de commerce s’était transmis jusqu’à François Xavier qui, réalisant sans doute les aspirations des siens et quittant la boutique, avait fait son droit et s’était établi avocat à Nice en 1729. De là, il visa à la magistrature et devint en 1730 « substitut de l’avocat général fiscal ». Il recueillit l’héritage d’un de ses frères qui était prêtre, de deux sœurs célibataires et, le vent bien en poupe, fut appelé en 1740 à siéger au sénat de Savoie.
Chambéry, malgré son titre de capitale ducale, n’était qu’un gros bourg agricole. Le procès était sa principale industrie et, avec la garnison, sa grande source de revenus. Les ducs, sûrs d’étendre mieux leur domaine sur l’Italie que sur la France, lui avaient préféré la résidence de Turin. Un intendant général sans prestige représentait le pouvoir et transmettait les ordres ministériels aux fonctionnaires. La noblesse savoisienne, pour avoir bien accueilli l’occupation française sous Louis XIV, était systématiquement écartée des hauts emplois et boudait l’administration piémontaise. Un certain renfrogné marquait donc cette société où, cependant, les sénateurs se distinguaient encore par la rigueur de leur conduite, leur vie laborieuse et retirée. Ce sénat n’était qu’une cour souveraine de justice, sans aucun rôle politique. Il jugeait en dernière instance mais n’avait pas à enregistrer les édits royaux. Ses membres n’étaient pas propriétaires de leurs charges. Simples fonctionnaires nommés par le roi et par lui révocables, ils recevaient un traitement mensuel.
Bien en avance sur la nôtre, la monarchie de Piémont-Sardaigne accomplissait alors d’immenses réformes, établissait pour asseoir l’impôt foncier un « cadastre » exact, rédigeait des codes judiciaires destinés à remplacer les anciens coutumiers, et s’apprêtait à abolir tous les privilèges féodaux. Une immense besogne administrative et juridique était en cours. Les hommes de robe studieux et retirés pouvaient aspirer aux plus grandes dignités dans un gouvernement où la supériorité de l’esprit prévalait sur la naissance. François Xavier Maistre appartenait donc à un corps très respecté. Ses fonctions l’absorbaient et il allait s’y consacrer avec un grand sens du devoir. De naturel solitaire et sévère, il demeura dix ans encore célibataire et c’est à l’âge de quarante-quatre ans qu’il rencontra Christine Demotz qui en avait vingt de moins. Elle lui plut au point qu’il demanda sa main. Son père, magistrat honoraire, était inscrit au « rôle » de la noblesse en Bugey comme « écuyer ». Le Bugey est riche pays, dont la chère savoureuse a formé le palais de Brillat-Savarin. La jeune femme apportera dans son foyer lumière et paix. C’est un être de douceur, de piété, mais qui ne méprise point le bien-vivre. Son goût paraît juste et solide. Elle sera capable d’assurer à ses enfants les bons soins qui leur feront une santé robuste et, le soir, de leur lire une tragédie de Racine. Elle élèvera cinq filles et cinq garçons. L’aîné sera Joseph de Maistre.
Au moment où celui-ci va naître, voici que nous sommes frappés par le souvenir d’un autre écri¬vain dont nous avons raconté la vie : Stendhal 1. Ces deux hommes, d’esprits si opposés, se présentent à nous dans des circonstances pleines d’analogies. Dans l’une et l’autre lignée, c’est par un effort récent que l’on vient d’échapper au négoce pour ac¬céder à la procédure. Secrètement, on aspire à la no¬blesse par la robe. Chérubin Beyle et François Xavier Maistre sont deux hommes profondément religieux, d’abord moroses, appliqués à leurs affaires, et qui ont passé la quarantaine avant d’épouser deux jeunes filles séduisantes. Les deux enfances seront entourées de gens graves et âgés, éclairées par le jeune sourire maternel. Fortunes et rangs dans la société s’équiva¬lent ; les modes de vie sont identiques. Rue des Vieux-Jésuites à Grenoble, chez les Beyle, la maison est plus sombre, plus humide que l’ancien hôtel de Salins loué par les Maistre à Chambéry, et qui donne sur la claire place de Lans où chante une fontaine. Mais on passe l’été à la campagne. Les Beyle vont à Furonnières, les Maistre à La Trousse, beau domaine situé dans la plaine de la Madeleine, à la sortie de la ville ; début octobre on s’en revient rapportant à pleines voiturées les provisions d’hiver qui vont remplir, au rez-de-chaussée de la maison de ville, les saloirs, le cellier, les fruitiers et les caves. On a quasiment le même domestique et chaque semaine les fermiers envahissent les cuisines. On les reçoit avec simplicité. Toutefois, pour Henri Beyle, cette harmonie familiale et l’unité du milieu se briseront dès sa huitième année. Il en recevra une inguérissable blessure. Sa sensibilité vive en sera meurtrie. Il ne tardera guère à s’insurger contre ce qui l’entoure et l’enferme. Il demeurera toute sa vie divisé contre lui-même.
Joseph de Maistre au contraire, personnalité raisonnable et monolithique, restera jusqu’au bout fi¬dèle à ses origines. Il faut souligner en outre que de Savoie à Dauphiné, tout s’oppose. Grenoble et Cham¬béry pourraient aligner autant de juristes, de mili¬taires et de salons. Mais l’esprit frondeur des par¬lementaires dauphinois, leur agitation, leurs prétentions contrastent parfaitement avec le loyalisme du sénat de Savoie. Un Choderlos de Laclos, incorporé dans l’armée sarde, soumis à une discipline quasi prussienne n’au¬rait jamais eu le goût d’écrire Les Liaisons dangereuses non plus qu’il n’en eût trouvé autour de lui les modèles. Traits par traits contrastent l’acerbe du Dauphinois, son opposition innée, son terre à terre, au regard de la fidélité savoyarde, de son unité reli¬gieuse, de son mysticisme modéré. D’une part Condillac et Mably, de l’autre saint François de Sales. Beyle et Joseph de Maistre illustreront deux versants opposés de l’esprit : l’idéologue et le traditionaliste. Il est vrai que trente années tout juste les séparent au cours desquelles ne fera que se préciser l’antagonisme de deux forces irréconciliables.
Joseph de Maistre vient au monde en 1753 et grandit dans un milieu soumis à des habitudes régulières. La vie lui apparaît dès ses premières années bien prise en son cadre et sans dissonance. La loi fondamentale est celle du travail. Précocement il a été, écrira-t-il, « abîmé dans les études sérieuses ». Il échappe cependant au morne régime de l’internat. Le « collège royal » qu’il fréquente a été dirigé autrefois par les jésuites. En 1730, Victor-Amédée II leur a re¬tiré l’enseignement public sans les chasser de ses États. Ils sont restés comme professeurs libres. Les Maistre ont de grands amis dans la Compagnie et chargent les pères de compléter l’éducation officielle que reçoivent leurs enfants. Dans la jeune monarchie sarde, tout semble tiré au cordeau. Le roi nomme les profes¬seurs ; un magistrat du sénat contrôle l’enseignement et la régularité des études. Le jeune Joseph remporte vite des succès scolaires assez brillants pour que la jalousie les attribue à la faveur que lui vaudrait la situation de son père. Mais ses condisciples témoigneront plus tard qu’il dominait sa promotion. Il est pieux, certes, comme tous les siens. Ses parents appartiennent à des confréries religieuses et lui-même, dès sa dixième année, est inscrit à celle des « Pénitents noirs » que préside son grand-père Demotz. Sous une cagoule, ceux-ci assistent les condamnés à mort durant la nuit qui précède l’exécution, les accompa¬gnent à l’échafaud et assurent leur inhumation. Ils visitent aussi les prisonniers, leur apportant une aide religieuse et morale autant que matérielle. De telles images où la rigueur des lois se soutient d’un sombre appareil religieux sont bien faites pour frapper une imagination toute fraîche. Lorsqu’il se promène sur la route des Échelles après la Porte-Reine 1, le jeune homme passe devant la maison de l’exécuteur située en face du château ducal, au bas de la chapelle Saint-Sébastien qu’entoure un étroit cimetière. Cette demeure, très humble, ne suscite point d’horreur. Nulle malédiction ne l’entoure et on se tromperait en voyant un souvenir dans ce personnage mythique qui apparaîtra aux premières pages des Soirées de Saint-Pétersbourg faisant tournoyer une barre de fer pour briser les membres du condamné lié à la roue. Car la justice savoisienne est bien plus humaine que la nôtre. Tandis que les Français se pressent pour voir des condamnés martyrisés, « n’existant plus que par la douleur » et « prolongeant leur agonie d’un soleil à l’autre », elle abrège leurs souffrances. Le supplice de la roue n’est appliqué que très rarement et d’une façon plutôt symbolique puisque les membres du coupable ne sont rompus qu’après qu’il a expiré.
Les Maistre représentent une famille patriar¬cale, modeste dans ses ressources bien qu’assez en vue et surtout étroitement unie. Sur quinze enfants, cinq meurent en bas âge ; les dix autres constituent une « petite république » qui accepte dans ses jeux puis dans ses études la direction de l’aîné. Parmi les garçons, François Marie sera plus tard colonel au ré¬giment de Savoie ; André évêque d’Aoste et le petit Xavier, de dix ans plus jeune que Joseph, présentera très tôt avec ce dernier le plus parfait contraste, par sa nature rêveuse, sa fantaisie, son penchant à la flânerie. Mais ces divergences de tempérament ne nuisent point à une profonde entente. « Je suis aimé de tout ce qui m’environne et tu penses que je ne suis pas un ingrat », écrit Joseph. Plus tard, en Russie, songeant à ces heureux temps, il en aura le cœur tout rafraîchi. Il progresse très vite dans la connaissance du grec, du latin, de nos classiques. Son application est soutenue par une de ces prodigieuses mémoires à la Retz, à la Chateaubriand, qui lui permet d’apprendre du jour au lendemain tout un chant de L’Éneide.
À quinze ans, il a terminé le cycle des études secondaires. Personne ne se pose de question au sujet de son avenir. Il a été dès sa naissance voué au droit, par décret familial. Ainsi, son grand-père, mourant à cette époque, choisit parmi ses biens, pour les lui transmettre, tous les accessoires nécessaires à sa future carrière, pour la servir et pour en rehausser la dignité : « Je lègue à mon très cher petit-fils et filleul Joseph Marie Maistre, tous les livres de ma bibliothèque, tant de droit qu’autres, en quoy ils consistent, compris les étagères, grande table et petite bibliothèque à porte grillée qui sont à présent dans mon arrière cabinet (sauf les trois volumes de Vanespin que je lègue à mon cher neveu, l’avocat Charles Fortis), le corps de droit à gloses de Godefroy dont je me sers, de même que ma petite épée à manche et poignée d’argent. Léguant de plus à mon dit petit¬-fils, deux grands flambeaux d’argent, mouchettes et porte mouchettes assortissantes, mon flacon et mon bougeoir aussi d’argent, la montre que j’auray et ma canne ordinaire. »
Depuis Victor-Amédée II, Turin est dotée d’une université avec internat appelée « Collège des provinces » et les étudiants piémontais ou savoyards doivent en suivre les cours alors que leurs prédéces¬seurs avaient la liberté de s’inscrire dans les gran¬des universités italiennes. Ainsi, saint François de Sales étudia-t-il à Padoue. Au-delà du droit romain et du droit canon, les droits civil, administratif et pénal sont simplifiés du fait que le despote éclairé de Sardaigne a édicté un Code fort précis et impératif, alors que les juridictions françaises se noient dans les diverses coutumes. Les « royales constitutions », publiées en 1723, règlent dans leur premier livre les problèmes de la religion et du culte. On est gallican en ce sens que les évêques ne sont nommés que sur proposition du roi. Le catholicisme est seul reconnu. Dans leurs autres livres, les « royales constitutions » traitent de la compétence et des devoirs des magistrats comme des fonctionnaires, de la procédure, des droits féodaux, des justices seigneuriales, des mines, routes, forêts, douanes et enfin gabelles, lesquelles sont établies non d’après les foyers, ainsi qu’en France, mais plus équitablement selon les biens.
La discipline du Collège des provinces est aussi tendue que celle d’une caserne. Joseph de Maistre continue à accumuler rapidement les connaissances. En 1771, le voici licencié et, l’année suivante, à dix-neuf ans, docteur. Il revient alors à Chambéry pour effectuer un stage de deux ans dans les bureaux de « l’avocat des pauvres », chargé de surveiller l’assistance judiciaire. Cette remarquable institution d’État assure aux plus misérables la possibilité de plaider pour la défense de leurs droits.
Comme il achevait ce stage, sa mère mourut, le 21 juillet 1774, à l’âge de quarante-six ans, sans doute de la rougeole qu’elle avait contractée en allant voir et soigner Xavier atteint de cette maladie chez M. le curé de la Bauche où il était en pension. Sa sœur qui l’avait accompagnée dans ce voyage, mourut huit jours après elle. Quatre mois avant, elle avait réglé le détail de ses funérailles auxquelles ne devait assister que la « confrérie de Sainte-Élizabeth ».
À lire les lettres par lesquelles François Xavier Maistre apprend à son second fils, Nicolas, alors of¬ficier d’infanterie à Pignerol et à sa fille aînée qui est à Novalaise, le deuil qui l’éprouve, on est frappé par le ton de soumission totale à la Providence. Beaucoup de gens parlent de la volonté de Dieu, mais bien peu accordent leur vie à ce gouvernement souve¬rain de toutes choses. Ce « providentialisme » paternel se retrouvera plus tard, et combien magnifié, sous la plume du polémiste, face à la Révolution.
Entrée dans la magistrature
Cette même année 1774, tandis que François Xavier Maistre accède à la seconde présidence du sénat, son fils Joseph entre dans la magistrature. Il est le plus jeune des magistrats royaux et on conçoit qu’il en manifeste quelque fierté. Il a vingt et un ans. Il vient de remporter en même temps un autre succès dont il ne parle pas : il a été élu grand orateur de la maîtresse loge des « Trois Mortiers » à Chambéry, tandis que le comte Salteur de la Serraz accédait au grade de « premier surveillant ».
Fils d’un premier président au sénat de Savoie, Salteur est l’intime ami de Joseph de Maistre. Avec un troisième étudiant, le chevalier Roze, ils forment un groupe très uni et c’est ensemble, sans doute, qu’ils ont été initiés à la franc-maçonnerie. Nous ignorons tout des premiers motifs qui ont poussé de Maistre vers cette société, comme des personnages qui l’y ont introduit. Peut-être tout simplement a-t-il obéi à l’ambition. La loge de Turin compte parmi ses membres le prince héritier et de nombreux dignitaires de la cour. Les dames de l’aristocratie se groupent en des loges parallèles tout comme les officiers en des fra¬ternités militaires. Un futur sénateur ne peut être en meilleure compagnie. Sans doute, la franc-maçonnerie a-t-elle été condamnée par le Saint-Siège, en 1738 et en 1751, mais les « bulles pontificales » n’ont pas été enregistrées par le royaume de Sardaigne et restent sans effet sur son territoire. Dans l’esprit gallican, de l’époque, l’évêque de Rome jouissait d’une autorité fort restreinte. Ce sentiment fut renforcé en 1773, par l’ordre de dissolution des jésuites. La confrérie de l’Assomption à laquelle appartenait Joseph de Maistre et que dirigeaient les pères fut dispersée. L’ingratitude du pape envers ses plus fidèles serviteurs achevait de déconsidérer ses décrets. Ainsi trou¬vait-on dans la franc-maçonnerie des catholiques fervents et même des ecclésiastiques. La loge des « Trois Mortiers » de Turin dépendait de la « grande maîtresse loge de Chambéry ». Elle avait été fondée par Joseph François de Bellegarde, marquis des Marches, gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté. Il tenait ses pouvoirs de Londres. Les « Trois Mortiers » étaient donc d’obédience anglaise. À Chambéry, on comptait quelque cent vingt cotisants, nobles pour la plupart, complétés par des fonctionnaires, des médecins et des avocats.
Tout jeune encore, Joseph de Maistre possédait donc déjà une tribune et un auditoire influent. Son passage dans la franc-maçonnerie a exercé une influence déterminante sur toute sa pensée. Malgré son souci d’orthodoxie catholique, il y a acquis une connaissance approfondie des doctrines ésotériques, théosophiques et illuministes. Il a essayé aussi d’agir, sur les événements et les idées, par les loges, avant de lutter à visage découvert, et c’est pour un convent qu’il a rédigé le premier document où sa personnalité s’impose. Enfin, il a été, par les sociétés secrètes, précocement informé des grands mouvements d’idées qui traversaient l’Europe et, tout provincial encore, il s’est accoutumé à embrasser du regard les vastes horizons internationaux. Ceux qui, alors, le regardaient vivre n’étaient frappés que de sa surprenante aptitude au travail, de la régularité de ses habitudes. « Il avait, nous dit Sainte-Beuve, une table ou un fauteuil tour¬nant : on lui servait à dîner sans que souvent il lâchât le livre, puis, le dîner dépêché, il faisait demi-tour et continuait le travail interrompu. N’oublions pas, comme trait bien essentiel, qu’à quelque heure et dans quelque circonstance qu’une personne de sa famille entrât, elle le trouvait toujours heureux du dérangement ou plutôt non pas même dérangé, mais bon, affec¬tueux et souriant. » Nous savons aujourd’hui (ce qu’ont ignoré les siens puis, pendant de longues années, ceux qui ont essayé de dessiner son vrai visage) que cette existence extérieure se doublait d’une vie clandestine et qu’il a vécu intensément l’aventure maçonnique. Pour éclairer celle-ci, force nous est de jeter un long coup d’œil en arrière.
La maçonnerie au XVIIIe siècle
Que fut exactement la maçonnerie au XVIIIe siècle ? La réponse à une telle question apparaît ex¬trêmement complexe dès les premières images qu’elle évoque et où se coudoient des aventuriers tels que Cagliostro, Casanova, Saint-Germain, Mesmer, avec de purs mystiques à la Willermoz, à la Saint-Martin. Selon les années, selon les pays, fluctuent profondément non seulement les rites, le pittoresque des attributs, des grades, des titres, mais aussi les idées, le message fondamental des sociétés sœurs et rivales, si bien que les systèmes les plus opposés des positions radicalement ennemies s’abritent sous les mêmes emblèmes.
Créée en 1740, la loge des « Trois Mortiers », à Chambéry, la plus ancienne et « la mère de toutes les loges de province », se rattachait à Londres et représentait la maçonnerie orthodoxe officielle.
Les loges anglaises ou de rite bleu avaient reçu leur organisation à Londres de 1717 à 1725. Elles étaient moins une société secrète au sens propre de ce mot qu’une fédération de clubs dont les membres possédaient des signes de reconnaissance soigneusement cachés aux profanes et célébraient des cérémonies con¬nues des seuls initiés… Le mystère qui enveloppait ces assemblées excitait la curiosité des amateurs d’inconnu et l’humanitarisme sentimental dont elles faisaient profession attirait les « cœurs sensibles » qui, dès cette époque, commençaient à battre d’une façon désordonnée. Le culte de la fraternité était célébré surtout par des phrases et par des banquets copieusement arrosés.
Il y avait, dans les loges anglaises, trois grades : apprenti, compagnon, maître, en partie imités des degrés usités dans les corporations médiévales, en partie enrichis d’additions dont l’origine et la signification sont restées assez obscures.
Le grade de maître, notamment, rappelait une légende, forgée de toutes pièces, qui racontait le meur¬tre d’Hiram, architecte du temple de Salomon, assassi¬né par trois compagnons rebelles et la découverte de son cadavre par les maîtres envoyés à sa recherche. La cérémonie de réception à ce grade mettait en scène ce récit apocryphe.
Quand le rite bleu pénétra en France grâce à l’anglomanie qui sévissait à Paris, les Français ajoutèrent d’autres grades « chevaleresques » qui assimilaient la franc-maçonnerie aux anciens ordres de chevalerie et dont les titulaires, nobles ou bourgeois, s’attri¬buaient en loge les plus hautes dignités de la société civile, et se paraient de belles décorations.
Les rites anglais et français pénétrèrent en Allemagne vers 1737. Le prince héritier de Prusse, futur Frédéric II, fut initié à Brunswick en 1738 par une délégation de la loge de Hambourg. Les loges allemandes qui se multiplièrent sous l’influence française, laquelle avait tant de force dans les mœurs et la littérature d’alors, furent fondées et peuplées par des nobles, sauf à Hambourg et Francfort. Frédéric II et les princes allemands qui suivaient son exemple paraissaient avec leurs grades dans les loges et les protégeaient. À la fin de la guerre de Sept Ans (1756-1763), appartenir à la franc-maçonnerie était une preuve de haute naissance.
En 1760, un officier français fait prisonnier à Rosbach, le marquis Gabriel de Lernais, créa, dans la loge « les Trois Globes » de Berlin, un chapitre nouveau de quatre hauts grades de chevalerie, appelé « chapitre de Clermont », du nom du comte de Clermont, grand maître de la franc-maçonnerie française.
Cependant, le fonds rationaliste et libéral de la franc-maçonnerie anglaise devait paraître extrêmement plat à des esprits allemands épris de mystère, agi¬tés par de vagues rêveries préromantiques. Si bien que l’initiation s’enrichit très vite d’un mélange fabuleux plein de résonances anciennes. Le goût des sciences qui marquait le siècle avait ramené l’attention sur les travaux des vieux alchimistes. Les « souffleurs » avaient rallumé leurs fourneaux. On reparlait des « rose-croix » et du « grand œuvre ». Les symboles maçonniques se confondaient avec les hié¬roglyphes alchimiques. Comme l’ordre des « Templiers » avait été suspecté jadis de devoir ses prodigieuses richesses à la transmutation de l’or, on se déclara héritier du « Temple ».
Or, autant qu’à ses connaissances sublimes, à sa richesse, à la vertu de ses adeptes, le Temple avait dû sa puissance à une organisation rigoureuse et secrète. Après la ruine de l’ordre par Philippe le Bel, les survivants s’étaient dispersés. Baudouin, neveu de Jacques Molay, le dernier grand maître, avait emporté les papiers et le trésor. Bon nombre de chevaliers avaient trouvé refuge en Écosse. On créa donc un grade important et nouveau : celui de « maître écossais » et on insinua peu à peu qu’une organisation hiérarchique de « supérieurs inconnus » couvrait toutes les loges, pour aboutir à un petit groupe, peut-être même à une tête unique dont on ne révélait point l’identité. Cet admirable édifice, plein de couleurs et de poésie, représenta l’apport original et diffus des loges allemandes. Mais il fut encore enrichi par des initiatives décidées.
Ainsi le baron de Hundt, conseiller intime de l’Électeur de Saxe et de l’impératrice Marie-Thérèse, gros propriétaire foncier dans la Haute-Lusace, entreprit en 1764 de perfectionner le système. Son but principal était de réunir les fonds nécessaires pour racheter les biens ayant autrefois appartenu aux « templiers » et dont les revenus seraient attribués aux membres du nouvel ordre.
De plus, il révéla à une assemblée de maçons que les Stuarts étaient les supérieurs inconnus de la franc-maçonnerie, et qu’à Paris il avait rencontré le prétendant, chef des jacobites écossais.
L’assemblée demeura réticente devant cette révélation et décida de laisser la question en suspens. Mais le premier point l’intéressa fort. Elle décida aussitôt de réformer la franc-maçonnerie bleue et de rédiger des rituels. Le nouvel ordre Templier serait nommé de la « Stricte Observance » pour indiquer qu’une discipline militaire allait régner dans ses rangs. Le rite anglais, jugé désormais corrompu et dégénéré, était désigné comme de « Late Observance ». Ces décisions furent englobées sous le vocable de « réforme écossaise ». On divisa l’Europe en neuf provinces, chacune de quatre diocèses et, pour la plus grande joie des promus, les chevaliers de tous grades furent dotés d’un nom latin, d’une devise et d’un blason.
Lors de sa réception, le candidat était revêtu successivement de toutes les pièces d’une armure et recevait à genoux les coups de plat d’épée sur les épaules. Mais la grande force de la « Stricte Observance » à ses débuts fut de poursuivre un but précis. Rejetant de la légende templière toute allusion aux sciences occultes, elle dirigeait l’attention de ses frères sur des objets plus pratiques et faisait luire à leurs yeux des avantages matériels qui ne pouvaient manquer de les séduire.
L’ordre envisagea de fonder une puissante société anonyme qui aurait, comme la Compagnie hollandaise des Indes, possédé de grandes richesses foncières. Ainsi les appellations désuètes de prieu¬rés, commanderies, préfectures auraient recouvert des domaines fort réels, acquis à beaux deniers comp¬tants et assurant aux initiés revenus et prébendes. Malheureusement, ce beau plan, économique et chevaleresque, échoua. On se rabattit donc sur le mythe et l’histoire. On reparla de « l’art royal » qui, bien avant les « templiers », avait procuré au roi Salomon des richesses immenses. Un certain regret se mêlait, sans doute, à ces évocations et la méfiance se ré¬veillait. Hundt n’ayant pu prouver que les Stuarts étaient bien les « supérieurs inconnus » fut déposé en 1775.
À un convent de la « Stricte Observance » qui se tint à Wiesbaden en août 1776, un certain baron de Gugomas, conseiller du gouvernement à Rastadt et membre de la loge templière de Cassel, raconta dans une circulaire que les moines catholiques et le pape étaient les vrais dépositaires des plus profonds secrets et qu’ils les lui avaient fait connaître : le véritable « ordre des Templiers » existait encore, mais il ne comprenait plus que quelques membres isolés qui travaillaient au « grand œuvre » ; trois d’entre eux résidaient auprès du Saint-Siège ; et lui-même, Gugomas, après un triple noviciat physique, moral et intellectuel, avait été fait chevalier par un « grand prêtre » délégué du Saint-Siège.
Ces extravagances rencontrèrent d’abord quelque scepticisme. Puis, à la réflexion, certains francs-maçons protestants en vinrent à se demander, avec in¬quiétude, s’ils n’étaient pas les dupes et les instruments inconscients des jésuites. Comment être sûrs que des chefs inconnus n’existaient pas et surtout qu’ils n’étaient pas catholiques ? Les jésuites, trom¬pant toute vigilance, n’avaient-ils pas affermi leur pouvoir en passant à la clandestinité ? On trouve ici à sa source une des innombrables légendes qu’a fait naître le secret autour de la franc-maçonnerie.
Un fait bien plus grave se produisit alors. Un pasteur initié, le franc-maçon Starck, prétendant vendre fort cher au « grand maître » certains parchemins mystérieux, fut éconduit et se vengea par une brochure dans laquelle il révélait au public l’histoire, l’or¬ganisation, les listes de membres de la « Stricte Ob¬servance », attaquant les chefs et laissant planer sur les buts de la société des suspicions graves. Une certaine panique s’ensuivit. Dans le but de dissiper toutes les incertitudes, le chef suprême décida, par circulaire du 12 septembre 1780, de convoquer un « convent général ».
Maistre dans la « Stricte Observance »
Ici apparaît Joseph de Maistre avec un « mémoire », admirable dans sa forme et d’une netteté de pensée qui dissipe d’un coup tant de brumes accumulées, tant d’équivoques et d’obscurités vo¬lontairement entretenues. Mais par quelles longues voies notre magistrat savoisien a-t-il été amené à s’adresser à « Son Altesse Sérénissime » Mgr le duc de Brunswick, à l’appeler son très cher « frère », et à lui soumettre un plan de réforme en douze points ? Il nous faut, pour l’expliquer, reprendre à son introduction en France la « Stricte Observance » et préciser la place que de Maistre y avait déjà prise. La « réforme écossaise » pénétra en France par Strasbourg qui reconstitua la « province de Bourgogne » et par Lyon qui devint le centre de la « province d’Auvergne ». Dans cette dernière ville, un riche marchand de soie du nom de Jean-Baptiste Willermoz acquit une grande influence par son inlassable activité et l’intense propagande qu’il faisait à ses idées. Sa pensée n’avait rien d’original ; il en avait emprunté l’es¬sentiel à un personnage mystérieux, juif d’origine, converti au catholicisme, venu peut-être du Portugal : Martinez de Pasqually. Auréolé d’une réputation de mage et de magicien, celui-ci prétendait communiquer avec Dieu par l’intermédiaire d’Adam et proposait à ses disciples des exercices qui rappelaient le yoga, avec position spéciale des membres, longues périodes de prière, évocation des esprits ou génies astraux. Martinez connut un grand succès dans la région de Bordeaux où Willermoz se rendit pour recueillir son enseignement en même temps qu’un jeune officier du régiment de Foix : Claude de Saint-Martin. Ces deux disciples suivirent le Portugais lorsqu’il créa dans la franc-maçonnerie une sorte d’Église ou d’ordre in¬térieur qu’il appela : « chevaliers élus Coens de l’Univers ». Puis Martinez disparut et on apprit qu’il était allé mourir à Saint-Domingue. Claude de Saint-Martin reprit ses théories, les débarrassa de leur formalisme, des invocations magiques, et constitua un corps de doctrine mystique d’une haute et pure qualité. Willermoz avait introduit « l’ordre des Coens » à Lyon et était devenu le chef d’un « rite bleu » déjà pénétré de martinisme lorsque la « réforme écossaise » fut apportée par un certain baron Weiler, représentant de Hundt. Ce propagandiste ardent préten¬dait avoir été armé chevalier du Temple à Rome, en 1743, par Lord Raleigh, dans l’église d’un couvent en présence de deux bénédictins. Il conquit Willermoz qui entraîna toute sa loge, et on tint de nombreuses séances pour initier les francs-maçons aux divers grades des « templiers ».
Cependant, Joseph de Maistre cumulait les titres dans la loge des « Trois Mortiers ». Grand orateur, substitut des généraux, il s’occupait des intérêts de ses francs-maçons et écrivait à Londres pour se plaindre des empiétements de Turin. Dans le fond de son cœur, il était cependant déçu et prêt à se détacher d’un mouvement qui, sous le secret de solennelles formules, lui était apparu parfaitement vide. Il jugeait la maçonnerie anglaise comme « un enfantillage », une occasion de banquets et de réu¬nions mondaines qui ne convenaient pas du tout à ses goûts. Et ses absences s’étaient multipliées à tel point qu’on lui avait envoyé une députation pour savoir s’il désirait être rayé des listes. C’est assez dire combien il était préparé à accueil¬lir un renouvellement. Or, voici qu’apparaît à Cham¬béry un lieutenant du fameux Hundt, l’Allemand Schubert, qui introduit la « réforme écossaise » et fonde une nouvelle loge : « la Parfaite Sincérité. » Joseph de Maistre abandonne alors le « rite anglais ». Quinze de ses frères le suivent. Les « Trois Mortiers » protestent avec véhémence, accusent les dissidents de céder à un bas intérêt (ce qui est une allusion au plan économique de Hundt) et vont se plaindre au « Grand Orient de France ». Vain tapage ! Les attraits de la « Stricte Observance » sont trop vifs ! Le mystère se renouvelle avec l’initiation templière. Salteur de la Serraz va suivre son ami. Le baron Weiler préside une séance ou l’on distribue les grades. Willermoz installe un chapitre de onze membres. La Serraz devient « préfet », Maistre « procureur ». On délimite l’étendue de la « préfecture ». On fixe à sept le nombre des « commanderies ». En séance, le « préfet » porte une cotte d’armes en fin cuir blanc doublé de taffetas rouge ; il revêt par-dessus le pallium de laine blanche à manches longues, blasonné d’une croix rouge. Son épée pend à un large ceinturon. Une ample chlamyde, à traîne agrafée au cou, accentue sa prestance, sans compter une croix rouge d’émail mise en cravate, et des bottes éperonnées.
Nullement ébloui par cet apparat, Joseph de Maistre n’attendra pas longtemps avant de poser des questions lourdes d’un gros bon sens : « Qu’est-ce qu’un chevalier créé aux bougies dans le fond d’un appartement et dont la dignité s’évapore dès qu’on ouvre la porte ? » Alors se prépare un « convent des Gaules » qui prendra des décisions fondamentales.
Cette assemblée des « provinces de Bourgogne et d’Auvergne » se tint en effet à Lyon du 25 novembre au 10 décembre 1778. La « Sincérité », par crainte de la police sarde, n’envoya pas de délégué mais se tint en relation régulière avec Willermoz dont cette réunion marqua le triomphe. En fait, la « Stricte Observance française » adhérait à travers le marchand de soie, chancelier de la province d’Auvergne, au martinisme. On ne reniait pas pour autant la fi¬liation templière qui fournissait plutôt les éléments du décor. Mais il était révélé l’existence d’une classe spéciale, à recrutement limité, astreinte à de nouveaux serments et qui se consa¬crerait à l’étude de vérités éternelles et cachées. Ses membres, les « profès », occupaient le « dernier gra¬de en France du régime rectifié » et le fruit de leurs travaux ne serait communiqué qu’à un petit nombre, à ceux qui auraient tenté déjà de soulever un coin du voile. Le collège des « profès » comptait à Chambéry quatre membres qui firent le voyage de Lyon « pour s’instruire à la source ». Ils reçurent des noms latins : de Maistre devint Josephus a Floribus, Salteur a Cane. Il se peut que de Maistre, déjà « chevalier de la Cité sainte », ait cumulé en outre le titre d’« élu Cohen » et ait été ainsi affilié comme membre actif du rite martiniste. Après une longue attente et bien des déceptions, voici qu’enfin al¬lait lui être proposé ce qu’il attendait : une somme d’idées, un enrichissement de connaissances, peut-¬être une doctrine inconnue. Hélas ! celle-ci lui pa¬rut d’abord plutôt évanescente. La vérité venait de Lyon.
Une lettre de J.-B. Willermoz, très longue et d’une fine écriture, datée du 2 juillet 1779, nous apprend que dans ce mois Joseph de Maistre reçut, à Chambéry, des documents maçonniques. Ils lui furent apportés et remis en main propre par un personnage considérable, le prévôt des marchands, Gaspard Guillaume de Savaron, préfet du « collège métropolitain des chevaliers grands profès ».
Ce message ultra-secret contenait un exemplaire « des instructions des grands profès et des statuts » ainsi que « le cahier de rituel » et de « l’instruction du noviciat ». Joseph de Maistre avait autorisation de les copier. Sa copie devait être ensuite certifiée conforme à l’original par les « grands profès » de Lyon.
Pour découvrir le sens des documents reçus, il fallait admettre du fond du cœur le dogme de l’existence de Dieu, de la spiritualité et de l’immortalité de l’homme. Il était recommandé une lec¬ture réfléchie et réitérée des récentes instructions secrètes et surtout de la dernière qui « ne contient pas un seul mot qui n’ait besoin d’être médité avec la plus grande attention ».
À peine reçus ces documents, Joseph de Maistre se mit avec zèle à les analyser. Au fur et à mesure qu’il avançait dans son étude, le nombre de ses objections augmentait et il ne les dissimula pas. Ainsi s’établit une bien curieuse correspondance entre les « supérieurs » lyonnais et ce « frère » savoisien qui, s’acharnant à comprendre, refusait de se payer de mots. En vain l’exhortait-on à se persuader de la vérité contenue dans les mandements reçus. « C’est le cœur qui décide et non la raison. La démonstration acquise par les efforts de l’esprit ne donnera jamais le sentiment, et le sentiment, au contraire peut conduire à la conviction de l’esprit », vaticine Willermoz. De Maistre demande des preuves et sa force logique est soutenue parfois d’une ironie sous-jacente qui a le don de blesser au vif les pontifes. On convient à la fin que les doutes du « profès » de Chambéry sont assez graves pour justifier une entrevue. Maistre propose une rencontre aux Échelles mais les Lyonnais éludent ce projet. Pour endoctriner à loisir le rétif, on l’invite à venir passer une semaine dans les loges lyonnaises. Son exemple risque en effet d’être contagieux : « Je vous trouve d’autant plus à plaindre dans cet état, sermonne Savaron, que je vous vois destitué de tout secours ; vos amis, par la confiance qu’ils ont en vous, ne vous en procurent aucun et, par une suite de cette même confiance, vos propres doutes viennent augmenter les leurs, de sorte que vous vous nuisez sans compensation satisfaisante. »
À travers ces pesantes formules transparaît la prudence d’un homme accoutumé à la psychologie des sectes. Willermoz et Savaron incarnent l’aspect pratique, extérieur, organique de la maçonnerie. Ils s’enferment dans un mesquin esprit de chapelle. Joseph de Maistre, avec ce mélange d’enthousiasme et de logique, de ferveur et d’analyse qui caractériseront toute son œuvre, va d’emblée à l’essentiel. Sur le plan des croyances comme dans le domaine de l’action, nous allons mesurer la dif¬férence de carrure entre ces hommes.
Des Lyonnais, le « profès » reçoit d’abord l’enseignement de Pasqually : Dieu est un, triple et quadruple, selon que l’on considère sa puissance et sa nature. Le monde physique a été créé après la révolte des esprits pour être la prison des pervers. La matière est d’essence trinaire, formée par la combinaison des trois éléments : sel, soufre et mer¬cure. Toute matière se résorbera finalement, amenant la disparition de tous les êtres du monde minéral, végétal et animal. Tous les êtres sont des esprits répartis en quatre classes, de plus en plus éloignées du centre divin selon que leur mission est plus temporelle et leur forme plus matérielle. Willermoz complète ces principes abscons par quel¬ques notions martinistes mais il est surtout attiré par les spéculations cabalistiques sur les nombres, par la symbolique maçonnique relative au temple de Salomon et par l’évocation des esprits astraux¬. On tombe avec lui promptement de la métaphysique dans l’occultisme. Plus tard, d’ailleurs, il se pas¬sionnera pour Mesmer, les fluides, le magnétisme, le somnambulisme.
Joseph de Maistre n’ignore pas ces expériences et ces évocations d’un monde intermédiaire entre les démons et les anges. Mais il s’en détourne, non sans en signaler les dangers. Quant au message des théosophes, il ne semble pas le prendre au sérieux. « Tout ce qu’ils disaient de vrai, écrira-t-il, n’é¬tait que le catéchisme recouvert de mots étranges. » Il aura beaucoup plus de respect pour Saint-Martin et pour la « voix intime » préconisée par ce dernier, accordant une importance essentielle à la « prière ». Il s’avancera durant des années dans cette recherche, à travers Swedenborg, Jakob Böhme, et la floraison surprenante d’écrits mystiques qui fait une contrepartie active à l’Encyclopédie. Dans l’immédiat, il observe avec attention, il réfléchit sur les dogmes obscurs dont on dispute dans les loges, et mène de véritables enquêtes sur les affirmations dont on se contente hâtivement. Quand on affirme que la franc-maçonnerie a repris le contenu des mystères d’Éleusis et de Memphis, il interroge tous les savants anglais, al¬lemands, français qui ont traité de cette question. Ainsi, lorsqu’en 1780 arrive à la « Parfaite Sincérité » la circulaire du prince de Brunswick, on peut ima¬giner que le cœur lui saute. Qui mieux que lui sau¬ra répondre aux questions posées dans ce document ? Nous avons relaté les événements qui avaient plongé dans une véritable anarchie la « Stricte Observance » en Allemagne (dont le dernier fut la trahison du pasteur Starck) et à la suite desquels les francs-maçons, méditant en leur particulier, devaient être amenés fatalement à s’interroger sur le fond même des pro¬blèmes : pourquoi se réunissaient-ils ? Quelle était la fin véritable et précise de leur société ? Enfin, d’où venait-elle ? Pour y trouver de pertinentes ré¬ponses, un convent général était convoqué à Wilhemsbad sous la présidence de Ferdinand de Brunswick-Lunebourg, oncle du vaincu de Valmy qui, brouillé avec Frédéric II, s’était retiré sur ses terres et consacrait ses aristocratiques loisirs à la maçonnerie. La « Parfaite Sincérité » envoya une motion collective. Mais le « grand profès », « chevalier de la Cité sainte » initié aux plus hauts secrets, était autrement qualifié pour saisir la portée générale du débat. Et d’un élan, avec une passion et une chaleur que reflète le mou¬vement du style, il rédigea un « Mémoire ». « En général, y peut-on lire, on désirerait bien vivement voir disparaître tous les mots qui ne signifient pas des choses. » Et d’appliquer aussitôt ce principe. Le bon sens, la simple logique soutiennent l’argumentation qui percute, frappe, rebondit et fait éclater en éclairs les évidences. Les « Supérieurs inconnus », l’origine templière, Éleusis et Memphis s’écroulent comme des châteaux de cartes, s’évanouissent comme des illusions. Que reste-il ? Une forme qu’il faut remplir, une matrice où peut germer un ordre nouveau. Il faut rebâtir. Intrépidement, le frère a Floribus s’en charge. Le futur diplomate, le politique et le philosophe se laissent entrevoir ici. De la structure purement extérieure des loges, il changera très peu. Les cérémonies, le serment, certaines complaisances flatteuses, les actes col¬lectifs de bienfaisance, il en sait le prix. Tout cela forme un cadre à l’intérieur duquel il enferme les vérités fondamentales, Dieu, l’âme, la vie fu¬ture, sans exclusion des autres vérités religieuses. Le premier grade se contentera de ces vérités simples. Qu’on lui accorde encore, si l’on veut, quelques lu¬mières sur la morale et la politique élémentaires. Mais au-delà ? Quel but peuvent bien s’assigner des hommes sages rassemblés en un corps solidaire ? Le bon sens répond : ou religieux ou laïc. Dans le se¬cond cas, une action collective débouche obligatoirement sur la politique. Éclairer les princes, cor¬respondre avec les agents du pouvoir, favoriser la justice, fort bien. Mais l’ordre est international et l’auteur entrevoit vite comment il peut dominer les États, comment le serment fait au prince peut devenir incompatible avec celui du franc-maçon. Il faut donc poser une limite à ce dernier. Quant au but religieux, quel peut-il être pour une société qui, fraternellement, réunit des membres de diverses confessions ? Sinon de chercher ce qui les rapproche, restant admise la foi en la révélation du Christ. Maistre insiste aussi sur l’interprétation symbolique des « Écritures ». Sans doute escompte-t-il que les voies de l’« illuminisme » conduisant à l’amour faciliteront un retour à l’Unité.
Sur le plan religieux, la plus grande sur¬prise est de découvrir chez le futur auteur du Pape un gallicanisme qui va jusqu’à l’outrance. Et nous remarquerons au passage combien la pensée qu’on croit la plus systématique demeure liée aux circonstances et à l’histoire, combien les idées d’un homme sont dans l’étroite dépendance de sa vie. Joseph de Maistre commence par combattre la hiérarchie ec¬clésiastique qu’il exaltera plus tard. Il souhaite que la maçonnerie reprenne le rêve de Bossuet, Leibniz et bien d’autres, réalisant la fusion de toutes les sectes chrétiennes dans une sorte de gallica¬nisme rénové. Les loges deviendraient le lieu de rencontre des catholiques, protestants et orthodoxes, loin du contrôle des autorités de Rome, Genève ou Saint-Pétersbourg. Or, ces vues qui nous paraissent subversives aujourd’hui, alors que, précisément, grâce à l’influence maistrienne, l’ultramontanisme a triomphé, étaient alors officiellement admises dans les États du roi de Sardaigne. Le sénat de Chambéry était gallican. Chargé de veiller à l’unité religieuse, il réprimait avec vigilance le prosélytisme des pasteurs de Genève qui empié¬taient volontiers au-delà de leurs frontières. Les sénateurs avaient pouvoir de censure sur les écrits théologiques et appelaient à leur barre les ecclésias¬tiques délinquants. L’application des bulles romaines était soumise à leur enregistrement. Le père de notre écrivain était, il est vrai, fort ami des jésuites et de sympathie ultramontaine. Mais, en 1773, le fai¬ble Clément XIV, peut-être par crainte de perdre Avignon, avait condamné la Compagnie de Jésus et, par là, aux yeux de beaucoup, s’était déshonoré.
Si l’on remarque que 1773 est précisément l’année où Joseph de Maistre s’est affilié à la maçonnerie, il est permis de supposer que cette in¬juste sanction contre ses anciens maîtres ne fut pas étrangère à sa décision.
Le « Mémoire » au duc de Brunswick atteste en tout cas chez son auteur âgé alors de vingt-neuf ans une somme immense de connaissances dans tous les ordres, une profonde réflexion, et un don d’é¬crivain. En une matière où l’amphigouri et l’obs¬curité semblaient de règle, le style s’impose, net, vif, tranchant, avec ces ellipses et ces rac¬courcis que les polémiques et le besoin de convain¬cre multiplieront dans les écrits futurs. L’ouvrage passa pourtant presque inaperçu et le plan de réfor¬me qu’il offrait ne fut point discuté. En effet, le vrai débat se situait à un niveau plus élémentaire, car l’aménagement maistrien présupposait une foi religieuse. Or, la lutte s’ouvrit vite entre les rationalistes dont le champion fut Bode, ami de Lessing, et le clan des déistes, martinistes, pié¬tistes de Silésie. « Chacun, écrira plus tard de Maistre, s’en retourna avec ses préjugés. » Mis en minorité, les amis de Bode se séparèrent pour re¬joindre les « Illuminés de Bavière », matérialistes et antireligieux. Le convent général, loin de résoudre les questions litigieuses, « avait trouvé le moyen de détruire tout ce qui donnait à la Stricte Observance quelque consistance ». Par une de ces contradictions habituelles aux assemblées, on renonçait à se dire héritiers du « Temple », mais on conservait l’appareil militaire et chevaleresque. La « réforme écossaise » allait vers sa décomposition. La tentative de Joseph de Maistre se soldait par un échec. Toutefois, entre les pages de son brillant « Mémoire », il avait glissé des espoirs plus personnels et qui se trouvaient également trompés. En effet, il supportait avec impatience l’étroitesse de sa vie provinciale et la monotonie de ses fonctions. S’il se plongeait avec une sombre ardeur dans des études historiques, philosophiques, théologiques, scientifiques, tout en suivant avec attention le mouvement des idées en France et en Angleterre, c’était par goût sans doute, poussé par cette faim de savoir qu’il ne devait jamais rassasier, mais aussi pour oublier l’amertume de se voir confiné dans une place médiocre. Car l’évidence s’imposait : il n’avançait pas. Son père avait parcouru une brillante carrière, et depuis deux ans venait d’être promu par son roi « comte sans fief ». Le titre était héréditaire et la descendance du sénateur François Xavier Maistre en¬trait désormais dans l’ordre de la noblesse. Mais Joseph n’en paraissait pas moins oublié par la cour de Turin. Aux heures de découragement, il rêvait d’éva¬sion, de quelque emploi où pourraient se déployer ses vastes connaissances et ses qualités comprimées par la routine. Pourquoi, par exemple, ne deviendrait¬-il pas le conseiller de quelque important personna¬ge ? Pourquoi n’accéderait-il pas à un bel emploi civil dans quelque cour allemande, tout comme les Bellegarde y avaient conquis de hauts grades mili¬taires ? C’est avec ces arrière-pensées qu’il avait offert son ouvrage au duc de Brunswick dans une dédicace apprêtée et flagorneuse, espérant en retour une faveur marquée, une recommandation précieuse. Il avait bravé un réel danger en correspondant ainsi avec un prince étranger, car la police sarde surveillait les courriers et appliquait de rudes sanctions. Risques vainement courus, espérances trompées : il apparaissait certain, désormais, que l’aîné des Maistre n’irait pas en Allemagne.
Une nouvelle tentation de fuir se présenta à lui l’année suivante avec un héritage. Par testa¬ment, un frère de sa mère, Jean François Demotz, archiprêtre et curé de Champdor, l’institua son lé¬gataire universel et lui laissa, dans la commune de Talissieu en Bugey, une maison de maître en bon état, avec caves, cuisine, rez-de-chaussée, deux chambres au-dessus et quatre cabinets ; le tout accompagné de dix-huit journaux de terres, seize sétérées de prés, quatre-vingt-six ouvrées de vigne, avec cellier et pressoir. Plus sept journaux de bois, de vignobles et de terres qui étaient affermés depuis 1778 pour deux cent quatre-vingts livres par an, prix du bail. Ces biens furent évalués dix ans plus tard à quatre-vingt-sept mille neuf cents livres. Le bon oncle de Talissieu demandait à son neveu d’unir dans son blason les armes des Demotz aux siennes. Notre substitut savoisien possédait dé¬sormais des terres dans une province devenue française par le traité de Lyon en 1601, ce qui le ren¬dait, sinon sujet, du moins ressortissant du roi de France auquel il payait l’impôt. Ce partage des intérêts suscita en lui comme un dédoublement de conscience. Puisque la monarchie sarde récompensait mal ses services, le roi de France ne serait-il pas un maître plus éclairé ? Et le voici aussitôt qui étudie de près le droit administratif français dont relève son nouvel avoir. On le verra suivre dans sa « Correspondance » le parti des réformes, Turgot, Necker, et blâmer la tyrannie et l’arbitraire des bureaux de Versailles. Il songera même à se lan¬cer dans la carrière des lettres à Paris. Causeur étincelant, polémiste-né, il eût pu y trouver une réussite à la Rivarol.
Joseph de Maistre fait alors partie de cette génération de jeunes gens encore inconnus et qui se préparent dans la médiocrité de leur vie provin¬ciale aux prodigieux événements qui mûrissent. Quel bouillonnement d’idées, quelle puissance de travail, quel élan ! Mais ce qui déjà le distingue de tant d’autres qui dogmatiseront autour des écha¬fauds, c’est l’absence d’orgueil.
« Dans mon état, ce qu’on fait est un minimum, comparé à ce qu’on voudrait faire. Tous les jours, je me lève avec mille projets ; la scribomanie me possède, je me sens la tête et quelquefois le cœur gonflés, mais je ne puis rien achever et pour ainsi dire rien entreprendre. Je trouve le soir que le devoir a pris tout mon temps. Il faut s’endormir comme la veille sans avoir pu suivre aucune de mes vues. Sans doute, vous vous formez une idée bien claire de ce tourment : le besoin de produire sans aucune explosion possible. Il y a de quoi crever. Jugez de la fermentation. C’est tout juste la machine à Papin. Quelquefois, pour me tranquilliser, je pense (sincèrement, sur mon honneur) que ces espèces d’inspiration qui m’agitent comme une py¬thonisse ne sont que des illusions, des sottes bouf¬fées du pauvre orgueil humain, et que si j’avais toute ma liberté, il n’en résulterait, à ma honte, qu’un ridiculus mus.
« D’autres fois, j’ai beau m’exhorter aussi bien que je puis à la raison, à la modestie, à la tranquillité, une certaine force, un certain gaz indéfinissable m’enlève, malgré moi, comme un bal¬lon. Je me perds dans les nues avec monsieur de l’Empyrée. Je voudrais faire, je voudrais, je ne sais, ma foi, pas trop ce que je voudrais. Peut-être cependant que les circonstances me feront vou¬loir, à la fin, une seule chose. Tiraillé d’un côté par la philosophie, de l’autre, par les lois, je crois que je m’échapperai par la diagonale. »
En attendant, il trace le sillon le plus droit. Ignorant tout de son activité maçonne et des désirs secrets dont s’alimente son imagination, ses proches le croient acharné seulement à sa lente carrière, et ils se sont réjouis, en 1780, lorsqu’il a été nommé substitut de l’avocat général fiscal près le sénat de Chambéry. Son chef, un certain Adami, piémontais, l’a chargé de la justice pénale, et là encore, dans l’exercice de sa fonction, notre magistrat doit dissimuler ses sentiments profonds. Car l’exercice du droit véritable, tel qu’il l’en¬tend, est faussé par une réglementation arbitraire. Victor-Amédée III, grand admirateur de Frédéric II et de la discipline prussienne, joue les adjudants, caracole à la tête de ses troupes, prend grand plai¬sir aux manœuvres, aux grandes revues. Il n’a ja¬mais assez de soldats à former en carrés bien que son petit État jouisse d’une paix garantie par les solides alliances de l’Autriche et de la France. Le militaire a pris le pas sur tous les fonctionnaires. Les « commandants de place » et « majors » exercent les pouvoirs de police. À la moindre infraction, les civils sont arrêtés sans jugement, humiliés, voire bâtonnés comme de simples soldats. Alors que la loi exige « pour une simple condamnation à trois mois de prison la présence de cinq juges consommés », n’importe quel blanc-bec frais échappé de l’académie militaire de Turin a licence d’incarcérer et de punir. Aussi, notre « substitut », indigné, en vient à rêver d’habeas corpus et à se pencher sur la ju¬risprudence anglaise. Il motive avec un soin par¬ticulier ses décisions. La besogne ne lui manque pas puisqu’on le voit en deux ans fournir plus de trente fois des conclusions. Il est contraint d’as¬sister à douze exécutions par pendaison et quatre¬ par la roue, à la fois comme représentant du sénat et comme membre de la « confrérie des Pénitents noirs ».
Son activité juridique déborde d’ailleurs vite ses attributions et embrasse les sujets les plus divers. Il multiplie les « mémoires » avec cette sorte de fièvre qui soutiendra plus tard les grandes « œuvres » et qui, provisoirement, s’alimente de questions fiscales, de droit criminel, civil ou administratif. En contrepartie de cette prodigieuse besogne in¬tellectuelle, on est surpris de le voir déployer une activité physique qui entretient sa robuste santé. Vrai montagnard, endurci au froid comme à la fatigue, il accomplit en toutes saisons de lon¬gues marches. Il lui arrive de parcourir plus de soixante kilomètres en un jour. Il aime la nage, la chasse autant que les randonnées à pied et à cheval dans lesquelles il entraîne souvent ses amis, car il est lié intimement à quelques garçons de son âge : d’abord Salteur de la Serraz et le chevalier Roze qui ont été initiés à la franc-maçonnerie en même temps que lui à Turin, et le comte Henri Costa de Beauregard qui sera le plus près de son cœur. Celui-ci est un peu son aîné. Héritier d’un grand nom, il a d’abord étudié la peinture à Paris, puis a servi dans l’armée pendant cinq ans et donné sa démission en 1776 pour vivre sur ses terres. Nous les retrou¬verons à la veille de la Révolution plongés dans des discussions passionnées, opposés d’abord puis réunis dans l’interprétation des événements drama¬tiques qui secoueront la France avant d’ébranler et d’abattre la monarchie sarde. Outre ces attache¬ments virils, il nous faut bien soupçonner dans l’âme ardente de notre substitut des sentiments plus tendres, encore que de Maistre ait été toujours fort avare de confidences sur son intimité. Autant Henri Beyle fut attentif à noter tout ce qu’il éprouvait, chaque fluctuation de son cœur mobile, voire ses moins glorieuses aventures physiques, pour utiliser ses observations en une inlassable étude des passions, autant de Maistre, absorbé dans des spéculations philosophiques, a pris soin d’effacer les traces de sa personnalité secrète, refusant d’avance cette familiarité qui nous attache si fort à des individus égocentriques comme un Stendhal ou un Benjamin Constant. Il est probable, cependant, qu’au cours des années que nous venons d’évoquer, quelques beaux regards aient parfois troublé notre laborieux magistrat, et qu’il ait lui aussi connu l’alternance des velléités d’ambition et des rê¬veries amoureuses. Trente ans plus tard, dans une de ses lettres, nous retrouverons comme une cendre encore chaude l’aveu d’une idylle qu’il vécut autour de sa vingt-cinquième année. Il venait d’être promu « surnuméraire de l’avocat fiscal » et cet avancement aiguisait son goût de paraître, de se pousser.
Ainsi lui revint en mémoire un parent un peu délaissé : Jacques Pauliani, son cousin germain, célibataire bien renté qui vivait à Nice. Encouragé par sa fa¬mille, il se rendit donc dans cette ville afin de renouer avec cette parenté trop négligée. Pauliani l’accueillit bien et l’introduisit auprès de ses relations. Ainsi fut-il présenté à une certaine comtesse de Saint-Barthélemy qui avait une fille de vingt et un ans. Il revint souvent. La jeune personne se nommait Appolonie. On en fut vite à de doux échanges, à de petits mots convenus, naïvement mystérieux, et les prénoms se muèrent en diminu¬tifs.
En 1806, écrivant à Pauliani et se souvenant de ces jeux dont l’évocation l’attendrissait encore, il sollicite de celle qu’il n’aura rencontrée qu’une saison un petit signe, un rappel discret. « Priez-la, dit-il, d’écrire de sa main “Poulon” dans votre lettre. » À peine formulée, la demande lui paraît trop osée. Il l’avoue, mais il n’y renonce qu’à regret. Nous ne savons rien des circonstances qui mirent fin à ces doux colloques niçois. Mais l’année suivante, Joseph de Maistre commença à fréquenter chez M. de Morand et ne tarda pas à entre¬prendre, auprès de sa fille, une cour assidue qui devait durer sept ans sans qu’on n’opposât le moindre obstacle à cette longue liaison. L’hiver 1785-1786, le soupirant devint fort mondain. Il fré¬quenta le théâtre, soupa avec des actrices de passa¬ge, dont Mlle Saint-Val qui donnait à Cham¬béry plusieurs représentations de tragédie. Il fut pour cent louis un des souscripteurs de la journée anglaise qu’organisa le riche marquis d’Yenne et qui marqua une date dans la chronique locale : soixante-cinq invités, le thé, dîner à cinq heures et le soir un gra
Quelle histoire étonnante que celle de ce manuscrit ! Rédigé il y a plus de quarante ans par Claude Boncompain, lui-même héritier de la volumineuse documentation amassée dans les années 20 par son ami François Vermale.
Aujourd’hui, à l’heure où l’histoire semble enfin vouloir rendre hommage au plus grand penseur contre-révolutionnaire, Joseph de Maistre a su garder toute sa fraîcheur pour devenir, de l’avis de son préfacier Philippe Barthelet, « la meilleure introduction possible à la pensée et à la vie du celui qui aimait à se définir comme le grand Allobroge ».
Pendant longtemps, Joseph de Maistre fut l’archétype même du classique maudit : son nom était symbole et sa légende, plutôt noire que dorée, dispensait ses détracteurs de l’étude de sa vie et de son œuvre.
Et pourtant ! Quel homme exceptionnel que ce fidèle sujet du royaume de Piémont-Sardaigne, qui, dans une des périodes les plus troublées de l’histoire européenne, celle-là même qui sous l’élan révolutionnaire et les coups de boutoirs de la grande armée napoléonienne vit les trônes d’Europe vaciller, les rois trembler, l’ordre établi s’effondrer. Car jamais Joseph de Maistre ne trahira sa devise : Fors l’honneur, nul souci.
Sa foi en la Providence reste absolument inébranlable. Peu lui importe le génie napoléonien, l’annexion de son royaume et de ses terres par la France, et même que son roi ne puisse pas subvenir à ses besoins dans la lointaine Saint-Pétersbourg où il est son représentant plénipotentiaire. Le combat qu’il mène contre cette aberration qu’est pour lui la Révolution ne souffre aucune contrainte, aucune limite. Ses armes sont ses mots et sa verve, il les couche dans ses textes, ses correspondances, ses réflexions.
Ses Considérations sur la France deviennent une référence, une lueur d’espoir pour toute une génération de nobles européens. Et pourtant, lorsque Louis XVIII revient sur le trône de France, lorsque l’Europe semble retrouver la paix, quel manque de reconnaissance … Lorsqu’en 1817 il entre enfin à Paris, cette ville dont il a si souvent rêvé, qu’il a tant contribué à rendre à son roi, Joseph de Maistre est devenu indésirable.
Quelques années plus tard, revenu sur ses terres piémontaises, Joseph de Maistre voit dans l’unification de l’Italie, dans l’usurpation du siège du pontife, la fin du vieil esprit chrétien. Celui-là même qu’il a passé sa vie à défendre, celui-là même qui avait animé l’Europe pendant quinze siècles. Quelques temps auparavant, il avait écrit : Je meurs avec l’Europe. Il aura fallu plus d’un siècle d’agonie pour que son Europe disparaisse, et, le 26 février 1821, Joseph de Maistre meurt en chrétien qui a souvent contemplé cette dernière heure en face et qu’elle ne surprend pas.
Disciple d’Albert Mathiez, François Vermale devint dans les années 20 le spécialiste de de Maistre et de Stendhal.
Claude Boncompain et lui-même avaient déjà rédigé un livre sur Stendhal ou la double vie d'Henri Beyle paru aux Editions Amiot Dumont
Le préfacier, Philippe Barthelet, est journaliste sur France Culture et à Valeurs actuelles. Il a publié L’Étrangleur de perroquets chez Critérion et Saint Bernard chez Pygmalion. Couronné par le prix Combourg pour l’ensemble de son œuvre.
Préface de Philippe Barthelet