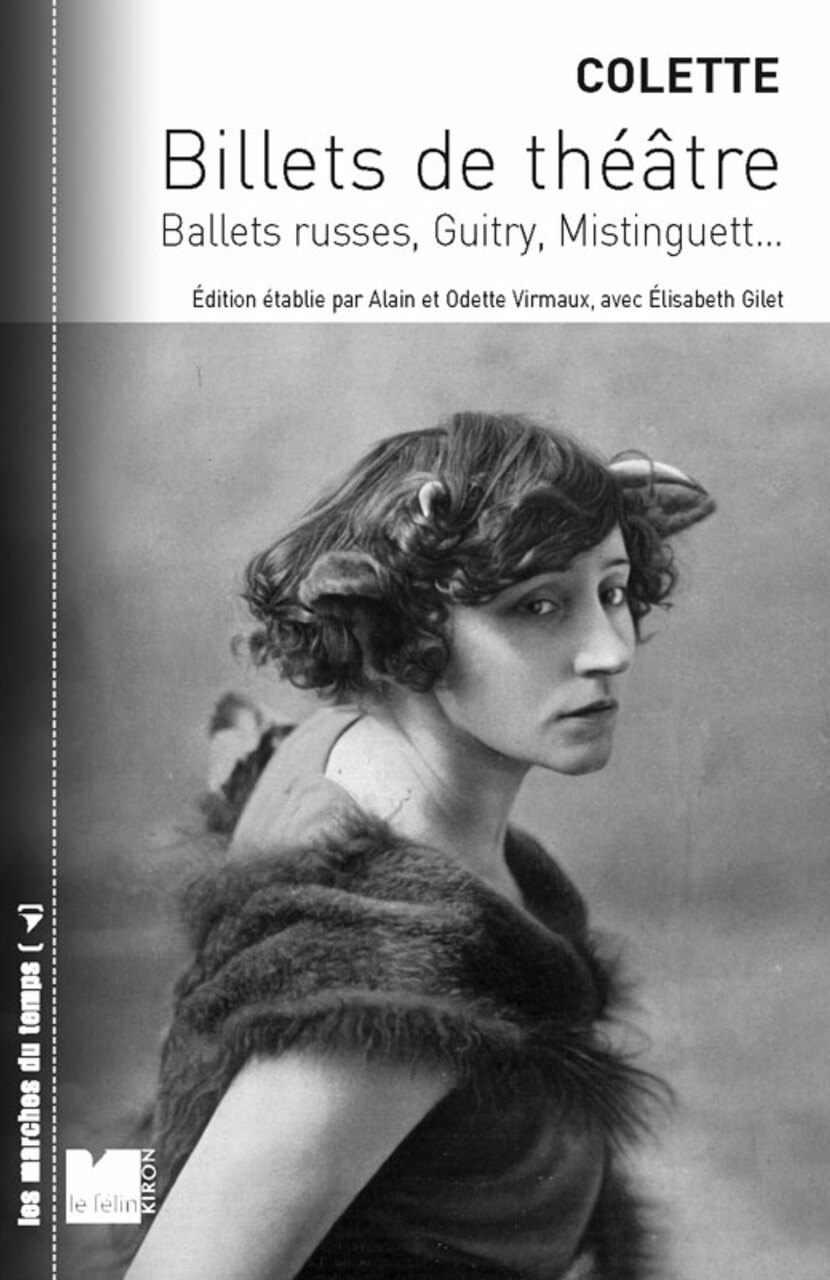
Billets de théâtre
Turqueries
Il n’y a pas longtemps qu’ici même1 je disais combien d’émotion, de fièvre gaie, de larmes simples, pouvaient tenir dans une petite salle de café-concert modeste, dans le premier café-concert qui rouvrit ses portes à Paris. Depuis ce temps-là, quelques music-halls l’ont imité, et tous les théâtres prêtent leur scène et leur salle pour des « galas », des matinées et des soirées où Paris, inépuisable, vide sa bourse au profit des soldats, des réfugiés belges et français. Tous les artistes, généreux comme des pauvres qu’ils sont, tiennent à honneur d’y paraître. Il ne faudrait plus, pour que tout fût pour le mieux dans le meilleur et le plus charitable des mondes, qu’une censure adroite qui régirait le programme de ces fêtes. « Régirait » est un mot un peu sec, mais je maintiens celui de censure. J’ai encore sur le cœur, si j’ose écrire, le plus récent d’un de ces longs spectacles. La bonne volonté des artistes s’y égare, au point qu’un comique âgé, notoire – le public rit d’avance, et salue sa grimace de singe spirituel – récite un drame d’aviation militaire. Une jeune actrice blonde loue, en des termes que ne renierait pas la Gazette de Cologne, la « bravoure » d’un turco2 (inventé), assez héroïque en effet pour occire vingt Allemands prisonniers confiés à sa garde… Une divette d’opérette gémit un drame d’infanterie, une comédienne murmure tragiquement un drame de cavalerie. Ce ne sont que Mort du tirailleur, Agonie du zouave, Dernier jour d’un héros… Que dire du compositeur-auteur qui exploite, en chansons interminables, le nom aimé d’un généralissime3 ? Le sentiment patriotique n’est pas une excuse à de la musique exécrable et à des vers pires. Le public, enthousiaste d’abord, patient ensuite, bientôt morne, s’ennuie et s’attriste parmi tant de carnages, de guerriers meurtris, tant d’étendards sanglants. Il admet encore, – car il est très bien élevé, le public, et très bon, et très indulgent, car il est présentement la crème des publics – il admet qu’une sorte d’échappée de la Salpêtrière déclame, sans musique, vêtue d’un drapeau, une Marseillaise méconnaissable ; mais il n’est pas sûr qu’il tolère longtemps ce genre d’exhibitions ni celle de quelques gardes-voie, ci-devant attachés, peu ou prou, à des scènes et qu’on entend, en uniforme et jambières – soigneusement crottés – réciter une Mort du pioupiou de leur cru ou quelque autre petite drôlerie. Il m’apparaît qu’il rêve comme moi, le public, de représentations où les comiques s’avéreraient comiques, les tragédiens tragiques, où les danseuses danseraient, et où des lèvres aimables distilleraient un miel de paroles joyeuses ou suaves ; un programme d’où seraient bannis certains commerçants en Lettre du blessé et en Hymne aux vainqueurs un peu prématuré…
C’est difficile ? On peut toujours essayer.
Le Matin, 9 mars 1915.
1. C’est en 1910 que Colette commence à collaborer régulièrement au quotidien Le Matin : pour les « Contes des mille un matins », mais aussi pour de nombreux reportages d’actualités et pour une série « Music-halls ». Cet article évoque ouvertement la guerre alors en cours. Or Colette ne cache pas sa répulsion pour l’exploitation mercantile du bellicisme régnant. Dans le climat hystérisé de l’époque, une telle attitude n’allait pas sans risques. Elle avait pu voir de près l’horreur sanglante du conflit, pour avoir veillé les blessés en 1914 dans le lycée Janson-de-Sailly transformé en hôpital.
2. Ce nom familier de « turco », donné aux tirailleurs algériens et fantassins arabes, datait du Second Empire et de la guerre de Crimée, où ils avaient été recrutés pour grossir les rangs de l’armée française. D’où sans doute le titre de « Turqueries » donné à l’article.
3. Le généralissime en question est très probablement Joffre, dont le nom se prêtait en effet aux pirouettes verbales. Il était considéré comme le vainqueur de la première bataille de la Marne (1914). Pétain et Foch s’illustreront plus tard dans cette guerre.
THÉÂTRE DU VAUDEVILLE
Deburau1,
comédie en quatre actes, en vers libres, de M. Sacha Guitry
« Deburau, quatre actes en vers libres. » Vers libres ? Plutôt vers involontaires. M. Sacha Guitry, à qui nul ne résiste, vient de rencontrer son maître : le rythme2. Encore dans toute la nouveauté d’un servage amoureux, l’auteur dramatique se laisse guider par son despote, se livre à lui, sauf de trop rares révoltes, cède à l’obsession versificatrice comme il céderait au besoin de danser. Pas une fois il ne cherchera à esquiver l’hémistiche irrésistible, le lieu commun harmonieux, la rime qui, d’être trop tôt devinée, déflore un effet savamment préparé. Comme on reprend en chœur un refrain facile, les spectateurs de la générale accompagnent plus d’une fois, en sourdine, un vers inévitable annoncé sans mystère par le vers précédent. C’est un perpétuel consentement heureux et vaincu, quasi voluptueux, que M. Sacha Guitry accorde au rythme. Il en résulte, disséminées sur sa dernière œuvre, des plaques d’anémie, si j’ose écrire, des défaillances de couleur. Le dialogue y rappelle parfois ce jeu, cher à l’auteur, de la conversation en alexandrins, jeu où il donnait prestement la réplique aux improvisations magistrales de Marguerite Moreno.
Ne tremblez pas pour le sort de la pièce : il était assuré bien avant la fin de la répétition générale. Même aux instants où l’on serait tenté de rappeler à Deburau, qui l’oublie, que le mutisme est, pour un mime, le plus intense moyen d’expression3, M. Sacha Guitry n’est jamais à court de séductions. N’a-t-il pas par sa voix, étoffée, émouvante, qui baisse jusqu’au murmure sans cesser d’être distincte, n’a-t-il pas le langage, sobre et complet, des mains et du visage et de tout le corps ? Cette voix, quoique un peu assoupie avant-hier au ronron des couplets, sa force contenue, sa suavité habile rendent malaisée l’estimation honnête d’un texte en vers qui pâtirait d’être comparé avec certaines scènes – raccourcis solides, dialogues vifs et d’un sûr équilibre – du théâtre en prose de M. Sacha Guitry.
Le prologue de Deburau nous montre le grand mime obscur encore, marié et sage. Au premier acte, le Pierrot des Funambules, qui a tout quitté, sauf son enfant et sa chienne, pour suivre la Dame aux Camélias, trouve celle-ci dans les bras d’Armand Duval4. Le deuxième acte suffit à vieillir de sept ans Deburau ; le mime regarde, aigri, défiant, malade, grandir un fils charmant qui lui ressemble comme un rival. La scène entre Deburau père et Deburau fils, amère, rapide, essentielle, est jouée – par Hiéronimus, adolescent d’une grâce aérienne et impatiente, et par un Sacha creusé, agité de fièvre et de rancune, – de manière à combler toutes les exigences. Elle me semble plus significative encore que celle du dernier acte où le vieux mime, lapidé sur la scène des Funambules, abdique en faveur de son fils qu’il maquille, conseille et habille lui-même pour la première bataille…
Cette scène dernière a été – d’autres aussi – frénétiquement applaudie. Elle ne m’a paru ni la meilleure, ni la plus difficile à jouer. Il n’y fallait… mon Dieu ! Il n’y fallait que la résignation, coupée de sursauts féroces d’un artiste dépossédé de sa gloire et de son amour. Il y fallait assez d’autorité pour dire le monologue des conseils, légèrement, à mi-voix, sans regarder le public. Il y fallait une « patte » assurée de peintre et de grime qui travaille en parlant… Est-ce que M. Sacha Guitry n’a pas tout cela, et plus, et mieux ?
Les excellents Galipaux, Janvier, Baron fils, Gildès acceptent, avec une modestie et une bonne camaraderie spirituelle, de tenir des rôles minces, ainsi que Mme Rosine Maurel, chiromancienne entremetteuse. Mme Yvonne Printemps5 nous révèle une Dame aux Camélias, à laquelle nous ne prêtions peut-être pas cette gentillesse, cet embarras « jeune fille », et d’ailleurs touchant. Elle nous montre aussi deux petites oreilles, effarées d’être nues, et un front entièrement déshabillé. Mais surtout elle fait voir – frais, empressé, inquiet et propre à désarmer les critiques – son sourire, tourné vers la même personne, son sourire d’élève bien apprise et bien éprise, qui quête, enfantinement, l’approbation.
L’Éclair, 10 février 1918.
1. Première chronique consacrée par Colette à Sacha Guitry, avec qui elle entretenait des liens d’amitié. Elle ne fait aucune allusion au fait que ce Deburau aurait notoirement favorisé la réconciliation du fils avec son père, Lucien Guitry. Pièce fréquemment reprise. L’auteur en tira même un film en 1951.
2. Colette n’hésite pas à prendre ses distances avec le succès avéré de la pièce et à multiplier les réserves, en disant clairement qu’elle attendait mieux de l’auteur. Tout en citant au vol sa vieille amie Marguerite Moreno, absente de ce Deburau mais à qui Guitry fera souvent appel.
3. Nouvelle flèche contre Guitry, malgré l’amitié. Éloge sans surprise du mutisme, Colette ayant pratiqué l’art du mime, comme on sait.
A-t-elle pu voir, bien plus tard, le film Les Enfants du paradis (1945) ? On aurait aimé savoir quel sentiment a pu lui inspirer le Deburau beaucoup plus mutique qu’incarnait Jean-Louis Barrault.
4. Précisons que le roman d’amour imaginé par Guitry entre Deburau et celle – Marie Duplessis – qui sera la Dame aux camélias ne repose sur aucune donnée concrète. La fable ne souleva aucune contestation.
5. Sur l’actrice, voir plus loin Nono, 26 mai 1918. Colette souligne qu’Yvonne Printemps joue ici nu-tête. Rappelons que les chapeaux étaient encore l’apanage obligé de la femme de condition (tout va bientôt changer dans les années dites « folles »). Les femmes « en cheveux » (l’expression eut longtemps cours) révélaient par là leur appartenance aux classes sociales inférieures.
Théâtre Michel
L’École des cocottes1,
comédie en trois actes, de MM. Armont et Gerbidon
Succès partout. Succès au Gymnase, au Vaudeville, aux Bouffes, et succès hier, au Théâtre Michel, pour l’École des Cocottes. L’école des cocottes, c’est Harry Baur, professeur de maintien, de bien dire, de bien manger, à l’usage des demi-mondaines. Il les prend au berceau, je veux dire rue Fontaine, et les mène, impitoyable, jusqu’à des chevets ministériels, où elles parviennent, il faut le noter, sans joie, et même en essuyant, au bout de leurs cils maquillés, une petite larme… C’est la moralité de trois actes, dont les deux derniers surtout sont faits pour plaire longtemps.
Passons donc tout de suite sur les présentations un peu traditionnelles du premier acte, celle, par exemple, du professeur d’élégance, sauvée par l’adresse d’Harry Baur. (D’ailleurs, c’est au milieu de ce premier acte qu’entre Raimu, et l’atmosphère change, simplement parce qu’il est entré, parce qu’il s’est tu un long moment, avec une figure incomparable de chien battu et concupiscent2…).
Passons à la leçon de maintien du deuxième acte, leçon qui aurait pu se souvenir de celle de Madame Sans-Gêne3, et ne se donne que la coquetterie de la faire oublier, tant la scène est bien menée par les auteurs, et jouée avec une légèreté et une précision quasi chorégraphiques, par Jane Marnac et Harry Baur.
Le rôle de Raimu, à partir de ce moment, tient, je crois, en peu de lignes ; mais qui s’en doute ? Il ne lui faut qu’un regard, qu’une moue apitoyée, qu’une réplique bougonne de dix mots, pour meubler la scène et occuper le public. Qui donc disait près de moi, hier, que « Raimu apporte son air avec lui » ? La fin du troisième acte est tout à l’avantage de Jane Marnac, que j’aime tant à voir sortir ainsi, toute vivante, toute émue et amollie, d’une sécurité victorieuse et parfois un peu catégorique. On la pare, en victime, pour une alcôve gouvernementale, pendant que le rideau tombe, et le public est sensible à la grâce pessimiste du dénouement.
J’ai parlé d’Harry Baur et de Raimu ; mais il y a encore Violet, qui joue vrai et écoute juste, et Etchepare, qui garde à un rôle jeune la gaucherie aimable de la jeunesse, et Mlle Dalmorès qui, personnifiant une charmante petite oie malchanceuse, sera tout à fait bonne quand elle s’appliquera moins.
L’Éclair, 17 février 1918.
1. Œuvre de deux boulevardiers alors réputés, Paul Armont (1874-1943) et Marcel Gerbidon (1868-1933), L’École des cocottes fut créée à Paris en février 1918 alors que la guerre faisait encore rage et que les troupes allemandes se rapprochaient de la capitale. La pièce sera souvent reprise, en particulier au Théâtre des Nouveautés en 1943 : autre période troublée. Deux fois elle fut portée à l’écran : en 1934 et surtout en 1958 par Jacqueline Audry, celle-là même qui avait connu, dix ans plus tôt, une sorte de triomphe avec Gigi (1948). Il n’est pas interdit de voir cette École des cocottes comme justement une des sources de Gigi.
2. Croisement frappant dans cette pièce et sous la plume de Colette, de deux futurs « monstres sacrés » du théâtre et du cinéma, à l’aube de leur glorieuse carrière. Harry Baur (1880-1943) et Raimu (1883-1956) avaient eu des débuts de parcours bien différents : le premier était passé par le Conservatoire, le second venait du caf’conc’ (mais fera en 1944 un bref passage à la Comédie-Française). Tous deux, Raimu surtout, s’illustreront dans les œuvres de Pagnol. Colette aura Harry Baur pour interprète dans une adaptation de sa Vagabonde au Théâtre de la Renaissance en 1923. Elle forme également un projet pour Raimu, mais qui n’aboutit pas (Cl. Pichois et A. Brunet, Colette, de Fallois, p. 253).
3. La performance d’Harry Baur dans l’École des cocottes rappelle à Colette une autre leçon de maintien : celle qui est donnée à l’héroïne de la célèbre pièce de Victorien Sardou et Émile Moreau, créée par Réjane en octobre 1893 au Théâtre de Vaudeville. Constamment reprise jusqu’à nos jours, et plusieurs fois portée à l’écran, notamment en 1941 par Roger Richebé, avec une Arletty taillée pour le rôle. Quant à la partenaire d’Harry Baur, ici Jeanne Marnac (1886-1976), c’était une actrice fort appréciée et souvent à l’affiche, dans le registre de la comédie comme dans celui de l’opérette. On la vit à l’écran dans Paris-Béguin (Genina, 1931) aux côtés d’un Jean Gabin pas encore « starifié ».
À Paris, dans les années 1905, Colette fait scandale au music-hall. Simultanément elle devient un écrivain reconnu. Elle gagne sa vie grâce au journalisme et les spectacles l’accaparent. Il y a là une frénésie qui la concerne de près, c’est une question de mouvement, de jeu, de rythme, de variations, de gravité aussi. Elle assiste aux succès du vaudeville – Guitry, Labiche, Feydeau – comme elle est curieuse des Ballets russes, d’Ibsen et d’Artaud (Les Cenci). Elle dessine les portraits de Marguerite Moreno, Mistinguett, Raimu, Michel Simon, sans oublier ses « souvenirs de Pâques ». Intelligence des situations, émotion discrète, acuité du style : telles sont ces chroniques retrouvées.
Colette (1873-1954) est un des plus grands écrivains du xxe siècle. Elle est l’auteur de romans et de récits, parmi lesquels La Naissance du jour, Le Blé en herbe et Le Fanal bleu.
Édition établie par Alain et Odette Virmaux, avec Élisabeth Gilet