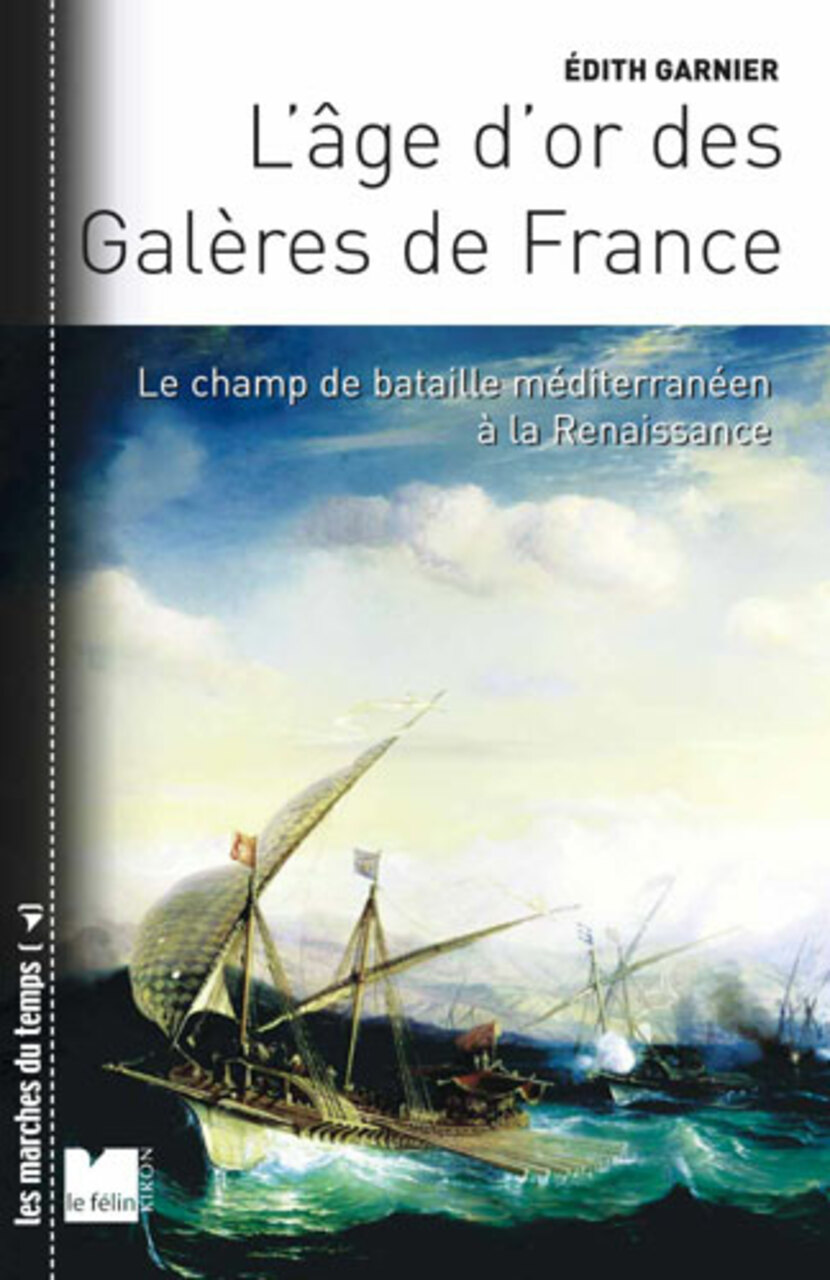
L'âge d'or des Galères de France
Avant-propos
LES ELEMENTS DU PROBLEME
« L’irruption de la puissance militaire turque dans le domaine de la civilisation chrétienne de l’Occident et dans le système des États et des souverainetés d’Europe fut l’un des événements les plus importants et les plus lourds de conséquences de la période qui se situe entre le Moyen Âge et les Temps modernes. »
Hugo Hantch,
Charles Quint et son temps.
La période qui va de 1494 à 1529 est, pour l’Europe, une étape de turbulences, celle où se mettent en place les nouveaux équilibres et les grandes fractures de l’ère moderne. Il s’agit d’une époque placée sous le signe de la volonté hégémonique et de la logique de guerre. C’est le moment, en effet, où les monarchies occidentales se lancent dans une course à l’agrandissement et à l’enrichissement, en un mot, celui où elles deviennent des puissances impériales. Ce mouvement d’expansion à l’ouest du continent est, toutefois, à mettre en relation avec celui qui se développait à l’est. Les Turcs occupaient les Balkans et campaient aux portes de l’Italie. Ils dominaient déjà le bassin oriental de la Méditerranée et menaçaient désormais le bassin occidental. Telles sont les circonstances dans lesquelles la France allait faire irruption sur l’échiquier méditerranéen.
La Méditerranée était encore le cœur du monde connu. Elle était surtout devenue, selon les termes de Fernand Braudel, une « économie monde » grâce au commerce international par voie de mer, contrôlé par les républiques italiennes de Gênes et de Venise – celles-ci l’ayant organisé selon les règles du capitalisme marchand. Promoteurs d’une civilisation portuaire florissante dont ils étaient aussi les produits, commerçants, banquiers et armateurs avaient tissé entre eux un maillage serré, et leurs réseaux de correspondants couvraient l’Europe entière, poussant même leurs ramifications au-delà. Les profits dégagés étaient considérables. Le monde méditerranéen s’était ainsi développé sous l’effet de sa dynamique propre, indépendamment des pouvoirs royaux, féodaux ou cléricaux. Les centres de commande du système se trouvaient en Italie, le pays le plus riche et le plus moderne d’Europe. Il était d’autant plus convoité que ses divisions faisaient de lui une proie facile. Aussi toutes les forces impérialistes, dont l’Empire ottoman, allaient-elles converger vers l’Italie et la Méditerranée.
À partir de la prise de Constantinople en 1453, le sultan Mehmet II ne cesse d’étendre ses conquêtes sur les fronts terrestres et maritimes. En 1480, seul le détroit d’Otrante sépare l’armée ottomane du royaume de Naples où règne Ferrant Ier dont les intérêts sont étroitement liés à ceux de l’Espagne de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille. C’est Charles VIII, roi de France, qui, après s’être ouvert l’accès à la Méditerranée grâce à l’annexion de la Provence, va provoquer une série de réactions en chaîne : à l’appel des Génois, il entreprend la conquête du royaume de Naples et, deux ans plus tard, toutes les nations européennes de grande tradition maritime se liguent contre lui.
Pour faire face, la France va devoir se doter de ce type de navires qui sera le fer de lance des flottes en Méditerranée au XVIe siècle, les galères. Maniables et mobiles, elles pouvaient se porter rapidement sur les points névralgiques. Outre leur usage commercial, elles étaient l’instrument privilégié de la guerre de course et donc adaptées aux raids de harcèlement et aux coups de main qui constituaient une part importante pour ne pas dire essentielle des actions navales. Enfin, les galères joueraient un rôle clé dans une nouvelle forme de guerre que l’on pourrait presque qualifier, avant la lettre, d’amphibie : l’encerclement conjoint par terre et par mer des positions côtières à prendre ou à défendre.
Ainsi sera mis sur pied à Marseille, en 1496, le corps des Galères du Levant sous la conduite d’un chevalier de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Prégent de Bidoux. Pendant près d’un quart de siècle, ce capitaine hors du commun et injustement méconnu va servir avec une extraordinaire maestria la politique de trois rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier. De la mer Ligure à la mer Ionienne et à l’Adriatique, de la Méditerranée à la Manche en passant par l’Atlantique, les galères provençales se trouvent toujours là où se cristallisent les enjeux. Suivre leur parcours, c’est, dès lors, plonger au cœur des grands conflits européens.
La Méditerranée va devenir un vaste champ de bataille où l’on distingue difficilement les ennemis des alliés, et cela d’autant moins que les coalitions se font et se défont à un rythme accéléré, sans qu’on en discerne toujours les raisons au premier abord. Guerre navale, guerre de course, guerre économique et guerre religieuse s’enchevêtrent. Mais toutes procèdent d’une même logique, car les affrontements en mer sont plus que jamais liés à la haute politique, laquelle est, à cette époque, particulièrement fluctuante.
Parmi les hommes de mer du temps, se détachent des personnalités exceptionnelles telles qu’en produisent des circonstances non moins exceptionnelles. Peu nombreuses, on les retrouve sur tous les fronts. Certains capitaines deviendront les amiraux des puissances en lutte. Leur champ d’action ne se limite cependant pas au seul domaine maritime. Individus aux talents multiples, ils ont, pour la plupart, un rôle diplomatique important, sont les conseillers des princes, en venant parfois à gouverner eux-mêmes à la tête de cités-États riveraines. Sur fond d’intérêts contradictoires et de renversements d’alliances, Français, Espagnols, Italiens, Autrichiens, Turcs et « Barbaresques » d’Afrique du Nord vont s’affronter pour maintenir ou entraver la liberté de naviguer, ramener du butin, ouvrir le passage à leurs troupes, défendre leurs propres zones d’influence ou les élargir au détriment des autres belligérants. En 1529, après plusieurs décennies de combats furieux et de retournements politiques imprévus, les choses seraient devenues claires. Il ne resterait plus en lice sur l’échiquier méditerranéen que deux protagonistes, Soliman le Magnifique et Charles Quint.
Mon approche, résolument narrative, fait une large place aux configurations politiques et commerciales sans lesquelles l’action navale n’aurait aucun sens. J’ai tenté de mettre en évidence le lien entre tous les événements en quelque lieu qu’il s’en soit produit, puisque, à un titre ou à un autre, tous participent d’une histoire unique. Pour cela, il m’a fallu suivre ce qui se passait dans les différentes régions concernées et établir une chronologie précise pour permettre au lecteur de ne pas perdre le fil d’histoires souvent entremêlées. Les missives échangées entre les acteurs nous aident à voir et à comprendre la façon dont les hommes appréhendaient les réalités de leur temps.
Ce temps correspondait à une période particulièrement mouvementée de l’histoire européenne. D’où, comme à d’autres moments cruciaux de cette histoire, la succession de rebondissements, de coups de théâtre, de hauts faits ou d’autres, moins glorieux, mais tout aussi prodigieux. Si elles peuvent surprendre, voire, parfois, laisser incrédule, ces péripéties ne sont pas le fruit d’une imagination férue de récits d’aventures. Toutes sont puisées dans des archives, mémoires ou ouvrages historiques où peu de chercheurs ont songé, jusqu’alors, à aller les trouver. Je me suis attachée à privilégier ce qui concernait l’évolution de la situation sur mer, sans négliger pour autant ses prolongements terrestres, quitte à réduire à l’essentiel, par exemple, l’imbroglio des guerres d’Italie pour en faciliter la compréhension.
Le type de narration adopté est volontairement linéaire, car j’ai souhaité éclairer quelque peu, sans prétendre à une explication globale, le fonctionnement de ce monde de la Renaissance « plein de bruit et de fureur », et de blessures d’honneur aussi. C’est pourquoi je n’ai pas négligé non plus, pour rendre intelligibles des situations parfois déroutantes, l’importance des codes, explicites ou non, qui sous-tendaient toutes les relations.
Je dirai, pour finir, que je me suis quelquefois attardée sur des épisodes, des scènes ou des caractères qui pourraient être considérés, à première vue, comme secondaires. Mais, outre qu’ils sont particulièrement emblématiques de l’esprit d’une époque et de ses mœurs, ils restituent son épaisseur et sa violence à l’histoire, et donneront, je l’espère, une idée de l’énergie et des passions qui animaient ses acteurs. Comme on le verra, ils sont tout sauf des personnages médiocres, et c’est pourquoi le tableau que l’on en dresse ne peut être que haut en couleur.
I
PRÉMICES D’UNE CONFRONTATION
(1453-1493)
À la chute de Constantinople, le commerce maritime était dominé par les républiques maritimes italiennes. Il faut dire que Gênes, Venise et, dans une moindre mesure, Florence avaient été, en fin de compte, les principales bénéficiaires des croisades. Grâce à celles-ci, la construction navale était devenue la première activité productive à passer au stade industriel en Occident. Emmener dans le Levant des hommes, des vivres et des armes pendant un siècle et demi avait fourni l’occasion de mettre en place une puissante logistique. Ainsi, Génois et Vénitiens purent-ils s’approprier les ports de Palestine que leurs navires avaient servi à conquérir.
Lors de la quatrième croisade, en 1204, le pragmatisme marchand prit résolument le pas sur les errements politico-militaires des croisés. Ce ne sont pas les Turcs ou les Égyptiens qui furent attaqués par les chrétiens, mais Byzance, qui ne s’en relèvera pas. Le traité de paix accorda aux Génois la mer Noire, et aux Vénitiens la mer Égée. Quand les guerriers quittèrent définitivement le terrain, les hommes d’affaires italiens étaient installés dans les ports. Ils avaient bâti des quartiers entiers, avec des entrepôts, des routes, des églises et organisé un maillage de correspondants dans le Levant.
C’est bien un nouveau système économique, appuyé sur une logique de réseau, qui s’élaborait. Dès cette époque, un marchand italien savait généralement lire, écrire et compter, ce dont ne pourrait se prévaloir un prince français du XVIe siècle. Pour
parer aux dangers d’une navigation encore hasardeuse et d’une piraterie endémique, les pratiques commerciales s’étaient perfectionnées grâce à la mise en place de sociétés en participation groupant plusieurs actionnaires, l’emploi de lettres de change pour éviter la circulation des espèces, la généralisation des assurances pour couvrir les risques. L’état d’esprit des commerçants n’était pas très éloigné de celui de nos modernes businessmen. Pénétrés des lois de la concurrence, ils avaient compris que l’efficacité était fondée sur des prévisions judicieuses. Ils collectaient des données, suivaient les cours des marchés de Beyrouth et Alexandrie jusqu’à Bruges, sachant où prendre les produits et où les livrer en calculant d’avance le bénéfice escompté1. Ainsi, le système élaboré en Méditerranée par les Italiens du Moyen Âge connaîtrait, à l’étape suivante de son développement, un bel avenir sous le nom de capitalisme. Mais cette mutation, décisive pour l’avenir du monde, se produirait ailleurs que dans le Levant.
Le début de la conquête des Balkans
Dit « le Conquérant », Mehmet II allait, en trente ans, faire de l’Empire ottoman une puissance mondiale. Un édifice à la construction duquel une longue lignée de sultans avait chacun apporté sa pierre. Mourad Ier (1359-1389) avait implanté les Turcs au cœur de l’Europe centrale, une présence dont allaient découler bien des crises du XVIe siècle, et au-delà. C’est à lui qu’il revient d’avoir transformé un petit émirat turkmène en véritable État. En faisant d’Andrinople (Édirne) sa capitale, il s’était approché de l’Europe. En 1389, soit soixante-cinq ans avant la prise de Constantinople, la victoire qu’il remporta à Kosovo face au prince serbe Lazare constitua la première étape de la conquête des Balkans.
Mourad Ier fut assassiné par l’un des vaincus, et son fils Bajazet Ier, surnommé Ildrim – l’Éclair – (1389-1403), lui succéda. Il s’empara de la Bulgarie (1393), de la Thessalie (1394) et de la Valachie (1396). En vue d’enrayer sa progression, une croisade fut mise en œuvre par les Byzantins, les Hongrois, les Valaques et les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem auxquels Français et Bourguignons vinrent prêter main-forte. L’armée fut rassemblée à Buda. Au lieu d’attendre l’ennemi, les chrétiens partirent à sa rencontre. Ils subirent une défaite sans appel à Nicopolis, le 25 septembre 1396. La menace qui pesait désormais sur la Hongrie, la Dalmatie, l’Épire et le Péloponnèse fut provisoirement écartée grâce à la vaste offensive lancée par Timur Lang (Tamerlan), un autre conquérant turc, sur les frontières orientales des possessions de Bajazet Ier. Fait prisonnier, ce dernier mourut en captivité, sa disparition déclenchant entre ses fils une guerre de succession.
L’un deux, qui deviendrait Mehmet Ier (1413-1421), l’emporta, mais avec un pouvoir fragilisé. Il fut pourtant le premier à poser les jalons d’une hégémonie sur la Méditerranée en attaquant deux positions clés, Thessalonique, sur la mer Égée et Valona, sur l’Adriatique. Il commença par faire le blocus de Thessalonique, le second port grec après Constantinople, en 1416. Les Vénitiens parèrent au danger en envoyant immédiatement sur place leur flotte qui infligea une sévère défaite à celle du sultan. Mais, dès l’année suivante, un raid permit à Mehmet Ier de prendre Valona (Vlorë), au bord de l’Adriatique que Venise considérait comme « son golfe ». Située à l’autre extrémité du canal d’Otrante, c’était aussi la position d’Albanie la plus proche du royaume de Naples. Mehmet Ier mourut sur ces entrefaites en 1421, laissant le trône à son fils, Mourad.
La consolidation
Mourad II (1421-1451) donna à la conquête des Balkans une assise solide. Il revint à son tour à la charge sur Thessalonique dont la population grecque s’était mise sous la protection de Venise. En 1430, une armée et une flotte ottomanes furent à nouveau envoyées pour faire le blocus de la ville. Au mois de mars, le sultan arriva en personne et la ville tomba à la fin du mois. Venise avait anticipé les conséquences de cette perte. Pour éviter à ses possessions en Albanie d’être prises par la force, elle accepta de payer pour elles un tribut annuel à Constantinople.
La prise de Thessalonique fut, en effet, le point de départ d’une nouvelle étape de conquête. Les Ottomans convoitaient désormais Ioannina. C’était la capitale de l’ancien despotat byzantin d’Épire, qui comprenait, entre autres, le golfe d’Arta et les îles Ioniennes. Cette province était passée depuis longtemps sous la tutelle d’une famille d’aventuriers italiens, les Tocco, dont les Épirotes souhaitaient se libérer. Sollicités, les Ottomans leur offrirent une aide qu’ils eurent le tort d’accepter. Leurs sauveurs arrivèrent, mais pour placer directement la ville sous autorité turque. Ioannina devint ainsi, dès 1431, la base arrière de la conquête de l’Europe centrale.
Dès lors, les Ottomans allaient s’installer dans le Sud de l’Albanie et progresser vers la Hongrie. Le territoire albanais était divisé entre différents clans dont le plus puissant était, au nord, celui de Jean Kastriota. Il fut vaincu et dut se déclarer vassal de l’Empire ottoman pour pouvoir continuer à gouverner la région depuis sa citadelle de Kroja. Mourad II profita ensuite de divisions entre les dirigeants serbes pour établir sa domination jusqu’aux rives du Danube, en s’emparant de Zvornik et Srebrenica. Pour prix de son allégeance au sultan, Jean Kastriota avait dû livrer son fils Georges comme otage, une situation qui correspondait généralement à un départ sans retour. Circoncis et élevé à la cour de Constantinople, le jeune garçon devint le favori du sultan Mourad II et l’un des meilleurs généraux de l’armée turque. Pourtant, le jeune général, connu bientôt sous le nom de Scanderbeg, allait se révéler, avec Jean Hunyadi, régent de Hongrie, l’un des piliers de la résistance à la progression ottomane.
Depuis 1440, les Ottomans occupaient Belgrade, verrou d’accès à la Hongrie dont elle faisait partie. Hunyadi commença par en chasser les Turcs puis renforça les fortifications de la ville. Ces derniers, en représailles, assiégèrent alors Sibiu en Transylvanie. Mais Hunyadi rassembla une armée où figuraient Ladislas, le jeune roi de Pologne, le Valaque Vlad Dracul, ainsi que Georges Brankovic, despote de Serbie, dont les alliances se révéleraient d’ailleurs fluctuantes2. Ils infligèrent aux Ottomans une lourde défaite avec la perte d’environ vingt mille hommes. Des renforts envoyés à la rescousse furent également écrasés. Cette position de force incita Hunyadi à passer à son tour à l’offensive. En 1443, à la tête de troupes nombreuses, il passa le Danube puis la Morava. C’est au cours de la bataille engagée pour reprendre Nich que le général de l’armée turque, Scanderbeg, passa avec trois cents autres Albanais aux côtés des chrétiens. Ces derniers reprirent ensuite Sofia, capitale de la Bulgarie.
Encouragés par ce succès, ils voulurent profiter de l’absence de Mourad II, parti réprimer les révoltes d’émirs turcomans d’Anatolie, pour poursuivre l’avantage sur terre et sur mer. Toutefois, bien qu’éloigné, le sultan selon une méthode traditionnelle chez les dirigeants turcs, s’employa à diviser ses adversaires. Il réussit à faire voler leur alliance en éclats. En 1444, Hunyadi et Ladislas de Pologne désormais isolés voulurent reprendre le port bulgare de Varna sur la mer Noire, mais ils furent écrasés par une armée ottomane nettement supérieure et le jeune roi Ladislas mourut sur le champ de bataille. Le pape et les Vénitiens avaient bien tenté de bloquer le détroit des Dardanelles, mais le sultan avait sollicité et obtenu, au grand scandale de la chrétienté, l’appui de la flotte génoise, ce qui fit échouer l’opération.
Constantin, dernier despote byzantin de Morée, en avait profité pour reprendre certains de ses anciens territoires. En 1447, Mourad II obtint sa soumission et occupa le Péloponnèse. Scanderbeg avait également employé ce répit pour organiser la résistance au nord de l’Albanie. Le sultan orienta donc sa nouvelle offensive sur lui tandis que, de son côté, Jean Hunyadi se préparait à venir prêter main-forte au chef des Albanais. Ayant appris en milieu de campagne que Hunyadi avançait dans sa direction, Mourad II se retourna contre lui. En octobre 1448, chrétiens et musulmans s’affrontèrent dans la plaine de Kosovo. L’Ottoman disposait de cent cinquante mille hommes et le Hongrois de vingt-quatre mille dont dix mille Valaques qui partirent avant la fin de la bataille. Le combat dura trois jours et se termina sur une sévère défaite des chrétiens. Le sultan s’attaqua alors aux dernières enclaves continentales de l’Épire qui résistaient encore. En 1449, Préveza, une position stratégique de première importance puisqu’elle commandait le golfe d’Arta (dit aussi d’Ambracie), fut prise. Ces derniers acquis achevèrent d’établir l’hégémonie de Mourad II sur la péninsule balkanique3.
Restait cependant Scanderbeg. L’année suivante, le sultan en personne se porta à l’assaut de Kroja, le nid d’aigle d’où l’indomptable défenseur de l’Albanie du Nord continuait à le narguer. Le siège ne dura pas moins de deux années (1449-1450) et se termina par l’abandon du sultan. En guise d’adieu, son arrière-garde fut écrasée sous des rochers lors de sa traversée d’un défilé. Peu après, en 1451, Mourad II décédait mais en laissant un Empire byzantin aux ailes définitivement rognées.
De Constantinople à Nègrepont
Son fils Mehmet II, dit « le Conquérant » (1451-1481), lui succéda. Il privilégia aussitôt la prise de la capitale byzantine, Constantinople. Afin de ne pas être distrait de son objectif, il eut recours aux armes ou à des négociations de paix séparées pour neutraliser ses adversaires potentiels. Une défaite définitive fut imposée au Caraman (gouverneur) d’Anatolie puis aux deux derniers despotes grecs du Péloponnèse, Thomas et Démétrios. Des traités furent signés avec le Serbe Brankovic, et le Hongrois Hunyadi.
En 1453, Mehmet II put s’enorgueillir, à vingt-quatre ans, d’avoir pris Constantinople. Tout son règne serait consacré à mener les conquêtes politiques et militaires que lui ouvrait cette victoire. La possession de la capitale de l’ex-Empire byzantin l’autorisait à se poser en héritier de celui-ci. Elle légitimait sa revendication des territoires de l’Empire lors de son extension maximale, sous le règne de Justinien, soit la rive occidentale de la Méditerranée jusqu’à l’Italie et la rive orientale jusqu’au Maroc. Avec Constantinople, le sultan disposait d’un port immense situé au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique qui lui permettait de se positionner sur l’échiquier méditerranéen. Une irruption qui allait, à terme, bouleverser entièrement les équilibres politiques, économiques et stratégiques de l’Europe.
Les deux campagnes de 1454 et 1455 concernèrent la Serbie. Novo Brdo au sud du pays fut prise. L’année suivante, en 1456, le sultan fit le siège de Belgrade, la clé de la Hongrie. Jean Hunyadi, grand capitaine devenu le régent du royaume, sauva la ville. Cependant, la Serbie proche était désormais sous contrôle ottoman, le Danube étant devenu la frontière entre les positions chrétiennes et musulmanes. Hunyadi mourut peu après, mais il fut remplacé par son fils, connu sous le nom de Mathias Corvin. D’une valeur égale à celle de son père, il poursuivit la résistance. Simultanément, la progression ottomane s’étendait en tache d’huile à partir de Constantinople. Mehmet II dépêcha une flotte qui s’empara d’abord de l’ancienne et la nouvelle Phocée, le principal centre de production d’alun, puis de la colonie génoise d’Enes, en Thrace, et enfin des îles de Samothrace, Imbros et Thassos, à l’entrée des Dardanelles. Une flotte fut bien envoyée par le pape Pie II et le roi de Naples Alphonse V, mais elle ne put les reprendre que temporairement. Athènes fut également occupée aux dépens du duc florentin Nerio Acciaiuoli.
En 1461, les Ottomans opérèrent en mer Noire. Les enclaves indépendantes de mer Noire, Asmara et Trébizonde, furent prises, ce qui permit aux Turcs de pousser vers la Valachie. Cette avancée provoqua la réaction du Valaque Vlad Dracul, qui répondait à la terreur par la terreur dans les territoires ottomans de Bulgarie. Il fut finalement défait et les Ottomans prirent le contrôle de cette zone.
Le but de la campagne suivante était déjà fixé : le retour dans les Balkans. Le jeune roi de Bosnie, Stefan Tomasevic, vassal de la Hongrie, en appela au pape : « J’ai été informé que Mahomet, empereur des Turcs, m’attaquerait l’été prochain et qu’il avait déjà préparé ses troupes et ses machines de guerre. Je ne suis pas en mesure de résister à une telle offensive. J’ai prié les Hongrois, les Vénitiens et Georges d’Albanie [Scanderbeg]. Je ne te demande pas des montagnes d’or. Je veux que mes sujets comme mes ennemis sachent que ton aide ne peut me faire défaut4. » Stefan Tomasevic ne reçut aucun secours. La Bosnie passa sous domination ottomane. L’Herzégovine suivit. Ces territoires ajoutés à la Serbie amenaient les Turcs, dès 1466, jusqu’au bord de la Save, c’est-à-dire à la frontière de la Hongrie, tandis que la prise de Bar où ils édifièrent aussitôt une puissante forteresse leur ouvrait une porte sur l’Adriatique5.
La menace qui pesait désormais sur l’Adriatique provoqua la réaction militaire de Venise. Côté européen, le doge trouva prêts à le suivre le pape Pie II, le duc Philippe de Bourgogne, Mathias Corvin, le fils de Jean Hunyadi, et l’Albanais Scanderbeg. Tous espéraient un effet d’entraînement sur les autres princes chrétiens. Rien ne vint. Seuls les opposants orientaux au sultan se déclarèrent disposés à se soulever si l’occasion leur en était donnée. En octobre 1463, les cinq coalisés déclaraient la guerre à Mehmet II. Celui-ci plastronnait : « J’épargnerai à de faibles vieillards la fatigue du voyage en mer ; je sortirai le premier sur le champ de bataille et j’irai les chercher dans leurs propres maisons ; là, s’ils le veulent, ils me disputeront l’Empire. » Trois vieillards, en effet : le doge de Venise avait soixante-douze ans, Philippe de Bourgogne n’était plus en état de voyager et le pape Pie II mourut à Ancône le 15 août 1464, avant même de prendre la mer. Juste à temps. Si les croisés étaient partis pour l’Orient, ils auraient été écrasés. Pour arrêter Mehmet II, ce n’était plus une croisade qu’il fallait, mais un engagement total dans une guerre laïque et pragmatique. L’Occident était encore loin d’y être prêt.
La tentative de Venise pour reprendre l’île de Mytilène échoua. Mathias Corvin ne put garder longtemps les positions qu’il avait reprises aux Turcs. De son côté, Scanderbeg, à nouveau confronté à une attaque, dut s’enfermer dans sa citadelle de Kroja où il se retrouva encerclé. Il mourut peu après, épuisé, le 17 janvier 1468. Il faudrait pourtant encore dix ans aux Ottomans pour achever de prendre pied à pied le littoral albanais.
Première confrontation entre les flottes de Mehmet II
et de Venise
Les Ottomans étant mobilisés contre Scanderbeg, Venise en profita pour effectuer des raids autour de Thessalonique. Des représailles furent décidées et Constantinople se donna les moyens de réussir sans coup férir. Une puissante armée, dite d’Europe, forte de quatre-vingt mille hommes ainsi qu’une flotte estimée à quatre cents navires furent rassemblées. Elles étaient placées sous le commandement de Gedik Ahmed Pacha, un Albanais. En effet, les Ottomans mettaient toujours à la tête de leurs expéditions un chef originaire du pays concerné par la campagne.
Au début de juin 1470, l’armée et la flotte quittaient Constantinople. Leur destination était Nègrepont, nom donné à l’île d’Eubée, le centre commercial, militaire et administratif de « l’empire du Levant » de la Sérénissime. Dans une lettre au Sénat, un capitaine de galères vénitien, basé à Corfou, insistait sur l’importance capitale de l’enjeu : « Maintenant, il faut que notre Signoria montre sa force. Elle doit négliger tout le reste et envoyer immédiatement la totalité des navires, des hommes, des provisions et de l’argent qu’elle peut réunir ; sinon Nègrepont courra un grave danger et si Nègrepont tombe, avec lui tombera notre empire oriental, y compris même l’Istrie voisine. Car l’année prochaine, le Turc sera une fois et demie plus puissant et enhardi par le présent succès6. »
Venise ne put, en un laps de temps aussi bref, réunir plus de soixante-dix voiles. Le provéditeur Da Canal qui les conduisait serait ensuite convaincu de trahison pour n’avoir pas mieux résisté. Mais que pouvait-il faire contre des forces si nettement supérieures, d’autant plus que ses équipages étaient affolés par les cris aigus et le son assourdissant des trompettes et des buccins musulmans ? L’île d’Eubée n’est séparée de la terre que par le mince détroit de l’Euripe : un pont de barges accolées permit aux troupes ottomanes de déferler sur Chalcis, la capitale. Mehmet II y fit peu après son entrée solennelle. Il venait de démanteler l’organisation commerciale vénitienne et de gagner deux cents kilomètres de côtes supplémentaires. Kemal raïs (ou Camali bey), le Camali des chroniques, fit dans ces circonstances preuve de ses qualités. Il allait devenir le premier homme de mer de Constantinople.
La prise de Nègrepont n’était que la première étape de la campagne. Mais les opposants orientaux du sultan en profitèrent pour passer à l’action. L’attaque d’Ankara par un émir anatolien, Kasim bey, obligea Mehmet II à regagner sa capitale. D’autres potentats liés à la Perse se révoltaient aussi. Pour les aider, les Vénitiens tentèrent en 1473 des raids sur Izmir, Antalya et brûlèrent en partie l’arsenal de Gallipoli. Mais Mehmet II rappela Gedik Ahmed Pacha qui vint étouffer la rébellion en Anatolie, cette fois à jamais, et le sultan gagna ainsi une nouvelle étendue de côtes. Un allié des Perses s’étant révolté à Sinope sur la mer Noire, Mehmet II y dépêcha ses armées et sa flotte en 1475. Les Génois perdirent Tana sur la mer d’Azov et Caffa sur la mer Noire, mettant une fin définitive aux liaisons commerciales entre Gênes et ces deux mers. Le sultan put alors reporter son action sur le bassin oriental.
En 1477, le sultan envoya l’armée d’Europe et sa flotte sur le golfe de Corinthe. Lépante (Navpaktos) fut attaquée. En même temps, Gedik Ahmed Pacha faisait le blocus de Kroja, où les partisans de Scanderbeg résistaient encore, ainsi que de la ville proche de Shköder (Scutari), sous tutelle vénitienne. La quasi-totalité des côtes albanaises était désormais sous contrôle ottoman. Des troupes fraîches arrivaient par vagues successives. La Sérénissime, épuisée financièrement et militairement, n’avait plus les moyens de résister. Un traité signé avec la « Sublime Porte » en janvier 1479 mit fin à seize ans de guerre. Venise accepta de payer un lourd tribut pour sauvegarder son commerce dans le Levant. Elle remit les clés de la ville de Shköder et renonça définitivement à Valona, une position stratégique et économique de première importance située à l’une des extrémités du canal d’Otrante. À l’autre extrémité du canal se trouvait le royaume de Naples. C’était la voie choisie par Mehmet II, désormais maître de l’Albanie et du Péloponnèse, pour entrer en Italie.
Les îles Ioniennes
Gedik Ahmed Pacha, après avoir renforcé les fortifications de Valona, s’employa à convertir en bases arrière les îles Ioniennes. Dès lors, ces dernières allaient avoir pour plusieurs siècles une histoire fort différente. Corfou était le port d’attache de la flotte des Vénitiens, d’où ils pouvaient exercer une surveillance sur l’Adriatique, « leur » golfe. Ils y avaient dressé une citadelle considérée comme la plus puissante de Méditerranée. En revanche, les autres îles étaient les seules positions du despotat d’Épire encore aux mains des Tocco. Or, basé à Préveza, Gedik Ahmed Pacha n’était qu’à quelques milles de la forteresse de Santa Maura bâtie sur l’eau par les Byzantins, le verrou qui séparait l’île de Leucade du continent. Il s’en empara et poursuivit l’offensive sur l’île de Céphalonie. En dépit de la résistance farouche des habitants, la capitale, Agios Georgios, ville fortifiée à l’époque byzantine, tomba à son tour7. L’île de Zante suivit et son castel byzantin fut entièrement rasé. L’île fut peu après cédée aux Vénitiens pour « bonne conduite », mais ils durent s’engager à ne jamais remonter les fortifications. Les bases dont disposaient désormais les Ottomans leur permettraient des représailles immédiates si la Sérénissime sortait de sa neutralité, ou même en donnait le soupçon.
Les galères de Venise s’effacèrent, en effet, quand l’année suivante, en 1480, Gedik Ahmed Pacha traversa le canal d’Otrante. Il débarqua et s’empara de la citadelle éponyme en n’y laissant aucun survivant. De là, les raids commencèrent sur Brindisi, Tarente et Lecce. Le représentant de la communauté marchande vénitienne de Constantinople, Andrea Gritti, aurait, dit-on, assuré à Mehmet II qu’il était en droit d’occuper la Pouille, ancienne possession de l’Empire byzantin dont le sultan se disait l’héritier.
Les circonstances ne le lui permettraient pas. Sans doute, le sultan souhaitait-il clore la conquête du bassin oriental avant d’entreprendre celle du bassin occidental. Toujours est-il qu’en cette même année 1480, Mehmet II en personne arriva avec sa flotte devant l’île de Rhodes, fief des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem qui se refusaient à lui payer tribut. Mais le grand maître de l’ordre, Pierre d’Aubusson, était un adversaire coriace. Il infligea à Mehmet II le premier échec de sa carrière. L’année suivante, celui-ci préparait une nouvelle offensive quand il mourut « au moment où on s’y attendait le moins », dira Machiavel. Ses deux fils, Djem et Bajazet entrèrent dans une guerre de succession. Rappelé à Constantinople, Gedik Ahmed Pacha restitua Otrante au roi Ferrant Ier de Naples moyennant une somme exorbitante.
Cependant, la présence des Ottomans aux portes de l’Adriatique menaçait désormais la liberté de naviguer et la sécurité des côtes occidentales. Leur sauvegarde exigeait, pour les deux États riverains qu’étaient la France et l’Aragon de disposer d’une puissance maritime. Les conditions pour accéder à celle-ci sont, on le sait, de disposer d’un État solide, de ressources financières importantes et d’une vaste étendue littorale. La compétition entre les deux nations pour s’approprier les positions côtières occidentales était déjà ouverte par Maisons d’Anjou et d’Aragon interposées. Elle venait de susciter des conflits violents pour la possession de la Cerdagne, du Roussillon et de la Catalogne. Néanmoins, dans le domaine maritime, les nations ibériques avaient une nette avance.
La Reconquista du royaume de Grenade
La conquête de la Méditerranée avait été le but constant des rois d’Aragon. À partir de leurs trois États – Aragon, Valence et Catalogne –, ils avaient absorbé le royaume de Majorque qui comprenait, à la mort de Jaime Ier (1276), les Baléares, le Roussillon, la Cerdagne et Montpellier. Ils avaient arraché la Sicile aux Anjou (1285), Athènes et les Dardanelles à Byzance (1326), la Sardaigne aux Génois (1354). L’expansion aragonaise fut couronnée par la conquête du royaume de Naples où, en 1444, Alphonse V, dit le Magnanime, élimina du trône la Maison d’Anjou. Il se plut dans ses nouvelles possessions au point de s’y fixer. Le nouveau souverain choisit l’île d’Ischia comme siège de son pouvoir personnel et la fortifia pour en faire le bastion aragonais par excellence.
Après la chute de Constantinople, Alphonse V s’associa à la grande expédition que préparait le pape Pie II pour reprendre la capitale byzantine, mais la mort le surprit en 1458. Ses possessions ibériques, Aragon, Valence et la Catalogne, revinrent à son frère Jean II, auquel allait bientôt succéder Ferdinand d’Aragon, et le royaume de Naples, à son fils bâtard, Ferrant, les deux héritiers restant indéfectiblement liés.
La Castille, quant à elle, disposait depuis le XIIe siècle d’une marine militaire basée à Séville. La guerre de Cent Ans, en affaiblissant ses rivaux économiques anglais et français, facilita son irruption sur la place de Bruges où la ligue hanséatique détenait une position hégémonique en mer du Nord. Ensuite, la guerre de 1463-1479 entre les Ottomans et les Vénitiens avait permis de prendre, aux dépens de ces derniers, ce que nous appellerions aujourd’hui des parts de marché en Angleterre et en Flandre. La Castille entretenait par ailleurs des relations étroites avec le Portugal voisin dont les navigateurs poussaient leur avancée sur les côtes d’Afrique. Ainsi la péninsule Ibérique tendait-elle à devenir la première puissance maritime européenne.
En 1474, la reine Isabelle, avec la fermeté dont elle ferait preuve durant tout son règne, monta sur le trône de Castille. Elle se choisit pour époux Ferdinand d’Aragon. En 1479, alors même que Venise abdiquait face à l’Empire ottoman, il accédait lui-même au trône d’Aragon. Solidaires, chacun d’eux conservait le gouvernement de son État. « Où l’un monte, l’autre monte » serait leur devise. L’Espagne venait de naître. Dès l’année suivante, en 1480, les deux souverains lançaient la Reconquista de l’émirat de Grenade, dernière enclave musulmane de la péninsule Ibérique. L’objectif poursuivi était de souder l’unité nationale et territoriale de l’Espagne, de mettre un terme aux attaques des pirates qui entravaient le commerce et de s’assurer des cinq cents kilomètres de côtes qui séparaient les façades maritimes castillane et aragonaise.
Dix ans seraient nécessaires pour l’emporter, une longue confrontation pendant laquelle deux capitaines allaient asseoir leur réputation. Le premier, Gonzalve de Cordoue, cadet de famille andalou, deviendrait le généralissime, dit aussi le Gran Capitan, commandant en chef des armées d’Espagne. Le second était un Biscaïen d’obscure naissance, Pedro Navarro, militaire moins brillant mais ingénieur de talent. Ses services seraient d’autant plus convoités par les puissants du temps que, pour avoir pratiqué la guerre de course tant chez les chrétiens que chez les musulmans, il avait appris de ces derniers une technique qu’ils gardaient secrète : celle du maniement des mines. Navarro ne la transmettrait à personne et, de ce fait, se rendrait indispensable. Quand il ouvrit une brèche, le 27 avril 1487, dans les remparts de la forteresse de Velez à proximité de Malaga, l’émir Abou Abdallah, le « Boabdil » des chroniques, s’affola.
Kemal raïs dans le bassin occidental
L’année précédente, l’émir de Grenade avait fait appel à Bajazet II, lequel avait finalement succédé à son père sur le trône ottoman. Le sultan avait donc dépêché sur place le vainqueur de Nègrepont, Kemal raïs, ce que confirme un texte turc : « Dans cette année 891 de l’Hégire [1486], arriva une lettre du maître de l’Andalousie qui demanda de l’aide contre les incroyants, et, avec le message une casside [poème] dans la langue des Andalous, qui suppliait le sultan Bayezid Chah de l’aider et de le sauver des mains des ennemis de la foi, lui, ses enfants, ses parents et son pays. Sultan Bayezid Chah en eut pitié et promit de prendre position en sa faveur et de l’aider. Quand arriva l’année 892 [1487], il arma une grande flotte pour attaquer le pays des infidèles […]. Le capitaine Kemal Rei’s, explorateur de la mer, se mit alors en route, enleva des navires aux Francs et arrivant jusqu’à Malaga, prit possession de cette ville, détruisit ses constructions, mit en flammes les villages avoisinants, pilla les biens et fit prisonniers de nombreux habitants8. »
On peut considérer qu’à partir du règne de Bajazet II, il n’y a plus de distinction entre la flotte ottomane et une flotte corsaire. Kemal raïs arriva dans le bassin occidental sans ordre précis, avec un objectif fixé et la liberté des moyens à employer pour y parvenir : l’exacte définition de l’activité corsaire. Il allait donner le ton aux actions navales du siècle à venir fondées sur la rapidité et la mobilité. Les hommes de mer occidentaux devraient s’adapter à cette tactique et ces pratiques. Ils auraient les mêmes relations avec leurs souverains et, à peu de chose près, le même mode opérationnel.
Toujours en mouvement, le raïs surgissait en Corse, aux Baléares ou en mer de Pise, razziait des vivres, prélevait la population jeune, femmes et adolescents, puis brûlait la place avant de disparaître. Tandis que l’étau se resserrait sur Grenade, il effectuait des rotations avec le Maghreb, appelé alors la Barbarie, pour y conduire les Maures andalous qui s’enfuyaient. Au passage, il canonnait les ports d’Elche, de Malaga et d’Almeria, dont les Espagnols venaient de s’emparer. Cependant, le raïs n’était pas en mesure de s’attaquer directement à la flotte importante dont disposait déjà l’Espagne, notamment au contingent du Guipúzcoa (le Pays basque) qui sillonnait les côtes d’Afrique du Nord pour empêcher l’arrivée de secours. Après une longue résistance, l’émir de Grenade, Abou Abdallah, fut finalement vaincu. Quand il quitta sa terre natale pour un exil définitif, c’est à bord d’un vaisseau espagnol qu’il gagna le Maghreb.
Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille firent leur entrée solennelle dans Grenade en janvier 1492. Sans doute n’ignoraient-ils déjà plus que le problème n’était que déplacé. Le détroit de Gibraltar n’était pas long à traverser et l’Andalousie désormais espagnole serait menacée dès qu’ils baisseraient la garde. Le contrat de Christophe Colomb serait signé trois mois plus tard9. Ce dernier s’engageait à chercher au-delà des océans de nouvelles sources de richesses et un autre accès à l’Inde. La traduction en termes politiques était la suivante : trouver de l’argent pour, entre autres, poursuivre la guerre contre les musulmans et une voie qui permette de les prendre à revers. Il allait ainsi découvrir le Nouveau Monde.
Un projet d’offensive sur Constantinople
La disparition de Mehmet II permettait d’envisager une offensive sur Constantinople. En 1491, tous les princes chrétiens, sauf Venise, désormais liée à l’Empire ottoman, furent réunis à Bologne par le pape Innocent VIII. Le projet portait le nom de croisade puisque le pape en était le promoteur. Il était grandiose : cent vingt mille hommes devaient déferler sur la Turquie par le Péloponnèse. Une partie d’entre eux devait prendre la voie de mer. Mathias Corvin de Hongrie étant décédé, le souverain le mieux placé pour diriger les opérations était Charles VIII de France10.
En 1481, alors même que l’Espagne engageait la conquête des côtes andalouses, le roi Louis XI avait annexé la Provence, possession de la Maison d’Anjou. La France avait jusqu’alors pour seule ouverture sur la Méditerranée le port d’Aigues-Mortes, qui s’ensablait inexorablement. Elle disposerait désormais de Marseille, port traditionnel de galères, et de Toulon, auquel la profondeur de son bassin permettait d’abriter les grandes nefs.
La mort empêcha Louis XI de profiter de ces atouts, mais sa fille, Anne de Beaujeu, régente du royaume, poursuivit sa politique. En 1488, les Bretons perdirent leur indépendance à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et l’héritière du duché, Anne de Bretagne, fut mariée d’office au futur Charles VIII de France. Celui-ci accéda au trône en 1491. Il bénéficiait dorénavant d’une étendue littorale accrue, de la tradition bretonne en matière de nefs et de la compétence des Provençaux dans le domaine des galères. À la tête d’une nation prospère, peuplée et avancée dans sa constitution, son titre de « Très Chrétien » semblait en outre le désigner comme le défenseur naturel de l’ensemble qui se définissait alors comme la chrétienté.
À peu de temps de là, Innocent VIII et le duc de Florence, Laurent de Médicis, dit le Magnifique, moururent à peu près en même temps. Une fois disparues les deux autorités médiatrices de l’Italie, l’expansion aragonaise reprit depuis le sud. Le cardinal Rodrigo Borgia, Aragonais de naissance, accéda à la tiare sous le nom d’Alexandre VI. Le successeur de Laurent de Médicis, son fils Pierre, personnage attachant mais sans consistance, ne sut pas garder la république de Florence à l’écart de la zone d’influence de Ferrant Ier d’Aragon. Ce dernier qui briguait la première place en Italie convoitait désormais le duché de Milan.
L’engrenage
L’engrenage qui amènerait l’Italie à passer sous domination étrangère se mit en marche à Gênes. Contrairement à Venise, la République ligure n’avait pu conserver ses privilèges commerciaux avec l’Empire ottoman. La puissante flotte, fondement de sa prospérité, restait inutilisée. Les tensions s’aiguisaient entre les deux factions, en fait deux groupements d’intérêts, qui se disputaient traditionnellement le gouvernement de la cité, les Fregosi et les Adorni.
Les premiers, les Fregosi, associés à une grande famille, celle des Doria, étaient les tenants d’une politique axée sur le commerce maritime. Les Adorni recrutaient surtout leurs partisans chez les artisans. Ils étaient liés à deux familles importantes de l’aristocratie terrienne, les Spinola et les Fieschi. Le chef de cette dernière Maison était Gian Luigi Fieschi, personnage central de la scène politique génoise. Il semble que ce soit lui qui ait placé, en 1488, la Ligurie sous la protection, donc sous la tutelle, de Gian Galéas Sforza, duc de Milan en titre. Or, ce dernier n’était qu’un homme de paille entre les mains de son oncle et tuteur, Ludovic Sforza, dit Ludovic le More, qui de facto exerçait le pouvoir sur le duché de Milan. En récompense, Gian Luigi Fieschi reçut de Ludovic le gouvernement de Gênes en partage avec la faction Adorni. Tandis que le commandement des forces terrestres revenait, comme c’était la tradition, à un membre de la famille Spinola, Fieschi réclama et obtint la charge d’amiral de la flotte génoise. Il avait compris avant l’heure qu’être maître de la flotte, c’était être maître de la ville.
Pour Ludovic le More, le premier objectif était d’être reconnu officiellement comme duc de Milan. Il devait également faire atteindre à son État la taille critique nécessaire pour tenir le rang auquel il aspirait, celui d’arbitre entre les puissances italiennes. Il lui fallait enfin, pour se maintenir à Gênes, relancer l’activité du port, en déclin depuis la perte des possessions génoises dans le Levant et en mer Noire. En outre, Ludovic souhaitait mettre fin à l’ingérence dans ses affaires internes de Ferrant Ier de Naples, lequel avait multiplié à cette fin les liens familiaux avec les Sforza, d’abord en faisant épouser à son fils, Alphonse de Calabre, une des filles de cette famille, et ensuite en unissant sa petite-fille Isabella au falot Gian Galéas. Toutefois, la capacité militaire de Ludovic le More n’était pas à la hauteur de ses ambitions. Il lui fallait donc l’appui d’une puissance étrangère. Et quel meilleur compétiteur à opposer à Ferrant Ier, soutenu par l’Espagne, que Charles VIII de France ? Ce dernier allait ainsi se trouver entraîné dans les intrigues et les combinazione propres à l’Italie, mais qui se répandraient bientôt dans l’Europe entière.
Il restait dans le royaume de Naples une faction nombreuse et puissante se réclamant de la Maison d’Anjou, menée par des aristocrates que l’on nommait les « barons ». Mais, depuis la restitution d’Otrante, le sinueux Ferrant Ier leur gardait rancune de s’être montrés peu solidaires lorsqu’il avait fallu réunir une somme considérable pour récupérer la ville. Aussi, les Aragonais jouissaient-ils d’une faveur grandissante aux dépens des « Angevins ». Il ne fut donc pas très difficile à Ludovic le More de pousser ces derniers à fomenter une conspiration. Informé par ses espions, Ferrant Ier se livra sur les barons à de sanglantes représailles à titre préventif. À la tête des rescapés, désormais bannis et privés de leurs charges et de leurs terres, figurait le clan des Sanseverini, dont le chef, Antonello, prince de Salerne, était ex-amiral de la flotte aragonaise. En vue de prendre le pouvoir à Naples, ces derniers allaient en appeler à Charles VIII, roi de France, leur défenseur naturel au titre d’héritier de la Maison d’Anjou. Sur ces entrefaites, Ludovic Sforza envoya l’habile comte de Belgiojoso – Beljoyeuse diraient les Français – transmettre au roi une invitation officielle pour se rendre à Gênes, mettant à sa disposition les équipements du port et la flotte, ainsi qu’un crédit illimité auprès des banquiers de la cité.
Deux personnages pèseraient lourdement sur la décision royale. Ils appartenaient à la bourgeoisie marchande et financière dont Louis XI, père de Charles VIII, s’était entouré. Le premier, Étienne de Vesc, jadis le précepteur du roi, avait gardé tout pouvoir sur lui. Le second, Guillaume Briçonnet, évêque de Saint-Malo, était le général des Finances du royaume. Grassement rétribués pour cela, tous deux poussèrent le jeune et influençable roi de France à intervenir en Italie. Étienne de Vesc partit explorer les archives de Beaucaire dont il était le sénéchal pour y retrouver trace des droits de la Maison d’Anjou sur le royaume de Naples. Charles VIII, contre l’avis de membres de son conseil, décida de sauter le pas.
Les préparatifs de « l’entreprise »
Pour éviter d’être attaqué en son absence, le roi de France signa avec l’Angleterre, l’Autriche et l’Espagne des traités coûteux en argent et en territoires. L’Artois fut restitué à Maximilien d’Autriche, la Cerdagne et le Roussillon à Ferdinand d’Aragon. Dans le même temps, en 1493, un banni angevin du nom de Perron de Baschi partit préparer le terrain diplomatique en Italie. Les assurances de soutien qu’il recueillit étaient des plus vagues, mais, au titre d’intendant de la future expédition, il les valorisa fortement. Le plus réticent avait été le pape Alexandre VI11, mais il n’était pas en mesure de s’opposer au projet. Il allait, pour faire contrepoids, doter l’Espagne de deux atouts majeurs : l’un, économique, en partageant entre elle et le Portugal les terres du Nouveau Monde que l’on venait de découvrir ; l’autre était d’ordre politique. Sous son aspect honorifique, le titre de « Rois catholiques » décerné à Ferdinand et Isabelle d’Espagne les autorisait à contester au « Très Chrétien » roi de France sa position dominante.
La Provence n’était annexée que depuis peu. Les Marseillais étaient indépendants, chauvins et jaloux de leurs prérogatives. Au moindre litige, ils ne manqueraient pas de présenter au pouvoir royal le gros « Livre des privilèges12 ». Ils retireraient des guerres d’Italie de grands profits mais aussi de graves ennuis. Marseille, traditionnellement port de galères, servirait de base arrière aux guerres d’Italie. La ville avait déjà un statut de port franc sous les comtes de Provence. On disait d’elle que c’était une succursale de Gênes avec laquelle elle avait en commun les pratiques commerciales, et dont nombre de ses citoyens étaient originaires. Au conseil de ville, où les rivalités de clans n’étaient pas absentes, le parti le plus puissant était celui des négociants armateurs corsaires. Le roi allait se servir d’eux et ils allaient servir le roi avec fidélité et compétence. Quant à Toulon, elle deviendrait le grand port de guerre qu’elle est encore aujourd’hui et ses citoyens s’enrichiraient grâce aux lourdes taxes qu’ils imposaient aux « étrangers », c’est-à-dire à tout le monde hormis eux-mêmes.
Ce sont des armateurs provençaux qui mettraient sur pied, en 1496, les Galères du Levant. Leur chef, Prégent de Bidoux, ne ferait confiance qu’à des Provençaux comme capitaines mais aussi comme rameurs. Partageant ses services entre les rois de France et l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, il allait s’affirmer comme un acteur de premier plan sur la scène méditerranéenne. Craint des Génois, des Anglais, des Turcs et des « Barbaresques », respecté des Espagnols, redouté ou apprécié des Vénitiens selon qu’il combattrait contre eux ou à leurs côtés. Ses qualités hors pair d’homme de guerre et de marin auraient dû le placer, si elles n’étaient pas méconnues sinon ignorées, à rang au moins égal avec un Jean Bart, un Duguay-Trouin ou un Surcouf dans l’histoire de la Marine française.
Quand on évoque la Renaissance, viennent aussitôt à l’esprit la floraison artistique, les germes de l’humanisme et les Grandes Découvertes. Mais qu’en est-il de l’affrontement majeur qui a contribué à l’établissement des équilibres et des fractures des Temps modernes : la guerre navale pour l’hégémonie en Méditerranée ? Pendant près d’un demi-siècle, sur fond de renversements d’alliances, les Galères de France, armées par des entrepreneurs marseillais, firent face, tour à tour ou simultanément, aux Espagnols, aux Génois, aux Vénitiens, aux forces de la papauté, aux Turcs et aux « Barbaresques », et même aux Anglais. Il fallait permettre aux lecteurs de ne pas se perdre dans l’enchevêtrement des situations et dans la dispersion des lieux de confrontations. Aussi l’auteur s’est-elle attachée à suivre une chronologie précise comme à inscrire les faits dans une évolution politique générale qui donne sens à cette facette mal connue, voire méconnue, de la Renaissance : celle des poursuites, des abordages, des sièges, des débarquements et des villes mises à sac, celle du choc des armes et du fracas des canons. Le style, enlevé et imagé, est au diapason de l’âpreté des affrontements et de l’incroyable énergie de ces protagonistes hors du commun que l’on pourrait croire sortis d’un ouvrage de fiction s’ils n’étaient tout simplement les héros des mémoires, correspondances et ouvrages historiques que l’auteur a minutieusement interrogés.
Édith Garnier est diplômée d’histoire maritime à l’École pratique des hautes études. Ses travaux portent sur les conflits opposant les grandes puissances en Méditerranée au XVIe siècle. Elle prépare un ouvrage consacré à « l’alliance impie » nouée contre Charles Quint entre le roi de France, François Ier, et le sultan de Turquie, Soliman le Magnifique.
"[...] Dans cette évocation haute en couleur, l'historienne ressucite l'incroyable violence des combats navals et explique avec pédagogie les ressorts des multiples retournements d'alliance. Où l'on découvre la figure d'un stratége hors pair: Prégent du Bidoux, cheville ouvrière de cette flotte de galères, qui redora le blason de la France." La Tribune, 27 Janvier 2006