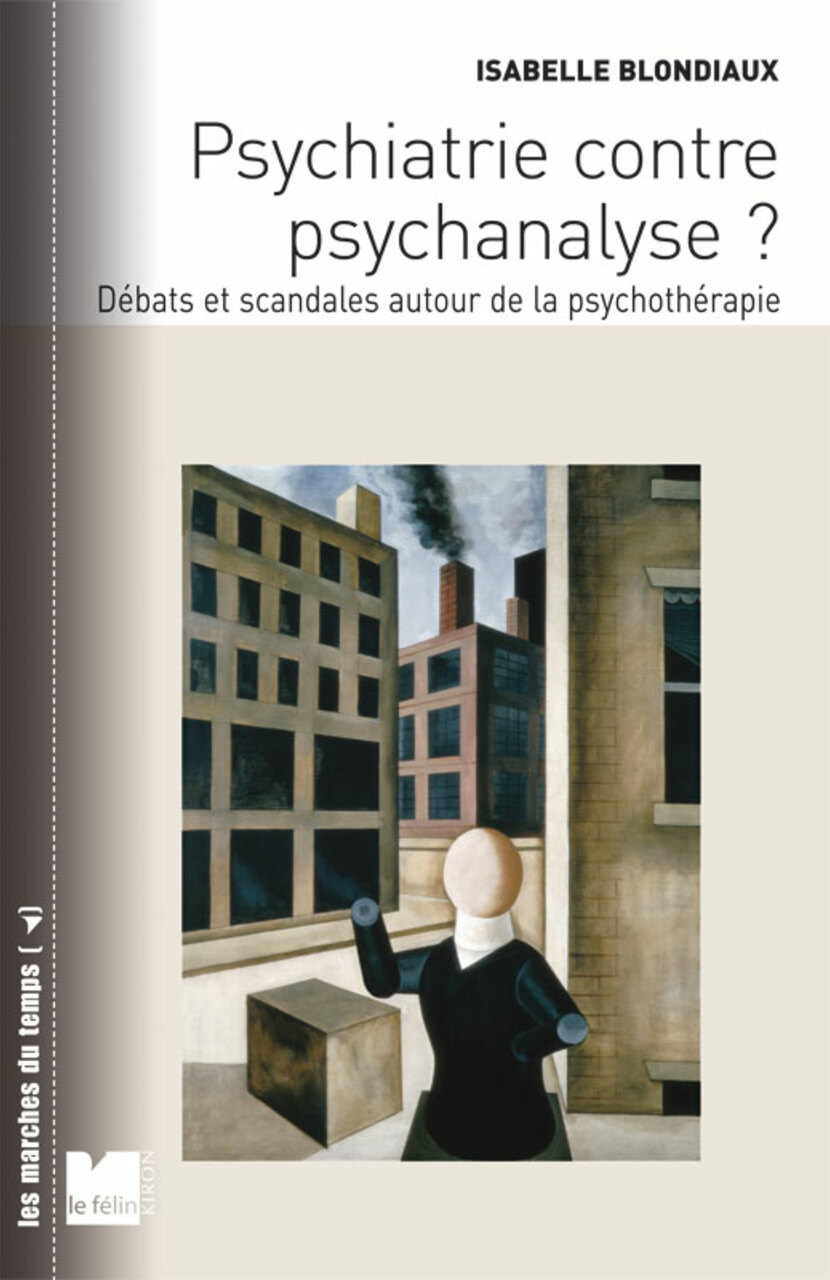
Psychiatrie contre psychanalyse ?
En Occident, c’est dans l’Antiquité grecque que la première question trouve son origine, lorsque la philosophie naissante s’est voulue une médecine de l’âme, réservant les soins du corps à la médecine. Et c’est au tout début de l’ère chrétienne qu’apparaissent les premiers thérapeutes. Leur ambition est de se vouer au culte de l’Être, en soignant leur âme comme on soigne le corps. Pour eux, le «thérapeutique» imite le médical et se met au service du religieux.
Dès lors, on comprend mieux que les pratiques apparues à la fin du xixe siècle sous le nom de «psychothérapie», et qui n’ont cessé de proliférer depuis les années 1960, fassent aujourd’hui figure de nébuleuse dont les frontières avec la médecine, la philosophie et le religieux sont mal définies. Tout comme s’explique, surtout lorsqu’elles sont confondues avec «une vie, mode d’emploi», qu’elles soient parfois difficiles à différencier de pratiques charlatanesques. Bornées d’un côté par la médecine, inséparablement diagnostic et traitement, et de l’autre par des entreprises charlatanesques, toutes ces méthodes, indépendamment de leurs particularités, mettent en jeu la même question: le thérapeutique est-il ou non réductible au médical?
La publication en février 2004 d’un rapport INSERM sur l’évaluation des psychothérapies et la promulgation, quelques mois plus tard, d’une loi de santé publique visant à encadrer l’usage du titre de psychothérapeute ont fait resurgir cette interrogation dans toute son acuité. Une très vive polémique, dont le retentissement en France a été largement médiatisé, opposait alors les promoteurs des thérapies cognitives et comportementales, favorisées par le rapport INSERM, aux défenseurs de la psychanalyse. En témoigne la publication de nombreux ouvrages, dont Le Patient, le Thérapeute et l’État en 2004, Le Livre noir de la psychanalyse en 2005 et L’Anti-livre noir de la psychanalyse en 2006.
Mais si la psychanalyse était ouvertement attaquée, la psychiatrie apparaissait également visée. Pour l’opinion, cette guerre sans merci entre factions adverses était caractéristique du déchirement de cette dernière entre des logiques irréconciliables. Pour certains, la psychiatrie était même devenue à la médecine ce que les Balkans sont à l’Europe: un ensemble de petits territoires explosifs et querelleurs, toujours au bord de la guerre. En titrant «Querelle publique au sujet de l’identité de la psychiatrie1 » un article de synthèse, le quotidien Le Monde officialisait ce point de vue. La polémique autour de la psychanalyse et des thérapies cognitives devait être comprise comme le symptôme d’une crise d’identité de la psychiatrie à la fois plus ancienne et plus profonde.
De fait, première discipline en France à être devenue une spécialité médicale, la psychiatrie est un champ en perpétuel mouvement. Après s’être organisée autour de trois axes ou «paradigmes» successifs: l’aliénation mentale, les maladies mentales et les structures psychopathologiques2, elle a connu une diversification considérable de ses références théoriques et des pratiques s’en réclamant. C’est ainsi que dans les années 1960 elle a quitté l’univers clos de l’hôpital psychiatrique pour s’implanter sur le «secteur» et étendre son activité au champ social. Dans le même temps, elle s’est installée à l’hôpital général et a élargi son domaine d’action à la «psychologie médicale», s’intéressant notamment au retentissement psychique des pathologies somatiques.
Par ailleurs, depuis les années 1990, sans renoncer à sa mission traditionnelle de contribution à la régulation de l’ordre public par la prise en charge des sujets dangereux: délinquants sexuels et malades mentaux potentiellement criminels, elle ne cesse d’accroître sa pénétration dans le champ social. Tandis qu’avec la création de «cellules psychologiques de crise» elle s’est vu attribuer le suivi des traumatismes collectifs, avec la prise en charge des situations de précarité et d’exclusion elle renoue avec l’accueil des indigents. Elle remplit par ailleurs une fonction très médiatisée d’expert en art de vivre.
La psychiatrie couvre donc aujourd’hui un vaste domaine aux limites mal déterminées dont les deux pôles principaux sont constitués par les neurosciences et les sciences humaines. Ce flou des limites, en rendant impossible la mise en œuvre d’un modèle théorique cohérent et unifié pour rendre compte de pratiques diversifiées à l’extrême, est à l’origine de l’incapacité contemporaine de la discipline à se doter du quatrième paradigme dont Georges Lantéri-Laura déplorait l’absence.
Mais les profondes mutations dont elle fait l’objet ne relèvent pas seulement d’une évolution interne de la discipline, elles s’inscrivent aussi dans le contexte d’une crise plus générale, à la fois politique et économique qui, par l’intermédiaire de la mise en question du système de soins et de son organisation, agite le monde de la santé. Corrélative de l’assimilation de la notion de demande à celle de besoin, et de l’insuffisance obligée des moyens de répondre à une demande en inflation perpétuelle, cette crise de la médecine devenue chronique n’est pas sans liens avec l’introduction par la Charte de l’OMS de 1946 de la notion d’un droit à la santé en lieu et place de la notion traditionnelle de droit aux soins. Ce développement d’un concept de «santé positive», où la santé se définit par un «état de bien-être complet, physique, psychique et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité1 », est marqué en psychiatrie par le passage à la notion de «santé mentale» qui, à côté de l’obligation traditionnelle de traitement des maladies mentales, lui assigne la mission inédite de promouvoir le mieux-être de la population prise dans son ensemble.
Les conséquences de ce changement de vocabulaire sont donc loin d’être anodines. D’une part, comme c’est le cas pour l’ensemble de la médecine, il entraîne une croissance exponentielle des demandes adressées à la discipline dans les domaines les plus divers, avec pour conséquences une surcharge de travail non nécessairement compensée par l’attribution de moyens supplémentaires, et une augmentation des dépenses de santé. D’autre part, en inversant les perspectives traditionnelles de la psychiatrie: assurer la promotion d’une bonne santé mentale n’équivaut pas à lutter contre les maladies mentales, il contribue à brouiller les limites d’un champ d’action qui, aujourd’hui, paraît viser davantage les masses que l’individu. Ainsi, en proclamant un droit à la santé, les rédacteurs de la Charte de l’OMS semblent avoir oublié que la tâche du médecin, psychiatre ou non, n’est jamais de guérir l’homme, «sinon par accident, mais Callias, ou Socrate, ou quelque autre individu ainsi désigné, qui se trouve être, en même temps, homme1 ».
C’est pourquoi si le brouillage des limites de la psychiatrie peut être l’occasion de mieux penser les interactions de cette spécialité avec les disciplines connexes et d’enrichir la réflexion épistémologique, il implique également des conséquences politiques et éthiques. Comment, par exemple, ne pas s’interroger sur la manière dont il augmente le poids de ce que Michel Foucault a nommé le «pouvoir psychiatrique»? Peut-on vraiment éviter de se demander s’il ne participe pas d’un déploiement de stratégies de médicalisation de l’existence, œuvrant de cette manière à une «biopolitique» dont la visée est un plus grand contrôle des populations? Par ailleurs, en semblant prendre à sa charge la promesse de bonheur par la contribution à un «état de bien-être complet, physique, psychique et social», n’est-ce pas à l’éthique que semble vouloir se substituer la psychiatrie métamorphosée en santé mentale, comme si la promesse de bonheur n’était pas d’abord l’apanage des charlatans, et plutôt que sa visée, sa fin dernière, ce qui vient questionner l’éthique dans ses fondements?
Mais si le passage à la santé mentale contribue à la mise en crise de l’identité de la psychiatrie, il peut également être revendiqué comme l’une des modalités de réponse à cette crise. Une crise possède en effet ceci de particulier qu’elle se produit toujours comme étant à la fois l’origine et le produit de mutations conceptuelles. Pour proposer un autre exemple, l’instauration d’une équivalence esprit/cerveau peut être lue comme révélatrice d’une psychiatrie (psukhès iatrikè) qui, en revendiquant sa seule appartenance à la médecine (iatrikè), apparaît en danger de perdre son «âme» (psukhès) dans le même temps qu’elle légitime l’appartenance de la discipline aux neurosciences, dont l’objet est bien le cerveau et non pas l’esprit. Elle peut alors être revendiquée au titre de remède miracle, réponse «révolutionnaire» de par ses conséquences à la double contrainte d’efficacité thérapeutique et économique qui détermine l’enjeu actuel de la politique de soins en santé publique1. De même, à travers l’instauration d’un «sujet de la folie2 », un changement de discours avait permis la constitution de la psychiatrie en spécialité médicale à la toute fin du xviiie siècle.
La crise contemporaine de la discipline apparaît donc exemplaire de toute crise en ceci qu’elle est d’abord une mise en crise du discours. Induite par des modifications lexicales, elle tient également à la pluralisation des discours tenus par la psychiatrie. C’est pourquoi Michel Foucault la fait débuter au xixe siècle, dès la contestation des travaux de Charcot sur l’hystéro-hypnotisme3. Il en fait la source de deux premiers mouvements de dépsychiatrisation dont les discours demeurent cependant référencés à un rapport savoir-pouvoir spécifique pour lui du discours médical. Le premier, initié par Babinski, en visant la réduction de la maladie à son strict minimum, annule la production de vérité. La psychochirurgie et la psychiatrie pharmacologique en sont les deux formes les plus notables. Le second, rapporté à Freud et à la naissance de la psychanalyse, vise au contraire, sans tomber dans le même piège que Charcot, à rendre la plus intense possible la production de la folie dans sa vérité. Mais si, en se retirant hors de l’espace asilaire, la psychanalyse efface les effets paradoxaux du surpouvoir psychiatrique, Foucault considère cependant qu’elle reconstitue le pouvoir médical, producteur de vérité, dans un espace aménagé pour que cette production demeure toujours adéquate à ce pouvoir. Elle relève donc pour lui de la même surmédicalisation de la folie que la psychopharmacologie. Seule l’antipsychiatrie, telle qu’elle s’est développée dans les années 1970, c’est-à-dire dans une lutte avec, dans et contre l’institution, en transférant au malade lui-même le pouvoir de produire sa folie et la vérité de sa folie, correspond pour le philosophe à une démédicalisation de la folie.
Peu importe ici que l’on adhère aux thèses de Foucault ou, au contraire, que l’on s’en démarque (nous verrons plus loin que la psychanalyse récuse cette référence à la médecine), l’important est de constater que la pluralisation des discours tenus par la psychiatrie est inséparable de leur inscription dans une relation polémique. Celle-ci articule le rapport de la discipline à la médicalisation/démédicalisation de ses pratiques.
La polémique, aujourd’hui comme hier, n’est donc pas un phénomène secondaire d’une crise qui bouleverserait la spécialité, et qui à travers la «balkanisation des pratiques1 » témoignerait d’une incapacité des différentes parties à s’entendre ou à se comprendre. Tout au contraire, elle remplit d’abord une fonction constitutive2. Chacun des discours en opposition va en effet définir son identité, la zone de sens qui le caractérise, à partir du rejet de l’autre, de son autre. La polémique est donc un conflit de frontières, où la disqualification de pratiques adverses contribue à préciser les limites du champ d’action des pratiques défendues, dans un mouvement qui est inséparablement d’autodifférenciation et d’autolégitimation.
Ainsi, dans la polémique qui oppose les thérapies cognitives et comportementales à la psychanalyse, il s’agit pour les thérapies cognitives de se légitimer, en affirmant tout à la fois leur scientificité et l’absence de scientificité de la psychanalyse, disqualifiée au titre de pratique «charlatanesque» qui, en médecine, est synonyme de «non scientifique». En retour, la psychanalyse se légitime elle aussi par la revendication d’un rapport à la science, mais différent, et dénonce le «scientisme» du discours adverse.
Les thématiques nourrissant l’argumentaire de la polémique dépendent bien sûr de la culture dominante et des idéologies en faveur au moment où elles se déploient. Aujourd’hui, la référence repoussoir au discours religieux, avec à l’arrière-plan le spectre des sectes, servira à dénoncer le charlatanisme des psychothérapies non référées au discours scientifique. En revanche, la mode de la philosophie aidant, une revendication commune de l’héritage du stoïcisme pourra être utilisée pour légitimer aussi bien les thérapies cognitives que la psychanalyse et, ce faisant… rendre également possible un retour subreptice du discours religieux dans leurs pratiques. Une légère différence toutefois distingue les adversaires. Leur figure de référence. Tandis que les cognitivistes semblent privilégier l’œuvre de Pierre Hadot1, les psychanalystes se revendiquent de l’héritage des recherches de Michel Foucault sur les exercices spirituels liés aux pratiques du «souci de soi2 », dont on sait par ailleurs ce qu’elles doivent aux travaux du premier.
De fait, la polémique relève du «dialogue de sourds». C’est pourquoi un discours ne va entrer en relation avec le discours adverse qu’en «traduisant» ses énoncés dans ses propres catégories. Par exemple, pour les neurosciences la «rupture épistémologique freudienne», inaugurée par le passage d’une clinique du regard à une clinique de l’écoute, sera récusée au titre de son absence de référence dans la réalité. Ce faisant, la psychanalyse se voit visée par les arguments mêmes qui, au xixe siècle, servaient à disqualifier le genre romanesque comme discours référant à un rien: simplement, le côté fictif, «mensonger» de la fiction romanesque est devenu le «mensonge freudien1 »; l’auteur vilipendé est accusé d’avoir inventé ses cas cliniques et sa théorie, référée à «rien», devient elle-même roman. À l’inverse, les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle, produisant pourtant des images virtuelles, c’est-à-dire de pures constructions, sont très à la mode et connaissent une grande faveur car elles donnent une consistance à l’axiome selon lequel la valeur de vérité du tableau clinique est donnée par la vérification anatomique.
Rendue possible par l’ambivalence fondamentale de la parole, la «traduction» rend compte de l’«interincompréhension» fondatrice de toute relation de parole qui, pour paraphraser un auteur à succès, peut donner l’impression que les hommes et les femmes ne sont pas issus de la même planète. Il en découle que l’unité d’analyse d’un discours polémique ne peut pas être le discours tenu par chacun des adversaires mais cet espace d’incompréhension réciproque entre discours, nommé interdiscours, et à partir duquel vont se déployer les discours rivaux. A contrario, la méconnaissance de cette interdiscursivité rend possible l’installation dans le conflit. Les discours apparemment coupés de leurs interrelations, c’est-à-dire dans le déni de leurs propres frontières, y semblent réduits à des contenus dont les porte-parole s’agitent comme des boxeurs trop occupés à combattre pour se soucier du ring sur lequel ils s’affrontent.
Or, de même que la scène de ménage, modèle canonique de la relation polémique, contribue simultanément à la légitimation/dé-légitimation du couple qui s’y livre, le discours polémique, en dépit ou au-delà des querelles partisanes et des déchirements internes à toute discipline, oblige à interroger ce qui fonde la légitimité des pratiques dont il débat. Telles sont ainsi pour la psychiatrie certaines des questions que la polémique aide à penser: si elle n’est pas une science, au sens où une science se définirait par son aptitude à se doter d’un paradigme, est-elle encore une spécialité médicale? Et si, désormais, elle excède le champ de la médecine, peut-elle cependant continuer de prétendre à une visée scientifique? Quel est alors le statut actuel de la psychiatrie? À un degré de plus, si pour la médecine les pratiques charlatanesques sont des pratiques « non scientifiques », comment peut-elle se différencier de ces pratiques? Ou bien, tout au contraire, en reprenant la distinction opérée par Michel Foucault entre le registre du médical, ou «iatrique», et celui du «thérapeutique», dont sont issues les pratiques du «souci de soi», relève-t-elle désormais d’une logique thérapeutique qui récuse tout lien avec la médecine mais dont pourrait se réclamer la psychologie? Autrement dit, comment la psychiatrie peut-elle fonder aujourd’hui sa légitimité, si ce n’est en interrogeant son rapport aux «discours constituants»: scientifique, psychanalytique, juridique, littéraire, ou même religieux, qui en dessinent les limites?
Par ailleurs, dans la relation polémique, chacun des combattants, indissociablement animé de la volonté d’anéantir son adversaire et convaincu d’être le meilleur (s’il en doute, il perd), c’est-à-dire animé par la volonté d’anéantir le mensonge (ici, le charlatanisme ou le scientisme) et persuadé d’être le seul à dire le vrai, est trop affairé pour se soucier des conditions de possibilité de l’affrontement. Pourtant, il n’est pas de combat de boxe envisageable en l’absence d’un lieu géométrique qui en rende le déploiement possible. S’il est méconnu des combattants, l’espace où se bâtit le ring n’en est pas moins fondamental pour penser les boxeurs. L’appareil, le dispositif qui, dans la polémique, rend l’affrontement possible se constitue à partir de la relation entre les discours. C’est pourquoi nous commencerons par établir ce qui dans cet interdiscours rend possible l’émergence progressive d’une dualité psychiatrie/psychothérapie symptomatique de la crise de la psychiatrie et de ses enjeux de médicalisation/démédicalisation des pratiques. Une fois mis en place, ce dispositif nous permettra de décrire les modalités opératoires de la polémique. Elles s’organisent autour du repérage de différentes catégories de pratiques dénoncées comme charlatanesques, et aussi à partir de l’opposition d’adversaires qui se taxent réciproquement de scientisme ou de charlatanisme. En tentant de cerner ce qu’est une pratique charlatanesque, la polémique permettra d’interroger ce qui fonde la légitimité d’une pratique mais aussi ce qui définit une parole véritablement thérapeutique, inséparablement éthique et curative. L’éthique apparaîtra ainsi comme l’enjeu véritable de la mise en crise de la psychiatrie.
À qui s’adresser si l’on se sent l’âme ou l’esprit chavirés ? Comment s’orienter et se repérer dans le dédale des pratiques et des méthodes ? Mon trouble relève-t-il de la médecine ? De la psychologie ? De la philosophie ? De pratiques spirituelles empruntées aux méthodes de développement personnel? Ou, pourquoi pas, de la religion ? Mais aussi, qu’est-ce qu’un thérapeute ? Est-ce un médecin ? Un directeur de conscience ? Un gourou ? Un éducateur ? Un charlatan ?
Psychiatre des Hôpitaux et psychanalyste, Isabelle Blondiaux est également docteur en philosophie et en littérature. Elle a déjà publié Louis-Ferdinand Céline, portrait de l’artiste en psychiatre, Société d’Études Célinienne, Paris, 2005 et Une écriture psychotique, Louis-Ferdinand Céline, Éditions Nizet, Paris, 1985.