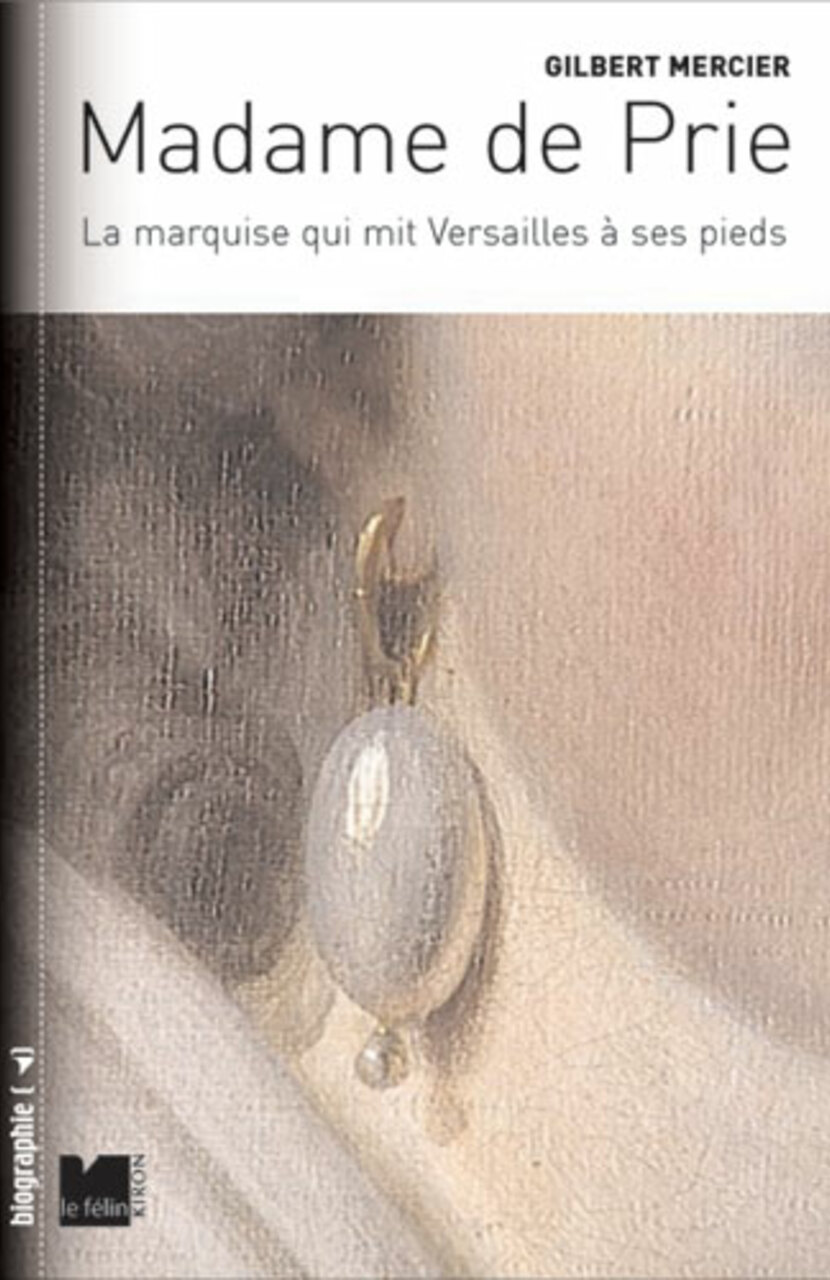
Madame de Prie
I
Comme une mèche qui achève de se consumer, dans son résidu de cendre blanche, le vieux fermier général des poudres et salpêtres, François Berthelot, s’éteignit doucement, vers la fin de l’été 1712, au premier étage de l’hôtel de Cléry, formant angle avec la rue Poissonnière, à Paris. Il était âgé de quatre-vingt-six ans. Son fils, Étienne Berthelot de Pléneuf, et surtout sa bru, la Pléneuf, estimèrent qu’ayant beau¬coup reçu de la vie, le général – comme ils le sur¬nommaient avec une pointe d’ironie – pou¬vait gagner le cimetière quasiment tout seul. D’ailleurs, la Pléneuf n’avait pas attendu que le moribond achève de rendre l’âme pour se retirer avec ses gens dans son château de Ville-Évrard, laissant le soin à son mari de s’occuper des formalités. Le spectacle des pleurnicheries d’Agnès, sa fille aînée, vouée à ce patriarche comme une petite vipère à sa ruine, lui aurait soulevé le cœur.
Étienne évita donc de convier le ban et l’arrière-ban à venir faire semblant de s’apitoyer sur la fin de ce vieillard desséché dont la toute petite tête ridée faisait penser à une marotte oubliée sur les plumes de l’oreiller. Certes, « le général » avait superbement tra¬versé le siècle – et quel siècle ! Sans re¬lâche, il avait besogné pour que les armées royales – et quelques autres, à commencer par celles du Grand Condé, au temps de la Fronde – fussent pourvues de ce qui se fabriquait de mieux en mèches et poudres. Mais, depuis plus de vingt ans – cela remontait à l’année 1690, le temps passe si vite –, Étienne Berthelot de Pléneuf dirigeait la Ferme des poudres d’une main autrement énergique. Il n’en tirait pas moins l’essentiel de ses énormes revenus de la gestion de multiples affaires dans l’intendance des armées.
Que de changements durant ces vingt-deux années ! Au début, « le géné¬ral » essayait encore de se donner des airs, mais les commis sa¬vaient à quoi s’en tenir. Ils ne soulevaient plus leur chapeau que par habitude quand il venait à pousser la porte du bureau, lui aussi par habitude. Vingt-deux ans ! Plus qu’il en faut pour voir se re¬nouve¬ler les hommes dans les mi¬nistères, les administrations, les banques, les commerces ! Plus qu’il en faut aussi pour se faire nombre d’ennemis à force de bras¬ser de l’argent aux quatre coins du royaume. Plus qu’il en faut pour devoir supporter le regard ré¬probateur de ce trop vieux père qui appartenait décidé¬ment à une autre époque.
À la vérité, les quelques liens encore capables de réunir le père et le fils n’avaient pas résisté à la scandaleuse affaire des hôpitaux militaires de la campagne d’Italie, en 1702. Étienne essayait bien d’en enfouir le souvenir au fond de lui-même, il ne pouvait oublier que seule l’intervention d’amis haut placés – vraiment haut placés – lui avait permis d’échapper à l’embastillement et au désastre de la banqueroute. Et encore, n’avait-on réussi qu’à faire traî¬ner le pro¬cès en longueur, à enterrer le dossier sous des monceaux de pape¬rasses, dans l’espoir qu’il finirait par s’égarer.
Alors, raison de plus pour éviter les frais d’un enterrement avec tralala. Et, s’il avait eu besoin d’évacuer quelque relent de mau¬vaise conscience, Étienne Berthelot de Pléneuf n’aurait eu qu’à se dire que, dans son milieu des affaires militaires, on considérait les veillées funèbres comme des pertes de temps et les funérailles comme des mondanités peu lucratives.
*
Quand un cocher vint chercher Agnès au couvent des Bénédic¬tines de la Magdeleine du Trainel, rue de Charonne, elle ne fut pas étonnée. Depuis plusieurs jours, elle se tenait prête. Pendant qu’elle nouait sa cape et son cha¬peau, l’abbesse et les nonnes se fi¬rent plus tendres, certaines même compatissantes, es¬sayant de trouver les pieuses consolations de circonstance. Mais Agnès n’entendait et ne voyait rien. Le grand-père Berthelot occu¬pait toutes ses pensées. Elle ne son¬geait plus qu’à faire de ces adieux avec le seul être qui comptât dans sa vie quelque chose dont elle n’aurait pas à rougir plus tard. Dans ses intuitions de jeune de¬moi¬selle de quatorze ans, elle savait que la mort de son grand-père son¬nait le glas de son enfance. Lui parti, elle serait seule.
Agnès ne détourna sa petite tête triste qu’en voyant accourir du fond des corridors sa meilleure amie, Marie de Vichy-Chamrond, de deux ans son aînée. La jeune fille la prit dans ses bras et l’embrassa. Puis, dans le coup du fouet du cocher, Agnès entendit juste Marie qui disait : « Ils ne lui ont même pas envoyé un car¬rosse ! » Elle s’aperçut, à cet instant, qu’elle venait de grimper dans un simple cabriolet, fort égratigné par les embarras de la rue Poissonnière, et même pas décrotté.
À l’angle de la rue de Cléry, elle interrogea le cocher : « Est-elle là ? »
Sans détourner la tête, l’homme répondit du ton de la plus parfaite neutralité : « Madame est au château depuis hier. »
Cette réponse soulagea Agnès. Dans un moment pareil, il lui aurait été pénible de se trouver en présence de cette personne qui n’avait de mère que le nom. Depuis plus d’un an, elle ne pouvait plus la croiser sans recevoir les humiliations d’une femme si ja¬louse et méchante qu’elle croyait voir les flammes de l’enfer lui dévorer le fond des yeux quand elle la toisait, attifée de ses parures tapageuses.
Agnès se reprit en franchissant le portique à colonnes doriques de l’hôtel familial, à l’angle de la rue Poissonnière. Elle gravit l’escalier de pierre d’un pas lent mais sûr. Pourtant, au moment où une servante poussait la porte de la chambre mortuaire, en s’effaçant, elle fut prise d’une frayeur subite. N’ayant rencon¬tré la mort que sous la forme d’un loqueteux couvert des pustules de la petite vérole et dévoré par la vermine, sur le pas de la porte où il agonisait, dans la neige, un matin du terrible hiver de 1709 – elle avait alors onze ans –, il lui sembla que ce corps rigide, apprêté comme un personnage de cire, n’était qu’une représentation théâtrale de son grand-père. Puis, elle s’habitua. Elle ouvrit un peu les rideaux qui d’ordinaire laissaient pénétrer la lumière par la grande porte-fenêtre aménagée au-des¬sus des colonnes doriques. Elle avança un fauteuil au bord du lit et s’y assit. Sans hésiter, sa main alla cher¬cher un livre dans le tiroir de la commode. Dès qu’elle le posa sur ses genoux, il s’ouvrit pour ainsi dire de lui-même. Lentement, elle lut : « On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre, elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité ; déjà on ne le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection : il a commencé par dire de soi-même, un homme de ma sorte, il passe à dire, un homme de ma qualité, il se donne pour tel, et il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer : sa demeure est superbe, un dorique règne dans tous ses dehors, ce n’est pas une porte, c’est un portique ; est-ce la maison d’un particulier, est-ce un temple ? Le peuple s’y trompe : il est le seigneur dominant de tout le quartier ; c’est lui que l’on envie et dont on voudrait voir la chute, c’est lui dont la femme par son collier de perles s’est fait des ennemies de toutes les dames du voi¬sinage : tout se soutient dans cet homme, rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, qu’il a payée. Que son père si vieux et si caduc n’est-il mort il y a vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune mention de Périandre ! Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes qui déchif¬frent les conditions, et qui souvent font rougir la veuve et les hé¬ritiers ? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, claivoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent abso¬lument tenir leur rang à des obsèques ? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble homme, et peut-être un Honorable homme ? Lui qui est Messire. »
Agnès referma le livre. Elle le porta sur son cœur dans un soupir qu’elle aurait voulu rendre à celui qui lui avait enseigné les choses de la vie qu’une demoiselle de sa qualité ne doit point ignorer. Ses mains soignées se crispèrent sur le maro¬quin bruni de la couver¬ture. Dans une édition de 1694, l’ouvrage avait pour auteur M. Jean de La Bruyère et portait en titre « Les caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle ».
Aucune pièce de la collection d’armes de toutes époques et tous pays réunies par François Berthelot et devant lesquelles les visi¬teurs se figeaient avec des mines béates, aucun bijou – pas même le collier de perles que la Pléneuf faisait balancer sur sa gorge pour le plaisir pervers de provoquer les jacassements des péronnelles du quartier –, aucune parure ne pourrait jamais remplacer ce simple livre dans le cœur d’Agnès. Pas même cette basane assouplie qui faisait la fierté de François Berthelot. On y voyait dessinés les con¬tours d’une gigantesque forêt. Cette peau de caribou, affirmait-il, faisait de lui le propriétaire d’une étendue canadienne aussi vaste qu’une pro¬vince. Non, rien de tout cela n’aurait pu combler Agnès autant que ce livre. Entre les lignes, il contenait, en quelque sorte, le testa¬ment de François Berthelot mais elle seule pouvait le dé¬crypter.
*
Sans sortir de la cuisse de Jupiter, les Berthelot pouvaient se flatter de quelques belles enjambées dans les allées du pouvoir. On s’arrangeait toujours pour faire savoir aux visiteurs de l’hôtel de Cléry que le pre¬mier connu de la famille, Simon Berthelot, avait coup sur coup oc¬cupé des fonctions indispensables dans les cabi¬nets des célèbres mi¬nistres Colbert et Louvois. Parfois, on se laissait aller. Péremptoire, on osait affirmer que si nul ne pouvait plus ci¬ter Colbert sans qu’aussitôt le nom de Louvois lui vienne sur les lèvres, c’était parce que des collaborateurs de la trempe de Simon Berthelot avaient su les réunir dans une même conduite florissante des af¬faires du royaume. En somme, les Berthelot et leurs sem¬blables étaient les véritables pères nourriciers du pays, au temps béni où les ma¬melles des vaches grasses faisaient l’orgueil des mi¬nistres de Louis XIV.
Longtemps avant cette époque, Simon Berthelot avait déjà initié son fils François aux ficelles du métier de vivrier. Quand le roi est encore un enfant et qu’un Le Tellier de Louvois se voit offrir un fauteuil de ministre à l’âge de quatorze ans, les bourgeois n’attendent pas que leur progéniture ait trois poils au menton pour la mettre à la besogne. Les Berthelot père et fils suaient donc sang et eau pour satisfaire aux exigences des intendants de l’armée tou¬jours prompts à brandir la menace de la concurrence. Bien se¬condé par son fils François, l’atout de Simon Berthelot consistait en une vieille manufacture de mèches située à Pont-Sainte-Maxence, sur les rives de l’Oise, au-delà des immenses forêts royales de Picardie, propices aux grandes chasses comme aux sauvages agres¬sions des brigands. On fabriquait encore les mèches avec de la vieille corde battue et bouillie dans un mélange de soufre et de sal¬pêtre. Comme au temps des arquebuses ! Après quoi, on retressait la corde et on la découpait en mèches de différentes longueurs.
Il revint aux oreilles de Jean-Baptiste Colbert que la meilleure mèche proposée sur le marché était celle de Simon et François Berthelot. Se souvenant, peut-être, de ses origines dans la draperie et de ses débuts comme petit commis dans les services du tout-puis¬sant seigneur de Chaville, Michel Le Tellier, M. le ministre Colbert décida de donner leur chance à ces besogneux, déjà nantis en réalité d’un beau pignon sur rue. Eu égard à leurs compétences, ce fut bientôt le ministre de la Guerre lui-même, François Louvois – fils de Michel Le Tellier –, qui sollicita leurs services. Il n’eut pas à s’en plaindre. Les Berthelot se montraient aussi ponctuels dans les livraisons que sûrs dans la qualité. Les inspecteurs généraux Martinet, pour l’infanterie, de Fourilles, pour la cavalerie, et sur¬tout Surirey de Saint-Remy, pour l’artillerie, ne déposaient que des rapports élogieux sur le bureau de Louvois.
Pour les récompenser de leur loyale collaboration, on leur pro¬posa d’adjoindre à la manufacture de mèches une fabrique de poudre noire. Aux lisières des terres du Grand Condé, prince de Chantilly, cette manufacture serait sous bonne garde.
Simon Berthelot hésitait à prendre la responsabilité d’une pa¬reille fabrication. Pour qu’il accepte, François dut le convaincre que le fusil ne tarderait guère à remplacer le mousquet dans la quasi-totalité des régiments. C’en serait donc fini de la vieille pra¬tique de la mèche allumée que les soldats protégeaient dans un étui en fer-blanc percé de petits trous. Avec une fabrication diversifiée, et la certitude de remporter les marchés de poudre noire, grâce à la caution de M. Louvois, depuis longtemps maître incontesté des vi¬vriers et munitionnaires, et les appuis efficaces de son bras droit, Daniel-François Voysin, la manufacture des bords de l’Oise connaî¬trait encore de beaux jours.
Dès lors, Simon Berthelot jugea le moment venu de confier la gestion de son affaire à son fils. Il ne joua plus, à ses cô¬tés, qu’un rôle de conseiller. Comme une bonne entente régnait entre le père et le fils, les commissionnaires ne s’aperçurent même pas du chan¬gement.
À la mort de Simon Berthelot, l’affaire des vivriers prospérait plus que jamais. En témoignait l’hôtel Berthelot, formant angle avec les rues de Cléry et Poissonnière. Il ne possédait pas en¬core son portique à colonnes doriques mais il provoquait les réflexions des envieux : « Les voyez-vous, les mar¬chands de poudre à canon ? » Pourtant, François Berthelot ne changeait rien aux vieilles habi¬tudes. Il ne se passait guère de mois, à certaines époques de se¬maine, sans qu’il fît avec ses chariots le trajet de Paris à Pont-Sainte-Maxence. Plus de quinze lieues à par¬courir, soit dans des faubourgs pourris de coupe-gorge, soit à tra¬vers des forêts infes¬tées de brigands. Même si on lui affectait une escorte armée, en raison des risques encourus par des transports de barils de poudre, il ne commençait à respirer qu’une fois traver¬sée la plaine Saint-Denis et franchis les remparts de Paris. À l’aller, c’était moins op¬pressant. Il se permettait même de laisser le convoi poursuivre son chemin et de s’attarder à l’auberge du relais de poste de Senlis. Il y réglait ses affaires avec les chi¬neurs de vieille corde et ses fournis¬seurs en barils installés aux lisières des forêts voisines de Pontarmé, Chantilly ou Halatte. Il lui arrivait de s’y at¬tarder, en bonne compagnie. Avait-il fait l’acquisition de sa fa¬meuse forêt canadienne au cours d’une de ces soirées ? Là-dessus, sa petite-fille Agnès n’avait pas reçu toutes ses confidences…
Étant parvenu à donner à son affaire assez d’ampleur pour lui permettre d’installer une réserve à l’abri des fossés de Montmartre, François Berthelot put, en 1664, prendre à bail pour neuf ans la fourniture générale des poudres et salpêtres aux armées royales. Le Grand Condé – toujours soucieux de garder ses distances avec le Palais-Royal – commença alors à manifester quelques petits signes d’intérêt pour la manufacture de Pont-Sainte-Maxence.
Il est vrai que, jusque-là, le terrible prince de Chantilly n’avait guère eu le loisir de prêter attention à ces marchands de poudre, installés à une galopade de cheval de son château. Bataille après bataille, il s’était illustré au nord comme au midi pour des causes dont certains disaient qu’il n’en avait aucune idée. Le Grand Condé, c’était bien connu, ferraillait d’abord et réfléchissait ensuite. François Berthelot en savait quelque chose. Jamais il n’oublierait l’affaire de la « fronde des princes ». Elle avait si profondément marqué ses premiers pas dans la carrière de vi¬vrier !
Ces événements se déroulaient au début des années 1650. D’abord, on avait appris avec incrédulité l’enfermement du géant à la face d’aigle au fort de Vincennes, sur ordre de la reine Marie-Thérèse, excédée par ses prétentions et ses manigances. Libéré au bout d’un an par Mazarin, il n’avait pas hésité à se mettre à la tête des princes frondeurs et à installer son gouvernement à Bordeaux. Après avoir saccagé tout le Midi, avec le concours de la redoutable infanterie espagnole – bien qu’il l’eût taillée en pièces quelques années plus tôt à Rocroi et Lens –, il s’était rué sur Paris. La correction infligée par Turenne sur la chaussée de Bléneau n’était pas de nature à calmer ses ardeurs. Poussé par la troupe des che¬vau-légers de la Grande Mademoiselle et de ses « maréchales », l’intrépide Condé s’était aussitôt élancé, ventre à terre, sur le grand chemin de Paris. Ce furent alors les combats sauvages du faubourg Saint-Antoine. Longtemps après, François Berthelot en faisait en¬core des cauche¬mars. Comment oublier la vision de ces soldats ar¬rachés de la bou¬cherie avec des fronts et des joues frangés d’horribles lambeaux de chairs sanguinolentes, de ces femmes et de ces enfants agglutinés aux abords d’un Palais-Royal aussi paniqué qu’une fourmilière en¬fumée, de ces voitures de parlementaires fonçant à bride abattue dans toutes les directions et allant buter sur d’énormes chaînes tendues en travers des rues? Les nouvelles les plus contradictoires circulaient. Certains rapportaient que Turenne achevait d’encercler les troupes du Grand Condé, ce n’était plus qu’une question d’heures. D’autres affirmaient que tout le faubourg Saint-Antoine était à feu et à sang, que le Grand Condé venait de franchir les remparts, que la vie même du jeune roi se trouvait menacée… Soudain, le canon tonna. Un parlementaire, qui ne savait même plus où il se tenait, dit à François Berthelot que la Grande Mademoiselle avait coup sur coup ordonné aux magistrats d’ouvrir la porte Saint-Antoine et aux serveurs du canon de la Bastille de tirer sur les troupes royales. Cette bravade de la fille de Gaston d’Orléans suffit à renverser le cours des événements. Le Grand Condé pénétra dans Paris debout sur ses étriers tandis que, couché sur sa jument, le cardinal em¬menait le roi sur les hauteurs de Charonne, avant un prudent repli sur Pontoise.
Cette victoire fut de courte durée. La nature outrancière de Condé reprit le dessus. D’abord ralliés à sa personne, les bourgeois du parti de l’ordre le jetèrent hors les murs. Pourchassé jusque dans le royaume des Flandres, il prit une nouvelle fois la tête des troupes espagnoles. Pendant ce temps, le roi rentrait à Paris par la grande porte, celle de Saint-Honoré…
Mais le guerrier à la face d’aigle ne manquait pas, lui non plus, de portes où aller frapper. Bien que condamné à mort par contumace, il parvint, quelques années plus tard, à se faire rétablir dans ses honneurs et ses dignités, moyennant un serment de soumission qu’il tiendrait, on le savait, jusqu’à son prochain coup de folie. Comme il ne rêvait plus que de s’installer sur le trône de Pologne, on fit semblant d’avoir tout oublié. Au moins, on serait tranquille pour un temps.
Ces noires années avaient été bien difficiles à traverser pour François Berthelot, sans cesse pris entre deux feux. On croit tou¬jours que, dans les époques de troubles, la poudre se vend comme de la farine. N’entre-t-elle pas dans les denrées de première nécessité ? Ce serait vrai si le marché ne devenait pas plus aléatoire que jamais, soumis à des contrôles, des tracas, des menaces permanentes. Au moindre faux pas, vous craignez pour votre vie. Et quand, derrière les suspicions, les contrats avec des intermédiaires dont vous ne savez jamais quelle armée ils servent au juste, se profile le spec¬tacle d’un pays affamé, dépouillé de tout, exsangue, il est bien dif¬ficile de dormir sur ses deux oreilles.
Ayant traversé ces épreuves sans faillir, François Berthelot sentit monter en lui une grande fierté le jour de 1678 où un bon du roi lui fut remis avec solennité. Ce bon faisait de lui le tout premier fermier général des poudres et salpêtres du royaume. On n’avait sans doute pas décidé de créer la nouvelle ferme pour lui mais nul ne contestait que la charge lui revenait de droit.
Dans son costume tout neuf, il traversa comme un prince la grande cour qui allait de la rue du Louvre à la rue du Bouloi. Au fond, se dressait le palais historique converti depuis cinq ans en hôtel des Fermes. Françoise d’Orléans, veuve de Louis de Bourbon, le premier des Condé, l’avait d’abord occupé. Puis son fils, Charles de Soissons, et successivement le duc de Montpensier, le duc de Bellegarde et le chancelier Séguier. Alors, Richelieu en avait fait le tout premier siège de l’Académie française. Et, depuis 1673, il abri¬tait les bureaux des quarante fermiers généraux. Autant que d’académiciens ! Pour un peu, François Berthelot se serait vu avec un costume d’académicien. Quand, le croisant au milieu de la cour, le puissant fermier Jean Fauconnet en personne lui adressa une inclinaison de tête, en signe de bienvenue dans la confrérie, il se sentit en quelque sorte adoubé.
S’ensuivirent dix années d’un sage gouvernement des poudres et salpêtres dans tout le royaume. Fort d’une expérience acquise à la tâche, François Berthelot savait aplanir les difficultés sans avoir besoin d’aller frapper à toutes les portes. Il apparaissait ainsi, aux yeux des experts militaires, des ministres et des parlementaires, comme un administrateur sans histoires, compétent et bon organi¬sateur de la collecte des taxes. Sans doute, souffrait-il de la mauvaise réputation faite aux fermiers généraux et faisait-il partie du lot quand on vouait aux cent diables ces suceurs d’argent, ces affa¬meurs du peuple, mais il s’agissait là d’un sort commun. Dans les milieux où il exerçait son activité, tous les suffrages lui étaient ac¬quis. Il aurait longtemps encore tenu sa ferme, prélevant les taxes sur le commerce des poudres avec un doigté souvent souligné, si le mal¬heur ne s’était abattu sur lui avec la soudaineté d’un orage qu’on n’a pas vu venir.
Ce malheur portait le nom de son propre fils, Étienne. Dans sa confortable situation, François Berthelot vivait dans cette croyance trop répandue que l’histoire ne peut que se répéter. Il s’imaginait donc que la bonne entente qui régnait entre son père Simon et lui-même se répéterait avec Étienne. Élevé comme un fils de haut bour¬geois, bénéficiant même d’un train de vie que bien des fa¬milles en vue ne pouvaient offrir à leurs enfants, Étienne roulait carrosse vêtu de costumes taillés dans les riches étoffes de Gaultier et fré¬quentait le cabaret de Rousseau et autres cafés à la mode à un âge où d’autres, confinés dans les études, regardent encore sage¬ment passer les demoiselles, à travers les carreaux de la fenêtre. Mais comme, justement, Étienne manifestait des dispositions cer¬taines pour le calcul rapide, la manipulation de l’argent et que l’on sentait chez lui un sens inné des affaires, son père ne se faisait au¬cun souci à son sujet. Il ferait, à son tour, un bon fermier général des poudres et salpêtres.
Les illusions de François Berthelot s’envolèrent dans les der¬nières années 1680. Dévoré par la fringale des affaires, alors qu’il n’avait même pas atteint sa vingtième année, Étienne semblait agacé par les méthodes de son père. Dans de longs soupirs impa¬tients, il ne se gênait pas pour lui faire comprendre qu’il les consi¬dérait comme dépassées, archaïques, stériles. François Berthelot aurait accepté les observations de son fils si, dans le même temps, il ne l’avait vu s’acoquiner avec quelques-uns de ces fripons qui ma¬raudaient autour des bureaux du ravitaillement aux armées. Il im¬posa donc ses vues avec une fermeté qui l’étonnait lui-même et mé¬dusait le personnel tant il avait habitué son monde, jusque-là, à une certaine courtoisie bonhomme.
Ce que François Berthelot ne voyait pas, c’était la considération grandissante dont son fils bénéficiait dans les administrations, les banques, et jusque dans les antichambres du roi. On louait partout sa clairvoyance, et surtout on soulignait à l’envi ses talents de né¬gociateur dans la conduite des affaires les plus ardues, de celles qui réclament un caractère d’acier et pas trop de sens moral.
François Berthelot reçut le coup de grâce en 1690. On lui fit sa¬voir, sans ménagement, qu’il serait bien inspiré de laisser la ferme des poudres et salpêtres entre les mains d’un fils si doué. À son âge, il pou¬vait sereinement envisager de résilier sa charge et de prendre un repos tellement mérité.
À son âge ? « Je n’ai que soixante-quatre ans, bougonnait François Berthelot, ja¬mais la moindre maladie n’est venue pertur¬ber mon travail, et je me sens fort capable de gérer la ferme pen¬dant dix ans encore. » Mais son expérience de l’administration lui avait depuis longtemps enseigné qu’il est vain de vouloir s’accrocher quand on a décidé, là-haut, de se passer de vos services. Il fit donc semblant de se plier de bonne grâce à la volonté supé¬rieure. Quand le décret royal fit d’Étienne le nouveau fermier gé¬néral des poudres et salpêtres, il fut même le premier à proclamer à la cantonade qu’il se réjouissait de voir « sa » ferme rester entre les mains d’un Berthelot. En son for intérieur, il espérait qu’il aurait juste à déplacer son fauteuil et que, dans les apparences, il appa¬raîtrait toujours comme le maître de la ferme. Pauvre de lui ! Après quelques mois de cette cohabita¬tion, il dut se rendre à l’évidence : on le supportait comme on sup¬porte le vieux chien galeux de la maison en raison des services rendus, c’était tout.
François Berthelot finit par comprendre qu’il était devenu indé¬sirable. Il décida alors de prendre ses distances avec la ferme et de s’adonner à ses occupations favorites : une collection d’armes de toutes époques et de tous pays, des évasions sur les allées forestières qu’il connaissait le mieux, du côté de Senlis et de Chantilly.
Les relations qu’il avait su développer jadis lui permettaient d’être toujours reçu comme un hôte de qualité quand il se présen¬tait au château de Chantilly avec l’espoir secret d’y croiser un vieux compagnon du Grand Condé (mort en 1686) à même d’y déni¬cher une des toutes premières arquebuses ou un pistolet espagnol à longue crosse ciselée.
Un curieux climat régnait désormais au château. Capable de tous les caprices, riant aux éclats le matin, se levant de table et quittant la salle à manger avec une tête d’enterrement le midi, décidant subitement de partir à la chasse à 4 heures, le fils du Grand Condé, Henri-Jules, donnait chaque jour des sueurs froides à la do¬mesticité. Fort heureusement, l’aîné de ses enfants, Louis III de Condé, né en 1668, tempérait quelque peu cette vie dé¬sorganisée d’un château en apparence pourtant si paisible, entre étang et fo¬rêt. Quoique Louis fût capable, lui aussi, de frasques assez carabi¬nées. Sa meilleure réputation venait de ce qu’il manifestait un don inné pour la guerre. Tout le portrait de son grand-père !
Après quelques visites, François Berthelot sentit qu’un homme fort distingué, d’une vingtaine d’années son cadet peut-être, cher¬chait à engager la conversation. Cet homme semblait prendre grand intérêt à la façon dont il avait construit peu à peu sa noto¬riété dans le monde si difficile des affaires et de la finance, à ses rela¬tions lointaines et plus récentes, à ce qu’il pensait de tel ou telle, aux potins qu’ils suscitaient…
François Berthelot ne fut pas long à apprendre qu’il avait affaire à M. Jean de La Bruyère. Ce bel esprit – au premier abord, on sen¬tait que c’en était un – avait été engagé par la famille Bourbon-Condé au tout début de 1685, sur la recommandation de l’évêque de Meaux, Mgr Bossuet, pour être le précepteur du jeune prince. À la vérité, il n’avait accompli cette tâche que durant deux petites an¬nées. La mort du Grand Condé avait, en effet, contraint Louis de Bourbon à abandonner ses études. Mais M. de La Bruyère était resté au service de la famille. Partageant sa vie entre l’hôtel des Condé, à Versailles, et le château de Chantilly, il s’occupait surtout de la bibliothèque avec le titre de « gentilhomme ordinaire de M. le duc ». Comme la duchesse – Mme de Nantes, fille naturelle de Louis XIV – venait de donner naissance à un nouvel héritier prénommé Louis-Henri, en 1692, on lui disait parfois, sur le ton de la plaisan¬terie, qu’il allait pouvoir reprendre du service dans quelques an¬nées. Cela avait le don de l’agacer. Depuis l’année 1688, M. de La Bruyère consacrait, en effet, le meilleur de son temps à la publi¬cation des Caractères de Théophraste qu’il avait traduits du grec en les assortissant de ses propres réflexions sur les caractères et les mœurs de ses contemporains. Au fil des éditions, l’ouvrage avait fini par soulever toutes sortes de commentaires dans les bureaux d’esprits que certains appelaient plus simplement salons. Des noms circulaient à propos des portraits dont l’auteur émaillait ses ré¬flexions de plus en plus affinées – quoique parfois obscures – sur les sujets qui alimentaient justement les conversations des beaux esprits : le mérite personnel, les femmes, le cœur, les biens de la fortune, la mode, les usages…
D’un naturel timide et emprunté, M. de La Bruyère ne cherchait nullement à tirer avantage de cette popularité naissante. Sa thé¬baïde de Chantilly suffisait au bonheur simple auquel il aspirait. Et comme l’esprit de François Berthelot vagabondait à cent lieues de celui de M. de La Bruyère, le vieux fermier général ne se faisait pas la moindre idée des intentions de son interlocuteur. Leurs échanges de vues lui semblaient parfaitement anodins.
Des liens se tissèrent ainsi peu à peu entre l’homme sage de Chantilly et le visiteur parisien. À vrai dire, François Berthelot ne passait au château guère plus d’une fois par mois, et seulement à la belle saison. Il ne pou¬vait s’agir d’amitié mais le ton de la confi¬dence que M. de La Bruyère prenait naturellement – il chuchotait entre ses dents plus qu’il ne parlait – mettait François Berthelot en confiance. Bribe par bribe, il se mit à évoquer ses souvenirs. Nul besoin de le presser de questions pour l’amener à li¬vrer son opi¬nion sur les événements dont il avait été le témoin ou sur les per¬sonnages qu’il avait eu l’occasion de croiser. Un jour, il racontait l’incroyable escroquerie du médecin Barbereau qui ven¬dait de l’eau de la Seine comme eau minérale. Une autre fois, il dé¬crivait la fameuse maison du riche Langlée, rue Neuve-des-Petits-Champs, dont on disait : « Quand on vient chez lui, ce n’est pas pour le voir mais pour voir sa maison. » Tout de même, il ne pouvait se retenir de la comparer à la sienne, car il était très fier de sa façade de la rue de Cléry (il préférait ignorer la rue Poissonnière). Il de¬venait in¬taris¬sable quand la conversation venait à toucher les deux mondes qu’il connaissait le mieux, le militaire et le financier. Il pouvait aussi bien s’étendre sur la vie tumultueuse du duc de Lauzun, tour à tour adulé de la cour et voué aux oubliettes, que sur la triste fin du che¬valier de Soyécourt ou la double face du premier président du Parlement, Achille de Harlay, capable de briser qui¬conque se pré¬sentait en travers de son chemin en affichant une candeur d’anachorète.
Mais il arrivait aussi à M. de La Bruyère de se laisser aller à quelque jugement marqué au coin de ce bon sens et de ce goût pour les vieilles valeurs, les valeurs sûres – « bien malmenées de nos jours, monsieur » – que le fermier général devinait chez lui. Le jour où François Berthelot lui confia les soucis que lui causaient les au¬daces de son fils – pour éviter de dire les tripatouillages –, il l’entendit répondre comme s’il se parlait à lui-même : « Une belle res¬source pour celui qui est tombé dans la disgrâce, c’est la retraite. Il lui est avantageux de disparaître plutôt que de traîner dans le monde le débris d’une faveur qu’il a perdue et d’y faire un nouveau personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il conserve au contraire le merveilleux de sa vie dans la solitude ; et, mourant, pour ainsi dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire agréable. Une plus belle ressource pour le fa¬vori disgracié que de se perdre dans la solitude et de ne plus faire parler de soi, c’est d’en faire parler magnifiquement et de se jeter, s’il se peut, dans quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou confirme du moins son caractère et rende raison de son an¬cienne faveur ; qu’il fasse qu’on le plaigne dans sa chute et qu’on en rejette une partie sur son étoile. » Quand il eut pris le temps de méditer ces paroles, François Berthelot se dit qu’on ne lui avait ja¬mais donné conseil plus précieux.
Il se sentit presque honoré le jour de 1693 où il apprit que l’Académie française accueillait M. de La Bruyère dans ses rangs. Alors, il se procura son livre. À peine l’avait-il ouvert qu’il crut se reconnaître à toutes les pages, surtout celles où il était question des parvenus que M. de La Bruyère appelait les PTS, les ParTisanS. « N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses ; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point : ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir ; cela est trop cher et il n’y a rien à gagner à un tel mar¬ché… Les PTS nous font sentir toutes les passions l’une après l’autre : l’on commence par le mépris à cause de leur obscurité ; on les envie ensuite, on les hait, on les craint, on les estime quelquefois, et on les respecte ; l’on vit assez pour finir à leur égard par la com¬passion. »
On les estime quelquefois ! François Berthelot s’arrêtait sur ces quatre mots, oubliant ou feignant d’oublier le reste. Dans une sorte de tour de passe-passe de son esprit, il voyait en bleu ce que M. de La Bruyère peignait en noir. Tout de même, il rasait les murs de son quartier de plus près qu’à l’accoutumée, persuadé qu’on allait le montrer du doigt. Si le « pst, pst » de quelque marchande de poires cuites lui venait aux oreilles, dans l’ombre d’une porte cochère, il croyait entendre : PTS, PTS.
Par une ironie du sort, le monde des parvenus le rattrapa, le bouscula, le laissa désemparé comme une rencontre fâcheuse au coin de la rue. Sans lui demander son consentement, ni même le consulter, Étienne lui annonça tout à trac son mariage avec Agnès Rioult d’Ouilly. De vingt ans sa cadette, la demoiselle était la fille du puissant financier Rioult d’Ouilly, à la tête d’une fortune amassée en deux générations seulement et qui, pour faire bonne mesure, avait décidé de s’anoblir sans que qui¬conque y trouve à redire. Ce mariage arrangeait bien les affaires d’Étienne qui connaissaient des hauts et des bas. Voilà qu’un beau château situé au cœur des grands bois de Ville-Évrard tombait du ciel à ses pieds.
Que ce mariage fût dans l’ordre des choses, François Berthelot le reconnaissait volontiers. Ayant perdu sa femme peu de temps après la naissance de son fils, et n’ayant jamais éprouvé le désir – pas eu le temps ! – de se remarier, il aurait dû se réjouir de voir la maison retrouver en quelque sorte une nouvelle jeunesse. C’étaient les fa¬çons d’Étienne qui lui déplaisaient, son manque d’esprit filial, son arrogance.
En fait de nouvelle jeunesse, la maison se trouva prise dans un tel tourbillon que François Berthelot n’eut que la ressource d’aller se réfugier, autant dire se cloîtrer, dans ses appartements du premier étage. Bien qu’âgée d’à peine plus de quinze ans, mais en paraissant vingt et affichant une sûreté de soi peu ordinaire, Mme de Pléneuf, comme elle entendait être appelée, ne recevait jamais moins de trois fois par semaine. Grande et cambrée, la taille par¬faite, un visage des plus expressifs porté par un cou à donner des frissons à tous les joailliers de la place de Paris, elle ne paraissait à l’aise que sous les candélabres des fêtes mondaines. Et quand la belle Pléneuf ne recevait pas, les irruptions de ses bruyantes rela¬tions faisaient autant de tapage que le marché de Saint-Germain. François Berthelot ne trouvait un peu de répit que les jours où Madame donnait rendez-vous à son cercle au château de Ville-Évrard.
Au fil des mois, le pauvre homme se mua en une sorte de fantôme couleur de muraille auquel on prêtait à peine attention. Passant généralement à table avant « les maîtres », il s’enfermait durant la plus grande partie de la journée dans ses appartements. Il occupait son temps à démonter et remonter ses armes, à les fourbir ou à rê¬vasser devant sa peau de caribou. Pour éviter d’avoir à subir les bruyants roucoulements de la Pléneuf, il se fourrait des bourres de cartouches dans les oreilles. Il ne retrouvait un peu d’allant que lorsque, calé au fond de la berline laissée par bonté d’âme à sa dis¬position, il reprenait ses vieux chemins de Senlis, Chantilly et Pont-Sainte-Maxence.
Revenant de la procession du vœu de Louis XIII, à la mi-août de 1698, il fut très étonné d’apprendre, par un domestique, que la Pléneuf venait d’accoucher d’une fille à laquelle elle avait donné ses prénoms de baptême : Jeanne Agnès. Dans la solitude triste où on le tenait confiné, le vieux fermier ne s’était même pas aperçu de la grossesse de sa bru.
L’enfant fut bientôt confiée à une nourrice et la vie de l’hôtel de la rue de Cléry reprit son cours dans le brouhaha des fêtes et des soupers désormais donnés chaque soir. La maison ne désemplissait pas. Occupé à ses affaires, Étienne ne passait qu’en coup de vent. La Pléneuf n’en prenait pas ombrage, bien au contraire. Du moment que l’argent de son fermier pouvait ruisseler entre ses mains de Messaline couvertes de bagues grosses comme des noix ! Messaline était le surnom qu’on lui avait donné, tant elle s’y entendait à me¬ner les mirliflores par le bout du nez. On ne savait plus qu’inventer pour obtenir les faveurs de la nouvelle « reine de Paris ».
En 1703, une salve de rumeurs ébranla soudain cette vie de fêtes et de plaisirs. Les milieux militaires, puis ceux de la finance et de la robe, se mirent à colporter à qui mieux mieux les détails du scan¬dale au centre duquel se trouvait Étienne Berthelot de Pléneuf en personne. Son entregent lui avait permis de s’octroyer un quasi-monopole de la fourniture de vivres aux armées engagées dans la campagne d’Italie depuis deux ans. Comme si ce marché ne suffisait pas à satisfaire son énorme appétit de profits – que sa femme s’employait généreusement à dilapider –, il avait mis au point une machination qui en donnait long à penser sur les perversités de son esprit. On disait que, non satisfait de laisser mourir de faim les malheureux blessés entassés comme des harengs dans les hôpitaux de campagne, il continuait à les faire porter vivants après leur mort. Ainsi, leur allocation ne cessait pas de tomber dans son es¬carcelle.
Au début, les amis de la Pléneuf crièrent à la méchanceté, à la calomnie, à la plus abominable des diffamations. Mais quand ils apprirent l’ouverture d’une enquête officielle sur les agissements d’Étienne, beaucoup trouvèrent des excuses pour se faire de plus en plus rares aux soirées de la rue de Cléry. Sentant le vent tourner, la Pléneuf se replia avec un carré de fidèles dans son château de Ville-Évrard. Cette décision aurait comblé François Berthelot si le pauvre homme ne s’était trouvé anéanti par le déshonneur en train de tom¬ber sur une maison jadis si respectable.
Cependant, avec l’aplomb qui le caractérisait, Étienne jurait que celui qui toucherait à un seul de ses cheveux n’était pas né. Il avait d’ailleurs de quoi envoyer à la Bastille, à Bicêtre, aux enfers qui¬conque voudrait fourrer son nez d’un peu trop près dans ses pa¬piers. Au lieu de se voiler la face comme un vulgaire escroc pris la main dans le sac, il arpentait les allées des hautes administrations avec une assurance qui médusait les plus déterminés de ses adver¬saires. En réalité, il s’employait à s’assurer de la bienveillance des autorités, à tout le moins de leur neutralité. Rares étaient ceux qui, un jour ou l’autre, n’avaient pas été ses obligés. À la surprise géné¬rale, il se retrouva ainsi avec le titre pompeux de directeur de l’Artillerie auquel, pour faire bon poids, on ajouta celui de conseil¬ler du roi. Jamais les chapeaux n’avaient effleuré de si près la poussière sur son passage. Jamais non plus la Pléneuf, revenue pa¬rader rue de Cléry, n’avait donné de soupers plus éblouissants. Et jamais François Berthelot ne s’était senti aussi désemparé et mal¬heureux.
D’aucuns, cependant, attendaient patiemment leur heure. Le dossier ne faisait que sommeiller dans le silence poisseux des greffes où le moindre rayon de soleil parvient à révéler la pous¬sière de papier chargée des vilenies humaines. Il suffirait d’un de ces coups de balai comme il s’en produit régulièrement dans les administra¬tions pour que la justice réclame des comptes à l’arrogant Berthelot de Pléneuf. On avait déjà vu des escrocs de haut vol, devenus de respectables notables ayant pignon sur rue, devoir rendre des comptes quinze ou vingt ans après leurs tripa¬touillages.
Apparurent alors les jeunes frères Pâris. Avec son sens aigu de la valeur des hommes, le nouveau directeur de l’Artillerie avait tout de suite repéré ces garçons intelligents, malins et ambitieux. Ils appartenaient, comme lui, à la race de ceux qui ont les dents longues. Simple aubergiste à Moirans, aux portes de Grenoble, leur grand-père était parvenu à introduire son fils dans la bonne so¬ciété dauphinoise. C’était ainsi qu’Augustin de Ferriol, receveur général du Dauphiné, venu s’installer rue des Fossés, à Paris, avait proposé à cet ami d’user de ses relations et de celles de sa jeune femme, Angélique, pour permettre aux quatre garçons, fort bril¬lants et entreprenants, de se faire une place sous les ors de la capi¬tale.
Les Pâris ne passaient pas inaperçus. Né en 1668, l’aîné, Antoine, dit le Grand Pâris – il mesurait plus de deux mètres –, était toujours suivi comme son ombre par Claude, dit la Montagne, de deux ans son cadet. L’un et l’autre exerçaient une surveillance de tous les instants sur leurs jeunes frères qui s’en agaçaient parfois. Surtout Joseph, dit Duverney, né en 1684 mais assez bien bâti lui aussi pour paraître plus que son âge. Le dernier, Jean, dit de Montmartel, né en 1690, avait la particularité de pouvoir compter une poignée de monnaie aussi vite qu’un Chinois.
Installés à Plaisance, par les soins de M. de Ferriol, les frères Pâris n’avaient pas tardé à exercer leurs talents, déjà affirmés, dans le milieu des vivriers. Mais ils ne dissimulaient pas leur am¬bition de se faire une place dans la finance.
Étienne Berthelot de Pléneuf ne pouvait donc pas les manquer. Il s’en fit des amis en attendant de nouer des relations plus lucratives avec eux…
*
Entre les affaires bien embrouillées d’Étienne et les plaisirs non moins troubles de la Pléneuf, tel était l’étrange climat qui régnait à l’hôtel de la rue de Cléry quand, à la chute des feuilles de 1709, la plus ravissante des enfants fit son apparition. Le vieux François Berthelot ne put dissimuler une larme au moment où, de sa propre initiative, la petite demoiselle s’avança vers lui pour lui faire la révérence qu’on lui avait apprise à Ville-Évrard. Dans un éclair, confusément traversé par les propos de M. de La Bruyère sur la retraite – « Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se perdre dans la solitude et de ne plus faire parler de soi, c’est d’en faire parler magnifiquement et de se jeter, s’il se peut, dans quelque haute et généreuse entreprise… » –, il sut que le Ciel venait de lui envoyer un ange pour lui permettre de donner un sens aux quelques saisons qui lui restaient à passer sur terre. Il ne vivrait plus désormais que pour cette enfant.
L’initiative d’installer Agnès – à laquelle sa mère avait donné son prénom sans se douter de ce qu’il lui en coûterait, on le verra par la suite – à l’hôtel de la rue de Cléry venait d’Étienne Berthelot. Cela aurait dû aller de soi mais la Pléneuf ne possédait pas un ca¬ractère de mère soucieuse d’essuyer une morve sous le nez, de rele¬ver une mèche de cheveux ou de s’emparer de menottes douteuses ve¬nues traîner sur ses toilettes. Faire des enfants était une chose à la¬quelle elle s’entendait, les élever en était une autre. Car à cette fille aînée avaient succédé, année après année, un garçon, pré¬nommé Étienne, puis une fille, prénommée Henriette, puis Alban, et une autre fille… On cessa ensuite de faire le compte de sa pro¬géni¬ture mais on se demandait comment elle pouvait bien s’y prendre pour continuer, dans son état, à tourbillonner comme une comé¬dienne de théâtre italien au milieu de ses admirateurs. Certains di¬saient que la Pléneuf était comme la poule pressée d’aller agacer le coq chaque fois qu’elle vient de pondre un œuf.
Pourtant, Étienne n’avait installé que l’aînée à l’hôtel Berthelot. Les mêmes qui tenaient des propos peu amènes à l’endroit de la Pléneuf ajoutaient que c’était sans doute parce qu’il s’agissait de sa fille unique. En tout cas, Étienne avait des idées bien arrêtées sur l’éducation qu’il entendait donner à Agnès. À la fin de l’hiver, il la confierait aux Bénédictines de la Magdeleine du Trainel, rue de Charonne. Nul n’ignorait que l’abbesse, Gilberte-Françoise Veni d’Arbouze de Villemont, n’avait pas sa pareille pour préparer à la vie mondaine les demoiselles qu’on lui confiait. D’une grande beauté – on n’hésitait pas à comparer ses yeux à ceux d’une Vierge de Raphaël –, elle avait eu deux enfants – dont un d’un musicien flû¬tiste ! – avant de faire la connaissance de « l’homme en noir » qui de¬vait bouleverser sa vie. Cet « homme en noir », Étienne le connais¬sait bien, et pour cause ! Il s’agissait de Marc-René de Voyer d’Argenson, l’inamovible chef de la police, avec lequel il ne fallait pas jouer au plus finaud. « Le Damné », comme on l’appelait, en fai¬sait trembler plus d’un, même s’il savait se montrer aimable et di¬sert en société. Mais d’Argenson avait un talon d’Achille : sa double vie. Le soir, après avoir dispersé ses hommes dans tous les lieux où les murs doivent avoir des oreilles, il s’habillait de noir et allait to¬quer à la porte du couvent de la Magdeleine du Trainel. On le con¬duisait aussitôt jusqu’à l’appartement de l’abbesse, Gilberte-Françoise Veni d’Arbouze de Villemont. Cet appartement de grand style avait été construit sur intervention du chef de la police lui-même, grâce à des prélèvements sur les 15 % de la loterie royale destinés à la remise en état des couvents jugés incapables de sub¬venir à leurs besoins. Pour dissimuler le passe-droit – détourne¬ment ? –, un bâtiment destiné aux pensionnaires des Bénédictines avait été construit et le mur de clôture consolidé aux endroits les plus exposés aux regards des passants.
Dans le cercle des hautes autorités militaires où il lui arrivait de passer, Étienne en avait entendu de belles sur les soirées du chef de la police et de son abbesse. « Dès qu’il arrive, lui avait rapporté un officier supérieur, sous le sceau de la confidence, il s’étend molle¬ment sur le duvet d’un amas d’oreillers que les saintes filles placent elles-mêmes pour délasser la tête, les épaules et les bras de monsei¬gneur. On délivre ses pieds de ses pantoufles pour les frotter avec de l’eau-de-vie, et monseigneur, un peu douillet, demande toujours qu’on les lui gratte doucement. Les plus jeunes et les plus jolies nonnes font le service autour de son lit. Les plus belles mains vi¬dent ses poches et ses portefeuilles. Les placets et les rapports ad¬ministratifs charment son oreille en passant par de jolies bouches. Après le travail, viennent les plaisirs de la conversation, et puis le souper qu’assaisonnent les propos galants. À 11 heures, le sérail se retire. On embrasse le génie protecteur de la maison, on le dorlote, on le bercerait même au besoin pour l’endormir. »
Ces confidences ne dissuadaient pas Étienne de confier Agnès à la Magdeleine du Trainel, bien au contraire. La pensée que sa fille pourrait un jour se prêter à ce que d’Argenson appelait son « massage oriental » – fallait-il donner du crédit à tout ce qui se col¬portait au Cercle militaire ? – ne lui venait même pas à l’esprit. Ou s’il en entrevoyait la possibilité, dans un futur éloigné, c’était pour se dire que celui qui tient le chef de la police peut se permettre de mener ses affaires sans avoir à trembler chaque fois qu’il se per¬met une petite entorse à la loi. Les calculs de cette sorte faisaient partie de la nature d’Étienne Berthelot de Pléneuf.
Le couvent lui-même menait une double vie. Nul ne se serait permis de contester l’excellence de l’éducation qu’on y dispensait. Jusque du fin fond des provinces, on venait lui confier des demoi¬selles présentant les plus enviés des quartiers de noblesse. Certains trouvaient même qu’on y imposait une discipline bien contrai¬gnante. Mais c’était le prix à payer pour pouvoir se flatter, plus tard, d’être passée par la Magdeleine du Trainel.
En cette année 1709, Étienne multipliait donc les démarches pour parvenir à inscrire Agnès à ce prestigieux couvent qui vous clas¬sait une famille encore mieux qu’un banc à l’église. La Pléneuf prêtait à peine attention à ce qu’elle considérait comme une for¬malité. Quoiqu’il ne lui déplût pas de voir sa fille s’éloigner un peu de ses miroirs. Elle com¬mençait à l’agacer avec sa façon de co¬pier ses poses. Mais la Pléneuf avait d’autres chats à fouetter. Submergée par les préparatifs de ses fêtes d’automme, elle ne savait plus où donner de la tête. Son principal souci venait du froid arrivé en avance cette année et fort désagréable quand le vent du nord, surgissant de la rue Poissonnière en rafales cinglantes, s’engouffrait dans les por¬tières des carrosses obligés d’attendre leur tour au pied des co¬lonnes doriques.
Le vieux François Berthelot en profitait pour passer de longs moments avec sa petite-fille. C’était une demoiselle vive, curieuse de tout et toujours de bonne humeur. Il ne lui avait pas fallu long¬temps pour apprendre à démonter et remonter un pistolet aussi bien qu’un vieux fantassin, en dépit de la finesse de ses mains qui faisaient penser à de la porcelaine. Mais chose curieuse, elle ne manquait jamais de s’enquérir de la valeur des objets qu’elle cares¬sait longuement quand elle les savait plus précieux que d’autres. La peau de caribou la fascinait avec le dessin de cette mystérieuse fo¬rêt canadienne dont les contours avaient fini par s’effacer à la longue. « Je serai la reine de ce pays et vous en serez le roi. On m’appellera la reine Caribou », disait-elle de sa voix fluette, en le¬vant vers son grand-père ses beaux yeux clairs, un peu chinois, dans lesquels il n’y avait cependant nulle trace d’innocence. On aurait dit qu’elle se voyait reine pour de vrai.
Dédaignant Les Contes de ma mère l’Oye que son grand-père avait cru bon de lui offrir au lendemain de son arrivée, Agnès ne semblait s’abandonner aux rêveries propres à son âge qu’en l’écoutant raconter sa longue existence de vivrier puis de fermier général. Mais elle cherchait toujours à entrer dans les détails : comment on traitait la vieille corde à Pont-Sainte-Maxence pour la transformer en mèche, comment on préparait les barils de poudre, comment, plus tard, s’organisait la collecte des taxes… Comment, c’était toujours comment. Mais quand François Berthelot se mettait à raconter les guerres du Grand Condé, il n’avait plus en face de lui qu’une petite demoiselle rêvant d’être à son tour une Grande Demoiselle. Inlassablement, il dut lui décrire les scènes dont il avait été le témoin à l’époque de la Fronde des princes. Elle ne se lassait jamais de l’écouter. Dotée d’une mémoire stupéfiante, elle reprenait parfois son grand-père quand il s’emberlificotait dans les dates ou confondait certains personnages. Pareillement, les descriptions du château de Chantilly la mettaient aux anges. On voyait bien que, dans son esprit, il n’y avait rien de commun entre le château fami¬lial et tapageur de Ville-Évrard, où elle avait passé les dernières années de sa petite enfance, et ce noble palais revêtu de la patine de l’histoire. François Berthelot aurait bien voulu présenter à son Agnès ces lieux qui lui étaient si chers mais, outre que le voyage n’était pas de saison – il faisait décidément bien froid cette année –, l’âge lui interdisait désormais de s’aventurer sur des chemins de campagne.
Mais les promenades à pied ou en calèche dans un Paris déjà fri¬gorifié ne déplaisaient pas à Agnès peu sensible aux caprices du ciel. Le vieil homme et la jeune demoiselle prirent ainsi l’habitude de déambuler aux alentours du Palais-Royal qui n’avait depuis longtemps plus de secrets pour François Berthelot. Après avoir longé les berges de la Seine, il leur arrivait de s’égarer dans le fau¬bourg Saint-Antoine et de prolonger leur promenade jusqu’à la Bastille. Agnès fut frappée de stupeur le jour où elle découvrit le monument que le marquis d’Argenson (« l’homme en noir ») avait fait dresser dans l’une des deux cours. Des statues de prisonniers enchaînés soutenaient une monumentale horloge. Et, comme si l’allusion ne suffisait pas, le cadran de l’horloge s’ornait de lourdes chaînes. En pareil lieu, c’était odieux. « Quand je serai la reine Caribou… » Le vieil homme préféra prendre sa petite-fille par la main et l’entraîner plus loin.
La boutique de Gaultier, où se trouvaient exposées les plus riches soieries de Paris, avait les faveurs d’Agnès. On pouvait déjà deviner qu’en matière de coquetterie, elle n’aurait rien à envier à sa mère. Grande pour son âge, les bras longs, les mains fines, la taille déliée, un petit air de nymphe – mais François Berthelot savait qu’il ne fallait pas trop s’y fier –, la chevelure d’un blond cendré et d’une extrême finesse, elle franchissait avec grâce cet âge que l’on sait arrivé rien qu’en sentant le regard des hommes se poser sur soi.
François Berthelot eut envie de lui faire confectionner une robe. Pas une robe de fillette épaisse et droite comme un sac de blanchis¬seuse, avec des dentelles blanches et des rubans roses, mais une robe en mousseline de coton cintrée d’un bleu affirmé avec des fronces du haut en bas. Une vraie robe de demoiselle. Les mesures furent prises dans le plus grand secret et, au jour dit, la voiture de Gaultier vint livrer la précieuse toilette enveloppée dans du papier de soie. La Pléneuf n’y vit que du feu. Les derniers préparatifs de sa réception du soir suffisaient à retenir son attention.
Mais elle était bien la seule à rester dans l’ignorance de ce qui se tramait. De l’officier de Madame au dernier laquais chacun voulut participer à sa manière à la surprise. On s’empara d’Agnès, on orna sa chevelure de chérubin d’un gros ruban, on lui poudra le visage, on lui passa la robe de Gaultier avec des précau¬tions de sœur tou¬rière enfin autorisée à préparer le saint sacrement, on s’extasia de voir apparaître une vraie demoiselle et on la poussa dans l’escalier.
Ce jour-là, la coterie de la Pléneuf se pressait, nombreuse mais choisie, sous les candélabres du grand salon en attendant le souper. On y côtoyait, entre autres, le chevalier de Belle-Isle, le marquis de La Fare, Moreau de Séchelles, le conseiller d’État Claude Le Blanc et surtout le beau chevalier d’Angennes dont il fallait savoir qu’il jouissait des faveurs de la Pléneuf. Pour le moment car, en comp¬tant bien, certains réussissaient à trouver vingt et un amants à la Messaline de la rue de Cléry ! Chez la Pléneuf, il suffisait d’avoir la patience d’attendre son tour.
L’apparition d’Agnès au détour de l’escalier fit aux invités l’effet de la poupée en nouvelle porcelaine de Saxe, venue de Meissen, qui, depuis le début de l’hiver, trônait au centre de la boutique de Fresnaye, au Palais-Royal. Il y eut des « oh ! », des « ah ! », et même quelques applaudissements. On croyait que, sans en avoir informé personne, la Pléneuf faisait à ses amis la surprise de l’entrée de sa fille dans la société. Sans se concerter, Claude Le Blanc et le cheva¬lier d’Angennes posèrent chacun un pied sur la première marche de l’escalier et tendirent le bras dans l’intention de s’emparer des doigts fluets de la jeune demoiselle. Charmée, éblouie par tant de regards posés sur sa personne, Agnès se voyait reine, avec un dia¬dème posé sur ses cheveux d’ange, comme dans ses rêves les plus féeriques. Et, dans l’entrebâillement de sa porte, François Berthelot devait se cramponner pour résister aux coups précipités de son vieux cœur comblé.
Un « Suffit ! » glacial interrompit le mouvement de Le Blanc et d’Angennes. Ils se regardèrent, aussi gênés que des comédiens en train de rater leur scène. Mais Agnès ne les voyait plus. Sentant ses jambes lui manquer sous la robe d’organdi, elle recevait le « Suffit ! » de cette femme plus durement qu’un crachat. Elle aurait voulu s’écrouler et mourir au bas de l’escalier pour échapper à ce regard, ce rictus, ces mouvements de tête nerveux qui ne venaient pas d’une mère, non, mais d’une femme dont les traits se décomposaient sous l’effet de la jalousie. Il n’y avait qu’une reine ici et il fallait qu’on le sût une fois pour toutes. Agnès se retourna et s’enfuit, petite Cendrillon meurtrie à jamais, alors qu’en guise de premier sourire au monde qui l’attendait il lui avait pris la fantaisie de faire la belle. François Berthelot l’agrippa au passage. Elle s’effondra dans ses bras et se mit à pleurer sans s’arrêter. Plus tard, il l’accompagna jusqu’à son lit et la coucha avec l’aide d’une cham¬brière. Il l’endormit en fredonnant les chansons qui lui venaient toujours à l’esprit sur la route de Chantilly.
*
Plus que quelques jours et Agnès allait faire son entrée au cou¬vent de la Magdeleine du Trainel. Elle se sentait soulagée. Depuis l’affaire de la robe, la Pléneuf, déjà peu encline à lui manifester une quelconque marque d’intérêt – quant à la tendresse, c’était un sentiment réservé à ses seuls amants –, se montrait d’une froi¬deur confinant à la dureté. Pour obtenir qu’Agnès prenne ses re¬pas à la table familiale, au moins aux fêtes liturgiques et votives, son père usait d’arguments cent fois rabâchés : c’est le seul moment où je peux juger de son éducation, il faut lui apprendre à bien se te
Cette biographie retrace l’extraordinaire ascension d’Agnès Berthelot de Pléneuf (1698-1727), fille d’un fermier général des poudres et épouse d’un aristocrate normand désargenté, le marquis de Prie, à la cour de Louis XV. Belle et intelligente, et devenue la maîtresse du puissant duc de Bourbon-Condé, cette jeune marquise incarnera ce mélange d’ambition effrénée et de distinction mondaine qui caractérisa la Régence. Après être entrée en relation avec le roi de Pologne détrôné, Stanislas Leszczynski, elle organisera le mariage de sa fille Marie avec Louis XV. Pendant deux ans, son amitié avec la reine Leszczynska fera d’elle la femme la plus puissante de la cour, mais sera source de jalousie qui la conduiront à une semi-disgrâce qui l’obligera à quitter Versailles pour s’isoler en son château normand de Courbépine et y mourir du tétanos.
À l’instar de sa Madame Voltaire, Gilbert Mercier construit une biographie à l’architecture subtile : l’échange épistolaire propre à cette époque lui permet de raconter la vie à la cour du Régent, alors que nous sommes avec Mme de Prie à la cour de Savoie. Un livre au charme certain qui déroule la vie de la marquise de Prie comme un menuet ou une pièce de clavecin.
" Autant le dire d'entrée, Gilbert Mercier est possédé par son sujet. Il en parle avec flamme,admire sa grace,son intelligence, s'apitoie sur ses déboires, trouve toutes les excuses à son héroine, trauma dès le départ, pauvre jeune fille jalousée par une mère coquette invétérée qui avait "vingt-et un amants à la fois"".
L'est Républicain, 18 Septembre 2005.