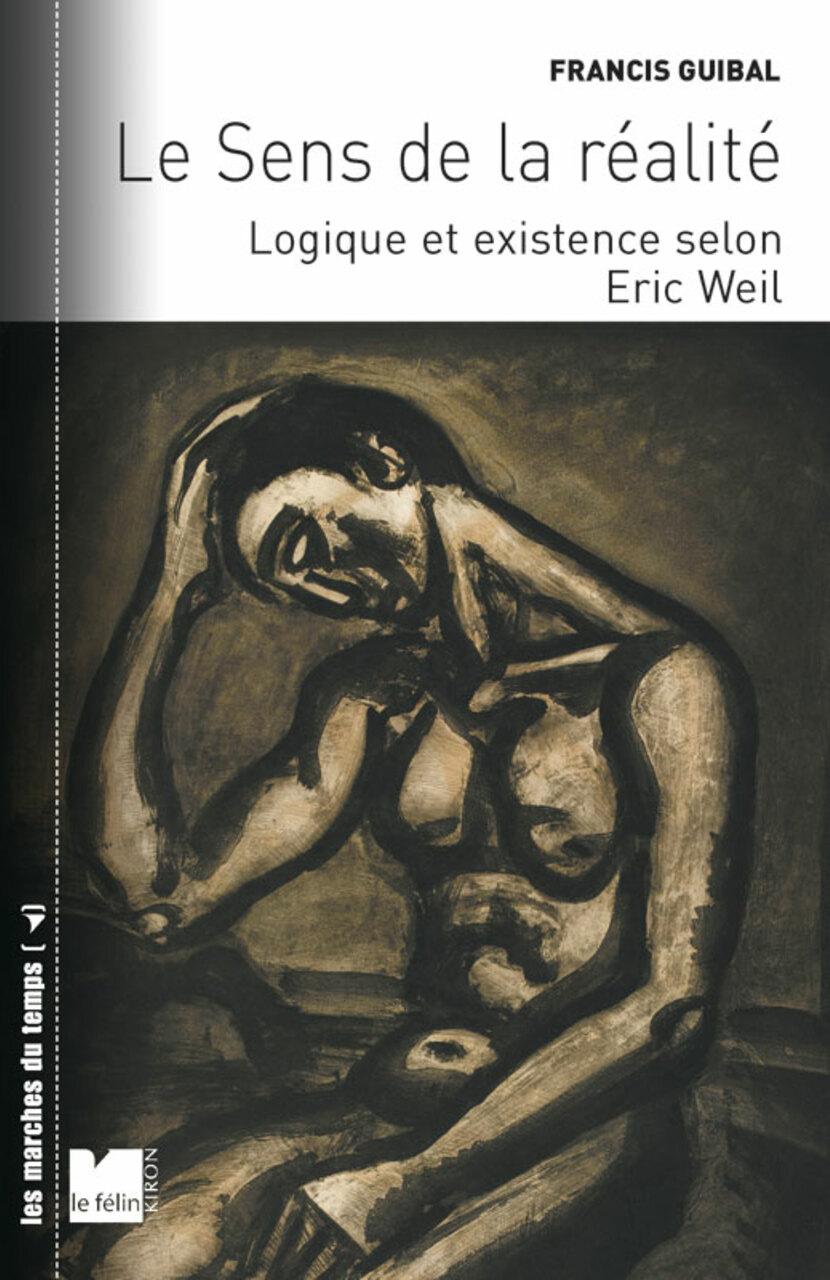
Le Sens de la réalité
«L’homme, fini et raisonnable à la fois, ne peut pas ne pas chercher l’infini, le fondement dernier, la totalité de la réalité (…)»
Philosophie et réalité, p. 64.
On propose ici un premier parcours de l’œuvre weilienne. En partant d’abord des principaux héritages historiques qu’elle se reconnaissait : Hegel, Kant et Aristote sont ici trois «géants» omniprésents. En abordant ensuite la pensée systématique par son versant pratique, qui fait passer la raison de l’exigence morale à sa concrétisation politique et historique. En laissant entrevoir enfin le projet d’auto-compréhension raisonnable qui anime la Logique de la philosophie : sur fond de langage et de violence rationalisés en discours, la pensée, toujours ancrée dans l’effectivité de l’action, s’oblige à articuler au plus juste la vue du sens et la vie de la sagesse.
De l’homme Weil on a souvent dit qu’il était à la hauteur de sa pensée, incarnant avec un humour souriant et bonhomme une sagesse consciemment accordée au présent de sa situation. D’une culture exceptionnelle, attentif à tous les domaines du savoir, il s’intéressait notamment à ce lieu par excellence de l’exister humain qu’est l’histoire; et la puissance spéculative capable de lier en systématicité cohérente la complexité contingente du réel ne s’opposait nullement chez lui à la finesse d’une sensibilité sachant apprécier et goûter les saveurs toujours singulières du vécu. L’œuvre, quant à elle, s’impose par une sorte de force austère étrangère à tous les effets de mode. En son centre, le maître-livre qu’est la Logique de la philosophie contient sans doute, à sa manière, tout l’essentiel du penser weilien. Celui-ci se déploie et se concrétise plus explicitement en philosophie pratique, inséparablement éthique et politique. Et il sait même se faire plus circonstanciel et accessible dans des essais divers, où la qualité de l’information soutient une problématique toujours rigoureuse mais soucieuse de clarté pédadogique, le jugement philosophique le plus sûr s’y alliant constamment à la conscience historique la plus avertie. C’est en fidélité à cet esprit du philosophe-éducateur que procèdera l’approche ici proposée, en suivant l’ordre inverse d’une découverte progressive qui tentera d’acheminer par étapes jusqu’au cœur vivant de cette pensée exigeante.
Sur les épaules des géants
«Le nain a tout intérêt à ne pas descendre pour essayer de marcher tout seul avant que le géant n’ait terminé sa course.»
Problèmes Kantiens, p. 11.
L’histoire – et singulièrement l’histoire de la philosophie – habite toujours la pensée weilienne. De sa richesse multiforme émergent notamment les figures de trois géants que Weil n’a jamais cessé de fréquenter et de méditer pour mieux les repenser : Hegel, Kant et Aristote.
Ce fut d’abord comme hégélien que Weil trouva accueil sur la scène de la pensée française : Hegel et l’État exhibait en effet la modernité et la pertinence politiques des Principes de la philosophie du Droit, cependant que J. Wahl n’hésitait pas à saluer dans la Logique de la philosophie une «Phénoménologie de l’esprit 1950» ! Montrant, en effet, que l’État hégélien «n’est rien d’autre que la société consciente d’elle-même », Weil indique à la fois la lucidité politique de cette pensée qui reconnaît dans «la réforme de la société» « le problème de l’État moderne» (PR 2, 250) et la signification inséparablement historique et spirituelle de ses orientations essentielles. Ce qui lui permet de recueillir du maître de Berlin le sens conjoint des conditions et de la liberté, des structures et du sens, de l’intégralité (objective) et de la négativité (subjective), bref de ce qui permet à l’esprit de venir à soi dans et par la saisie logico-conceptuelle de la concrétude historique. Qui plus est, dans la mesure même où il entend tout comprendre en se comprenant soi-même, le système de l’idéalisme spéculatif élève à son auto-conscience raisonnable la cohérence du discours philosophique tel qu’il s’exerce à la fois dans et sur l’effectivité du monde. Dès 1950, cependant, distance était clairement prise à l’égard de certain constructivisme théorétique faisant finalement (trop) bon marché de l’existence finie. Sans oublier jamais les avancées et les acquis – irréversibles – du geste hégélien, il fallait tenter de l’ouvrir – autrement – au sens de l’altérité et du respect, à l’écart irréductible qui interdit toute identification de la liberté et de la raison à l’intérieur d’un prétendu système du savoir ou de la totalité où se déploie souverainement l’auto-mouvement de l’Esprit.
On comprend donc que Weil ait été amené à reconnaître de manière toujours plus explicite dans «la conscience kantienne» de la séparation et de l’injonction ce qui ne cesse de résister à «la prétention hégélienne» (PR, 51) trop avide d’Absolu. Ni critique de la connaissance, ni nostalgique d’un Être inaccessible, le Kant de Weil pense la finitude de l’existence comme lieu et quête du sens. Le philosopher mondain excède chez lui toute doctrine d’école, fût-elle kantienne ou transcendantale, la liberté n’est raisonnable qu’à éprouver et reconnaître ses limites rationnelles et sa violence potentielle. Entre savoir et devoir, dès lors, ni totalisation réconciliatrice ni abîme infranchissable, mais une articulation sans confusion, à l’intérieur d’un monde dont la factualité même s’avère structurée et dans l’espace duquel l’individu est invité à s’orienter. Loin de toute maîtrise déterminante, il revient au jugement réfléchissant d’accueillir et de déchiffrer dans la contingence les signes d’un sens à la fois existant et infixable, «toujours réel, toujours à découvrir, toujours à réaliser, toujours assuré à qui le cherche ». Et Weil n’hésite pas à voir dans le tournant engagé par la troisième Critique une «seconde révolution copernicienne» qui reste encore à poursuive, car certaine obsession de la pureté (transcendantale ou pratique) a en partie empêché Kant de s’engager décidément et sans réticence dans la voie nouvelle qu’il avait pourtant découverte et commencé à frayer : celle d’une pensée du sens à même la finitude mondaine, sensible et historico-culturelle…
Il reste à évoquer le troisième – peut-être pas le moins grand ni le moins important – des «géants» weiliens, Aristote. Weil s’y réfère dans des essais importants qui portent sur son anthropologie, sa logique et sa métaphysique. Significativement, il ne cherche nullement à minimiser la distance d’une certaine manière abyssale qui nous sépare du penseur grec : l’appartenance à un «cosmos» fini et harmonieux, l’autarcie de la cité, le prix social (travail servile) de la liberté des «maîtres», autant de faits décisifs qui «nous» éloignent de l’univers aristotélicien. Mais cela n’empêche pas Weil de souligner ce que peut encore comporter d’exemplaire pour nous la pensée du Stagirite, dans sa manière notamment de lier et d’articuler l’expérience singulière et la raison universelle, la vie sensible et la théorie sensée, les vertus du caractère et celles de l’esprit, l’éthique et la politique, la prudence pratique, finalement, et la sagesse théorétique… Comme si restait encore à trouver, ou peut-être à réinventer, dans le contexte radicalement autre de notre société mondialisée, de notre liberté et de notre finitude historico-spirituelles, une pratique plus «juste» du discours et du dialogue, du «travail» et du «jeu» de la raison.
Les dieux, la loi, l’existence
«Tout philosophe de la morale introduit de nouveaux dieux, un nouveau dieu, l’exigence de l’universel.»
Philosophie Morale, p. 14.
La «morale», entendue comme question, appel et injonction à la responsabilité, a souvent constitué, depuis Socrate notamment, la voie royale d’accès à la philosophie. Aujourd’hui encore, elle est sans doute pour nous, individus modernes, l’entrée la plus «naturelle» dans le monde de la pensée. Car elle s’adresse à l’existence singulière de chacun en son désir le plus constitutif : celui d’une vie bonne et heureusement accomplie.
Au point de départ, pourtant, l’objectivité première est plutôt celle d’un vivre-ensemble inter-humain, à l’intérieur de communautés de sens toujours déjà organisées et structurées, dotées d’institutions et de valeurs normatives. Mais le monde de la «certitude» – de la cohésion sans faille du groupe et de ses membres revendiquant une «vérité» certaine de soi, inséparablement théologique, ontologique et axiologique – n’est qu’une fiction-limite, voire une projection mythologique. Aussi l’effectivité historico-culturelle, en faisant se rencontrer, se heurter et s’affronter l’absolu pluriel de ces «certitudes» massives, tend-elle à susciter comme une guerre des dieux qui expose et abandonne finalement les individus à la nudité sans abri d’une liberté devenue problématique et sans recours. Perdue la sécurité dogmatique de la tradition, ce qui menace alors, c’est le risque de l’équivalence et de l’indifférence généralisées, du vide et de la violence nihilistes.
Mais de cette crise des morales concrètes en leur prétention à l’absolu du sens, peut naître également l’exigence réfléchie de la philosophie morale. Ce qui demeure, en effet, dans le naufrage des certitudes traditionnelles, c’est la nécessité impérative pour l’existence de s’orienter et la possibilité corrélative de chercher dans «la pure forme de l’universalité» (PP, 19) raisonnable un critère de jugement et un principe d’orientation. Et Weil s’inscrit explicitement dans le sillage de la pensée critique lorsqu’il s’efforce de lire dans ce pur vouloir de l’universel, reposant lui-même sur l’auto-détermination, «en toute liberté », de l’homme à la raison, le fondement abyssal de la morale et l’invitation à une nouvelle auto-compréhension de la philosophie. Par quoi ne s’énonce ni ne s’annonce aucun dieu concrètement nouveau, aucun contenu moral original, mais bien la seule instance formelle et négative d’une loi susceptible de juger tous les dieux et d’ordonner toutes les règles des morales historiques diverses en les soumettant au seul impératif catégorique de la dignité humaine ouverte à l’absolu de l’universalisation raisonnable.
À l’individu effectivement existant, une telle loi n’enjoint d’autre devoir que celui de se vouloir et de s’éprouver «heureux en tant que raisonnable», c’est-à-dire en tant qu’universalisable. Exigence toute formelle que ce respect en moi de la raison comme faisant la dignité sans prix de l’humain; mais qui ouvre à l’infini l’espace d’une «formation» – à la fois in-formation et trans-formation – aussi effective que possible. «Entre l’universalité de la loi et l’individualité irréductible du sujet moral» (PM, 38), je me dois, en effet, de chercher à vivre non seulement sous la loi, mais de la loi, en tentant d’accorder au mieux et au plus juste en moi raison et sensibilité, en laissant la forme raisonnable devenir en moi principe de vie et de personnalité, source d’une «vertu qui soit perfection de l’homme tout entier1 ». La morale, autrement dit, trouve son accomplissement dans la vie morale des existants singuliers, une vie dont l’équilibre, toujours à inventer, passe par l’excellence d’un juste milieu situé entre l’exigence et l’effectivité, l’universel et le concret, la forme du sens et le contenu du sensible.
Cet équilibre dynamique culmine ainsi dans une sagesse pratique à laquelle Weil, après Aristote, donne le nom de phronèsis ou de prudence. «Faculté de discerner, grâce à l’expérience et la réflexion» (PM, 191), ce que requiert ici et maintenant une vie effectivement bonne et sensée, cette «vertu» fondamentale est à la jonction toujours mouvante de la pensée et de l’action, de l’universalité raisonnable et de la situation singulière. Et elle tend à former et comme à engendrer une spontanéité nouvelle, une sensibilité et un «tact» (PM, 197) spirituels qui se traduisent finalement en créativité «de nature poétique» (PM, 167), capable d’inventer des «formes de vie autres et supérieures» (PM, 166) – un tel «héroïsme» ne faisant d’ailleurs que mener à sa vérité toujours en acte une vie morale à l’originalité de laquelle tous sont appelés selon leur mesure propre.
Il y a donc bien place ici, et éminente, pour «l’invention morale» et «les créations de cette inventivité», mais sans que cela donne lieu à aucun débordement arbitraire; cette «vie morale», en effet, «a son lieu dans les limites et sous le contrôle de la loi morale1 » qui en juge l’orientation universelle ainsi que «dans le contexte d’une morale historique» (PM, 64) qui en vérifie la pertinence effective. C’est que, dans la mesure où elle se veut raisonnable et agissante, cette «morale des vivants» (PM, 140) tend à s’excéder en intervention politique dans l’effectivité commune d’un monde pluriellement partagé : «l’individu novateur dans le domaine moral n’agit pas sur le plan moral, mais sur celui de l’histoire» (EC 1, 145). Et cette action n’a de sens qu’à «chercher la justice ici et maintenant» (PM, 139), au cœur d’un monde impur, ambigu et violent, mais dont les institutions déjà existantes sont moins à «abroger» qu’à «parfaire» (EC 1, 145). Dans ce désir et cette quête d’une justice vivante, la prudence ne saurait aller sans le courage, sans «l’acceptation raisonnable et courageuse du risque moral inévitable» (PM, 187) au sein de notre condition finie.
Une telle pensée morale, on le voit, trouve son principe (kantien) dans la pureté formelle de l’universalité raisonnable; mais elle souligne autrement, plus nettement et plus vigoureusement que Kant, que c’est cette universalité même qui «fonde en raison le droit de l’individu à son individualité, à sa personnalité» (PM, 149). Elle recueille d’ailleurs également certain héritage hégélien en inscrivant cette instance de jugement critique au cœur de l’effectivité socio-historique concrète et en rappelant que «l’exigence de l’universel» n’a de sens que référée «à la morale historique d’un monde donné» (PM, 143) dont elle ne cesse de présupposer l’existence. Mais c’est sans doute à Aristote qu’elle doit sa compréhension de la vie morale comme «inventitivité prudente et courageuse» (PM, 191) se déployant dans les limites de la finitude sensible, personnelle et communautaire. Toutes ces dimensions constitutives se joignant et se nouant finalement au présent toujours singulier et chaque fois nouveau – «la vie morale commence à chaque instant» (PM, 127) – d’une existence dont la réalité finie se vit, se réalise et se comprend comme «liberté dans la condition, appuyée sur la condition, existant grâce à la condition» (EC 1, 196).
Le rationnel, l’historique, le raisonnable
«La raison existe dans l’histoire et elle y existe de façon historique.»
Philosophie Politique, p. 126.
Pour le philosophe, la morale fournit à l’action (politique) son fondement et sa visée raisonnables : le vouloir libre d’un monde d’égalité et de justice pour tous les sujets de la loi. Mais, entre le principe et la fin, il y a toute la résistance et toute la violence effectives de notre condition finie. Prendre la mesure de cet écart, penser par là même l’articulation, à la fois réelle et possible, de ces deux dimensions, sans sacrifier l’exigence de sens (Kant) ni minimiser l’organe-obstacle de la puissance (Machiavel), tel est le défi que tente de relever la Philosophie politique. Elle part donc de la moralité, mais en la prenant dans l’accomplissement qui la mène à sa «fin» : l’individu vivant qui, pour «agir à sa place comme il convient d’y agir» (PP, 51), accepte de se laisser former et éduquer à la responsabilité d’un jugement non moins lucide que critique. Cette mise «en marche» (PM, 213) et en œuvre de la morale et de ses exigences à travers la politique et son agir passe par un discernement qui, pour «changer le monde», commence par s’obliger à le déchiffrer et à «le comprendre dans ce qu’il a de sensé ».
Aussi importe-t-il de partir de ce qui constitue, aux yeux de Weil, la nouveauté décisive de notre modernité : l’apparition, l’expansion et la mondialisation tendancielle d’une société qui se construit tout entière autour du travail rationnellement organisé. Notre humanité n’a d’autre «sacré» qu’une puissance techno-
scientifique qui la met en position de domination et d’exploitation à l’égard d’une nature réduite à l’état de matériau disponible. La finitude besogneuse et laborieuse d’une «condition» socio-économique soumise au règne de l’entendement objectivant, voilà le cœur d’un monde, le nôtre, qui ne fonctionne qu’au calcul opératoire et à l’efficacité matérielle. Il y a là, estime Weil, une réalité nouvelle, irréversible et inévitable, mais qui débouche de ce fait sur une crise dont il faut mesurer la portée historico-culturelle : cette société, en effet, produit des individus radicalement insatisfaits, en «manque» conjoint de justice effective et de sens vivant.
Pour prendre en charge ce monde de la «condition» et ses tensions, pour l’orienter autant que possible en liberté raisonnable, il ne suffit pas d’en appeler au seul (bon) vouloir moral des individus; c’est au plan de l’agir socio-historique que la question doit être affrontée. Et l’acteur «décisif», dès lors, ne saurait être que l’État, cette forme d’auto-organisation qui permet aux communautés historiques de se poser comme «sujets» capables de répondre de manière pertinente aux défis de la contingence.
Sans méconnaître le «techniquement nécessaire» de la rationalité efficace, il s’agit pour l’acteur étatique de le confronter et comme de «l’ajuster» au «moralement souhaitable» (PP, 211) du sens éthique en vigueur dans les mœurs; et cet accord du «juste avec l’efficient» (PP, 185) ne relève d’aucun savoir, pas plus spéculatif qu’objectif, mais du seul jugement prudent. Aussi l’action responsable de l’État raisonnable passera-t-elle (en principe), pour maintenir au mieux la cohésion, l’autonomie et les avancées historiques du groupe, par une éducation réciproque dont la discussion, démocratiquement instituée, «réglée par la loi, ouverte et continue» (PP, 211), est le ressort central : l’autorité gouvernementale en est bien le maître d’œuvre – c’est elle qui la prépare et la suscite, qui la dirige et la mène à son terme –, mais à l’intérieur d’un rapport interactif avec la communauté et ses représentants (Parlement), tous considérés comme citoyens, c’est-à-dire «gouvernants en puissance» (PP, 203), aptes «à commander» non moins qu’à «obéir» (PP, 255).
C’est dans un monde déjà rationalisé mais encore violent, soumis à la compétition socio-économique et aux conflits politiques, que s’exerce l’action en principe raisonnable de l’État – ou, plutôt, des États. Prendre conscience, lucide et vigilante, de ces tensions, invite par là même à dessiner idéalement un horizon pratique de sens qui s’ouvre, notamment, à partir d’une mondialisation qu’il s’agirait de parfaire en la maîtrisant et en l’orientant. Car il est possible d’estimer qu’il est de l’intérêt bien compris des puissances politiques, même dominantes, de travailler à mettre en place une telle instance de régulation de la «société mondiale »; non pour s’en satisfaire, mais pour y trouver, justement, la condition de survie, voire de libération, de ces particularités signifiantes que sont et doivent demeurer les traditions historico-culturelles diverses.
Se doter de cet organe de rationalisation de la société économique signifierait, pour les acteurs politiques décisifs que restent les États, se donner les moyens d’une transformation endogène qui les rapproche de leur «idée» finale : l’universel de l’entendement rendant possible la libération des noyaux de sens éthico-culturels de l’humain, les «États particuliers libres» (PP, 240) pourraient cesser en principe de se crisper sur leur «souveraineté» de puissance contraignante et de défense belliqueuse pour (re)trouver leur vocation raisonnable de communautés historiquement organisées d’éducation et de valeurs. C’est dans cette direction – idéale –, en tout cas, que doivent chercher à les orienter, dès à présent, les citoyens et les dirigeants conscients, afin que ces communautés deviennent un peu plus et un peu mieux des espaces éthiques d’amitié et de vertu, où les individus vivants accèdent à leur «personnalité» effective en se formant à l’expérience, à la pensée et au partage interculturel du sens.
Le courage de la raison passe par une pensée de l’agir éthique et politique qui invite finalement à une remontée réflexive jusqu’aux sources du discours et d’une cohérence accordée au sens de la réalité. La Logique de la philosophie se voue à cette tâche systématique d’une pensée résolue à penser sa propre pensée, à se comprendre elle-même, soi et toute chose. Logique du sens, elle soumet l’ensemble des philosophies apparues dans l’histoire à une mise en ordre idéale qui en tire une succession signifiante de catégories intelligibles. Sur fond de silence et de langage archaïque, le déploiement de la raison antique fait ainsi place aux avancées de la liberté moderne avant que la mise en question de la récapitulation spéculative n’ouvre la voie à un philosopher contemporain en quête d’une plus juste articulation entre la pratique, la vue et la vie. Reste à mettre à l’épreuve du réel cette idéalité logiquement dégagée. La forme vide du sens se voit alors confrontée à la condition historique de l’existence ainsi qu’à la fragilité des constructions raisonnables et à la violence potentielle de la liberté finie ; avant que soit examinée la manière dont le discours de la compréhension tente de replacer les tensions et contradictions de la négativité dans l’infinité positive du tout sensé de la réalité. Entre logique et existence, l’accord ainsi pensé n’est ni garanti ni arbitraire, ni nécessaire ni impossible, mais il se donne à inventer, toujours à nouveau, comme effectivement possible. Dans le sillage de la pensée kantienne du sens, F. Guibal esquisse pour finir une mise-en-dialogue entre ce sens formel de la réalité (Weil) et le sens éthique de la transcendance (Levinas).
Francis Guibal, agrégé et docteur en philosophie, est actuellement professeur émérite de l’Université de Strasbourg. Auteur de nombreux articles et livres, il s’appuie sur une formation hégélienne pour explorer les grands axes de la pensée contemporaine, en rapport notamment avec l’éthique et la politique, la culture et la religion. Dernières publications : Emmanuel Levinas – Le sens de la transcendance, autrement (PUF, 2009) et Le courage de la raison – La philosophie pratique d’Eric Weil (Le Félin, 2009), dont le présent ouvrage est le prolongement.