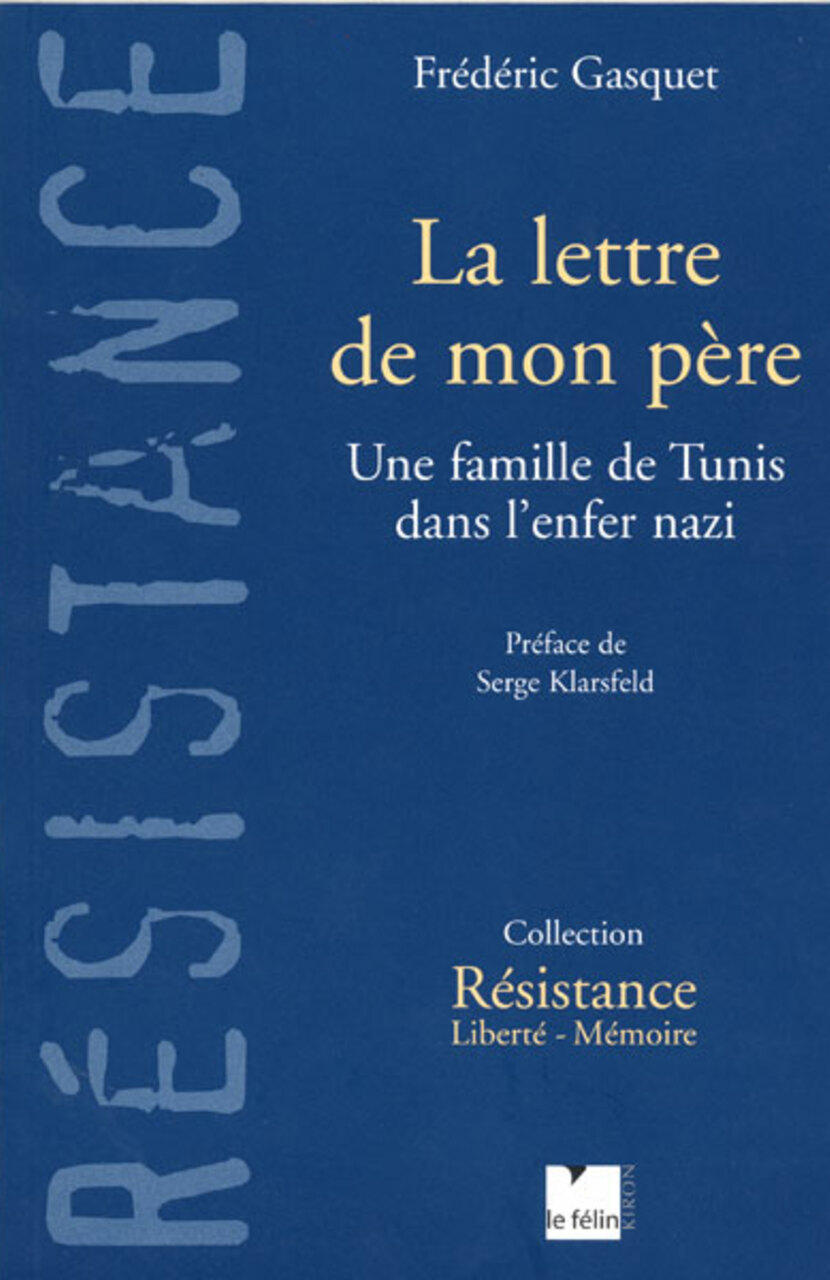
La lettre de mon père
Au revoir la Russie, à nous Paris
Lila, ma mère, et Ola, sa sœur, Vilenkine de leur nom de jeune fille, naquirent dans les années 1910, à Tachkent, aujourd’hui capitale de l’Ouzbékistan. Russe juive, leur famille avait perdu toute référence à ses traditions et au culte de ses ancêtres, probablement bien avant la révolution de 1917.
Maxime et Rachel, leurs parents, tous deux originaires de Moscou, vivaient avec leurs deux enfants une vie bourgeoise et paisible. La révolution battait son plein quand un cousin, alors officier enrôlé de force dans l’armée russe pour vingt-cinq ans comme cela arrivait souvent, prévint mon grand-père de son arrestation imminente. En effet, Maxime Maximovitch était chef d’une entreprise de soierie prospère et faisait à ce titre partie de la catégorie des bourgeois capitalistes à abattre. Il réussit à quitter précipitamment la Russie, seul, prétextant des affaires en Turquie. Il se réfugia à Constantinople, aujourd’hui Istanbul. Nous étions en 1920. Ma mère et sa sœur avaient alors respectivement deux ans et sept ans. Toute tentative de mon grand-père pour retourner en Russie et y récupérer sa famille aurait été vaine et dangereuse. Un an et demi plus tard, Rachel, sans nouvelles et sans ressources, lasse d’attendre un retour improbable, prit la décision de le rejoindre bien qu’elle n’eût pas son adresse : l’échange de courrier avec l’étranger était impossible. Retrouver son mari dans une grande ville comme Constantinople n’était pas une affaire simple et sans risque. Et d’ailleurs, y arriverait-elle ? Elle décida tout de même de tenter l’aventure. Elle vendit les maigres biens qu’elle possédait encore, contre des roubles dévalués qu’elle dissimula dans la doublure de son manteau et dans l’ours en peluche de ma mère. Elle passa ainsi courageusement la frontière après une fouille corporelle minutieuse. Récupérant son manteau laissé négligemment sur un banc, elle mit précipitamment l’ours dans les bras de ma mère, et toutes trois rejoignirent par train et autocar Constantinople. Rachel ne savait pas que ni elle ni ses enfants ne retourneraient jamais dans leur pays.
Leur arrivée à Constantinople fut épique. Chargées de maigres balluchons destinés à satisfaire les besoins d’un voyage supposé court, elles débarquèrent dans un hôtel de catégorie modeste. Ma grand-mère commença alors la recherche désespérée de son mari, arpentant avec ses filles le Grand Bazar, haut lieu du commerce du tissu. Son premier objectif : trouver des Russes capables de la comprendre et de l’aider. Quelques journées d’errance et de questionnement au hasard des rencontres, l’oreille aux aguets pour identifier ses compatriotes, et le miracle se produisit. « Maxime Maximovitch Vilenkine, mais oui, madame, il est probablement là-bas… » C’est dans un des cafés où se réunissaient de nombreux Russes expatriés en Turquie que ma grand-mère le retrouva. Lila et Ola se rappelaient le moment de leur rencontre comme une sorte de sauvetage d’un naufrage annoncé. Restées immobiles quelques instants qui leur parurent une éternité, incapables d’émettre le moindre son, toutes trois se dirigèrent timidement vers le père. Ému, il ne savait pas qui serrer dans ses bras, de sa femme ou de ses deux filles, dont sa petite dernière qu’il avait du mal à reconnaître après un an et demi de séparation. Ma mère me parlait parfois de cette histoire extraordinaire, non qu’elle en eût gardé une quelconque mémoire, elle était trop jeune pour cela. Elle la tenait de sa mère qui la lui avait racontée tant de fois et avec tellement de réalisme qu’elle me disait croire qu’elle s’en souvenait parfaitement. Lorsque j’étais enfant et qu’elle voulait m’endormir je lui disais : « Maman, tu me racontes comment vous vous êtes tous retrouvés ? » Et elle repartait dans cette histoire comme dans un conte merveilleux, qu’elle agrémentait de détails souvent renouvelés !
La famille Vilenkine résida dix ans en Turquie. Maxime, entrepreneur invétéré, s’était à nouveau lancé avec succès dans la fabrication et le commerce de tissus. Le train de vie de la famille Vilenkine n’était pas celui qu’ils avaient connu en Russie, mais il leur permit de retrouver une existence agréable : appartement bourgeois, école anglaise pour ma mère et sa sœur, « nurse » pour toutes deux, et aides domestiques. À nouveau, une réussite professionnelle qui aurait dû calmer les ardeurs voyageuses de mon grand-père. Il n’en fut rien ! Pourquoi décida-t-il que le Brésil serait leur prochaine et ultime destination ? Prémonition d’un drame qui s’annonçait pour les Juifs en Europe ? Certes pas. Qui, alors, aurait pu le prévoir ? Nous étions au tout début des années trente. Plutôt des plans sur la comète, tirés avec ses compatriotes russes en mal d’Eldorado !
Rachel, inquiète de ce projet incertain dont elle ne voyait que les risques, s’y opposa farouchement. Elle finit par céder devant l’entêtement et la force de conviction de son mari. Elle était d’un tempérament trop faible pour lui résister longtemps. Les rares photos d’elle montrent effectivement une femme au regard tendre, à l’allure distinguée et timide à la fois.
« Elle était si fragile, disait ma mère, et tellement douce qu’elle s’est laissé entraîner, contre tout bon sens ! »
Les voilà donc, tous les quatre, partis sur un paquebot à destination de Marseille, première escale d’un bien long périple. Une rencontre de hasard avec un compatriote russe sur le Vieux-Port de la ville changea le cours des choses : « Que savait-il vraiment du Brésil, Maximovitch ? N’avait-il pas entendu parler de la France ? Ignorait-il que c’était le pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, que c’était là qu’il devait absolument s’installer, qu’il pouvait faire fortune ? Lui, il la connaissait bien, la France ! La communauté russe qui avait fui la révolution bolchevique s’y était établie avec succès ! C’est là, en France, qu’il devait rester, Maxime ! » L’interlocuteur de mon grand-père ignorait-il vraiment que beaucoup de leurs compatriotes émigrés en France, aristocrates, généraux ou bourgeois, n’avaient trouvé leur salut que dans des petits métiers – chauffeurs de taxi, serveurs de restaurant ou chasseurs dans des hôtels – certainement moins rémunérateurs que ceux que leurs précédents statuts et situations leur conféraient ?
Quoi qu’il en soit, mon grand-père fut vite convaincu que Paris devait être leur étape finale. Voilà comment les Vilenkine interrompirent leur voyage au long cours et se retrouvèrent dans un trop petit appartement, au 73 de la rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Ma mère se souvenait avec nostalgie et sympathie de leurs voisins du dessous, les Aznavourian, dont elle ne savait pas que l’un des enfants, Charles, deviendrait un jour un chanteur célèbre ! Elle avait en projet dans les dernières années de sa vie de les rencontrer, lui et sa sœur Aïda, très certainement pour raviver des souvenirs communs. Mais cela ne se fit pas.
Peu après l’arrivée des Vilenkine à Paris, Maxime investit ses économies dans la création d’un restaurant, russe naturellement. Rachel, aux cuisines, fut vite écartée de l’entreprise familiale par son mari qui prétexta, pour justifier sa décision, un travail trop harassant pour sa femme. Ce qui était en partie vrai. En fait, il avait besoin de plus de liberté pour cultiver de coupables relations avec leur petite serveuse. L’ambitieuse employée eut raison de la fidélité de Maximovitch dont les élans amoureux allèrent de pair avec la diminution de ses finances. Usant immodérément de son charme, elle lui soutira plus d’argent que son travail n’en méritait. Confondant la caisse du restaurant avec ses propres deniers, elle finit par acculer l’entreprise de mon grand-père à la ruine et disparut sans laisser d’adresse, quand elle n’eut plus rien à en attendre financièrement.
Foudroyé par une congestion pulmonaire au cours de l’hiver 1935, Maxime mourut à l’âge de quarante-huit ans, bien loin du rêve qui l’avait conduit à Paris. Comme pour « parfaire » cette situation dramatique, ma grand-mère tomba à son tour malade et mourut quelques mois après la disparition de son mari. Elle venait d’avoir quarante-cinq ans. Selon ma mère, elle était trop fragile pour survivre aux épreuves qu’il lui avait imposées.
Nos deux jeunes filles désemparées avaient bien un oncle en Angleterre où il s’était établi dans les années vingt ; leurs parents avaient entretenu avec lui des relations épistolaires espacées. Une lettre de ma mère expliquant leur situation et leur besoin d’une aide financière momentanée resta sans réponse. L’oncle fut vite oublié.
Voilà donc les deux sœurs orphelines et démunies. Lila, encore lycéenne, était âgée de seize ans, Ola, étudiante en piano classique au Conservatoire de Paris, en avait vingt et un. Paris, qui les avait si bien accueillies, leur devenait soudainement hostile, quatre ans après leur arrivée. La misère n’était pas loin. C’était méconnaître la grande détermination de Lila et de sa sœur Ola ! Interrompant leurs études, toutes deux se mirent à travailler pour vivre, en fait pour survivre. Ma mère, armée d’un courage et d’une énergie dont elle ne s’est jamais départie au cours de sa vie, entraîna sa sœur, timide et moins entreprenante, mais tout de même très volontaire, dans une entreprise de tricot dont elles furent les uniques employées. Travaillant toutes deux sans relâche, ne s’accordant que quelques heures de sommeil, elles réussirent à vendre leur production aux meilleures boutiques de Paris. C’était à ma mère qu’était dévolu le rôle de commerçante. Je l’entends encore maugréer contre l’exploitation dont sa sœur et elle avaient été victimes : « Nous vendions nos œuvres trois sous et elles étaient revendues dix fois plus. De plus, nous devions repousser les tentatives de certains de nos clients qui voyaient dans les deux jeunes filles que nous étions des proies faciles. » Et elle ajoutait avec fierté : « Mais nous avons réussi à nous en sortir, honnêtement et dignement ! »
C’est au cours de l’année 1936 qu’Ola s’enamoura d’Alexandre Racine, Russe juif fraîchement émigré en France. Avant de rencontrer Ola, Choura, diminutif usuel d’Alexandre, avait eu un parcours surprenant alors qu’il était adolescent. Pour fuir la Russie qui devenait soviétique, sa famille avait quitté Moscou et traversé d’ouest en est le pays. Elle avait fait une étape en Chine où elle était restée quelques mois. Après un long parcours dont j’ignore les détails, les Racine débarquèrent à Paris au début des années trente, démunis, mais déterminés à y refaire leur vie. Les parents croyaient leur errance terminée.
À l’hiver 1938, le père de Choura, en voyage touristique en Palestine, fit une chute fatale de bicyclette. Choura fut chargé par sa mère de ramener le corps de son père à Paris. Son rapatriement fut une mission impossible. À la même époque, des bruits de bottes inquiétants se faisaient entendre dans toute l’Europe, la guerre civile ensanglantait l’Espagne et des rumeurs d’un antisémitisme féroce en Allemagne leur étaient rapportées. La mère de Choura décida de rejoindre son fils, de se recueillir sur la tombe de son mari et de laisser l’orage passer.
Choura engagea Ola, sa bien-aimée, à le rejoindre pour l’épouser et s’établir dans ce pays dont elle ne savait rien. Selon lui, l’Europe devenait dangereuse. Pour elle, partir, apprendre une nouvelle langue, l’hébreu…, reconstruire sa vie était une épreuve qui l’effrayait. Mais allait-elle pour autant rester seule à Paris, à vingt-six ans, alors qu’elle était amoureuse de cet intrépide garçon ? De surcroît, Lila, sa sœur, plus jeune de cinq ans, fréquentait alors un jeune homme sérieux, mon père, et allait bientôt se marier. Après tout, la Palestine n’était pas au bout du monde ! Ils pourraient toujours en revenir. De plus, Choura y avait trouvé du travail ! Et puis, lui écrivait-il, l’avenir y était prometteur. Elle accepta finalement, sans joie, de quitter la France, son pays d’adoption. Elle avait appris à le connaître et à l’aimer, comme tous les émigrés en mal de liberté qui y avaient trouvé refuge. Elle saurait faire valoir dans quelque temps que l’antisémitisme, en Europe, c’était de l’histoire ancienne, que l’affaire Dreyfus appartenait au passé, qu’un grand homme politique juif avait été à la tête du gouvernement français, un certain Léon Blum, que le Front populaire était une garantie d’avenir pour tous. Elle saurait bien convaincre Choura de revenir à Paris, quand les temps seraient meilleurs.
Dubitative quant à ce qu’elle allait trouver, Ola le rejoignit donc, effondrée de quitter tout à la fois la France, devenue son pays, et Lila, sa sœur adorée. Adieu sa ville et ses amis français, adieu la stabilité – toute relative – durement gagnée, adieu le Conservatoire et la musique ! Cette expérience n’était pas sans lui rappeler celle de sa mère quittant la Russie, sauf qu’elle-même, cette fois-ci, laissait sa sœur. Quant à la Terre promise, serait-elle à la hauteur de l’espérance de Choura, ou, plus vraisemblablement, un mirage pour immigrés en perdition ?
En quittant la France, ni Ola ni Choura ne savaient alors que leur décision leur sauverait la vie. Au regard de ce qui s’y produisit après, on pourrait presque considérer comme une chance le décès accidentel du père de Choura puisqu’il les amena tous deux en Palestine. Juifs russes, étrangers, les premiers visés par les lois scélérates de Vichy, ils auraient été déportés comme des dizaines de milliers d’autres et auraient probablement fait partie des disparus à tout jamais.
"Et maintenant, Lila, je vais te dire une chose qui me brise le coeur mais que je crois indispensable à ton bonheur et à celui de Freddy..." Freddy c'est Frédéric, l'auteur de ce livre. Lila est sa mère, et ces lignes ont été écrites par Gilbert Scemla, juif français de Tunisie, le père de Freddy, le mari de Lila, ancien élève de l'Ecole polytechnique, peu de temps avant qu'il ne soit exécuté par les nazis. Si Frédéric Scemla, plus tard Gasquet, a été malgré tout heureux, pour suivre l'injonction paternelle, il le doit à sa mère et à son père adoptif qui a été son père "sur terre tandis que l'autre père était au ciel". C'est à soixante ans, pour ses enfants, pour lui-même et pour l'histoire, que Frédéric a conçu le projet de reconstituer la vie, les derniers mois surtout, de son père Gilbert, de son grand-père Joseph et de son oncle Jean, tous trois assassinés par les Allemands en 1944 à Halle (Saxe-Anhalt). Une quête opiniâtre de la vérité qui l'a mené jusqu'à la découverte de l'horreur particulière de leur mort. Dès lors, il y a lieu de croire que le "devoir" d'être heureux s'effaçait devant celui, plus essentiel, de vivre, c'est à dire d'écrire, de témoigner. Ce devoir-là a été rempli. Il l'a été par la lucidité et la rigueur quasi scientifique du récit, par la ferveur de l'hommage aux trois martyrs, mais il l'a été par-dessus tout par l'amour, à la fois si difficile à inventer et si éblouissant dans son accomplissement, pour le père que Frédéric n'aura jamais connu.
Frédéric Gasquet est né en 1941 en Tunisie. Après des études scientifiques, il fait une carrière en France et à l'étranger, comme cadre et dirigeant de sociétés de haute technologie. Il est père de trois enfants.
Préface de Serge Klarsfeld