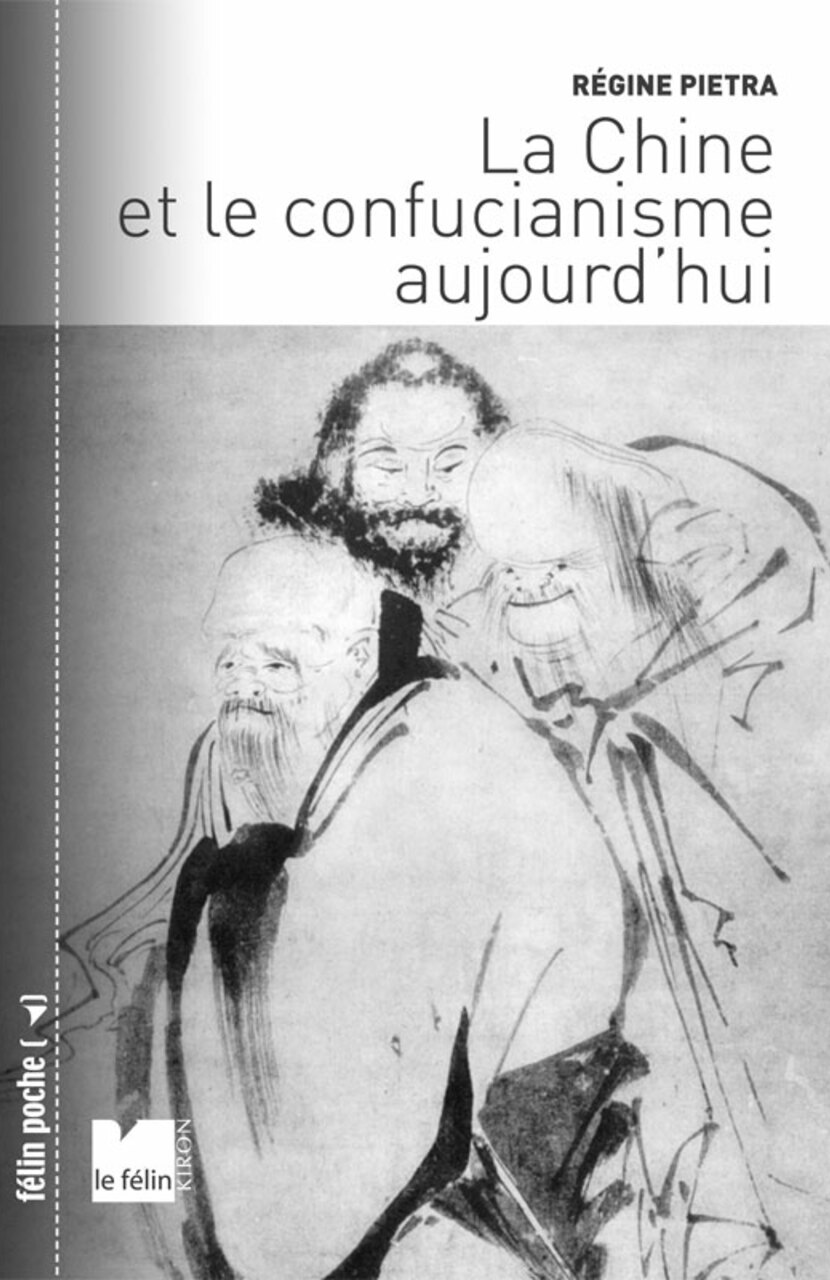
La Chine et le confucianisme aujourd'hui
La pensée chinoise a trois fondements : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Selon les époques, l’un de ces courants a prédominé, laissant les deux autres jouer en sourdine. Durant les cinq siècles antérieurs au christianisme, confucianisme et taoïsme, bien qu’opposés dans leurs exigences et leur finalité, ont servi de visions du monde aux Chinois qui, suivant les aléas d’une carrière ou les humeurs du moment, pouvaient se référer à l’un ou à l’autre. Le fonctionnaire lettré se devait d’être confucéen, animé par le sens du devoir, l’observation des rites, le respect de la hiérarchie, l’attention à autrui. S’il se trouvait mis à l’écart de toute responsabilité ou si délibérément il choisissait un cheminement plus individualiste, il adoptait alors, en taoïste, un comportement plus iconoclaste, à l’écart des normes sociales. Ces philosophies opposées n’étaient pas vécues comme contradictoires (la contradiction n’est-elle pas redevable de la seule logique aristotélicienne ?), mais comme des points de vue reposant sur le fond commun de toute la pensée chinoise, selon lequel il y a un ordre du monde, constitué de l’affrontement et de la complémentarité de deux principes, le yin et le yang, pris dans le mouvement qui anime toute chose, le Dao. Nulle métaphysique ici, mais une cosmologie, dont la notion centrale est celle de Nature, natura naturans qui sert de modèle à la conduite humaine.
Au début de l’ère chrétienne fait irruption, venant de l’Inde, une doctrine nouvelle qui devait ébranler fortement ces philosophies chinoises : le bouddhisme. Il proposait une sotériologie qui dénonçait les illusions terrestres et donnait les moyens d’y échapper. Totalement contraire au pragmatisme chinois, à sa façon de penser le réel et la place de l’homme dans la société, le bouddhisme ne s’en imposa pas moins, souvent en phagocytant le taoïsme.
La réaction à cette hégémonie, si elle s’est fait attendre, n’en sera pas moins importante. Du xe au xiie siècle environ, on assiste à une levée de boucliers contre le bouddhisme, de la part de penseurs qui tenaient à redonner ses lettres de noblesse à une pensée qui ne serait plus exogène, mais intrinsèquement chinoise : renouveau du confucianisme.
Dans les siècles suivants, la Chine, envahie successivement par les Mongols, puis par les Mandchous (dynastie Qing), ne semble pas avoir accordé une place de choix à la philosophie! On retiendra cependant le nom de deux figures de premier plan, au xvie siècle, Wang Yangmin, au xviie, Wang Fuzhi. Tous les deux prolongeaient avec des modalités très différentes le renouveau confucéen.
Bientôt, avec les Jésuites, la pensée occidentale pénètre en Chine, la marquant d’une influence durable.
Qu’en sera-t-il au xxe siècle ? Ni le taoïsme et son « laisser-faire » (wou wei), ennemi de tous les artifices de la civilisation, contempteur du progrès, ni le bouddhisme, prêchant l’évasion hors de ce monde, ne paraissent aptes à assurer la stabilité d’un système politique et les règles de la vie sociale. On ne s’étonnera pas dès lors de voir surgir, au xxe siècle, un renouveau du confucianisme, un néoconfucianisme, illustré par une dizaine de grands penseurs, parfaits connaisseurs de la philosophie occidentale, et dont les œuvres sont imposantes.
D’aucuns ont pu s’interroger sur les soubassements idéologiques d’un tel renouveau, dont les promoteurs s’étaient donné pour tâche de desserrer l’étau de la seule philosophie alors admise, celle du marxisme maoïste.
Aujourd’hui, quelque cinquante ans plus tard, dans une Chine préoccupée essentiellement de son développement économique, cette réhabilitation du confucianisme peut être interprétée tantôt comme une utopie, tantôt comme le témoignage d’un nationalisme rétrograde. Que ce retour aux sources ne soit en rien une stagnation stérile, mais qu’il manifeste la vivacité d’une philosophie riche de possibles, il s’agira de le démontrer. De l’éthique confucéenne, indépendante de toute religion, tout entière centrée sur « l’honnête homme » (junzi), exigeant envers soi-même, respectueux vis-à-vis d’autrui, l’Occident laïque a peut-être une leçon à recevoir ; leçon d’autant plus précieuse que l’éthique est inséparable de toute une esthétique du comportement où la dignité est faite d’élégance. À l’écart de toutes les dichotomies qui fondent notre métaphysique, la Chine place au noyau de sa réflexion le xin, ce concept qui dénote à la fois le cœur, l’esprit, l’intellect, racine de toute attitude morale et de tout élan créateur.
Introduction
L’importance que la Chine a prise aujourd’hui en bien des domaines, au point que l’on parle beaucoup de cet immense territoire, conduit à se demander quelle place la philosophie y tient1. Modeste sans doute, comme partout ailleurs, mais encore2 ?
Certes, il est assez difficile de s’en faire une idée précise, étant donné le grand désordre qui règne sur bien des plans : sur le plan économico-politique d’abord, où la Chine est livrée au capitalisme le plus sauvage, dans un régime qui est cependant encore communiste. C’est dire, d’une part, que la corruption3 est partout, dans l’appareil d’État où les fonctionnaires pratiquent à grande échelle les pires malversations, où le népotisme est roi, où la compétition exige un travail inhumain des ouvriers, sans souci de justice, de respect de l’individu (notion peu connue en Chine), de liberté (pas de mot pour la désigner) ; d’autre part, que ce même appareil d’État exerce une domination exclusive et, à la façon du totalitarisme, contrôle tout ce qu’il peut contrôler : d’où la difficulté d’une saine information (Internet même est soumis à censure)1.
On comprendra dès lors que la liberté intellectuelle y est suspecte et qu’elle est souvent sanctionnée. Petit à petit, l’étau se desserre, semble-t-il, mais naguère encore le pouvoir interdisait revues et journaux, évinçait chercheurs et enseignants quelque peu critiques, les contraignant à l’exil ou au silence. Un sinologue contemporain, Jean-François Billeter, a commis récemment un petit livre plein de dépit, Chine trois fois muette2, pour déplorer que la Chine, pourtant le pays des archives et de l’Histoire, soit devenue aujourd’hui sans mémoire, non seulement du lointain passé, mais aussi du passé récent, car si le marxisme, sur le plan philosophique, fut le passage obligé, il n’est plus guère enseigné aujourd’hui ; muette encore en ce qu’il n’y a pas de débats actuels. Ce que Balazs écrivait dans les années soixante, dans un parallèle entre la Chine populaire et le régime impérial, n’est-il pas encore valable ?
Primauté de l’État et de la classe des fonctionnaires privilégiés – dans cette perspective, la bureaucratie du Parti serait le pendant du mandarinat ; importance des travaux publics exécutés par des millions de coolies ; surveillance constante de la police ; intolérance d’un absolutisme éclairé, avec son côté paternaliste, son sentiment de supériorité, sa suffisance et sa morgue ; et, pour finir, l’impuissance de l’individu, incapable d’échapper à la pression sociale de la collectivité, à son conformisme1.
La Chine est loin d’être un pays démocratique. Des penseurs chinois du xxe siècle voient dans son régime actuel, comme dans son retard (de plus en plus relatif) sur le plan scientifique, de graves déficiences qu’il faudrait combler. Contrairement à ce que pensait Francis Fukuyama2 et que continuent à penser certains philosophes chinois contemporains, néoconfucéens, tel Li Zehou [Li Tse-heou3], il semble que le libéralisme économique ne soit nullement accompagné d’une politique démocratique. Et d’aucuns dénoncent la croyance illusoire selon laquelle l’accession de la Chine à un certain niveau de développement entraînera un passage automatique à la démocratie1. Il semble même, au contraire, que la société de consommation et ses possibilités de jouissance agissent sur la jeunesse, en particulier sur la jeunesse des villes, à l’instar d’un baume qui vient calmer toute velléité de transformation sociale. Quant aux entrepreneurs, plus ou moins choyés par le pouvoir politique, ils n’ont aucune envie de s’y opposer et de donner la parole aux dizaines de millions d’ouvriers réduits au chômage, à la servitude, à l’expropriation. On pourrait donc parler de fascisme, de posttotalitarisme, comme on dit postmoderne.
Tout cela n’est peut-être que temporaire, il faut le souhaiter. Mais il faut aussi rappeler que la Chine est un immense pays, que le poids du passé, des institutions, est lourd, et qu’elle ne change en profondeur que très lentement.
Rappelons certaines données :
– superficie : 9 600 000 km2 (France : 550 000 km2) ; une grande disparité entre les régions ; entre le Nord et le Sud, entre l’Ouest (le Xinjiang, par exemple, où les habitants sont de religion musulmane) et l’Est, où se concentre l’activité économique ;
– population : 1 300 000 000 (dont 64 % de ruraux) : une majorité de Han, 55 nationalités minoritaires. Il y a un contraste saisissant entre l’indigence des paysans et l’opulence de certains habitants des grandes villes (Chongqin, 31 millions d’habitants, Shanghaï, 15 millions, Pékin, 14 millions), nouveaux riches, dont les demeures sont d’un luxe insolent.
Rappelons aussi quelques grandes dates du xxe siècle, sans lesquelles on ne comprendrait pas ce qui se passe en philosophie :
1898 : Kang Youwei [Kang Yeou-wei] tente une réforme politique, avec un essai d’établissement d’une monarchie constitutionnelle : échec.
1911 : date capitale, c’est l’effondrement du régime impérial installé depuis la nuit des temps, et l’instauration d’une république ; disparition du confucianisme et suppression des examens basés sur les classiques confucéens qui, depuis des siècles et des siècles, servaient à recruter les fonctionnaires du régime.
4 mai 1919 : violente révolte des intellectuels qui accusent Confucius d’être le responsable de tous les maux dont souffre la Chine. Un slogan : « À bas la boutique Confucius » ; le confucianisme est relégué au musée de l’histoire. On se met en quête d’un modernisme à l’occidentale.
En 1920, thèse de Max Weber : l’éthique protestante est à l’origine du capitalisme en Europe. S’il n’y a pas de capitalisme en Chine, c’est à cause du confucianisme qui empêche d’accéder à la conception occidentale du monde. Aujourd’hui certains penseurs prennent le contre-pied de cette thèse, arguant que les valeurs confucéennes, valorisation de la famille, respect de la hiérarchie, goût du travail acharné, sens de l’épargne, encouragent le développement.
1949 : établissement par les communistes de la République populaire. Fuite du gouvernement nationaliste (Guomindang) à Taïwan.
1958 : date philosophiquement importante, puisque paraît à la une du journal La Tribune démocratique un manifeste signé de quatre philosophes, Zhang Junmai1, Mou Zongsan, Tang Junyi2, Xu Fuguan, manifeste adressé au monde, dans lequel ces penseurs supplient leurs semblables de croire que la culture confucéenne n’est pas morte. Alors prend naissance ce mouvement philosophique du xxe siècle : le néoconfucianisme. Le manifeste n’eut pas immédiatement une grande diffusion ; il ne sera discuté qu’autour de 1980. Ce mouvement prôné par des penseurs qui étaient en exil (Taïwan, Hong-kong, Singapour) commence aujourd’hui à être reconnu en Chine continentale et il a d’ardents défenseurs outre-Atlantique.
1966-1976 : révolution culturelle.
1976 : mort de Mao.
1978 : premier colloque en Chine visant à réhabiliter le confucianisme.
1989 : alors que les étudiants manifestent en faveur d’un régime plus démocratique, violentes répressions : massacre de la place Tianan men.
Ces quelques dates semblent nécessaires pour baliser historiquement le siècle. Philosophiquement, maintenant, qu’en est-il ? Dans un article récent (2005) de la Revue internationale de philosophie, le professeur Chen Lai de l’université de Pékin déplore, à l’instar de ce que font souvent chez eux les philosophes occidentaux, que la philosophie soit remplacée par les sciences humaines et les études d’histoire sociale, qui sont d’un tout autre ordre.
Autant qu’on puisse le savoir, il semble que l’on peut distinguer aujourd’hui dans l’enseignement :
1) La philosophie occidentale, qui exerce une grande séduction ; cela n’est pas nouveau, mais date seulement d’un siècle. Car si, jusqu’à la fin du xixe, la Chine était fermée sur elle-même, dès le début du xxe siècle la plupart des grands philosophes chinois sont allés étudier à l’étranger, surtout en Amérique et en Allemagne ; ils en apprennent les langues et obtiennent des diplômes avant de revenir en Chine. La connaissance qu’ils ont de la philosophie occidentale est surprenante. Aujourd’hui, les philosophes occidentaux sont invités en Chine, mais, dès 1920, John Dewey1, Bertrand Russell et Alfred North Whitehead y sont allés faire des conférences qui ont marqué durablement leurs auditoires.
2) L’influence du marxisme, qui a si longtemps régné sur la pensée, n’a pas complètement disparu et certains philosophes, sans être dogmatiques, y restent attachés.
3) Par ailleurs, les grands courants de la pensée chinoise, bouddhisme et taoïsme, font aussi partie de l’enseignement et certains penseurs néoconfucéens, tel Xiong Shili [Hioung Che-li], tentent de synthétiser confucianisme et bouddhisme. Quant au taoïsme, qui sert de substrat à la mentalité chinoise, il pourrait demeurer le parent pauvre des enseignements : il est vrai que la société de profit et de consommation qui est celle d’une partie de la Chine actuelle (une partie, car, ne l’oublions pas, la Chine est essentiellement rurale) s’accorde peu avec ceux qui prônent le non-agir, qui critiquent la technique et tous les artifices de la civilisation.
4) Enfin – et c’est essentiellement ce courant qui nous intéresse –, le néoconfucianisme du xxe siècle, représenté par quelque dix à douze grands philosophes, s’il fut longtemps enseigné ailleurs qu’en Chine continentale, y fait aujourd’hui l’objet d’une certaine attention.
Notre trajectoire sera balisée par l’exposition des trois visions du monde que sont le confucianisme, le taoïsme, et le bouddhisme. Chaque Chinois se réfère à ces trois courants, à la fois ou successivement suivant les nécessités de ses fonctions et les âges de sa vie. Pas d’exclusivisme sur ce point. Fang Dongmei [Fang Toung-mei], l’un des néoconfucéens (1899-1977), disait – et sa confession peut être celle de bien des philosophes : « je suis un confucéen par tradition familiale ; un taoïste par tempérament ; un bouddhiste par inspiration religieuse ; cependant un Occidental par formation1. »
Nous pourrons alors tracer les grands traits de la philosophie chinoise, et mettre en évidence ses différences par rapport à la philosophie occidentale. Les successeurs immédiats de Confucius, Mencius, Xunzi [Siun-tseu], vont s’affronter au sujet d’un problème capital pour la réflexion, celui de la nature humaine : l’homme est-il bon, est-il méchant ? Les premiers siècles de l’ère chrétienne verront l’expansion du bouddhisme jusqu’au moment où les philosophes chinois vont combattre radicalement cette pensée venue de l’Inde et rétablir la spécificité de la philosophie chinoise : néoconfucianisme de la période xe-xiie siècle, dont l’influence persistera dans les siècles suivants.
Le xxe siècle fera renaître, mais de façon tout autre, le néoconfucianisme. On verra, dès lors, se succéder trois générations de penseurs, défenseurs de ce mouvement ; on étudiera la pensée des plus représentatifs d’entre eux. La conclusion s’interrogera sur la signification, la valeur et la portée de cette reviviscence du confucianisme.
La pensée chinoise a trois fondements : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Selon les époques, l’un de ces courants a prédominé, laissant les deux autres jouer en sourdine. Et aujourd’hui ? Ni le taoïsme et son « laisser faire » (Wou wei), ennemi de tous les artifices de la civilisation, sceptique face au progrès, ni le bouddhisme, prêchant l’évasion hors de ce monde, ne paraissent aptes à assurer la stabilité d’un système politique et les règles de la vie sociale. On n’est pas surpris d’observer un regain du confucianisme, illustré par une dizaine de grands penseurs, parfaits connaisseurs de la philosophie occidentale. Bien sûr, on s’interroge sur les soubassements idéologiques d’un tel renouveau. Cinquante années après le marxisme maoïste, dans une Chine préoccupée essentiellement par son développement économique, cette réhabilitation du confucianisme peut être interprétée, tantôt comme une utopie, tantôt comme le témoignage d’un nationalisme rétrograde. Que ce retour aux sources ne soit en rien une stagnation stérile, mais qu’il manifeste la vivacité d’une philosophie riche de possibles, voilà l’enjeu de ce livre.
Régine Pietra est professeur de philosophie à l’université de Grenoble. Elle est l’auteur d’un essai sur Paul Valéry (Valéry, directions spatiales et parcours verbal, Minard, 1981) et de Sage comme une image, figures de la philosophie dans les arts (Le Félin, 1992).