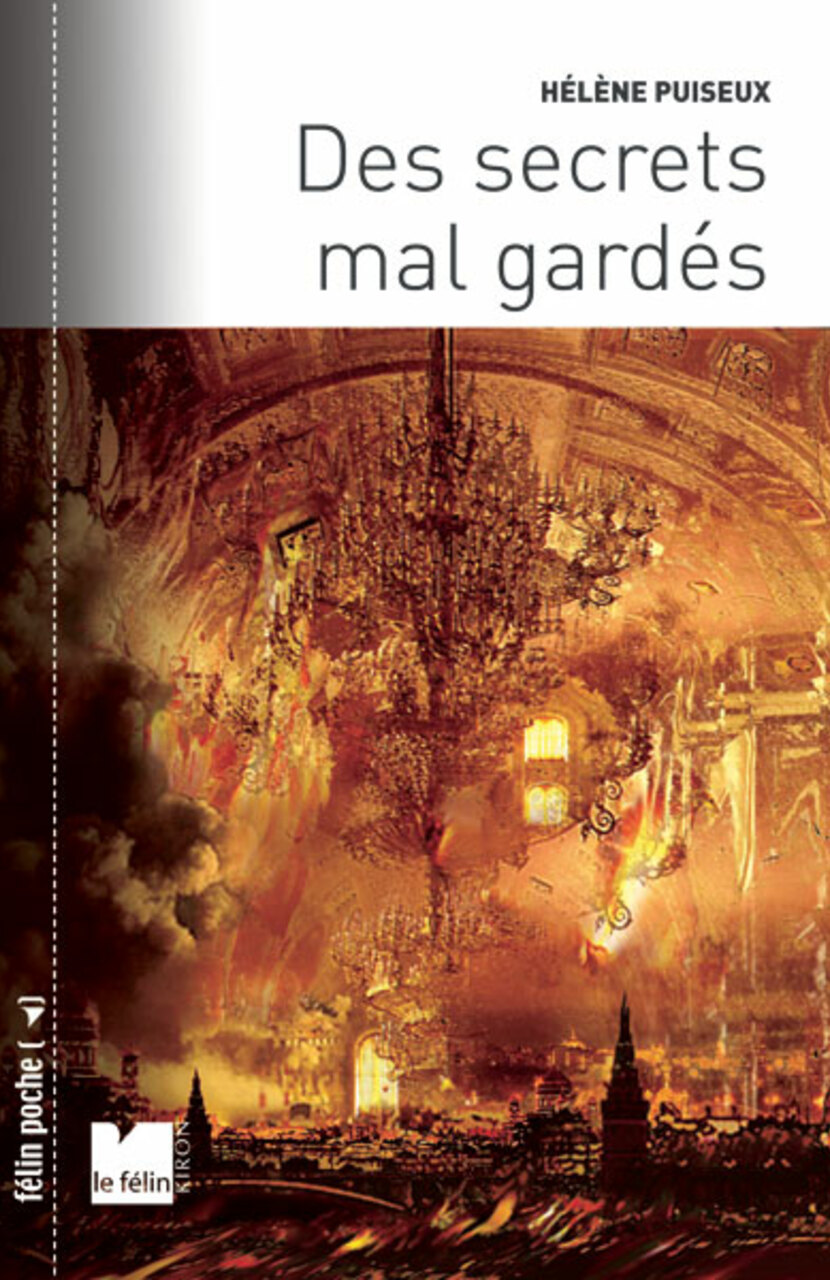
Des secrets mal gardés
ou «Une vieille maîtresse»
de Jules Barbey d’Aurevilly
«Dès qu’il existe un secret entre deux cœurs qui s’aiment, le charme est rompu, le bonheur est détruit.»
Benjamin Constant,
Adolphe, chapitre v.
Femmes et boîtes
Peut-être faut-il en deux mots rappeler qui est Ryno de Marigny, le jeune héros d’Une vieille maîtresse, et quelles sont les grandes lignes du roman de Barbey d’Aurevilly, paru en 1851.
Ryno a trente ans, il a passé dix ans de sa vie à séduire les femmes du faubourg Saint-Germain, séduisant et compromettant les jeunes mariées ou les femmes qui étaient vertueuses avant de le connaître. Cette vie de célibataire élégant rappelle en bien des points les «lions» de Balzac: sur le plan sentimental, Ryno est le frère de Lucien de Rubempré, d’Eugène de Rastignac, d’Henri de Marsay. Il mène de front une liaison orageuse avec Vellini, femme plus âgée que lui, issue de la noblesse portugaise, mais bâtarde: en raison de cette origine illégitime et compte tenu de sa vie amoureuse à scandales, elle n’est pas admise dans la bonne société parisienne.
Ryno vit donc sa sexualité sur deux plans, l’un tapageur et ruineux pour la réputation des femmes, l’autre marginal et ruineux pour sa propre réputation. Au moment où Barbey commence son récit, Ryno projette d’abandonner ces deux genres de vie et de se marier, car il vient de tomber amoureux, vraiment amoureux, en «cinq minutes» (VM,226), d’une jeune et belle orpheline, petite-fille de la marquise de Flers, qui l’a élevée, et désire faire son bonheur. Pour elle, il se décide à quitter Vellini. Le roman conte l’histoire de la décomposition de leur bonheur conjugal et de la reprise en main de Ryno par Vellini. Il se présente, d’une certaine façon, comme une sorte de Carte du Tendre à l’envers, où Ryno retrouve, pour y circuler, les vieux chemins de l’habitude tandis qu’Hermangarde apprend, par à-coups, la trahison.
Ryno de Marigny passe tour à tour et selon l’interlocuteur de la confidence à la demi-confidence, de la demi-confidence au mutisme. Barbey ne nous le fait connaître que dans son rapport aux femmes et à travers les techniques qu’il utilise pour les envelopper dans un système basé sur la séduction.
Ryno a affaire, simultanément, à trois femmes: sa fiancée puis femme, Hermangarde de Polastron; la grand-mère d’Hermangarde, la marquise de Flers; sa «vieille maîtresse», Vellini.
Chacune de ces femmes l’adore, ce à cause de quoi il construit avec chacune d’elles, à la fois pour leur plaire, pour les garder et pour se préserver, des espaces de secret. Ce qu’il révèle à l’une, il le cache à l’autre et réciproquement. Si bien qu’il entretient avec chacune d’elles un rapport proche de celui que l’on entretient avec une consigne dans un lieu public: ces femmes sont des cases non communicantes, dont il a la clé et qu’il n’ouvre pas en même temps. Tout fonctionnerait très bien si Ryno comprenait que «ses» femmes ne sont pas des boîtes, qu’elles ont aussi la clé qui leur permet de sortir de l’espace de secret qu’il crée autour d’elle et qu’il ne croit partager qu’avec celle qu’il a enfermée dedans, lui-même régnant et circulant dans l’espace général.
Cette double métaphore de boîtes étanches et de Carte du Tendre, termes pris dans la catégorie de l’espace, impose de faire, en même temps que l’analyse des techniques de Ryno à l’égard de chacune des femmes, le relevé topographique des trois espaces de secrets édifiés par Barbey pour le compte de Ryno dans son monde de fiction, espaces que Barbey offre donc, clé en main, au lecteur.
Ces espaces sont complexes. On a affaire à trois corps de femme, avec leurs yeux, leurs oreilles, leur sexe – on a reproché à Barbey la crudité de son roman–, mais aussi à un espace mental affecté à chacune d’elles, délimité et semé de barrières par le travail de Barbey agissant en tant qu’écrivain et créateur et par le système complexe de confidence ou de silence qu’il fait adopter par Ryno; enfin, on doit compter avec les lieux géographiques où se déploient ces corps et ces pensées de femmes et le corps de Ryno: ils sont l’objet de descriptions amples, souvent très picturales, utilisées de façon très métonymique.
Barbey situe les actions successives dans deux endroits.
Paris est marqué par la clôture: les salons et des boudoirs, dont les principales propriétaires sont Mme de Flers et Vellini; et l’église Saint-Thomas-d’Aquin, un espace à la fois public et clos, où est célébré le mariage de Ryno et d’Hermangarde devant le Tout-Paris.
Puis l’action se déplace à Carteret, situé au bord de la mer, espace lui-même divisé en trois points: le manoir de Mme de Flers, la chaumière louée par Vellini, et enfin cet espace indécis, mi-côte, mi-campagne, fait de landes, de plages, de rochers où les éléments du trio adultère, Ryno, Hermangarde, Vellini, circulent et se rencontrent sous les yeux de la population locale, paysans et pêcheurs.
Le roman, construit en deux parties, utilise deux procédés narratifs alternés: deux flash-back sont racontés par Ryno à la première personne et décrivent l’espace de sa vie qu’il offre à la marquise de Flers; autour de ces deux flash-back, l’ensemble du récit est fait à la troisième personne, au fil du temps, au passé simple et à l’imparfait pour dérouler devant le lecteur la fresque des événements.
Deux personnages secondaires, amis de la marquise, la comtesse d’Artelles et le vicomte de Prosny, introduisent deux autres récits à la première personne, grâce aux lettres qu’ils échangent et qui servent de commentaires mondains et extérieurs, une sorte de «voix des salons» sur les personnages de Ryno et de Vellini.
Enfin l’ensemble du roman met en scène et exploite des situations d’opposition géographique, la ville et la campagne, le manoir et la chaumière; opposition sociale, l’aristocratie opposée à Vellini qui a choisi de s’en exclure, les nobles opposés aux paysans-pêcheurs de Carteret. Enfin, une opposition archétypique est créée: femme-ange contre femme-démon, femme pure contre femme impure.
Ces oppositions passent, se relient et se court-circuitent par le personnage de Ryno, dont la préoccupation et l’occupation sont de construire des barrières contrôlables entre ces mondes et se soldent par autant d’échecs, dont certains mortifères.
Les techniques de Ryno: confidences pour une marquise
Le faubourg Saint-Germain d’Une vieille maîtresse, comme celui de La Comédie humaine, a son code de la route. Lorsqu’une femme est mariée, elle devient maîtresse de sa réputation: libre à elle de la laisser se faner ou se détruire par des liaisons sottement affichées. Le seul travail qui lui incombe, dans ses histoires d’amour extraconjugales, est de ne pas «s’afficher»; elle n’a pas à être secrète, mais discrète. On regarde, on surveille, on commente, derrière les éventails dans les salons et dans les loges au spectacle. Tout est scène. Les douairières ne se mêlent pas d’imposer une autre conduite de vie que celle basée sur la discrétion. Éventuellement, on ne veut pas savoir, on fait celui qui ne sait pas, on évite de regarder les drames intimes si ceux-ci viennent à être visibles. Ce mode de faire propre à l’aristocratie parisienne du xixe siècle laisse Ryno martyriser sans problèmes ses conquêtes féminines: aucune douairière ne songe réellement à lui reprocher d’abandonner et par cela même de faire mourir de chagrin et de phtisie la comtesse Martyre de Mendoze, la bien nommée. En revanche, le monde est mécontent de son attitude avec Vellini, car celle-ci est à la charnière de la noblesse et du demi-monde. D’origine bourgeoise ou populaire, Vellini serait ignorée purement et simplement, comme appartenant au monde des femmes entretenues, de mœurs libres, sur lesquelles les douairières dressent des paravents: Ryno aurait une liaison, une vieille liaison et chacun fermerait les yeux.
Mais Vellini est une créature hybride: elle est liée à l’aristocratie parce qu’elle est la fille adultérine d’une duchesse portugaise et d’un toréador, et elle a été un temps mariée à un baronnet anglais, Sir Reginald Annesley. En tant que telle, elle aurait dû être tenue au devoir de réserve. Or cette carte de visite, barrée par sa naissance bâtarde mais rafistolée par son mariage, elle l’a à nouveau déchirée, montrant ainsi le mépris qu’elle a du faubourg Saint-Germain, en abandonnant le baronnet pour vivre avec Ryno, de manière spectaculaire et tapageuse. De plus elle est vieille –trente-six ans – et laide, «jaune comme une cigarette, l’air malsain» (VM, 267, je précise que la description est de Ryno lui-même). Aussi, lorsque Ryno se décide à demander la main d’Hermangarde, y a-t-il émotion dans l’entourage de la marquise de Flers. Ryno ne convient pas; une liaison aussi longue – dix ans – laisse planer un mystère. Lequel? C’est ce que la marquise de Flers veut découvrir en provoquant une explication avec Ryno. La marquise est une de ces vieilles femmes sorties tout droit du xviiie siècle et qui n’ont cessé de hanter les romans du xixe, avec leur hardiesse de langage et souvent les souvenirs amusés de leurs amours, leur gaieté, leur bonté.
Le couple secret et sexualité
Les confidences de Ryno ont lieu dans une charmante petite pièce, le boudoir de la marquise, «dessiné en forme de tente […] gris de lin et rose pâle, aussi chaud, aussi odorant, aussi ouaté que l’intérieur d’un manchon» (VM, 206). Une petite table en laque de Chine, la lumière verte d’un abat-jour.
On trouve là une des premières conditions du secret, n’appartenir qu’à des initiés: les deux adultes, Mme de Flers et Ryno, qui savent ce que sont «les choses de l’amour», comme dirait Chérubin, écartent Hermangarde. «Il faut te retirer, ma chère enfant.» C’est d’elle qu’il s’agit pourtant, de l’homme qui va être son mari, de celui qui lui offre, pour parler clair, de partager un corps tout pétri d’habitudes par Vellini. Mais, dans la morale du siècle, elle ne doit pas savoir les usages que les hommes et les femmes font de leurs corps. «Vous me cachez donc tous deux quelque chose ?» (VM, 257) dit Hermangarde en les quittant.
Oui, le quelque chose, c’est la sexualité. Dans Barbey, le secret est directement en prise avec le sexe, d’une manière précise, concrète et non pas diffuse ou sublimée comme on verra dans Verdi. Ryno commence l’histoire, avec grand luxe de détails, de la rencontre avec Vellini, le divorce d’avec Sir Reginald, la nature sensuelle et violente de leur relation, les amants se prenant, se quittant, se battant, parfois à coups de cravache (VM, 289).
Ryno assure la marquise, à la fin du récit, qu’il lui a épargné bien des détails qu’il appelle «les dessous de cartes d’une intimité», et pourtant, il ne se prive pas, il dit à la vieille dame que leur amour était «physique et sauvage», que «la possession le vivifiait, l’accroissait»; que Vellini savait «éterniser les voluptés délirantes», que sa bouche «criait de plaisir» (VM, 301-303); qu’à la mort de leur bébé, elle se jetait dans les bras de Ryno «avec une avidité vorace et sombre» (VM, 313); qu’après avoir décidé une première fois de se séparer, «le vertige nous roula au bras l’un de l’autre», «nous nous engloutîmes dans cette dernière et flamboyante heure de plaisir» (VM, 320). «C’était le coup de l’étrier» (VM, 321), commente la marquise. Il y eut beaucoup d’autres fausses ruptures, faux départs, où toujours la scène recommençait, «le charme opérait. Je la pris et je me sauvai dans le salon, l’emportant liée et tordue autour de moi comme une couleuvre».
Ces premières confidences sur la sexualité créent trois effets pervers.
On assiste d’abord au développement, chez la marquise, d’une sorte de vieil amour, de vieille tentation presque physique, elle est séduite par le futur mari de sa petite-fille. Au début de la soirée, une fois Hermangarde retirée chez elle, et l’espace physique du secret créé, «La pendule marquait près d’une heure. La marquise mit le coude sur le bras de son fauteuil» (VM, 263). Au cours des soixante-dix pages que dure le récit dans l’édition de la Pléiade, ses réflexions lestes, ses «yeux de lynx» montrent la grande part qu’elle y prend. Barbey la peint comme prête à participer à ces évocations, et, sinon dans l’attente que quelque chose lui arrive à elle, au moins perdue de plaisir dans le voyeurisme de l’imagination. Lorsque «le jour [commence] à introduire ses blancheurs dans l’appartement et à lutter autour de la lampe qui éclairait le boudoir» (VM, 321), la marquise, après l’ultime récit de l’ultime séparation d’avec Vellini, excitée et soûlée par les confidences de Marigny, le rassure, oui, elle lui donnera Hermangarde en mariage; la nuit qu’il vient de passer avec la marquise est comme une nuit d’amour et l’art de Barbey est de faire sentir combien cette nuit a été longue, fatigante et jouissive, lorsque le petit jour se lève. Sur la pointe des pieds, Ryno quitte le boudoir, «enchanté de ces assurances, laissant la marquise dormir un peu dans son grand fauteuil» (VM, 336). Et quelques pages plus loin, Barbey assure: «Oui, la marquise aimait Marigny», en insistant sur la différence entre l’amour pour Hermangarde et l’amour pour le jeune homme, y glissant, bien sûr la nuance filiale, mais les habitués du boudoir, la comtesse d’Artelles ou le vicomte de Prosny, ne s’y trompent pas, ils voient leur vieille amie, du haut de ses soixante-quinze ans, amoureuse: «Vicomte, dit la comtesse d’Artelles, comprenez-vous une pareille chose? Elle aime mieux ce Marigny que sa petite-fille, je n’en doute pas.» «Avouez que vous l’aimez autant que moi, dit Hermangarde» (VM, 337). D’ailleurs, c’est quand Hermangarde se retrouve sans sa grand-mère, à Carteret, que Marigny retombe dans les bras de Vellini.
Or ces confidences ne sont pas seulement un espace de secret créé, ce sont aussi des secrets révélés.
D’où la création du deuxième effet pervers: l’enrichissement du personnage de Ryno. D’homme sensuel, guidé par son seul désir, il devient un traître, à travers ce récit et par ce récit même, en disant tant d’anciens secrets qui appartenaient à d’autres; en effet, il ne se borne pas à avoir, avec ces dix années racontées à la marquise, trahi des corps avec sa bouche, – Sir Reginald Annesley, ses amis Cérisy et de Mareuil, Mme de Mendoze, etc. – des amitiés avec des amours, des contrats avec des désirs. Il ne s’est pas borné à osciller en laissant dériver, insensiblement ou par à-coups, des situations à demi bloquées, en laissant végéter des personnes qui l’aimaient dans des enclos de secrets dressés par lui: de cette technique, les exemples fourmillent dans le récit fait à la marquise. Mais une chose était de vivre ces tourniquets triangulaires et ces trahisons, c’en est une autre de les raconter. Voilà qu’il les bichonne avec sa mémoire, ses effets oratoires, ses effets de style; il offre à une étrangère, dans l’ordre choisi par lui, et caractérisés comme il les sent à présent, les personnages qu’il a déjà trahis et qu’il trahit pour la seconde fois, dans une forme de confession, inspirée par son désir de plaire à la marquise pour avoir Hermangarde (au sens vulgaire du verbe), et pour quêter une forme d’absolution. Des personnes que sa passion sensuelle pour Vellini a piétinées et que sa passion récente pour la pureté d’Hermangarde continue de détruire, il donne un portrait dégradé, en nuances souvent méprisantes ou noircies, Cérisy, «un pauvre garçon», Annesley, «un mélange de Normand et de Saxon» qui a aimé Vellini «par orgueil, par ennui», Mme de Mendoze, «patricienne blanche, blonde et languissante» et surtout Vellini, traînée dans mille confidences à la fois fascinées, intimes et grossières.
Enfin, troisième effet pervers de cette nuit de confidences et de secrets, où se mêlent trahison et sexualité: Ryno adopte la marquise de Flers pour confesseur. Aussi, lorsqu’il retrouve Vellini, lorsqu’il perçoit chez Hermangarde comme une froideur, comme un espace secret dont il est exclu et qui lui tient lieu de bouclier, il va écrire à la marquise retournée à Paris, en lui racontant toutes les phases et tous les détails de son adultère, en lui demandant secours dans l’espoir de reconstituer leur ligue autour d’Hermangarde, pour la protéger, une fois encore, du monde de la sensualité et du pouvoir du sexe.
Dans cette longue lettre à la marquise, on retrouve l’emploi du «je», ce mode narratif qui permet à Barbey de passer directement dans son personnage et au lecteur de se trouver en prise directe avec l’interlocuteur: Barbey nous transforme par cette technique en autant de marquises de Flers, dans nos fauteuils, voyeurs et écartés de la scène en même temps: «Que j’ai longtemps balancé avant de vous écrire. Que j’ai eu de peine à accoutumer mon cœur à la pensée du chagrin que j’allais vous causer.» Il s’adresse encore à elle comme à une experte, pour lui conter «une histoire que toutes les femmes savent par cœur» (VM, 511), sauf la sienne qu’il n’a toujours pas mise au courant. La lettre se situe entièrement dans le champ de la sexualité, elle entrera, par hasard, dans l’espace qui lui était interdit dans l’esprit de son auteur, celui d’Hermangarde, où on la retrouvera plus bas.
Les techniques de Ryno (suite):
secrets pour Hermangarde
Le contrat de secret passé entre la marquise et Ryno est basé sur un aveu et concerne la passion physique de Ryno pour Vellini, que Ryno montre enclose dans des lits, des boudoirs mauresques, sur des coussins dorés à la lueur des cheminées où Vellini boit le sang de son amant, etc. dans un bric-à-brac qui nous semble très kitsch.
Avec sa femme, Ryno agit à l’inverse: ici, nul aveu en forme de confession, seulement des bribes d’attitudes mal gardées, des silences là où il faudrait parler, des absences là où il faudrait être présent. L’aveu se fait par petits bouts, comme des pièces de puzzle, et prend la forme des dissimulations successives faites par Ryno avec la complicité de la marquise, perçues par Hermangarde tout au long de ses fiançailles et de son mariage.
La marquise et Ryno sont donc convenus de ce que Vellini ne doit entrer ni dans l’espace mental ni dans l’espace physique d’Hermangarde, comme si celui-ci pouvait en être abîmé, souillé. Aussi décident-ils de s’établir tous les trois loin de Paris, loin de la rue de Provence où vit Vellini, dans le quartier des cocottes de Balzac. Accompagnée de sa vieille amie la comtesse d’Artelles, pourtant très hostile au mariage, la marquise de Flers part donc avec le jeune couple dans une propriété qu’elle possède en Normandie, à Carteret.
L’espace d’Hermangarde se déploie entre le manoir qui domine la plage de Carteret et le bord de mer. Lyrisme de Barbey sur les grands espaces, accumulation de superbes tableaux de marines: «la mer qui montait alors, – qui semblait venir majestueusement vers Hermangarde comme Hermangarde venait vers elle», «le havre, la falaise, la longue grève, les dunes lointaines», «les vapeurs d’incarnat du couchant» (VM, 372-373). Barbey dépeint la sauvagerie et la pureté de ces espaces en miroir de la jeune femme contemplant la mer «éteinte mais pure, [qui] s’harmonisait avec ce ciel aux nuances voilées et rêveuses et s’étendait en large bande, molle comme une huile, glacée comme de l’argent» (VM, 406).
Au physique, si Vellini est souvent comparée à un serpent et à des flammes, voire à un démon, Hermangarde est un archange, une Vierge de Raphaël. On peut douter, avec le développement du roman et la facile reprise en main de Ryno par Vellini, qu’à cet archange Ryno ait su – ou mieux, ait osé ou voulu – offrir le partage des éléments de la science sauvage et amoureuse de Vellini. Pour les jeunes mariés, les termes réservés au plaisir sexuel sont «des abandons», des «langueurs», des «irrésistibles envies de laisser tomber son front sur l’épaule aimée, prie-Dieu vivant où les têtes qui s’aiment s’appuient pour cacher l’extase de l’ivresse». Rien de bien hard.
Les confidences restées secrètes entre sa grand-mère et son mari ont plus ou moins transpiré et créé une sorte de distorsion dans la personne même de la jeune femme. En apprenant, dans son corps peu à peu, comme inconsciemment, la présence de Vellini dans les gestes de son mari, en ignorant la toile de fond collée, inséparable, de cette science de l’amour, Hermangarde semble avoir saisi et accueilli dans son propre espace mental certains des goûts «kitsch» de son mari, mais un ton au-dessous, plus distingué: sans savoir que Vellini couchait avec tous ses bracelets d’or et de cuivre, elle-même se pare de bracelets d’opale. Elle accueille sans doute «les douces furies» et les «langueurs», mais en les craignant, comme si elle les sentait liées à d’autres mondes; un jour, alors que la présence de Vellini a déjà bien entamé sa confiance, Ryno lui baise la paume de la main: «elle eut peur, sans doute, du trouble qui se fit en elle» en sentant «les titillements des muqueuses idolâtres» de Ryno (VM, 510) et elle retire sa main. L’excitation de Ryno vient de la pureté, de l’opposition qu’il fait et qu’il tient à garder entre sa Vierge de Raphaël et sa «bohémienne».
D’ailleurs ce que Ryno recherche avec Hermangarde, c’est moins le sexe qu’une obsession personnelle de Barbey: c’est-à-dire l’intimité. Ce terme revient constamment dans l’ensemble de sa correspondance et ses journaux intimes. C’est cette intimité conjugale, douce, tiède, qu’il est venu constituer dans la solitude, loin du monde, et que vient briser Vellini en arrivant à Carteret le jour où la marquise de Flers quitte le jeune ménage pour rentrer à Paris.
Vellini et Hermangarde se trouvent brusquement, contrairement aux prévisions des conjurés, dans le même espace; elles parcourent les mêmes lieux, se croisent et se toisent sur les mêmes grèves, sur les mêmes landes et elles se partagent le même corps d’homme. Les espaces que Ryno avait cru si bien séparer en fuyant Paris et en se dédouanant de ses souvenirs auprès de la marquise vont se heurter par l’entremise de son propre corps, de ses propres attitudes et par ses déplacements incessants.
Hermangarde: cinq regards pour la mort d’un secret
Premier regard. C’est en raccompagnant Mme de Flers et la comtesse d’Artelles sur le chemin de Paris qu’Hermangarde et Ryno croisent «tout à coup un coupé noir, élégant et simple» (VM, 406). Il y a deux femmes dans le coupé, mais les deux époux n’accommodent pas sur la même silhouette. Hermangarde voit Mme de Mendoze parce qu’elle la connaît et qu’elle la plaint. De cette liaison mourante et peu gênante, Mme de Flers et le «monde» l’avaient avertie. Hermangarde perçoit vaguement une autre silhouette sur laquelle elle ne se renseignera que plus tard pour essayer de distraire Ryno de l’accablement où il se trouve et se réfugie depuis cette rencontre. Ryno, lui, qui «n’avait pas d’émotion au service de Mme de Mendoze […] avait reconnu Vellini» (VM, 407). La vague silhouette tassée à côté de la mourante n’inquiète pas vraiment la jeune femme, encore qu’elle cherche à la situer, à la nommer. Elle craint surtout l’effet produit par Mme de Mendoze sur Ryno, effet qu’elle déduit et construit à partir de sa propre impression: voilà donc à quoi réduit l’amour de Ryno quand il s’est retiré d’une femme. À ce premier regard d’Hermangarde correspond le premier mensonge de Ryno, qui dit à propos de la seconde silhouette: «C’est peut-être une femme des châteaux voisins» (VM, 408).
Entre le moment où Ryno a vu Vellini et celui où Hermangarde va enfin la voir, entre ces deux moments visuels et affectifs, un intervalle de temps se remplit par des inquiétudes à contresens, dont Ryno profite pour y garder son secret, en craignant qu’il n’ait été découvert. Le soir même a lieu l’invasion de l’espace sonore d’Hermangarde par Vellini, qui vient crier sous les fenêtres du manoir comme un oiseau de mer. Pour l’empêcher d’entendre davantage, Ryno se jette sur sa femme pour «la douce furie d’une amour interrompue dans ses plus ineffables jouissances» (VM, 415).
Deuxième regard. Dès le lendemain, il retrouve Vellini sur la grève, se croyant hors du regard d’Hermangarde restée au manoir. Mais celle-ci sort bientôt à la recherche de son mari.
Elle voit Vellini à cause de Ryno. Ce jour-là, Vellini porte une voyante robe écossaise rouge.
«Au moment où Hermangarde arrivait de ce côté, son regard errant fut attiré par le rouge, dans le soleil, de la robe d’une femme qui parut toute droite, dans l’embrasure de deux créneaux, le dos tourné à l’abîme, comme si elle eût eu peur, tout en l’affrontant. Presque au même instant, les bras d’un homme entourèrent cette femme et deux têtes disparurent derrière les créneaux. De si loin, elle ne pouvait juger quelle était cette robe rouge, mais de quelle distance n’eût-elle pas reconnu Ryno?» (VM, 428).
Brusquement additionnée avec les comportements insolites de Ryno, avec le cri d’oiseau, la robe rouge produit «une association d’idées foudroyantes, terribles», et se lie avec le coupé noir. Le soir, Hermangarde ment pour savoir, un demi-mensonge: «J’ai cru vous voir» et «Ryno comprit qu’elle l’avait vu, et que si elle l’avait vu, elle avait vu Vellini» (VM, 431). Le secret de Ryno est à moitié par terre: il n’a pas pu préserver la vue du corps de Vellini. Dans le même temps, le secret d’Hermangarde commence à se constituer, elle a vu une femme et vu l’embarras de son mari: «il en resta muet, comme un homme pris entre deux dangers.» Les voilà entre deux secrets. En se constituant, le secret d’Hermangarde commence à attaquer «l’intimité» du couple, comme les pommes qui commencent à pourrir: «cette pensée qu’on ne dit pas, cette petite tache noire dont les plus saines et les plus fortes intimités peuvent mourir» (VM, 436).
Troisième regard. Hermangarde comprend les relations de son mari et de la femme. On est sur la grève, de nuit. Vellini est assise sur un tas de planches et parle à des matelots espagnols. Hermangarde la prend d’abord pour un mousse, mais les chiens de Ryno arrivent en courant et se roulent de plaisir aux pieds de cette personne menue, qui était leur ancienne propriétaire. Ryno arrive, il saisit sa femme dans ses bras «avec amour» (VM, 450), mais le secret est aux trois quarts entamé: «les chiens mentent donc moins qu’un homme», se dit Hermangarde, trahie. Elle comprend que les silences, les airs absents de Ryno, sont dus à cette femme à l’allure de mousse. À quelques jours de là, «le temps était à la neige», dans un parallèle de dégradation météorologique établi par Barbey; Ryno boit du rhum, se reverse un verre, en négligeant les questions de sa femme: «elle fut frappée au cœur de ce geste muet. Il lui disait trop qu’il y avait dans l’âme de son mari des espaces parcourus par d’autres qu’elle», tandis qu’elle se plonge «dans la douleur d’avoir épousé et d’aimer un homme […] qui a senti, vécu, aimé, alors qu’on n’était qu’une enfant, roulée dans les langes d’une nourrice, somnolente dans les langes de l’impuberté» (VM, 454-455). Ici, éclate l’identité du secret et de son objet, la sexualité.
Quatrième regard. Vellini et Ryno sont dans la chaumière où Ryno la retrouve presque toutes les nuits, laissant le «suave calice de neige» au manoir, pour «le pavot sombre au cœur brûlé» (VM, 508); ils viennent de faire l’amour, vont le refaire encore. Hermangarde se réveille, ne voit pas Ryno à ses côtés, et saute à cheval pour aller jusqu’à la chaumière de celle que les paysans du coin appellent «la Mauricaude», elle se colle à la fente du volet. Elle voit. Elle rentre au manoir, s’évanouit, puis délire: «Oh, c’est lui qui l’embrasse, ah! Malheureuse Hermangarde, regarde par le trou du volet, regarde, regarde. […] Garde-le dans tes bras si tu l’aimes, mais bouche le trou que je ne vous voie plus et que je m’en aille, que je m’en aille.»
Elle était enceinte, elle fait une fausse couche et prend l’engagement solennel, au pied de l’autel de la Vierge, de ne plus coucher, jamais, avec son mari. Le secret établi autour de la sexualité de Ryno, puis la vue de cette sexualité en acte ont abouti à la mise hors circuit, la mise au secret, de son corps et de son propre sexe, par Hermangarde elle-même.
Cinquième regard. Les nouvelles confidences de Ryno à la marquise, sous la forme d’une lettre, n’arrivent pas à temps avant la mort de la vieille dame. Hermangarde décachette l’enveloppe et lit.
Adressée à la marquise, la lettre est, comme le récit oral d’avant le mariage, inspirée par le même souci de confier un secret pour en être innocenté. Elle reste aussi dans le même champ de la sexualité, dans le terrain des «dessous de cartes de l’intimité» par des descriptions enflammées et d’une allégorie transparente, raides pour la marquise qui aurait dû les lire, pires pour Hermangarde à qui elle offre le catalogue des attraits de Vellini: «fanatique et vêtue comme une Begum de l’Inde, sensuelle et languissante comme une Cadine qui attend son maître, mettant son orgueil à n’avoir plus d’orgueil et à ramper sous les pieds de son maître» (VM, 518), elle surexcite Ryno. «Remonté sur la croupe ailée de ma Chimère de dix ans, j’en aiguillonnai l’ardeur à tous crins, j’en précipitai la course furieuse, j’essayai de la briser sous mon étreinte, pour que, tombés tous deux du ciel, elle ne vînt plus jamais offrir son dos tentateur à ma force épuisée» (VM, 519).
Plus grave est la description suivante, car elle montre l’infini du pouvoir de Vellini, basé autant sur la sensualité que sur le mythe: «Quand on la voyait comme je la voyais alors, étendue par terre sur ces gerbes déliées, avec des torpeurs de couleuvre enivrée de soleil, je ne pouvais m’empêcher de penser à tous ces êtres merveilleux […] à ces Mélusine, moitié femme et moitié serpent, à ces doubles natures, belles et difformes, qu’on dit aimer d’un amour difforme et monstrueux comme elles» (VM, 520). «Ainsi, je sortis de chez elle, non pas guéri comme je l’avais espéré, mais les artères plus pleines du poison qu’elle m’avait versé» (VM, 520).
Il ne se préoccupe, écrit-il, «que de cacher à Hermangarde une liaison qu’il était impossible de briser; que de sauver le bonheur de cette noble femme et la dignité de notre amour» (VM, 520).
Comment Hermangarde, à lire cela, ne se fermerait-elle pas comme un coffret, mais de l’intérieur et sans plus jamais donner de clé à Ryno?
Dès lors, pour Ryno, privé de la marquise, privé d’Hermangarde, démasqué dans ses pratiques les plus anciennes et les plus intimes, celles dont il avait décidé avec la marquise de tenir sa femme exclue, il n’y a plus rien à cacher: il affiche carrément sa liaison avec Vellini, tout comme il se laissait voir, les derniers jours à Carteret, par les paysans. Revenu à Paris, il laisse sa voiture stationner tous les soirs rue de Provence, devant chez Vellini et le vieil ami de la marquise a pour mot de la fin: «Marigny n’aime pas l’incognito.»
Hermangarde, elle, a terminé à dix-neuf ans sa vie de femme.
Les techniques de Ryno (suite): pas de secret pour Vellini
Entre Ryno et Vellini, il y a du sexe, du sexe assumé, triomphant, il n’y a pas de secret. Barbey est sans ambiguïté sur la nature de leur relation: après toutes les descriptions fougueuses de leur liaison, de leurs ébats, de leurs fâcheries, de leurs retrouvailles, après avoir joué le grand jeu du mauvais goût et de l’extase, Barbey résume d’une toute petite phrase à la fois la raison et la qualité du repos et du plaisir que Ryno trouve chez Vellini, dans les lieux les plus inhospitaliers, la grotte de la falaise, la chaumière: «elle [Vellini] était aussi la femme avec laquelle il pouvait être franc, à laquelle il pouvait tout dire, près de qui il se dilatait dans la confiance…» (VM, 502).
Il parle, il parle, il lui raconte tout, Ryno est un homme éperdu de confidence, il faut qu’il fasse le récit, à une femme, de ses amours avec une autre. On a vu comment, écartant Hermangarde, il avait utilisé la marquise: à elle, il offrait la mise en scène de sa passion pour Vellini. À Vellini, il offre le déploiement insistant de son amour pour Hermangarde: à l’indécence de la peinture de ses scènes d’amour avec Vellini, répond en miroir l’indécence de son amour respectueux et réduit à la chasteté par la froideur et le silence d’Hermangarde.
À chacune des rencontres effectuées, Barbey prête à Ryno cette logorrhée plaintive et scandaleuse qui consiste à dire à celle avec qui on vient de coucher combien celle qu’on ne touche pas est supérieure.
Vellini, à chaque fois, sans beaucoup de commentaires, répond dans les deux langages qu’elle connaît et qu’elle maîtrise: la sexualité et le temps.
«Vellini n’était pas seulement la femme de son passé; la vieille maîtresse régnant, comme les Rois de droit divin, en vertu des traditions et du souvenir, par le Génie des ruines de sa jeunesse»; et c’est là que se place la phrase citée plus haut: «elle était aussi la femme avec laquelle il pouvait être franc…»
Aussi, ce qu’elle offre à Ryno, en réponse, en récompense à ces plaintes, ce sont soit des caresses pour le présent, soit des souvenirs énumérés, soit des projets d’avenir. Elle occupe toute la place physique, toute la gamme temporelle, il n’y a pas de zone qui ne lui appartienne.
Voici une de leurs rencontres types, celle au cours de laquelle la pauvre Hermangarde colle son œil à la fente du volet (VM, 470-480): d’abord on a un long monologue de Ryno, sur son désarroi depuis que Vellini est réapparue, et comment, en contrepartie, il s’est lui-même «jeté à Hermangarde», pour terminer par «tu as empoisonné mon bonheur». Réponse de Vellini, entièrement vouée à des évocations du passé, tout y passe, les bons et les mauvais moments, les excursions: «Ryno, rappelle-toi! N’as-tu pas vu un jour avec moi, dans les Cévennes», le rappel du miroir-talisman donné pour elle à sa mère, à Malaga, jadis, par une Bohémienne, le sort et le sang qui les a réunis, en un mot «les dix ans élargis de Vellini dans ta poitrine» (VM, 472).
Intermède sensuel de quatre pages, dont le ton est donné par ce passage que Barbey, craignant d’avoir maille à partir avec la censure, avait supprimé, pour n’être rétabli que dans l’édition de la Pléiade: «La tête brune de Ryno était placée plus bas que le sein de l’Espagnole qui jouait d’une main avec son miroir. Était-ce le bras de cette femme qui liait ainsi le cou de Ryno? ou, car c’était bien blanc pour un bras, sa svelte jambe passée au-dessus des épaules de son ancien amant, couché vers elle?»
Pendant qu’ils font l’amour, longuement, Barbey montre qu’il y a bien passage, par le corps de Ryno, de l’une à l’autre de ses femmes. Si Hermangarde comprend et adopte sans savoir d’où ils viennent quelques-uns des goûts de son mari formés par Vellini, Vellini repère de même, mais en toute connaissance de cause, les traces d’Hermangarde dans les nouvelles manières de faire de Ryno: lieux mal gardés que ces sexes féminins qui lui sont dévoués. Mais, si les traces de Vellini apparaissent à Hermangarde dans la gamme de l’excès, du danger, dans les «titillements de muqueuse» ou dans les tintements de bracelets demandés par Ryno, Vellini perçoit les traces d’Hermangarde, au contraire, en négatif, dans la soif de volupté «et de ses plus brûlantes cantharides» que Ryno manifeste comme s’il en avait été longtemps privé.
Les échanges verbaux reprennent, il s’agit cette fois, dans la bouche de Vellini, de projets d’avenir, elle voudrait s’embarquer avec Ryno: «Nous pourrions bien partir ensemble… pour vivre, libres et unis, comme nous avons vécu autrefois.» Devant le silence de Ryno, elle propose un autre plan: elle reste ici et comme «ta femme est délicate, elle ne peut plus t’accompagner dans tes promenades, tu pourras donc sans danger y rencontrer Vellini». Passé, présent, avenir, tout est balisé par Vellini.
Vellini refuse, pour elle, le secret: elle parle constamment de tout, des grandes heures de leur passion, de ce qui a été triste, de la mort de Mme de Mendoze son ancienne rivale, de la mort de Juanita et de son incinération, «notre enfant que nous avons brûlée», de ses anciens amants, des perles que sa mère, la duchesse, lui offrait, etc. Elle lui offre tous ses souvenirs, toute son enfance, toute sa vie dissolue, en bribes, qui viennent corroborer les confidences de Ryno remises en ordre pour la marquise, elle ressasse, elle s’interrompt, ses monologues ou dialogues sont truffés de points d’exclamation, de points d’interrogation, de tirets, de points de suspension. Ces poussières de passé, ces poussières d’avenir sont entassées et remuées sous les yeux de Ryno.
Elle refuse que Ryno ait des secrets pour elle: c’est ce qui lui permet non seulement d’entendre mais parfois de provoquer les confidences cruelles de l’homme qui vient pleurer sur ses genoux et lui faire l’amour parce qu’il aime sa femme. Elle ne lui dit jamais de se taire, elle va même jusqu’à murmurer des «Pauvre Hermangarde» qui sont autant de demandes de confidences supplémentaires, tout l’intérieur et l’extérieur de Ryno, il le lui faut, sans zone d’ombre, même si elle en souffre. Même si elle reste «froide, lourde, meurtrie» (VM, 524) quand Ryno retourne au manoir, au risque qu’il la dépeigne ainsi: «se balançant stupide et morne dans son hamac. Je l’ai quittée souvent ainsi, croyant qu’enfin ce dégoût, cette laideur, cette stupidité, ces ténèbres, cet anéantissement, seraient éternels» (Ryno, dans sa lettre à la marquise, VM, 524). En se laissant ainsi piétiner par Ryno, tout en le dominant, en le tenant, elle contribue à éclairer le portrait de cet homme qu’elle aime, qui lui est nécessaire, mais dont elle sait la faiblesse, les velléités, la grossièreté, la cruauté, et à qui elle tient lieu de force, de noblesse, de courage et de ténacité.
Le mystère de Ryno
Barbey ne nous laisse approcher Ryno que par sa vie amoureuse, par les femmes qu’il séduit, qu’il désespère, et dont le portrait, dessiné avec force, enserre le jeune homme dans leurs exigences et leurs contraintes. Car sans elles, Ryno n’existe pas, purement et simplement.
Le secret de Ryno, celui qu’il essaye de cacher, mais qui est avec insistance la ligne et la raison même du roman, c’est le pouvoir qu’exerce sur lui le sexe féminin, non pas quand il appartient à une personne faible ou bien élevée, mais à ce qu’il se plaît à nommer une sorcière.
On comprend mieux l’accord qui se fait entre lui et Mme de Flers, si l’on sait qu’il a pour effet de laisser à l’écart de confidences sexuelles une vierge, dont la virginité constitue justement un mystère et un atout aux yeux blasés de Ryno. Mme de Flers se prête au complot, officiellement pour préserver la sensibilité de sa petite-fille, mais aussi pour ne pas doter cette Hermangarde riche et belle d’une science qu’elle-même a jadis utilisée, en l’inventant, avec génie, du jour au lendemain, ou plutôt précise Barbey «du soir au matin» (VM, 217). Au cours de la scène d’exposition du roman, Barbey indique que la marquise «avait traversé toutes les corruptions de Trianon, de l’Émigration et de l’Empire» et qu’«Elle avait eu la jambe leste» (VM, 213-214). Comme Vellini, mais dans le grand monde et avec un «tact merveilleux», elle avait su captiver et dominer le volage marquis de Flers: «Vous aviez asservi complètement le marquis de Flers», lui dit Mme d’Artelles qui ajoute: «Vous l’aviez ensorcelé.» Mais à sorcière, sorcière et demie, Mmede Flers, devenue vieille et inconsommable, n’ensorcelle plus, elle est ensorcelée non par la franchise de Ryno, mais par l’objet de cette franchise: le sexe. Ce qu’elle entend dans le grand récit de Ryno, c’est la manière dont il fait l’amour et dont elle souhaite, en bonne grand-mère, qu’Hermangarde profite: «Dans cette loterie du mariage, les qualités de M. de Marigny sont encore la meilleure mise», pense-t-elle (VM, 227). Ce que Ryno dit, c’est qu’il ne sait pas faire autre chose.
Car de lui, on ne sait que cela, avec profusion de détails, nous l’avons vu, mais à part cela, rien. Toutes ses activités sont commandées par son activité sexuelle: à Carteret toutes ses courses à cheval sont organisées entre Hermangarde et Vellini, du lit de l’une au lit de l’autre, parlant âme à l’une et corps à l’autre, sans que jamais il prenne le temps de se reposer, de se distraire, de faire quelque chose d’autre. À Paris, de même, il circule entre le boudoir de Mme de Flers et le salon indien de Vellini et les récits de sa vie passée ne mettent jamais sur scène un intérêt pour un quelconque domaine: ni politique, ni argent, ni terres, ni religion, ni famille, ni amis. Barbey a beau répéter de-ci, de-là que Marigny a «une forte personnalité», qu’il a de l’esprit, de la conversation, de la sincérité, cela reste des mots. Tout au plus lui connaît-on une occupation, le jeu, qu’il a beaucoup pratiqué aux eaux de Carlsbad avant de connaître Vellini: activité tout aussi compulsive que ses conquêtes féminines de l’époque.
De famille: pas. C’est le vrai secret de Ryno. Dans ce roman, où Barbey prend plaisir à donner les généalogies complètes des douairières du faubourg Saint-Germain ou du moindre pêcheur de Carteret, Ryno se trouve sans aucun parent, pas un Marigny ou allié qui se trouve au mariage à Saint-Thomas-d’Aquin. Il est seul représentant de sa génération et dépourvu de toute ascendance. Une seule allusion y est faite, par lui, au début de son récit à la marquise, en laissant le lecteur dans l’ignorance: «Vous connaissez ma famille, vous savez quelle place elle a tenue dans l’ancienne aristocratie. Lorsqu’à vingt ans, je la quittai brusquement pour aller vivre à ma fantaisie, vous savez quel éclat ce fut dans ma province et dans votre faubourg Saint-Germain, où mon père avait conservé beaucoup de relations» (VM, 263).
La marquise ne disant mot, nous ne saurons rien sur les événements familiaux auxquels il se réfère. Cela reste leur secret. Par l’emploi du possessif «votre faubourg Saint-Germain», Marigny se situe en étranger par rapport à ce monde clos et bien réglé, étranger par choix, par «éclat», tout comme Vellini l’est par sa naissance illégitime, sa nationalité hybride, portugaise par sa mère, espagnole par son père et anglaise par son mariage: hors famille et hors règle, voilà les lieux où se revendique Ryno.
Barbey le prive également de descendance: la fille qu’il a avec Vellini meurt d’une «maladie violente» (VM, 310), mais auparavant, elle a été l’objet d’une folle passion physique de la part de sa mère qui «suçait les grands yeux» de la fillette, «mordait amoureusement sa jeune et délicate chair» (VM, 311) et dont Ryno était jaloux. «Qu’as-tu, Ryno […] n’es-tu pas mon enfant aussi?» disait Vellini avant la mort de l’enfant. Ce passage éclaire une partie de la nature des relations avec Vellini et explique peut-être aussi le charme, incompréhensible pour les autres femmes, des trente-six ans de la «Mauricaude». Avec Hermangarde, pareil échec: la fausse couche qu’elle fait la prive définitivement, indépendamment de son vœu de chasteté, de la possibilité d’avoir de nouveaux enfants. Ryno, se faisant consoler par Vellini de ce nouvel échec dans sa descendance, dit «avec un accent amer»: «Je ne suis pas heureux en enfants» (VM, 492).
Les mêmes béances remarquables figurent dans la ligne généalogique d’Hermangarde: comme Ryno, elle se trouve coincée entre deux «blancs», elle-même étant enfant posthume née d’une mère disparue en la mettant au monde, et vivant la fausse couche provoquée par la trahison de Ryno.
Quant à Mme de Flers, appelée «maman» par Hermangarde, et «mère» par Ryno, elle s’établit elle-même sur un court-circuit de générations, offrant par son grand âge le rassurant aspect d’une mère mise hors circuit de la sexualité. Ce qui explique peut-être l’attraction qu’elle exerce sur Ryno.
Il semble en effet que ce soit là le véritable «secret» du roman, qui est aussi celui de Barbey, pareillement fasciné par les femmes chez qui il cherche toujours une figure de mère pour remplacer la sienne, Sophie, avec laquelle il s’entendait mal, et cette quête se faisant par le choix de figures dédoublées d’ange ou de démon. Je cite ici pour mémoire deux femmes déchirées dans leur sensualité et leur éducation, qui ont été en relation amoureuse avec lui, Eugénie de Guérin et Mme de Maistre. Je cite aussi pour témoin son grand amour pour Mme de Bouglon, celle qu’il appelle l’Ange Blanc, mère d’une grande fille qui a quinze ans lors de leur rencontre, et sur laquelle Barbey, pendant des années, établira de vrais fantasmes d’un mariage toujours différé, et jamais réalisé. Et il y a un témoin sans doute capital mais secret, le modèle de Vellini, sur lequel Barbey ne laisse filtrer que de faibles indications: «j’ai aimé trois ans une femme horrible […]. Mon amour ressemblait à de l’ivrognerie» (Correspondance générale, t.III, 363).
Cependant, je ne puis traiter ici de Barbey autrement qu’en esquisse, car il faudrait autre chose qu’une visite chez Une vieille maîtresse, si instructive soit-elle. Je considère ici Vellini, Hermangarde et Ryno certes comme des créatures littéraires de Jules Barbey d’Aurevilly, mais aussi et grâce à lui comme des personnes à part entière, quels que soient les filaments et les pseudopodes qui les lient à leur auteur.
Si Barbey, lui, a eu une occupation immense, l’écriture, qui lui a fourni une vraie descendance, s’il a eu des amitiés, des passions pour la mode, en vrai dandy qu’il était, pour le théâtre, pour la politique, pour la religion où il s’est converti avec éclat, Ryno, au contraire, ne vit que pour et par ses femmes, ses malheurs, ses frustrations, ses plaisirs, ses dégoûts et ses érections, il ne fait de sa sexualité qu’un usage unique, celui du plaisir, voire un usage détourné, la recherche d’une mère fantasmatique, échouant toujours ou refusant la procréation.
Le gros roman, touffu, vivant, plein de personnages secondaires, se trouve d’une manière terrible et fascinante moins organisé autour de Vellini, pourtant rôle-titre, qu’autour de ce héros masculin, obnubilé, tournant entre tous ces sexes féminins qui n’en sont peut-être qu’un, n’en reproduisent qu’un, celui de l’origine sur lequel est fait le silence.
Cet ouvrage est comme un carnet de croquis, dessinés au cours de cinq visites rendues à cinq hommes. Cinq hommes a priori disparates : trois sont issus du monde de la fiction. Littérature avec Ryno de Marigny d’Une vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly, cinéma avec Archibald de la Cruz de Buñuel, musique avec le roi Philippe II de l’opéra de Verdi, Don Carlos. Les suivants, deux portraits d’hommes qui ont appartenu au monde réel, Théodore Rostopchine, l’incendiaire de Moscou et Maurice de Guérin, poète, mort à vingt-neuf ans, en 1839. Les visites sont conçues selon un fil d’Ariane, notion délicate et de faible scintillement, visible et invisible : le secret. Cette galerie de portraits nous mène d’un incendiaire à un enfant blessé, d’un roi à son rêve d’être dominé, du plus imaginaire au plus historique, du plus auditif au plus visuel, du plus faussement familier au plus secrètement caché, du plus assassin au plus suicidaire, car le secret est une arme souvent mortelle.
Hélène Puiseux est directrice d’études à l’École pratique des Hautes Études. Elle a publié l’Apocalypse nucléaire et son cinéma aux Éditions du Cerf et un roman Les Cerisiers de l’autre monde (Grasset). Elle a connu un fort succès avec son dernier essai, Les Figures de la guerre (Gallimard).