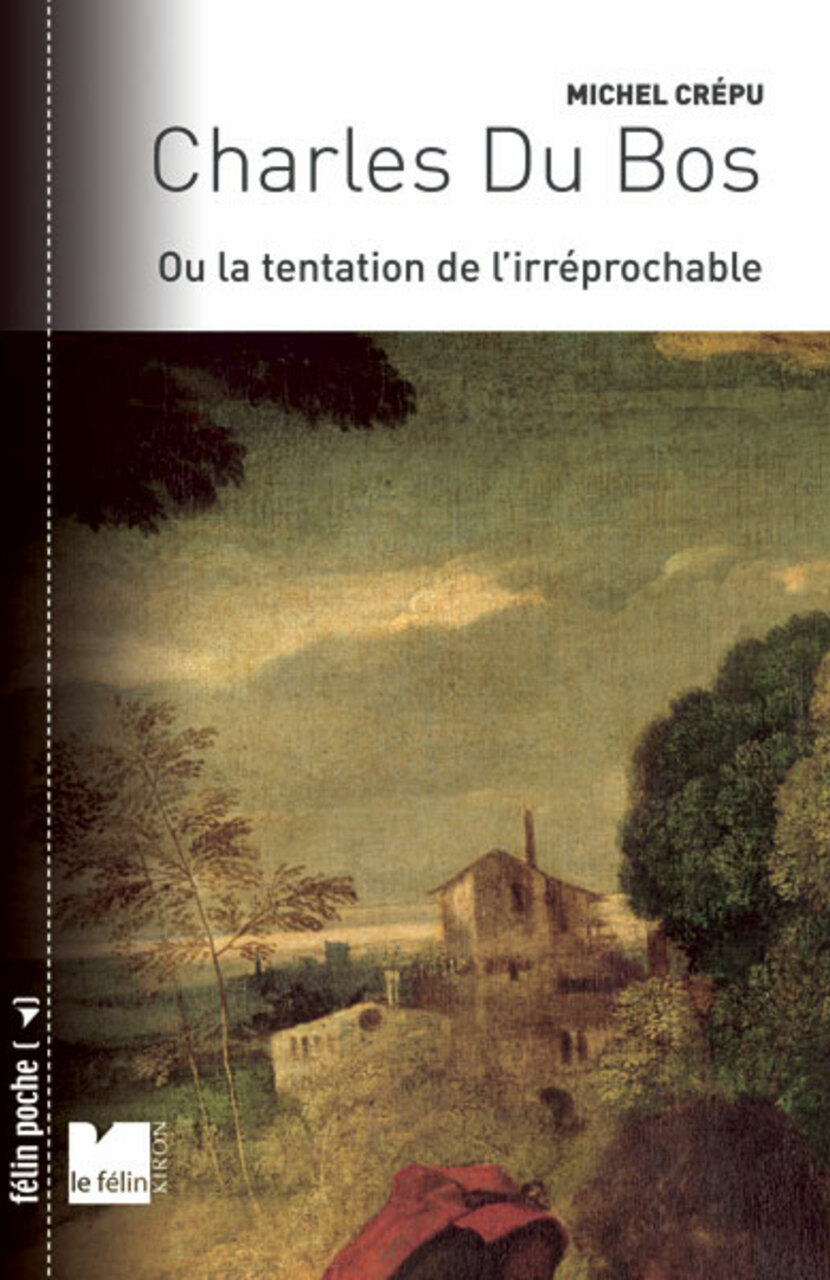
Charles Du Bos
Les profondeurs de la mer
Hofmannsthal écrit?: «?Le poète vit, et cela de façon ininterrompue, sous le poids d’atmosphères qui ne se laissent pas mesurer, comme le plongeur dans les profondeurs de la mer. Et rien n’est plus étrange dans l’organisation d’une âme que le fait qu’elle puisse supporter ce poids.?» Relisant ces lignes que cite Du Bos en préambule à son étude «?Le legs de Hofmannsthal?», je sais immédiatement que tout est dit là de ce qui fut la destinée spirituelle et littéraire de Charles Du Bos. Et je sais surtout, encore mieux qu’il y a vingt ans où j’écrivis ce livre, combien c’était déjà le motif, le cœur même, la grande affaire qui m’occupait, qui m’occupe toujours. Il y a vingt ans, on parlait beaucoup de ces auteurs qui, à l’exemple de Hofmannsthal, témoignaient d’un monde, celui de la Mitteleuropa, où dormait, invisible, l’héritage du Vieux Continent. C’était l’époque où l’on commentait la merveilleuse Lettre de lord Chandos tout en lisant l’autobiographie de Klaus Mann, Le Tournant?: on vivait une étrange atmosphère de crépuscule aux allures inconnues d’un recommencement d’autre chose. Jamais le sentiment européen ne me fut plus sensible qu’à ce moment et ce livre ne serait peut-être pas venu au jour en dehors d’un tel climat, où l’histoire et la littérature croisaient aussi intimement l’ordre du spirituel. J’écris «?spirituel?» comme pour dire «?littéraire?»?: chez Du Bos, c’est la même chose, il y a synonymie entre les deux termes. Je dis bien «?spirituel?» et non «?spiritualiste?», ce qui n’est pas identique. Je ne pourrais l’écrire de personne d’autre. De là ce Journal extraordinaire qui s’imposa à moi au fil des années, par ondes successives, une lente emprise, tout à fait le contraire d’un coup de foudre. Je revois ce jour, avenue de Breteuil, vers 1973, où j’achetais un volume du Journal à un libraire d’occasion qui existe toujours d’ailleurs. Mon étonnement à la lecture, ce labyrinthe, cette tension ardente, cette vie près des livres. Un livre du P.?Charles Moeller, Littérature du xxe?siècle et christianisme m’avait alerté, plus tôt encore, l’année de mon bac. J’étais intrigué par cet inconnu, je devinais son feu énigmatique. C’est venu comme ça, en fin de journée, à la fin d’une adolescence.
L’«?irréprochable?» renvoie chez Du Bos à une thématique jamesienne?: il a une valeur indissolublement esthétique et morale. Irréprochable, cela signifie un mode de présence, une tension vers la complétude, une capacité d’embrassement général. Cela est lié à l’idée d’un continuum, l’ininterrompu dont parle Hofmannsthal et que James tente de réaliser dans l’espace romanesque. De là aussi que l’expérience diaristique soit la seule façon, pour Du Bos, d’approcher cela. Être l’homme qui n’oublie rien, celui qui reste quand tous les autres sont partis et qui a encore une question à poser. Il a toute la nuit devant lui, il ne voit pas où est le problème. Les autres s’en fichent?? Il le sait, il ne sait peut-être pas à quel point ils se moquent éperdument de toute cette affaire de littérature. Il aurait sans doute mieux valu pour sa santé, qui était déjà fort défaillante, que Du Bos ne le sût pas. Ce qui l’intéressait, c’était la sphère sublime de l’art, où toutes choses deviennent à la fois limpides et profondes. Hölderlin dit quelque part que les pensées les plus profondes sont les plus vivantes. Le mot «?sublime?» fait rire tout le monde, et alors?? Qu’avons-nous à faire du monde?? C’est cela, l’irréprochable dubosien. Aujourd’hui, je pense que je n’emploierais pas le mot de «?tentation?». Pourquoi lui?? À cause du démon de la transparence?? Je ne crois pas que Du Bos ait été sujet à un tel démon. Le mot plus simple de «?passion?» me paraît préférable, il dit mieux ce qu’il en est que «?tentation?» qui appelle une problématique étrangère à Du Bos. J’aime qu’il ait si scrupuleusement résisté à Maritain qui voulait lui faire oublier sa bibliothèque?; et Gide disait affectueusement?: «?Charlie voudrait monter au ciel avec tout son bagage.?» C’est cela l’irréprochable dubosien, un sens quasi charnel de la dette. Et serait-ce une tentation?? Il meurt en plein mois d’août, murmurant les noms de Bach, Botticelli, Keats?: toujours la dette, en forme de louange, ce qui n’est pas du tout la même chose que le renfermement coupable et mortifère d’un fils qui n’en finirait pas de remercier les pères qui l’ont aidé à marcher. The noble pleasure of praising?: tout Du Bos peut se résumer dans cette expérience devenue si étrangère aux hommes de ce temps. Les textes sont là, cependant. Il suffit d’ouvrir, de lire, d’être embarqué. Du Bos est l’embarqué absolu?: en ce sens, son Journal, ses Approximations, ne témoignent de rien d’autre. Il a voulu cela, il l’a désiré, il en a vécu. Vivre dans les profondeurs de la mer. Si ce livre en donne la sensation, alors il n’aura pas été tout à fait vain.
Michel?Crépu
Paris, novembre 2006.
De source sûre
On ne lira pas ici une vie de Charles Du Bos, bien que sa vie soit au centre des pages qui suivent. Peut-on écrire la vie d’un homme qui a fait de la sienne le sujet de toutes ses pensées?? Les biographies sont vouées à trahir ce qu’elles cherchent à restituer, fût-ce au plus près?: mais que signifie donc, par exemple, «?au plus près?» avec un Amiel?? Que faire de toute cette nomenclature des états d’âme?? Le Journal intime d’Amiel décourage le biographe, à la lettre il le désespère.
Il en va un peu de même avec Du Bos. Un peu seulement?: l’énormité non résumable de son Journal ne produit pas la même impression d’asphyxie que nous ressentons à la lecture d’Amiel. Ce dernier se ronge les ongles, il écrit pour n’avoir point à vivre. Du Bos est à l’opposé?: le lire, ce n’est pas tourner avec lui dans la cage, mais suivre pas à pas dans son labyrinthe les tâtonnements d’un homme dévoré par une soif extraordinaire d’approfondissement.
Certainement, c’est là un trait commun aux grands diaristes?: ce sont des gens qui décident un jour d’approfondir, de garder la lampe allumée sur la myriade de quoi se compose une vie, leur vie. Une façon de fixer le vertige en tâchant de le réintroduire à l’intérieur d’une chronologie dont on se croit le maître, de revenir sur le temps passé en niant ce pourquoi, précisément, on y revient?: l’éternelle fugacité, signe de vie, signe de mort.
Ainsi, en se racontant à soi-même ce qu’on a vécu à travers ce que l’on est en train de vivre – de telle sorte qu’il est impossible comme dit Fénelon, si moderne en ces matières, de se trouver «?à soi-même fixe et présent pour dire simplement?: “je suis”?» – on construit un monde parallèle, la chimère d’un point de vue sur l’ensemble. Voyons par exemple Claude Mauriac et l’entreprise de son Temps immobile, Julien Green et ce Journal dont le paisible rythme semble d’ores et déjà avoir pris la route de l’éternité?: ils se tiennent auprès de la lampe, saisis, fascinés par cette puissance étrange qui les fait aller et venir d’un bout à l’autre du grand appartement des années. Mais c’est que la contemplation du vécu produit un genre de bonheur que l’approche des échéances rend d’autant plus suave. On peut se délecter d’être éphémère, surtout quand on a la chance de durer.
Ce n’est pas ce bonheur auquel on goûte en lisant Du Bos. Il ne semble pas qu’il y ait chez lui cette hantise qui pousse le diariste à «?aller contre?», à s’enchanter d’une négation, par les mots, de l’irrémédiable. La décision de tenir un journal, on le verra pour lui, relève d’une autre préoccupation?: il ne s’agit pas tant de résister au temps que de jouer, avec ce dernier, une autre partie. Il y a un moment dans la vie de Du Bos, où l’évidence de sa personne lui apparaît non plus seulement sous le signe d’un Donné reçu passivement, dont il n’y aurait qu’à enregistrer les variations climatiques, mais sous celui d’un certain Devoir, d’une Injonction. On serait plus près ici, en terme de parenté spirituelle, du Jacques Rivière des Carnets, de l’admirable petit volume?: De la sincérité envers soi-même. Le journal n’est plus ce vaste espace qui sert à nier le temps en jouissant de sa fugacité?; il servirait plutôt de lampe témoin, sentinelle vigilante, fruit d’un dédoublement guère moins illusoire au reste que les exorcismes mélancoliques. Mais qu’importe, c’est une espèce de long, d’irremplaçable corps à corps qui commence et qui n’aura pas de fin. «?Qu’ai-je fait???» «?Qu’ai-je à faire???» «?Quelles sont mes obligations, mes charges???» «?Comment puis-je me rapprocher de cet obscur sentiment en moi où je sais que réside la certitude d’un contentement moral, spirituel???»
Ces diverses questions furent pour Du Bos omniprésentes et c’est pourquoi nous devons prendre garde de faire trop vite de lui un introspectif pur quoiqu’il en revendique lui-même l’appellation en bien des endroits de son Journal. Ou alors parlons d’une introspection active, soucieuse d’élévation, de perfection.
Gide, ami et interlocuteur principal de Du Bos durant plusieurs années d’élaboration, de mise en route du Journal en tant qu’œuvre véritable et non plus seulement préalable, sera intrigué, séduit, fasciné, agacé par cette façon si provocante au fond d’ignorer les lacis de l’ambiguïté où lui-même se complaît. D’ailleurs ce n’est pas d’ignorance qu’il s’agit?: Du Bos ne joue pas naïvement sa partie comme si l’effort de droiture morale pouvait se permettre le luxe de compter pour rien les ambivalences de l’amour-propre. Disons simplement que pour Du Bos, ce qu’il appelle lui-même dans son étude sur Hofmannsthal l’«?hédonisme psychique?», et qui s’applique parfaitement à Gide, figure à ses yeux une limite. Loin d’y voir la certitude d’une plus grande liberté, on dirait qu’il en ressent l’aspect sourdement volontariste. Le plus «?militant?» des deux n’est pas forcément celui qu’on croit, de l’hédoniste acharné à se prouver à soi et aux autres le bien-fondé de ses conduites et du «?sérieux?» qui sait le peu de poids des «?convictions?», ces nervosités qui obstruent.
Narcisse a peu de place ici. Du Bos n’use que fort peu du miroir. Il le trouve vulgaire, c’est-à-dire rétrécissant. La vulgarité, pour Du Bos, loin d’être une simple et banale affaire de style ou de conduite, est d’abord un problème de dimension. Est vulgaire ce qui empêche la visibilité des nuances, opacifie la subtile complexité d’une figure. Et rien n’est plus complexe et subtil que soi-même?: s’y adonner requiert donc la capacité d’un certain dépassement que ne permet pas le recours exclusif à l’usage du miroir. S’il est impossible d’éviter ce dernier, et Du Bos le sait parfaitement, on doit pouvoir le passer, le traverser. Y est-il parvenu??
Il est extraordinaire que sur le nombre de pages au cours desquelles Du Bos se scrute avec une attention que sont loin d’atteindre nos actuels narcisses, il ne s’en trouve pas une seule qui fasse montre de cette complaisance au moyen de laquelle on se croit de nos jours plus «?vrai?». C’est étonnant comme on peut se tromper.
Nous paraissons en réalité las de ce goût d’approfondir qui frappe tant à la lecture et qui donne de Du Bos l’image contradictoirement harmonieuse d’un moderne qui n’aurait rien abandonné dans son bagage de ce qui caractérisait, en son temps, l’esprit classique. Du moderne, il tient l’essentiel?: à savoir un respect fondamental du principe d’incertitude – sans quoi ce journal n’aurait aucun sens?–?; du classique, ce qui nous paraît sûrement le plus inaccessible?: un sens moral du perfectible. Toujours chez Du Bos sont présentes ces deux forces en concours, en complicité?: l’interrogation inlassable?; l’exigence renouvelée sans cesse d’une transformation de soi. Approfondir, s’approfondir?: la poursuite d’un sens qui n’est pas donné d’avance et dont il n’y aurait plus qu’à gérer les aléas?; le désir, la volonté du perfectible, nous les rencontrons à tout instant chez lui comme si le fait d’assumer pleinement la condition d’un vrai moderne n’empêchait nullement l’exercice d’une fidélité qui se traduit principalement par une relation vivante à l’égard des maîtres.
Lorsque Du Bos écrit par exemple qu’il s’agit de «?maintenir en soi vivant le dialogue entre Pascal et Montaigne1?», nous comprenons qu’il n’y va pas seulement ici d’un scrupule d’homme cultivé (ce qui serait déjà fort extraordinaire) mais bel et bien de l’aventure personnelle d’un homme qui trouve encore au commerce de ces maîtres, non point les termes fixés à jamais d’un enseignement, ni cette trompeuse plénitude dont Thomas Bernhard sut naguère, en ses Maîtres anciens, dire tout le mensonge?; mais l’écho d’une expérience qui, par-delà les siècles et les formes où elle se manifeste, reste le lot commun. «?Les grands morts?», comme dit Du Bos, ne sont tels que parce qu’en réalité ils continuent de vivre d’une autre vie qui ne cesse pas d’informer la nôtre ici-bas. Du Bos ne les admirait pas en raison d’une grandeur étrangère à nos turpitudes, mais bien parce qu’il voyait mieux que quiconque en quel point de jonction secret cette grandeur était le fruit. Et voilà aussi bien pourquoi on ne saurait dissocier ce qui, dans l’œuvre dubosienne, relève du journal, de la sphère introspective et ce qui se rapporte au commentaire, à l’approche d’autrui. Entre l’espace du Journal, lieu labyrinthique de toutes les questions, et celui des Approximations, espace dévolu à l’interprétation des œuvres, à la reconnaissance et enfin à ce que Swinburne, souvent cité par Du Bos, appelait the noble pleasure of praising, «?le noble plaisir de la louange?», est noué un accord singulier qui n’a pas d’équivalent en littérature.
Étranges sont les chemins de l’admiration. Tandis qu’ils nous déportent loin du miroir, voici qu’ils nous y reconduisent. Mais alors, c’est une autre image qui apparaît?: un gouffre plutôt qu’un reflet, le visage d’un inconnu dont nous sommes le locataire étonné. Charles Du Bos fut cet admirateur d’autrui, aventurier de lui-même. Il n’admirait pas pour se fuir mais pour se trouver, si bien que d’une attitude à l’autre court chez lui une même nécessité, indivisible, qui rend tout à fait inutile le soin qu’on voudrait mettre à séparer l’égotiste minutieux de l’admirateur prodigue. Car c’est toujours de l’un que nous allons à l’autre et cela sans cesse. Toute sa vie, Du Bos n’a passé son temps qu’à ça?: admirer, s’étudier.
Ce sont là des luxes qui nous semblent aujourd’hui d’un autre monde. Et en effet, Du Bos relevait bien d’un autre monde que la Seconde Guerre mondiale a rendu tout à fait impensable, dont la Première, déjà, avait sonné le glas. Fils de la haute bourgeoisie parisienne par son père qui avait été secrétaire d’ambassade sous Decazes jusqu’en 1877, éleveur de chevaux et membre de l’inaccessible Jockey Club, Du Bos était, au juste dire de son ami Ernst Robert Curtius, «?originaire de ce grand monde qui possédait par héritage la richesse et les relations?». Au surplus, d’une mère anglaise dont le père, Charles Edward Johnston était président de la Westminster Bank et grand homme de culture, Du Bos eut également accès à un univers très réservé qui le conduira à Oxford dès l’année 1900. Reçu vingt-trois ans plus tard au Pen Club de Londres, un vieux monsieur lui dira se souvenir d’avoir croisé son père dans le salon de la princesse de Sagan, qui figure dans À la recherche du temps perdu. Son mariage avec Juliette Siry, issue d’une famille également fortunée, qui possédait à La Celle-Saint-Cloud une demeure, La Petite Châtaigneraie, où il mourut, devait prolonger cet état de douce apesanteur luxueuse jusqu’à ce que les choses se compliquent financièrement, à partir de 1920. Mais ce qui se compliquait alors, ce n’était pas seulement la situation financière du couple Du Bos… Ce monde au sein duquel ils avaient jusque-là évolué, de réceptions en expositions, de thés en dîners multiples et que l’abbé Mugnier – qui les maria – a célébré dans son irremplaçable Journal, ce monde penchait lentement au désastre. Il s’apprêtait à disparaître. Il a disparu, il ne reviendra pas. Quelle nostalgie nous pousse à remuer ses cendres??
Nostalgie vraiment?? En un sens oui, car il y a une tristesse légitime à regretter une époque qui permit de telles gratuités, de telles vies aussi merveilleusement offertes et remplies. Il faut être bien malade maintenant pour passer un après-midi avec Proust. Malade, en «?vacances?», chômeur, enfin, il faut être quelque chose.
Jamais autant qu’aujourd’hui la phrase de Baudelaire «?J’ai grandi par le loisir?» n’aura paru aussi loin, inaudible, probablement scandaleuse. Cependant Du Bos n’eût été qu’un de ces esthètes cultivés dont la compagnie console agréablement des médiocrités du jour, l’envie d’écrire à son sujet ne se serait pas imposée.
Nous l’aurions gardé pour nous, léger bibelot dont c’est toutefois l’étrange destin de résister à tous les déménagements sans qu’on sache bien pourquoi. Ce ne serait pas si mal. Or quoiqu’il en ait eu, Du Bos ne fut pas cet esthète cultivé qu’on trouve parmi ses proches contemporains et amis, cette myriade exquise où croisent un Jean-Louis Vaudoyer, une Anna de Noailles, un Guy de Pourtalès – pour ne citer que quelques noms. Ou plutôt si, il le fut bien et même au-delà de tout ce que l’on pourrait imaginer. Mais précisément il y avait en lui quelque chose de supplémentaire, plus difficile à dire, strictement indissoluble à l’épreuve du «?rétro?», impossible surtout à oublier une fois qu’on a eu cette chance, dans sa vie de lecteur, d’ouvrir un jour tel volume du Journal, telle série des Approximations et qui alors soudain – non pas soudainement, mais au contraire très lentement – fait paraître Du Bos hors d’un milieu ambiant où il se trouvait mais où pourtant il n’était pas.
Trêve de faux mystère, allons plutôt droit au sujet et posons clairement la question?: qu’est-ce qui fait qu’un homme compte pour un autre, quels que soient par ailleurs l’état de sa fortune, de sa culture, de ses relations?? Trente-six mille raisons?? Non, une seule?: nous savons, de source sûre, que cet homme ne ment pas. Voilà, c’est très simple, tout le monde sait, au fond, de quoi il retourne. Vouloir «?préciser?», dans ce domaine, c’est déjà bifurquer, abandonner la partie en faisant mine de continuer à jouer. Nous savons fort bien que la vérité ne goûte guère aux «?précisions?».
Dieu sait, cependant, si Du Bos en a eu le goût, des «?précisions?». Et pourtant, il ne s’est pas menti, il n’a pas menti aux autres. Ses hésitations, ses précautions n’étaient pas des louvoiements mais des haltes rendues nécessaires sur un chemin où il lui semblait toujours manquer à la lucidité. La littérature française, qui n’a jamais fait défaut d’experts en la matière, nous a rompus de longue date aux vertus de la concision, du «?bref?» qui cingle au juste endroit, comme s’il fallait éviter que l’énergie de vérité ne soit tentée de s’arrêter en route, de perdre de son précieux venin. Soi-même est un complice trop redoutable pour qu’on lui prête sans extrêmes vigilances?: le Journal de Jules Renard, aux antipodes de Du Bos, est un parfait exemple de cette sévérité au rasoir qui sait qu’elle ne dispose pas d’autre palliatif pour se prémunir de la mauvaise foi. Renard se regarde dans le miroir, cherche l’angle, ajuste posément et tire?; même opération avec autrui. Sec, découpé, sans arrière-plan. «?Renard me fascine, écrit Du Bos, par la perfection même, la netteté, le bien-fondé de ses limites?: il est peut-être le seul écrivain chez qui le fait même de la limite revête une valeur artistique.?» (Journal, 1928.) Tout est découvert chez Renard et la notion d’une «?vie intérieure?» est un réservoir néfaste de complaisance. C’est un héritier de la grande tradition des moralistes français. Du Bos, de ce point de vue, est fort peu français.
Si sa connaissance des moralistes est réelle, de La Bruyère à Joubert ou Alain, les principes, les affinités qui gouvernent sa recherche de vérité empruntent à d’autres espaces, étrangers à la culture française. Il parle d’ailleurs très bien l’anglais et l’allemand… au point d’employer indifféremment l’une ou l’autre langue en pleine phrase?: le Journal est ainsi truffé de ces passages commencés en français et poursuivis en anglais. On le voit, dans une série étonnante d’entretiens sur Bérulle1, faire le tour de ses mondes, chercher à mi-chemin du «?sérieux sobre français?» (l’«?auteur qui, sans élever la voix, dépose tranquillement ses conclusions?») et de la «?sagesse pourpre shakespearienne?», le dessin de cette «?totalité de l’expérience humaine?» dont la littérature a la charge et que la seule sévérité ironique du moraliste ne suffit pas à remplir. Car si les «?tirs?» d’un Jules Renard font mouche, ils donnent en même temps l’impression que le tireur s’acharne à la visée d’une même cible, à restituer au plus exact les contours de sa cage, comme si de cette exactitude devait jaillir non pas une récompense – tout gain ici est synonyme de trahison – mais le sentiment d’une dignité propre, acquise au terme d’un travail honnêtement mené. «?Voilà comme je suis?», «?voilà comment sont les autres?»?: telle est l’arrière-pensée qui court tout au long du Journal de Renard. Une affaire de paysage au fond et Du Bos n’est pas un paysagiste?: ce qu’il veut, c’est pénétrer à l’intérieur. Ne pas s’en tenir à la reproduction ascétique des limites mais trouver à leur contact le moyen d’une plus grande «?entrée en matière?». Il y a quelque chose d’étriqué dans Renard où Du Bos voit la raison principale de son inaptitude à l’élément du tragique, cette «?auguste désolation?» de la solitude humaine qu’il reconnaît au contraire dans l’œuvre de Thomas Hardy.
Chacun, en somme, a sa manière de se débrouiller dans le dédale?; Du Bos avait la sienne. Certains, qui sont assez nombreux, pensent qu’on se trouve d’autant plus libre et plus vrai qu’on se montre capable d’exister par soi seul, sans allégeances, sans dettes à rendre. Du Bos pensait tout juste l’inverse. Certes, on est bien seul à emprunter le chemin mais il y a les rencontres que l’on y fait, ces moments précieux entre tous qui approvisionnent le marcheur, lui redonnent des forces, l’incitent à poursuivre. On pourrait dire qu’il y a chez Du Bos, en ce sens, une véritable éthique de la rencontre où la présence des «?grands morts?» joue son plein rôle?; non seulement des «?grands morts?» mais de tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, au fil des événements de l’existence, apporte à celui qui «?est sujet au sort de vivre?» la certitude que le «?tout est joué?», base minimale d’une lucidité digne de ce nom, ne constituant pas tant un point final qu’un point de départ. Il n’est que de relire, pour s’en convaincre, le discours1 que Du Bos prononce à la Sorbonne en 1926 en l’honneur de Thomas Mann, au sujet duquel il évoque le fameux Tonio Kröger?: «?C’est la rencontre qui en le comblant – et parce qu’elle le comble – l’illumine?: seul, livré à ses propres forces, non seulement il n’aurait jamais trouvé, mais il n’aurait pas su ce qu’il cherchait?; peut-être même n’eût-il pas deviné – autrement que par ces sourds malaises qui ne portent pas avec soi leur explication – qu’il fût en état de recherche. Bien loin de nous fausser, de nous induire en artifice, (…) l’art, j’entends celui en qui l’artiste a requis, obtenu, engagé l’homme tout entier, nous révèle à nous-même.?»
On n’est jamais perdant à reconnaître la supériorité du génie. N’était le côté quelque peu pingre et sourdement intéressé d’une telle affirmation, nous l’attribuerions volontiers à Du Bos en guise de maxime secrète. À ceci près que l’admiration, telle que Du Bos la pratiqua, c’est-à-dire scrupuleusement, sérieusement, ne pouvait s’épargner, comme on comptabilise, an par an, les fruits d’un placement. Il faudrait mieux dire?: car il y a bien dans l’admiration de la rentabilité, le processus d’un enrichissement et Du Bos ne l’a jamais refusé. Mais ce même désir qui veut ramener toujours à lui les trésors qui composent le «?panthéon?» cherche aussi à s’élargir?; rien n’est jamais immobile dans ce grand dépôt où sont rassemblés les œuvres?: tout y travaille, tout y est en constante et invisible ébullition. La bibliothèque dubosienne n’est pas celle d’un collectionneur mais un lieu où le rassemblement des œuvres, où la présence des génies invite celui qui se tient auprès d’eux à une essentielle participation. La rencontre des «?grands?», en même temps qu’elle enrichit, expose, «?engage l’homme tout entier?»?: ce qui est gagné ne l’est véritablement qu’à la condition de cet «?engagement?» qui dénude alors même qu’il fortifie.
Du Bos a tout demandé à ses admirations et elles le lui ont bien rendu. Ce n’est pas toujours reposant. Souvent trompeur. Lorsque Jean-Louis Vaudoyer lui recommande dans une lettre de bien faire attention à ce moment du spectacle d’Isadora Duncan où celle-ci lui semble évoquer irrésistiblement tel geste d’un personnage de Mantegna, on voit bien l’engrenage?: cette perpétuelle duplication du monde réel à travers les figures de l’art comporte fatalement le risque d’une saturation, d’un brusque retour à la case vide, au désert de la sensation. L’esthète, touchant alors la limite d’émotions qu’il croyait peut-être plus profondes, comprend qu’il «?doit pousser plus loin?» s’il veut échapper à cette étrange malédiction. C’est le moment dans le Journal de Du Bos
où il apparaît cruellement évident que l’accumulation
incessante des émotions, la fréquence des moments d’«?exaltation?» ne forme aucune épaisseur, n’autorise aucun acquis, seulement des illusions, des reflets. On croit vivre une vie intérieure, et on en vit une en effet, mais elle n’est pas ce qu’on croit. La vraie aventure de Du Bos commence avec ce besoin d’une autre profondeur, elle s’achève avec lui à sa mort. Entre les deux, quoi?? Quelques milliers de jours et de nuits passés, à lire, à écrire, à penser, à souffrir, à prier, bref à aimer. Une vie géographiquement peu aventureuse, dessinée au fil des ans de l’île Saint-Louis à Versailles et La Celle-Saint-Cloud. À la fin, il fallait gagner de l’argent?: le Collège de France?? Gilson proposait ses bons offices. Pour Du Bos, solitaire absolu, disposer d’une chaire eût été plus qu’un bouleversement. Il n’aura finalement d’autre choix pour s’en sortir que de partir aux États-Unis, dans l’Indiana, où une université religieuse voulut bien l’accueillir pour une série de leçons sur la littérature. Qui seront les dernières. Du Bos, très malade, ne pourra y effectuer qu’un court séjour avant de rentrer en France pour y mourir le 5?août 1939. Les conférences américaines sont recueillies dans un volume récemment réédité?: Qu’est-ce que la littérature?? (Éd. L’Âge d’Homme.)
On ouvre, on lit?: «?Lequel d’entre vous n’a pas frémi en entendant ce dernier cri de Shelley qui devait être brusquement interrompu par la mort, le dernier cri de son poème inachevé The triumph of life?: «?Then what is life?? I cried… » «?Mais alors qu’est-ce que la vie, m’écriai-je???» À cette poignante interrogation, la réponse pour Shelley devait être inscrite dans ce qu’il appelle ailleurs the amourous deep, l’«?amoureuse profondeur?»…
Il se peut que nous ayons quelque difficulté à entendre ceci, nous autres adeptes fébriles de l’éphémère, à qui l’accès de la profondeur semble pour l’heure strictement hors de portée. Or ouvrir Du Bos aujourd’hui, c’est peut-être d’abord cela?: être saisi par l’existence d’une profondeur qui n’est désormais plus qu’exceptionnellement perceptible, être témoin d’une aventure spirituelle hors catégorie. Non que cette dernière s’impose par une puissance qu’elle pourrait envier à d’autres, à un Claudel, à un Valéry, à un Proust. Et alors?? Dans la région secrète du cœur où se joue pour un homme la grande affaire de la vérité, il ne saurait y avoir d’équivalences?: on entre seul dans le dédale, on en sort seul. Avec ou sans Dieu. Pour Du Bos, ce fut les deux. Est-ce à dire que par son Journal nous atteignions au cœur?? Certes non. Qui pourrait le dire?? Mais nous passons une frontière. Un silence particulier, une gravité, une musique nous le disent. Et comment ne serions-nous pas sensibles à ces signaux, nous qui poussons la porte de tant de livres pour en ressortir aussitôt??
Les œuvres, pour autant, ne sont pas des temples. Et c’est pourquoi elles nous sont si précieuses. Quiconque frappe est reçu, sans condition. Que quelqu’un ait fait de sa vie, comme l’a fait Du Bos, le lieu même de son œuvre, nous la rend plus précieuse encore. Car au fond, il n’y a peut-être pas de spectacle plus bouleversant que celui d’un homme qui cherche un sens à sa vie devant d’autres hommes, ses lecteurs inconnus. Il arrive parfois que, chez ces derniers, une flamme se rallume qui ne demandait qu’à brûler. Mais alors, ce n’est plus d’un spectacle qu’il s’agit. Plus tout à fait?: car, si séparés que nous soyons, cette séparation devient le signe d’un partage, d’une fraternité secrète. Ces longues heures de pensées, ces exaltations intimes, cette inquiétude foncière, comme une pierre énorme et invisible, toute cette liasse enfin d’instants insaisissables confiés à la page du Journal, nous les reconnaissons?: bien qu’ils ne nous appartiennent pas, ce sont pourtant les nôtres. L’inaccessible souffrance d’autrui devient ce par quoi nous nous découvrons liés. Rien n’est résolu, rien n’est franchi, tout est changé. Rien n’est résolu car on ne saurait s’oublier par l’entremise magique d’un autre qui s’avancerait pour nous, à découvert?; rien n’est franchi car nulle œuvre, si haute soit-elle, ne délivre de la prison de chair où Pascal dit que «?nous sommes embarqués?»?; tout est changé cependant, parce que quelqu’un l’a dit, l’a écrit. C’est un signe qui passe, une lueur, une petite lampe derrière le carreau sous la grande nuit. À peine éclaire-t-elle la route obscure mais cela suffit, nous n’avions pas l’intention d’en réclamer davantage. Dans le beau livre sur celui qui fut son ami, Jean Mouton écrit «?qu’il n’y a pas de plus grande joie pour un être que de découvrir un jour sa vraie condition1?». Charles Du Bos a connu cette joie et il lui a été fidèle jusqu’au bout. À vrai dire, il n’y en a pas d’autre. Mais quand on fait les comptes, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas si nombreux à l’aventure de cette fidélité. Il ne nous a pas paru inutile de le faire savoir. «?Parce que la vue de tels hommes fait du bien2.?»
Charles Du Bos aujourd’hui? Qui se souvient de son Journal, un des plus extraordinaires qui soient... De ses Approximations, preuves d’un critique hors pair? Derrière Du Bos (1882-1939), on devine la présence de tout ce qui a compté en littérature dans la première moitié de ce siècle: Proust, Hofmannsthal, Rilke, Claudel, Valéry et Gide. Européen de cœur, il a été l’ultime représentant d’une espèce disparue. Sa vie quotidienne s’est déroulée dans la familiarité des «grands» qui composent la bibliothèque. Mais il ne s’agit pas seulement de ranimer les souvenirs d’un temps révolu. Le Journal de Du Bos est d’abord, et cela d’une façon absolument singulière et inouïe, l’aventure d’un homme pour qui la littérature fut le lieu d’une expérience spirituelle sans équivalent.?Cet essai s’est donné pour tâche de la faire savoir. La réédition récente et intégrale de son Journal, aux Éditions Buchet-Chastel, et de ses Approximations, aux Éditions des Syrtes prouve un regain d’intérêt pour son œuvre.
Michel Crépu est rédacteur en chef de La Revue des Deux Mondes. Romancier (Quartier général) et essayiste (La Confusion des lettres), il a reçu le grand prix de l’Académie française en 1997 pour Le Tombeau de Bossuet paru chez Grasset. Il est également l’auteur d’un livre sur Sainte-Beuve. C’est actuellement l’un des critiques littéraires les plus fins.