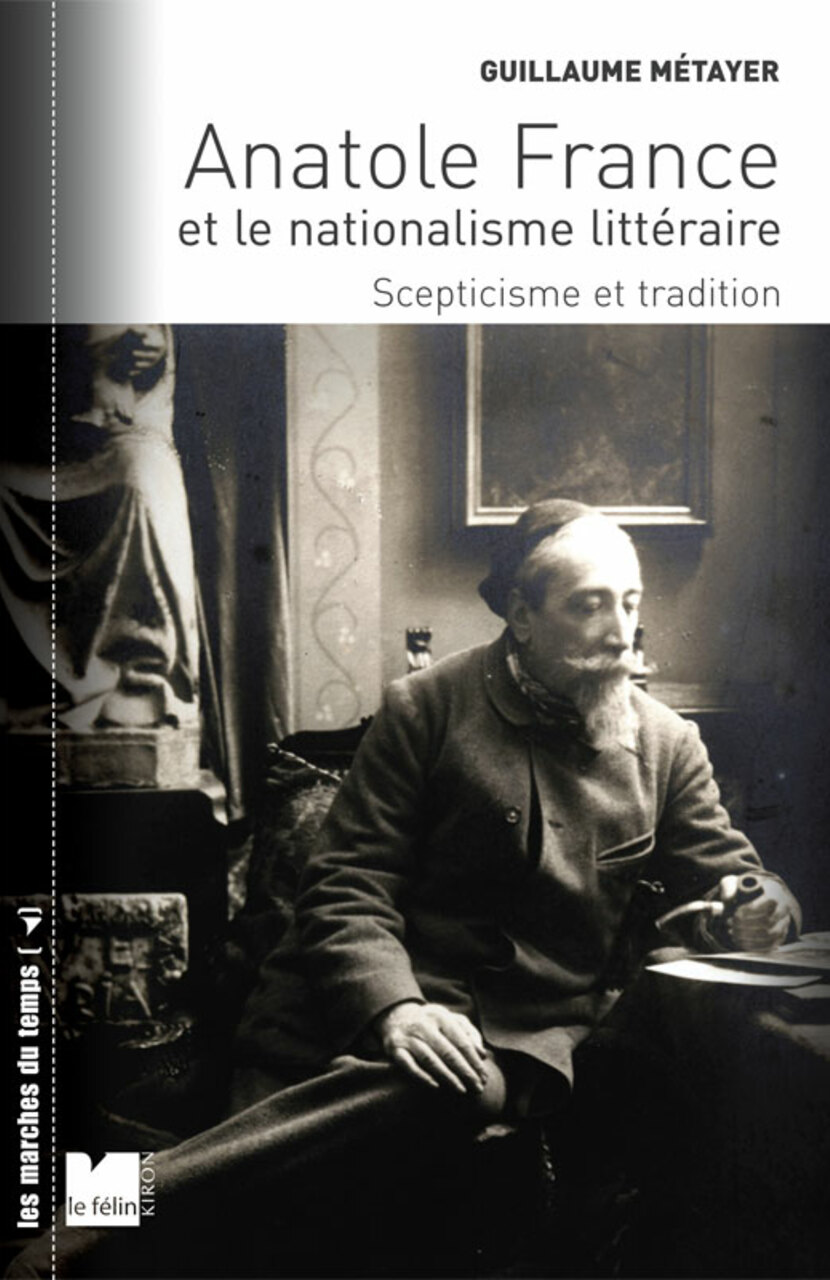
Anatole France et le nationalisme littéraire
Introduction
Ce livre s’enracine d’abord dans une curiosité.
Partout, chez les bouquinistes, ou dans les greniers familiaux, je voyais des livres d’Anatole France, aux titres plus énigmatiques les uns que les autres. Pas un seul de nos professeurs ne nous avait parlé des Dieux ont soif ou de L’Histoire contemporaine, encore moins de la Rôtisserie de la Reine Pédauque ou des Opinions de Jérôme Coignard.
La figure d’Anatole France léguée par les historiens ne présente rien non plus de bien distinctif parmi les autres Pères Fondateurs de la République qui ont une avenue dans chaque commune de France. Anatole France, – c’est peut-être un effet de son goût buissonnier de l’indépendance – n’a plus sa place dans notre panthéon.
Dilettante avant tout, il n’eut pas, comme Zola, l’opiniâtreté de la théorie et de la saga. Engagé en faveur de Dreyfus, il n’a pas écrit «J’accuse…», ni provoqué de procès retentissant. Sa mémoire n’a pas non plus la chance d’être maudite. Il ne s’est pas opposé à la République au nom des «quarante rois, qui, en mille ans, firent la France». Il n’a pas le charme sulfureux des anges déchus de l’histoire. Si son nom traîne ici ou là, c’est comme celui d’un invité obligé, nul ne sait plus pourquoi, sur le plan de table d’un dîner officiel.
L’histoire littéraire a horreur du vide. Quand elle ne connaît pas, elle devine, invente, volontiers substitue. L’imagination dessine, dans cette niche vide de l’hagiographie nationale, une figure redondante de l’histoire de la IIIe République, une statue barbue dont ni le nom ni le visage n’évoquent plus rien, ou presque, à personne. C’était sans doute, cet Anatole France, un écrivain médiocre pour cause de «bons sentiments» républicains, aussi louables qu’ennuyeux, dont chacun sait depuis Gide qu’ils ne font pas la «bonne littérature », tant l’enfer des écrivains est pavé d’opinions correctes. La République a beau être, de l’avis de tous aujourd’hui, le meilleur des régimes, quelque chose d’aristocratique dans l’ego littéraire des Français leur inspire toujours un peu de mépris pour les auteurs qui ont condescendu à la fonder ou simplement à la défendre.
Anatole France, pourtant, était allé plus loin. Il était devenu, à la fin de sa vie, socialiste. Même dans cette lumière rouge, ses traits n’apparaissent pas suffisamment distinctifs, ses couleurs pas assez criardes. On ne le voit pas – et pour cause – aux côtés de Louise Michel dans cette Commune qu’il détesta. Son visage pâlit par contraste, à côté du grand Jaurès, tribun de la plèbe et martyr de la paix, frappé en pleine action et en plein jour, par un Ravaillac cocardier, à la veille de la mobilisation générale et de la catastrophe mondiale. Il n’avait pas l’originalité ambiguë et profonde d’un Péguy, socialiste dans la thurne «Utopie» et patriote dévot immortalisé par la mitraille. La pensée de France s’efface aussi, falote, à côté des prédictions logiques d’un Lénine; il n’a pas, comme Blum, aperçu, de Tours, le Goulag. En un mot, Anatole France n’a pas davantage de place assignée ni de visage reconnaissable, malgré son engagement final, dans l’épopée socialiste que dans la légende républicaine.
Deuxième sur la «pétition des intellectuels» en faveur de Dreyfus, deuxième en tout en somme, en littérature, en républicanisme et en socialisme, Anatole France est voué à l’oubli que l’histoire réserve sans pitié à ceux qui sont deuxièmes à Rome, même quand cette Rome est le Paris de la «Belle Époque», si riche en talents. Voltaire lui-même, bon écrivain dans tous les genres, se serait peut-être évaporé de la même manière, s’il n’avait inventé, presque par hasard, le conte philosophique et pris la tête de la guerre contre «l’Infâme».
De cet oubli, rien ne semble pouvoir sauver France. Rien d’assez transgressif dans sa sensualité pour attirer une époque cent fois libérée comme la nôtre par Freud, puis par Marcuse, par Sade, puis par Bataille. Rien d’assez énergique, coloré, ou profondément philosophique pour rivaliser avec les déclivités digressives de Nietzsche son contemporain.
Rien de surréaliste non plus, bien au contraire : à peine disparu, le «cadavre» du Maître humaniste servit notoirement de bouc émissaire aux jeunes Breton, Aragon et Soupault, en mal de révolte et de gloire. Et puis, maître de Proust, celui-ci ne l’a-t-il pas éclipsé dans tous les domaines, la patience de l’œuvre totale et même «l’intelligence»? France n’est plus qu’une note de bas de page du Temps perdu, ce Bergotte bourgeois au suffixe mineur, dont, à vue de pays, le nom ne promet qu’un style effiloché, à force de repentirs subtils et d’inutiles repeints. Un nom qui rime avec ces «papillotes» en lesquelles France disait camoufler la «dynamite » de ses pensées…
Le communisme, longtemps si puissant dans les lettres françaises, conserva un temps le souvenir de son chantre tardif et paradoxal. Il fit effort pour garder mémoire de cette bénédiction que le «bon Maître» avait apposée à la «lueur à l’Est». Cette idéologie très structurée était alors intéressée à montrer dans la suite des grands esprits la logique d’une histoire des idées qui aboutissait implacablement à Maurice Thorez. Elle aurait eu tort de se priver du patronage d’Anatole France. Le grand-père bienveillant avait fini par sentir le frisson du «sens de l’histoire», par entrevoir et saluer, avant de mourir, ce qui ressemblait à l’avenir du monde. Il ne voulait pas reproduire l’erreur, qui l’amusait tant, de Ponce Pilate devant Jésus : et pourtant il eut l’orgueil de vouloir reconnaître, au sein du présent opaque, le germe de l’avenir. Hélas, bientôt l’adhésion au rêve socialiste ne suffit plus à sauver son souvenir, là où il aurait fallu montrer des lettres de noblesse en modernité esthétique, en goût de la rupture avec la tradition. France de ce côté n’avait rien à offrir. Et puis, le communisme s’épuisa, lui aussi.
Le dernier essai de relever la statue fut l’œuvre de Marie-Claire Bancquart, éditrice de France dans la «Bibliothèque de la Pléiade», auteur d’une biographie intellectuelle dans laquelle elle présente l’écrivain sous les traits d’Un Sceptique passionné. L’alliance de mots peut surprendre. Car au siècle de Hugo et des romantismes enflammés, France fut, à l’évidence, tout sauf un «passionné». Ce terme psychologique, qui décrit un entre-deux assez flou entre les domaines personnel et intellectuel, littéraire et politique n’appartient nullement, du reste, au vocabulaire de l’esthétique francienne et semble correspondre encore moins à sa pratique d’écrivain. S’il s’agit de prouver que France n’était ni un écrivain ni un être humain dépourvu de passions, l’évidence ne méritait pas démonstration. Personne n’eût pensé que le scepticisme signifiât l’absence de passions. Simplement, la présence d’impulsions irrationnelles n’est jamais le dernier mot du sceptique, surtout lorsque son esthétique obéit, comme celle de France, à des critères résolument classiques. France n’est pas un écrivain des passions, mais de leur équilibre et équilibrage sceptique, un spécialiste du renvoi dos-à-dos des opinions contraires, un amoureux de l’aporie, qui garde toujours foi dans la capacité de la raison à contrebalancer les tendances instinctives et émotives, à les modérer, à les maîtriser. Les valeurs qu’il professe tendent même, on le verra, à négliger, au sein de la trilogie classique, l’émotion («movere»), au bénéfice de l’instruction («docere») et du plaisir («delectare»).
La capacité que France admire le plus est sans doute celle, propre au scepticisme, qui consiste à observer un objet sous différents angles et, ainsi, à s’abstraire de cette forme d’intérêt à soi et de manque de recul sur soi qui caractérise précisément le caractère passionné. Le roman francien est, par excellence, le lieu de cet arrachement à la tyrannie de l’opinion personnelle, comme en témoignent les débats contradictoires entre l’abbé Lantaigne et M. Bergeret, moments de grâce du débat spéculatif, qui planent loin au-dessus des intérêts partisans et des enfermements passionnels. France est un disciple des sectes philosophiques classiques, qui visent à l’ataraxie : l’ombre d’un type oublié, le sage, hante sa critique et ses romans de moraliste. Son indulgence pour l’inconstance et son éloge de la sensualité sont autant d’esquives de la passion, que France, féru des doctrines psychologiques de son temps, décrit toujours avec le recul souriant de l’anatomiste.
La stratégie que Marie-Claire Bancquart jugea sans doute nécessaire dans les années quatre-vingt pour rehausser le profil d’Anatole France nous semble donc vouée à l’échec pour ne pas consentir à s’appuyer sur les véritables qualités de l’écrivain. France est un maître de la nuance (et non de la généralisation hâtive), de la délicatesse (et non de la brutalité), de la mesure, de la discrétion, de la tendresse (et non, certes, de «l’amour fou»). Si peu prisée que puisse être cette manière dans des temps où l’esthétique repose sur une plus grande appréciation de la violence du coloris, ce furent là ses choix et il est vain, nous semble-t-il, de vouloir maquiller un Prud’hon en un Delacroix.
Il ne sert à rien non plus de chercher à peindre Anatole France sous les traits unitaires d’un homme parfaitement et passionnément «de gauche», depuis toujours et par essence, pour la pure et simple raison que France ne le fut pas. Ce n’est pas la nature du scepticisme d’être unilatéral ni même univoque. France, en vrai sceptique, ne fut jamais, par définition, l’homme d’une foi politique entière, sans entorses ni ambivalences. À ce jeu, il ne peut pas rivaliser avec les vrais «passionnés» de l’action publique et de la cause du «peuple», les Jaurès et les Zola, dont les évolutions sont enfermées dans un territoire moins divers et moins vaste que les divagations et les curiosités du scepticisme francien. Peut-être parce que nous voulons être moins sûrs aujourd’hui de ce qui mérite d’être appelé Bien et Mal en politique comme en morale que ne l’étaient les sphères intellectuelles il y a trente ans, l’intérêt de son parcours nous semble plutôt résider, précisément, dans ses hésitations mêmes, ses circonvolutions, sa pondération, sans lesquelles, d’ailleurs, le retournement final de son scepticisme en engagement socialiste perdrait beaucoup de son intérêt. C’est dans ce cheminement personnel qu’il faut chercher précisément les traits distinctifs de son portrait.
Pour comprendre peut-être ces sinuosités, il est nécessaire d’attirer l’attention sur quelques détails que ce petit livre s’est efforcé de rassembler. De menus détails bibliographiques dans lesquels on veut croire que le diable se loge avec prédilection.
Dans la riche bibliographie francienne établie à la fin des quatre volumes de la Pléiade, il y a en effet un manque. C’est d’abord le choix de ne faire figurer, à part quelques rares exceptions, que des titres d’après 1945. Ce parti-pris est discutable parce qu’il se trouve justement qu’après 1945 un pan considérable des critiques les plus élogieux d’Anatole France s’est trouvé marginalisé, pour des raisons historiques bien compréhensibles. Ce sont tous les auteurs qui ressortissent, de près ou de loin, à ce que nous avons appelé ici le «nationalisme littéraire». Pas un seul de ses représentants n’est cité dans cette bibliographie : l’oubli, on va le voir, est de taille.
Par «nationalisme littéraire», nous entendons la mouvance de ces écrivains, critiques et publicistes qui, à partir de la Défaite de 1870 et jusqu’à la Grande Guerre et même après elle, ont, chaque jour davantage, cherché à mobiliser la fraction française de la République des Lettres dans la grande cause nationale de la Revanche. Ce sont des réactionnaires, des antidreyfusards, des adversaires, le plus souvent, du régime républicain. Leur mobilisation des forces intellectuelles, morales et littéraires de la nation est une figure de «l’engagement des intellectuels» qui a caractérisé la vie publique du temps.
Cette mouvance, chacun le sait, a été extrêmement active et influente tout au long de la IIIe République. Il eût été étrange qu’elle n’eût pas exprimé d’opinion sur l’œuvre et la pensée d’Anatole France, unanimement célébré alors, jusqu’au prix Nobel, comme le plus grand écrivain français de son temps. Notre thèse est la suivante: c’est dans cette réception nationaliste d’Anatole France que se cache sans doute l’un des puissants mobiles de l’oubli dont l’écrivain a été la victime depuis des décennies. Car nous savons bien que nous ne recevons pas un écrivain vierge des lectures successives dont il a été l’objet et dont les strates, conscientes ou inconscientes, dessinent peu à peu les traits sous lesquels il nous apparaît. Ne pas connaître sa «réception», c’est nous condamner à ne pas le connaître «tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change»; c’est n’en donner, pour ainsi dire, qu’un portrait hémiplégique ; c’est nous contraindre sans cesse à retrouver des évidences enfouies au lieu de vérités nouvelles. La lecture d’un écrivain ne se limite certainement pas à une construction articulée de ses réceptions, mais les connaître au lieu de les refouler offre à nos interprétations la chance d’échapper au pur et simple ressassement.
Or, l’analyse de la littérature publiée sur France nous montre que les critiques réactionnaires n’ont pas vraiment agoni d’injures, comme ils l’ont fait pour Jaurès ou Zola, ce Père Fondateur de la République au visage dépourvu de signe particulier. Bien au contraire. La quantité d’articles et d’ouvrages que les publicistes de cette mouvance ont consacré à cette œuvre et surtout la qualité des plumes qui se sont adonnées à cet exercice d’admiration, sont étonnantes.
Qu’on en juge.
En 1883, à peine débarqué de Lorraine à Paris, le jeune Barrès, l’un des écrivains les plus doués de son temps, consacre à un Anatole France bientôt quadragénaire une étude nourrie, sagace et somptueusement élogieuse, accompagnée d’un fac-similé de quatrains autographes d’Anatole France. Publié d’abord en revue, ce premier titre de la Bibliographie barrésienne ouvre au jeune provincial les portes de la reconnaissance. France est depuis longtemps l’ami du grand critique Jules Lemaître, futur Président de la Ligue de la Patrie Française, dont il parle avec éloge dans ses pages critiques de La Vie littéraire. De son côté, Lemaître, dans ses Impressions de Théâtre et surtout ses études des Contemporains, que Nietzsche avait lues et annotées avec passion, avait eu besoin de trois articles pour parfaire l’éloge de son ami, auteur de livres qu’il aurait, dit-il, «aimé avoir faits». France fut aussi un ami de jeunesse de Paul Bourget, le psychologue réactionnaire de la «décadence», qui se souvint toujours avec émotion et admiration, par-delà les divergences politiques apportées par le temps, de son brillant aîné. Un autre lien, vraiment intime, a uni, des années durant, Anatole France et la comtesse de Martel, plus connue sous le nom de Gyp, romancière nationaliste à succès et passionaria d’un antisémitisme terrible, plus efficace, au dire même de Maurras, que l’ensemble des publicistes qu’il chaperonnait et stimulait.
Charles Maurras lui-même, justement, le mentor de l’Action française et le maître spirituel du nationalisme intégral, fut longtemps l’ami et le disciple d’Anatole France, qui avait lancé sa carrière. Son admiration entraîna bien des critiques du nationalisme littéraire à s’intéresser à l’œuvre francienne et à y chercher, derrière les apparences de l’engagement à gauche, des formes et des figures du redressement rêvé. Autour de l’année 1924, jubilé des quatre-vingts ans d’Anatole France (qui fut aussi l’année de sa mort), de nombreux ouvrages et articles nationalistes emboîtent le pas de l’hommage que Maurras consacre à Anatole France politique et poète et prennent la peine de sonder l’œuvre complexe de l’adversaire politique qui inspira leur maître. Paraît ainsi, sous la plume de Gonzague Truc, critique réactionnaire, un long ouvrage à la gloire d’Anatole France. Un an avant, le maurrassien prosélyte Henri Massis, futur auteur de Défense de l’Occident, avait, lui aussi, brossé, dans ses Jugements, un portrait intellectuel et littéraire du même Anatole France, aux côtés de Barrès et de Renan : une place de choix, même s’il ose y mitiger, au nom du christianisme, l’admiration de son maître Mauras. Un an plus tard enfin, le fils d’Henry Roujon, ami de Mallarmé et de France, publie, pièces inédites à l’appui, une longue monographie provocatrice qui célèbre en Anatole France «l’homme le plus réactionnaire du monde». Il n’a pas jusqu’à Gabriel Syveton, historien, spécialiste de Voltaire et de Charles XII, grande figure de la Ligue de la Patrie française surtout célèbre pour avoir giflé le ministre de la Guerre en pleine Chambre pendant l’Affaire des Fiches ainsi que pour sa mort mystérieuse, qui ne paie son tribut d’éloges et ne tente son interprétation de l’évolution de France «de l’ironie conservatrice au mysticisme révolutionnaire».
Le dossier est étonnamment riche et l’on comprend mieux la chute d’une œuvre portée par un consensus étrange que l’histoire a rendu infâmant et finalement funeste à la gloire de l’écrivain.
Le personnage falot en deviendrait-il soudain excessivement suspect ? Disons que France, comme Victor Hugo, a suivi l’évolution du siècle, qui conduit de la droite à la gauche, un clinamen alors banal. Sur cette énigme de l’évolution d’Anatole France, nombre d’auteurs se sont interrogés. Nous avons cherché à y apporter un élément de réponse en présentant au lecteur contemporain quelques pièces de ce dossier oublié et, à notre avis, passionnant, car il montre de quelles ambiguïtés politiques a pu être tissée la plus grande gloire littéraire de la Troisième République.
Ce personnage en apparence si fade était assez complexe pour qu’aient pu communier autour de lui, non seulement le nationalisme réactionnaire («le tapir Maurras») et l’internationalisme communiste («Moscou la gâteuse») comme l’écrivaient les surréalistes en 1924, mais aussi le radicalisme républicain et le socialisme démocratique, presque tous les courants politiques, à l’exception notable, nous y reviendrons largement, de ceux qu’inspire d’abord la fidélité à l’Église.
Comment comprendre ces faveurs contradictoires?
Sans doute faut-il voir, dans cette unanimité vite brisée par l’histoire, le signe d’un consensus intellectuel de la «Belle Époque» sur une certaine forme d’humanisme, tandis que l’oubli d’Anatole France dénonce le mépris instinctif et tout aussi consensuel qu’inspire par la suite cet humanisme même. Ce consensus est aussi le symptôme d’une société française bouleversée par la Défaite nationale de 1870 et inquiétée par les hoquets de la Révolution dans la politique et dans les arts. À droite comme à gauche, elle cherche une survie symbolique de son humanisme à la fois national et universel dans une littérature néo-classique, une prose rationnelle et éclairée, héritière sans excès de l’ironie des Lumières. Anatole France par son œuvre et par son nom même apparaît alors comme le miroir transitionnel de cette survie de la France, le prodige d’un «lieu de mémoire» vivant, capable de concentrer et de cristalliser à lui seul un la plupart des «lieux» topiques de la France littéraire et politique : «la Coupole», l’art de la conversation, la visite au maître, la langue française, l’Affaire Dreyfus. Une fois l’enchantement éventé, ces figures pérennes reprennent leur place dont Anatole France n’aura su capter qu’un temps les prestiges à son profit.
Ce miracle de la survie, France le réalise aussi d’une autre manière, aux yeux de ses contemporains : en réussissant à se montrer créatif et même naïf, malgré toute sa science et toute sa culture, en cette période qui se définit elle-même sans cesse comme «l’ère de la critique»; en montrant à toute une génération hantée par son propre alexandrinisme et sa «décadence» vitale, le chemin d’une littérature savante certes, mais vivante et ironique avec fraîcheur. Par un charme qui n’opère peut-être plus complètement aujourd’hui, France paraît alors capable de prolonger l’héritage de siècles de prose intellectuelle française, la tradition même des classiques et des moralistes au sein d’une époque hantée par sa stérilité d’épigone.
En somme, les écrivains nationalistes, et tous ceux qui au moins partiellement partagent leur inquiétude sur le devenir de la civilisation, savent gré à France d’avoir donné deux grandes directions à la littérature et à la pensée françaises. D’une part, il a su opposer une éthique et une esthétique de la continuité et de la tradition au mythe révolutionnaire de la rupture qui travaille de secousses chroniques la vie politique, intellectuelle et littéraire du pays depuis 1789. D’autre part, il a eu le courage de mener jusqu’au doute sur lui-même l’esprit d’examen des Lumières. Par là, il semble avoir indiqué un chemin à une réaction qui se voulait à la fois héritière et ennemie des «philosophes», dans un pays où leur marque est alors la plus forte en Europe. Si forte même qu’elle inspire les deux côtés de l’échiquier idéologique et façonne jusqu’à l’esprit de ses adversaires traditionnels.
Même si les premiers pas de notre enquête remontent déjà à 1993, le temps semble venu de porter au public ces recherches sur Anatole France, à un moment où l’on s’interroge sur Brunetière et retrouve Thibaudet, où l’on redécouvre Sainte-Beuve et Paul Bourget, où l’on commence à mieux connaître ce que Nietzsche, fondateur de la postmodernité philosophique a puisé, n’en déplaise à ses disciples retournés de la French theory, dans les critiques français de cette époque et tout ce qu’il partage avec eux (Faguet, Maulnier, Lasserre s’en étaient aperçus), à un moment où un retour d’intérêt se fait sentir dans l’histoire littéraire pour la «critique de droite», pour Maurras même malgré l’indignité nationale et pour toute une période où, après la condamnation légitime, peut intervenir, sans complaisance pourtant ni compromis surtout, l’exigence francienne de «d’abord comprendre» et le regard ferme, et factuel, de l’historien.
En réalité, passer Anatole France au crible de sa réception par les tenants littéraires du nationalisme français permet de mieux comprendre la valeur, la portée et le sens de son engagement à gauche. Elle révèle ce que recouvre de réflexion et de courage personnel (il fut le seul Académicien dreyfusard), d’attachement réel à la justice, à la vérité et à la liberté et d’authentique amour du peuple, le fait de devenir un républicain socialiste lorsque l’on a été élevé dans l’atmosphère et les valeurs de cette Défaite qui donnait tant de puissance et d’ascendant aux idées de la réaction. Elle montre l’honnêteté intellectuelle d’un écrivain qui, loin de recevoir le programme tout fait d’un engagement réflexe, cherche à se rendre compte des choses à lui-même et inscrit ainsi ses choix dans l’essentiel : le libre exercice du jugement.
L’étude de cette lecture nationaliste de France et l’analyse des convergences réelles ou apparentes de l’écrivain avec certains de ses thèmes et de ses formes met en lumière le débat entre scepticisme et tradition qui anime la France littéraire de la Belle Époque, les questionnements liés à l’héritage de la civilisation des Lumières et, plus généralement les hésitations de l’humanisme d’alors à se fixer du côté des défenseurs de la nation, des prophètes du grand soir ou d’une République sceptique et libérale.
Cet ouvrage est une enquête sur un point aveugle de notre histoire littéraire, Anatole France, prix Nobel de littérature presque tombé dans l’oubli. Avant d’être l’une des plus grandes voix du dreyfusisme et un compagnon de route du socialisme, France a surtout été considéré comme l’écrivain français par excellence, capable de cristalliser et de fixer dans la littérature le prestige de la Nation, au long des décennies de doute culturel qui ont suivi la défaite de 1870. La réception enthousiaste d’Anatole France dans la mouvance du nationalisme français, Barrès et Maurras en tête, le confirme. Des tendances nostalgiques, une écriture et des idées néo-classiques, une posture sceptique face aux excès de la Révolution française donnent l’image d’un écrivain sinon de la tradition, du moins de l’« évolution », à distance du mythe révolutionnaire. France apparaît alors comme une sorte de « lieu de mémoire » vivant, capable de concentrer en lui nombre de « lieux de mémoire » nationaux (« la conversation », « la coupole », « la visite au maître »…). Il s’impose comme la figure transitionnelle d’une France inquiète, en quête de pérennité symbolique et le miroir littéraire d’une IIIe République avide de légitimité historique. Cet ouvrage, qui s’appuie sur une étude circonstanciée de la réception d’Anatole France dans le courant nationaliste, se veut aussi un parcours critique d’une œuvre qui marque un moment charnière dans les aventures de l’humanisme à la française.
Guillaume Métayer, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, est chercheur au Centre d’étude de la Langue et de la Littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles (CNRS, Paris IV). Il est également traducteur littéraire du hongrois.