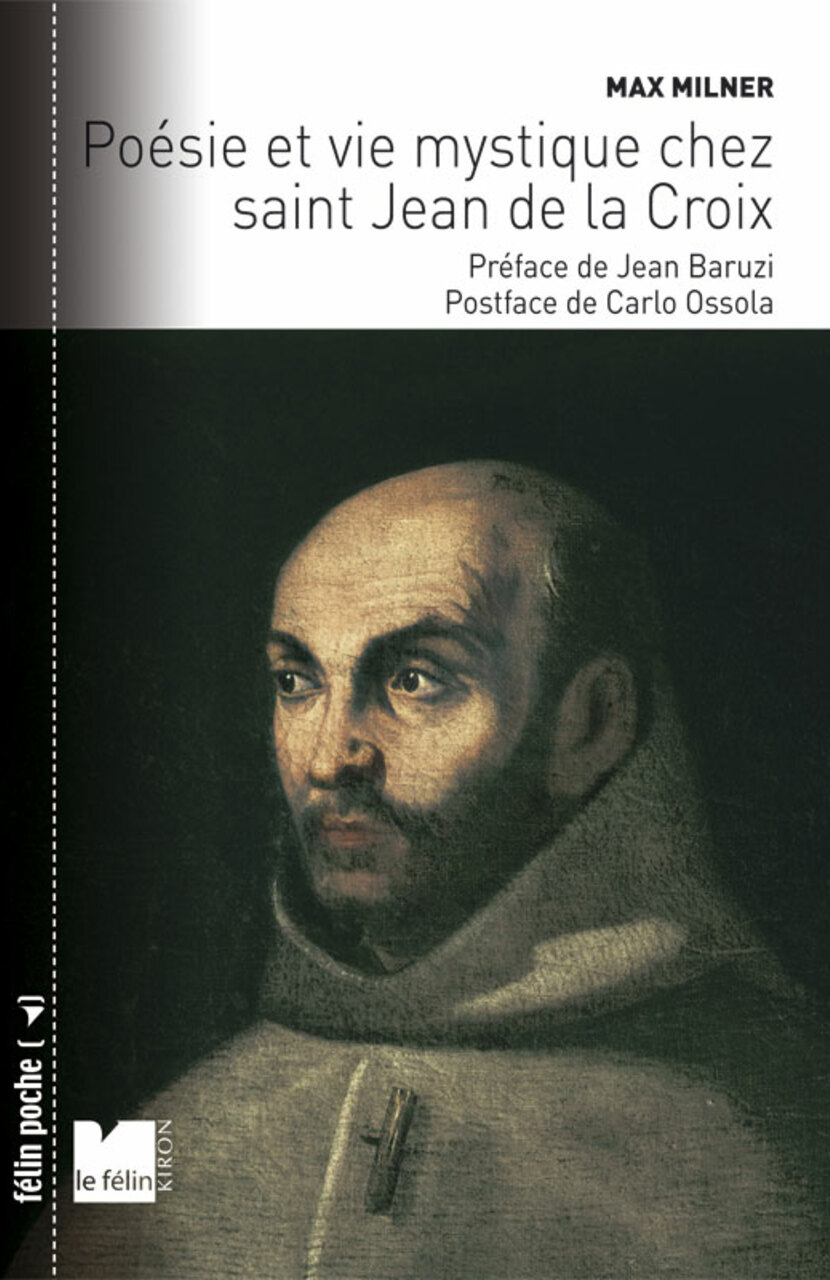
Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix
À prendre un premier contact avec l’œuvre poétique de saint Jean de la Croix, il apparaît que l’univers dans lequel il nous plonge n’a que peu de liens avec celui dans lequel les individus humains, naissant et mourant, agissant et souffrant, impriment la trace de leur passage. Sans cesse tendu vers un Dieu infini, et pratiquant pour cela l’oubli des choses créées, il ne nous a pas laissé dans ses vers ou dans sa prose de ces allusions précises ou de ces intimes confidences qui rendent indispensable et fécond le travail de biographe. Est-il bien nécessaire, dans ces conditions, de commencer une introduction aux poésies de saint Jean de la Croix par un récit de son existence? Et ne vaut-il pas mieux les regarder comme de purs joyaux engendrés du langage humain par je ne sais quelle divine semence?
S’il est vrai que bien des œuvres cessent d’être émouvantes dès que se laissent entrevoir les secrets trop humains de leur naissance, rien de tel n’est à redouter quand il s’agit du Cantique spirituel, de la Vive Flamme d’amour ou de la Nuit obscure. L’auréole de mystère qui les entoure ne sera jamais dissipée. Et le vertige qui nous saisit devant leur profonde beauté ne fera que croître lorsque nous aurons mesuré les dimensions humaines du petit moine à l’air souffreteux et doux qui fut l’instrument de ce chant surhumain.
De la vie de saint Jean de la Croix, dont il est si attachant de suivre pas à pas le déroulement, nous ne retiendrons d’ailleurs que les épisodes et les attitudes qui peuvent jeter quelque lumière sur les arcanes de son œuvre poétique et qui permettent de mieux comprendre dans quelle atmosphère et dans quel esprit elle fut élaborée.
Il ne nous est pas indifférent de savoir qu’il vint au monde dans le foyer modeste d’un tisserand. Celui-ci, Gonzalo de Yepes était d’ailleurs de famille noble, mais on raconte qu’une mésalliance l’avait obligé à s’établir dans la pauvreté. La rencontre, en ce petit villageois de Castille, d’un sang noble et d’un sang roturier, acquiert une signification presque symbolique lorsqu’on pense à ce mélange de grandeur et de simplicité terrienne qui est le fond du paysan espagnol et un des caractères les plus constants de la race.
Le lieu où naquit le petit Juan a aussi son importance. Fontiveros est au cœur de la Vieille Castille, entre Avila et Salamanque. Terre relativement fertile et unie, mais toute proche de ces paysages austères, bouleversés, dont Unamuno écrira1 : «C’est là que se dessécha et se durcit en moi ce noyau de l’âme, pour me maintenir celle-ci bien droite en face de Dieu.» Toute sa vie Juan de Yepes restera en face de son Créateur ce Castillan à l’âme dressée comme un cyprès. Les rudes paysages où se déroule son enfance ne sont peut-être pas étrangers à cette volonté constante de ne pas arrêter son regard ici-bas.
La très grande pauvreté dans laquelle il vécut, avec son frère Francisco et sa mère, devenue veuve, lui imposera d’ailleurs, dès son enfance, ce dépouillement qui devint plus tard une vocation et la clef de son ascension mystique. Elle l’obligera aussi à vivre dans un contact intime avec les choses, à connaître par le dedans un nombre remarquablement varié de techniques humaines. Son frère aîné rapporte qu’il s’exerça aux métiers de menuisier, de tailleur, de sculpteur sur bois et de peintre. Il lui restera de ces apprentissages des habitudes artisanales qui le pousseront à exprimer son émotion, dans certaines circonstances de sa vie par des sculptures ou des dessins. Nous verrons aussi que le «métier» n’est pas absent de ses poèmes. Ainsi l’expérience de la vie, dans ce qu’elle a d’enrichissant et de pénible, est antérieure chez lui à la réflexion et à l’étude, et plus tard, au moment de se choisir définitivement, ce n’est pas une conversion totale qui s’opérera en lui comme chez un François d’Assise, il ne fera qu’adopter par choix volontaire et en la poussant jusqu’à ses dernières limites une simplicité qu’il avait déjà connue.
Mais avant ce changement décisif, le jeune Juan de Yepes voit se modifier le cadre de son existence. Pressée par le besoin de gagner plus largement sa vie, sa mère, Catalina, quitte Fontiveros pour aller s’établir dans l’important centre de commerce qu’était alors Medina del Campo. De son calme village castillan, Juan de Yepes passe ainsi dans une ville sans cesse agitée par le va-et-vient des marchands. Il y voit vendre, pendant les quatre-vingt-dix jours que dure la plus longue foire, des soies de Valence et de Grenade, des cuirs de Cordoue, des toiles et des tapis de France ou de Hollande, et s’affairer autour de l’or des changeurs anglais, genevois, hollandais. Il voit des fortunes se bâtir en un jour, comme celle de ce marchand qui fait construire le grand hôpital de la ville. Il en voit d’autres s’écrouler en banqueroutes frauduleuses. Il saisit au vif les relations sociales dans ce qu’elles ont de plus âpre, et, au milieu des produits de l’ingéniosité humaine, l’activité de l’homme s’appliquant aux objets les plus profanes. Peut-être la vue de quelque denrée d’Amérique lui apporte-t-elle déjà une bouffée de ces « îles étrangères» qu’il évoquera dans son Cantique. Son horizon, borné par les «sierras» de Castille, s’élargit en tout cas immensément. Ce n’est pas sans en rien connaître qu’il décidera de renoncer au monde.
À Medina il entre aussi en contact avec l’univers des idées. Bien humblement, d’abord, parmi les «enfants de la Doctrine», puis, à cause de sa facilité pour les études, chez les Pères de la Compagnie de Jésus. Années décisives, sans doute, pour sa formation intellectuelle. Quiconque s’attache à retrouver en saint Jean de la Croix le poète et l’écrivain y recherchera les premières traces de cette culture profane si curieusement fondue à son chant sacré, et qui donne à celui-ci une large résonance humaine.
En effet, l’enseignement des Jésuites ne reste étranger à aucun des grands courants qui traversent, vers 1555, le monde intellectuel. Le P. Bonifacio, en particulier, dont les documents d’archives permettent d’affirmer qu’il fut le maître de saint Jean de la Croix, était un esprit très ouvert. Professeur de latin épris de sa tâche au point de refuser la prêtrise pour ne pas suspendre son enseignement, il dut communiquer à son élève le goût des «Lettres humaines» et ce souci de l’expression juste qui donnera fermeté et densité à la langue du futur Docteur de l’Église. Francisco de Yepes nous apprend que son frère, grâce à ses bonnes dispositions, «profita beaucoup en peu de temps». Le collège de Medina était encore dans sa première jeunesse. Les exercices de composition, de déclamation, de dispute dirigée, y étaient particulièrement en honneur. Le premier samedi de chaque mois se livrait une véritable joute philosophique ou littéraire entre les élèves. Parfois ceux-ci exécutaient une pièce de théâtre, mi-partie en latin, mi-partie en castillan, comme le «David et Absalon» qu’ils jouèrent en 1562.
Mais Juan de Yepes ne passait chez les Jésuites qu’une petite partie de ses journées. Pendant toute son adolescence il resta attaché au service d’un des principaux hôpitaux de Medina, où l’on soignait les maladies à pustules, et il lui arrivait de prendre sur ses nuits le temps nécessaire à l’étude: «notre mère contait que lorsqu’on venait le chercher au milieu de la nuit, on le trouvait étudiant au milieu des fagots». C’est ainsi que parle son frère Francisco. Son expérience humaine, élargie par le spectacle d’une ville très commerçante et prolongée au-delà de ses horizons par une culture humaniste, s’approfondit au contact des plus hideuses misères. Le jour où son bienfaiteur Alfonso Alvarez de Toledo lui proposera de devenir chapelain de l’hôpital, il refusera la perspective d’une vie trop facile.
En 1563, à l’âge de 21 ans, il prend l’habit de carme au Couvent de Santa Ana et, l’année suivante, il fait profession sous le nom de Juan de Santo Matía. Résolution conforme à la prudence du siècle, dans cette famille peu fortunée? La volonté de détachement qui lui impose ce choix s’affirme de façon claire lorsque le jeune religieux demande à vivre selon l’observance primitive de l’ordre, et lorsqu’il projette, un peu plus tard, de devenir chartreux. Ce fils de la Castille est bien possédé par cette insatisfaction essentielle qui jette les «conquistadores» sur les routes de l’Océan, comme leur frère Don Quichotte sur les chemins de son pays.
Mais le voyage de Juan de Santo Matía est intérieur. Pendant les années qu’il passe à Salamanque de 1564 à 1568, pour acquérir le diplôme de «teólogo», nous ignorons quelles sont ses découvertes, et comment il atteint cette intensité de vie spirituelle qui l’imposera à l’admiration de sainte Thérèse au moment de leur première rencontre. Du moins pouvons-nous déterminer certains éléments de sa formation intellectuelle, qui n’ont sans doute pas été sans influence sur l’élaboration – peut-être inconsciente – d’un univers poétique et d’une technique littéraire dont on ne retrouve de traces que beaucoup plus tard.
Avant d’aborder la théologie, un étudiant de Salamanque devait normalement, pendant trois ans, suivre le cours de la Faculté des Arts: grammaire, logique, philosophie naturelle, éthique, morale pratique, et, à titre facultatif, humanités gréco-latines, hébreu. Aucun document ne nous apprend si Juan de Santo Matía s’initia à toutes ces disciplines. Son œuvre, en tous cas, ne révèle aucune trace d’une connaissance du grec ou de l’hébreu. Mais on peut deviner quelle fut l’ambiance de ces années de découverte.
Le jeune religieux loge au collège carmélitain de la ville, où les maîtres de son ordre donnent certains cours. Le reste de l’enseignement est dispensé dans la célèbre université de l’«Athènes Castillane», bruyante de ses cinq mille étudiants. Il est confié à des maîtres aussi renommés que le Brocense, Fray Luis de León ou Mancio de Corpus Christi. Et il n’est pas impossible de discerner quels sont les grands courants intellectuels qui dominent à Salamanque à l’époque où Juan de Santo Matía entre en contact avec l’Alma Mater.
À partir de 1560 environ se livre une lutte très vive pour généraliser l’emploi du parler castillan, du «romance», à la place du latin. Les autorités universitaires résistent et font interdire les «guitarrillas et chants en romance». On imagine sans peine à quel parti allaient les sympathies de celui qui puisera si largement dans le répertoire de la poésie populaire et qui écrira tous ses traités en langue vulgaire, suivant d’ailleurs en cela l’exemple d’illustres prédécesseurs tels que Luis de Granada, Francisco de Osuna ou Bernardino de Laredo.
Mais la culture latine n’est pas méprisée pour autant, la chaire de rhétorique étant confiée au célèbre philologue «el Brocense», qui explique en 1567 le livre III des Métamorphoses d’Ovide et le De Narratione de Cicéron. Saint Jean de la Croix, il faut pourtant le reconnaître, bien qu’il n’ignore pas systématiquement les Romains, ne fera pas souvent appel à leur exemple. Et le surnom de «petit Sénèque» que sainte Thérèse lui donne à cause, sans doute, de ses lumineuses sentences, ne doit pas nous faire croire qu’elle le considérait comme un grand latiniste.
Quant aux études hébraïques et aux efforts que certains esprits audacieux tels que Fray Luis de León, Gaspar Grajal ou Martinez Cantalapiedra faisaient pour pénétrer directement l’Écriture sainte, il est peu probable que Juan de Santo Matía ait pu les ignorer. Le procès inquisitorial et l’emprisonnement, en 1572, de ces maîtres jugés trop hardis devait être la conclusion d’une lutte engagée de longue date et suivie avec intérêt par tous les étudiants. Mais quelques très rares rencontres1 entre des citations bibliques de saint Jean de la Croix et la traduction du Cantique des Cantiques en espagnol par F. Luis de León peuvent très bien être le fruit du hasard et ne sauraient nous autoriser à dire que Juan de Santo Matía avait lu cette traduction. En tous cas le jeune carme, s’il était fidèle à l’esprit de son ordre, devait désapprouver ceux qui se détachaient de la tradition scolastique.
En effet, durant ses trois années de «teologo», qui succédaient aux études d’«artista», l’étudiant carme ne faisait guère qu’approfondir la Somme et ses commentaires, qui sont alors à Salamanque plus à l’honneur que jamais.
C’est à leur contact qu’il acquiert cette armature extrêmement ferme de sa pensée, ces structures préétablies, dont Jean Baruzi regrette qu’elles aient limité l’expansion de sa recherche. Les commentateurs ecclésiastiques voient au contraire en elles un instrument libérateur: considérant les problèmes métaphysiques comme résolus, l’esprit peut s’appliquer tout entier à sa transformation en amour.
Y eut-il en dehors de l’enseignement officiel ou semi-officiel d’autres courants qui pénétrèrent à Salamanque? Il est bien naturel de se le figurer.
La place centrale qu’occupe l’idée de la Beauté dans l’œuvre de saint Jean de la Croix2 nous incite à penser qu’il n’a pas ignoré le platonisme et son esthétique de l’amour, telle que pouvaient la présenter un Castiglione dans son Cortegiano ou un Léon l’Hébreu dans ses Dialoghi di Amore, deux ouvrages qui avaient été traduits à l’époque en espagnol.
Enfin et surtout c’est à Salamanque que Juan de Santo Matía, selon toute vraisemblance, découvre les poètes italianisants de son siècle. La question de leur influence sur l’œuvre qui nous occupe est assez importante pour que nous nous réservions de l’examiner plus loin en détail1. Notons seulement ici que les églogues de Garcilaso, jointes en appendice à celles de son ami Boscán, ont déjà eu, en 1564, quatre éditions. Quelles que soient les influences qui se sont interposées par la suite, rien ne peut nous empêcher de penser que l’harmonie fluide du vers de Garcilaso et la limpidité de son rêve bucolique révélèrent au jeune étudiant tout un monde poétique rétabli par l’art dans un état de pureté et d’innocence; lorsqu’il éprouvera plus tard le besoin de donner un cadre matériel à sa quête amoureuse de Dieu, c’est tout naturellement vers cet univers épuré qu’il se tournera.
Un autre poète pouvait d’ailleurs, dès l’époque de Salamanque, lui donner l’idée d’utiliser une poésie tout imprégnée de culture antique pour exprimer les plus hautes aspirations de l’âme: ce même Fray Luis de León que nous avons déjà rencontré. Pendant qu’il enseigne à Salamanque précisément entre 1561 et l572, il compose des poésies, dont certaines, telle l’ode A Salinas ou A la vida del cielo obéissent nettement à des aspirations mystiques. Les copies manuscrites des œuvres du maître circulaient parmi les étudiants et il est fort possible que Juan de Santo Matía en ait eu entre les mains.
Sans doute fit-il à Salamanque bien d’autres lectures. Mais il est impossible d’en parler avec la moindre certitude. Dans l’ensemble de ses traités, on dirait qu’il évite de se référer explicitement à toute tradition mystique un peu rare. Est-ce là prudence nécessaire à une époque où l’accusation d’illuminisme menaçait tout auteur spirituel qui essayait de dépasser ou d’approfondir une tradition rigide et pourtant difficile à délimiter? Dans le catalogue de l’Index qui paraît en 1559, Juan de Avila, Francisco de Osuna, Luis de Granada, Francisco de Borja, la traduction espagnole de Tauler, Denys le Chartreux, Henry de Herp ne sont pas épargnés. Il valait mieux dans ces conditions, pour rester en paix avec le Saint-Office, éviter toute référence explicite et même tout emprunt de vocabulaire à des auteurs dont il n’était pas sûr qu’ils seraient toujours tenus pour orthodoxes. Mais en réduisant ainsi au minimum le nombre des autorités sur lesquelles il s’appuie, saint Jean de la Croix suit peut-être simplement la pente d’un génie dont il semble qu’un des traits dominants ait été une singulière faculté d’assimilation. Il est donc légitime de supposer que ses lectures furent plus nombreuses que ses références ne semblent l’indiquer; et c’est dans les années passées à Salamanque1 qu’il doit les avoir faites. Plus tard il ne lisait guère, au dire de plusieurs témoins, que la Bible «qu’il savait par cœur presque tout entière», saint Augustin, et le Flos Sanctorum.
Tout ce faisceau de faits établis et d’hypothèses, nous l’avons dit, ne nous permet de pénétrer que très imparfaitement dans l’évolution intérieure de Juan de Santo Matía. En 1567, une année avant de quitter définitivement Salamanque, il rencontre Thérèse de Jésus et lui confie son intention de se faire chartreux. Reconnaissant en lui l’instrument désigné par la Providence pour réformer le Carmel, elle le détourne de son projet et lui dévoile ce qu’elle attend de lui. «Il me donna sa parole, écrit la sainte, à condition qu’il n’eût pas à attendre longtemps1.»
On se prend à rêver sur cette rencontre, au sujet de laquelle nous avons si peu de détails. Entrevue poignante, sans doute, que celle au cours de laquelle la fondatrice de cinquante-deux ans, jouissant déjà de façon ordinaire des faveurs mystiques les plus hautes, découvre dans les yeux de l’étudiant de vingt-cinq ans cette flamme qu’elle a cherchée en vain chez des religieux plus âgés tels qu’Antonio de Heredia. Nous savons qu’elle apprécia d’emblée la perfection de sa vie et la profondeur de son intelligence, impression qui ne fera que se renforcer par la suite, quelle que soit la différence de leurs tempéraments2. Mais elle ne nous a laissé à son sujet aucun de ces portraits rapides et pénétrants, tant au physique qu’au moral, qu’elle ne se fait pas faute d’esquisser chaque fois qu’elle rencontre un personnage marquant. Plus tard, si elle partage avec Jean de la Croix le secret d’une expérience mystique que lui seul peut comprendre, il semble qu’elle ait eu, sur le plan humain, plus d’abandon avec un Jerónimo Gracián, esprit plus préoccupé de réalisations matérielles, qu’elle domine mieux et qui se prête docilement à cette emprise.
Juan de Santo Matía s’est maintenant donné tout entier à la réforme de son ordre, qu’il s’agit de rétablir dans son austérité primitive et dans sa destination proprement contemplative. Il a voulu, pour souligner ce changement d’orientation de sa vie, que la Croix fût présente jusque dans son nom. Il s’appellera désormais Juan de la Cruz.
De l’évolution de sa pensée, du progrès de ses états intérieurs, nous ne pouvons rien dire. Sans doute les paysages qu’il traverse et au milieu desquels ses fondations de couvents l’appellent à vivre n’ont-ils pas été sans laisser au fond de lui-même certaines images qui entreront comme éléments dans ses poèmes, où elles se rencontreront et se combineront avec des souvenirs livresques: douce et calme solitude de Duruelo, en contraste avec l’âpreté environnante du plateau de Castille; vertu bienfaisante de la fontaine «qui sourd et coule». Jean de la Croix a transformé en maison de prière une masure de paysan, où il vit avec deux Pères. On songe devant cette simplicité pastorale à la Thébaïde, ou bien, comme sainte Thérèse, à l’étable de Bethléem. Puis Mancera, Pastrana. Un bref séjour dans le milieu universitaire d’Alcalá de Henares. Enfin Avila, la sévère cité castillane couronnée de tours, étalée sur un plateau stérile, à laquelle Jean de la Croix sera arraché une nuit de décembre, par les Carmes mitigés. C’est le réformateur de l’Ordre, le contempteur de la hiérarchie – disent-ils – qu’ils veulent paralyser en l’enfermant dans leur monastère de Tolède.
Arrêtons-nous dans le sombre cachot où Jean de la Croix va passer les neuf mois les plus déchirants de sa vie. C’est dans cette obscurité et au plus profond de cette détresse que se noue l’inépuisable chant.
Autour de lui un réduit de six pieds de large sur dix de long, servant ordinairement de débarras, où le jour ne pénètre que par une minuscule lucarne, trop haut placée pour qu’il soit possible de lire. Au-delà des murs épais, Tolède, ville de passion et de colère escaladant le ciel, «un cri dans le désert», dira Maurice Barrès. Cette même Tolède où le Greco dans une maison qui domine un peu la ville, invente une humanité qui ne pèse pas sur terre et fait monter vers le ciel la prière de ses corps étirés. Au pied du couvent, dans une gorge profonde, le Tage passe en grondant sous l’arche du pont d’Alcántara.
Tous les soirs on amène le prisonnier au réfectoire, et là, après avoir pris à terre du pain et de l’eau, il doit subir torse nu les coups et les injures de ses frères. «Lime sourde», lui crient ceux que son silence exaspère. Rentré dans sa prison, il doit encore essuyer les assauts de ceux qui veulent lui arracher une rétractation, lui promettant la liberté et des avantages matériels. Point de nouvelles de ses amis, à qui il a lié son destin. Eux-mêmes ignorent où il se trouve et leurs démarches pour le sauver demeurent mystérieusement vaines. «Je ne sais quel sort fait qu’il n’y ait jamais personne qui se souvienne de ce saint», écrit Thérèse de Jésus. Et chaque fois qu’on lui apporte sa nourriture dans sa prison, il croit sentir peser sur lui une menace de mort.
Délaissé par les hommes, trouva-t-il au moins dans les faveurs divines une consolation à ses souffrances? Bien rarement, répondra-t-il à Marie de Jésus, quand elle lui posera cette question: «Tout souffrait, âme et corps1.» Mais voici le grand secret qu’il confie à la mère Ana de san Alberto: «ma fille Anne, une seule grâce parmi celles que Dieu me fit là-bas ne se peut payer par de nombreuses années de prison». Et le souvenir de ces grâces est assez puissant pour faire jaillir les vers libérateurs du Cantique spirituel et de la Nuit obscure. Dans ce paradoxe se trouve incluse toute la doctrine du saint. Par la privation de toute jouissance, par la mortification du moindre appétit, par l’abandon total où le tiennent les hommes, et Dieu lui-même, le laissant à la merci des attaques du démon, il est arrivé à se conformer au Christ jusqu’au «Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné» du Vendredi saint. Il est alors entièrement libre. Plus rien ne s’oppose à ce que Dieu se saisisse de lui et à ce que la vive flamme d’amour le consume. Et il peut s’écrier en toute vérité, quoique muré de partout,
«Dans une nuit obscure… je suis sortie…»
… « Ô nuit qui conduisis,
nuit plus aimable que l’aurore,
ô nuit qui réunis
l’Aimé et l’Aimée,
l’Aimée en l’Aimé transformée.»
Et malgré les murs épais les images du monde sensible affluent, mais épurées, rajeunies, toutes «revêtues du regard de Dieu».
«Mon Aimé les montagnes,
les vallons solitaires, ombreux,
les îles lointaines,
les fleuves tumultueux,
le sifflement des vents amoureux.»
Dans la prison de Tolède, Jean de la Croix a composé les 30 premières strophes du Cantique spirituel, la poésie:
Que bien sé yo la fonte que mana y corre
aunque es de noche
et vraisemblablement les strophes de la Nuit obscure.
Il porte ces vers en lui (peut-être même les a-t-il déjà transcrits) lorsqu’il s’échappe miraculeusement de sa cellule peu après le 15 août 1578, et lorsqu’il arrive, à bout de forces, chez les carmélites de Tolède, auxquelles il demande de le cacher. Après Vêpres, racontant à ses sœurs ses souffrances et sa prison, il leur récitera quelques-uns de ces vers, dont deux novices, Isabelle de Jésus-Marie et Constance de la Croix, prendront copie. C’est au rythme des mêmes «Canciones» que peu de temps après les moniales de Beas vont entreprendre leur ascension spirituelle.
De la «solitude» du Calvario, aux confins de l’Andalousie, où il a été envoyé, Jean de la Croix va diriger les âmes ardentes de cette petite communauté. Celles-ci manifesteront un grand désir de le voir continuer le Cantique spirituel, qu’il n’a pas achevé et elles demanderont des éclaircissements sur les symboles déconcertants qu’elles y découvrent. «Et quant aux explications, il en fit quelques-unes à Beas, répondant aux questions que lui posaient les Religieuses1 », nous dit l’une de ces dernières. C’est ainsi, semble-t-il, que s’édifient ces commentaires, dont l’ingéniosité et le didactisme peuvent choquer les purs artistes, mais qui restent le témoignage d’un travail très émouvant: le poète reprend son chant vers par vers et s’efforce, par charité, de le faire servir au bien immédiat des âmes dont il a la charge. Les traités de la Montée du mont Carmel et de la Nuit obscure, entrepris peut-être à la même époque, et plus indépendants du texte poétique, obéissent aux mêmes préoccupations.
Il importe de bien connaître ce point pour ne pas se méprendre sur le sens d’une telle démarche. Si Jean de la Croix, désormais, revient sur ses poèmes, les charge de commentaires dont la minutie nous fait parfois sourire et brise le charme incertain des images, ce n’est pas par complaisance pour ses propres créations, ni par simple jeu intellectuel, pour donner libre cours à une virtuosité d’exégète qui côtoie la préciosité. Le souci, beaucoup plus noble, qui l’anime, est celui qui s’exprime dans le prologue de la Montée du mont Carmel.
«C’est une chose digne de compassion de voir beaucoup d’âmes, auxquelles Dieu donne du talent et des grâces pour passer plus avant (qui, avec du courage, parviendraient à ce haut état) demeurer néanmoins dans une façon basse de traiter avec Dieu, faute de vouloir ou de savoir, ou faute d’être acheminées et instruites à se détacher de ces principes.»
C’est sur cette charité vraiment apostolique qu’il faut insister si l’on veut se représenter l’atmosphère dans laquelle furent composées les dix dernières strophes du Cantique spirituel, la Vive Flamme d’amour, nombre des poèmes qu’on appelle ordinairement secondaires, et tout ce que le saint du Carmel écrivit en prose. Rien ne serait plus faux, en effet, que de se représenter saint Jean de la Croix comme un poète égoïste uniquement préoccupé de cultiver son extase et ce «jeu du seul», dont parle P. de la Tour du Pin.
À Beas, à Grenade, il aura à diriger des âmes d’élite: une Anne de Jésus, que beaucoup de contemporains osaient égaler à sainte Thérèse et à la demande de qui il achève le Cantique spirituel ; Françoise de la Mère de Dieu, qui, à vingt ans, lui inspire les cinq dernières strophes du même Cantique. Et combien d’autres! Beatriz de San Miguel, qui fut ravie d’extase le jour de sa profession, Catalina de San Alberto, dont Jean de la Croix devait dire: «Si vous connaissiez le trésor que vous possédez en elle, vous baiseriez la trace de ses pas.»
Dans l’atmosphère intellectuelle de Baeza, où il dirige à partir de juin 1579 le collège carmélitain, il se sent comme exilé et il écrit à sa fille spirituelle Catherine de Jésus ces lignes déchirantes:
«Bien que je ne sache où vous êtes, je veux vous écrire ces lignes, en me disant que notre Mère vous les enverra si vous ne voyagez pas avec elle; consolez-vous avec moi, qui suis encore plus exilé et plus seul ici. Depuis que cette baleine m’avala et me vomit en ce port étranger1, jamais plus je ne méritai de la voir, elle et les saints qui sont là-bas. Dieu fit bien ainsi, puisqu’enfin le délaissement est une lime et que grande lumière se prépare en la souffrance des ténèbres2.»
Cette souffrance s’accentuera dans les dernières années de sa vie. Après la mort de Thérèse de Jésus, en 1582, tous ceux qui cherchent à sauver son œuvre et à maintenir dans le Carmel la primauté de la contemplation auront à subir une persécution tantôt couverte, tantôt déclarée. L’austère et inhumain Nicolas Doria, cet ancien banquier de Philippe II, nommé provincial en 1585, mènera une lutte sourde contre le défenseur opiniâtre et doux de l’esprit thérésien, jusqu’au moment où, en mai 1591, il arrivera à le dépouiller de toute charge et de toute dignité, lui donnant l’ordre de se retirer au désert de La Peñuela.
Jusqu’à la fin, jusqu’à son agonie au Carmel d’Ubeda, la souffrance restera inscrite dans sa vie. La jambe dévorée par un mal qui lui met à nu l’os du tibia, en butte aux avanies d’un prieur qui se venge d’anciennes remontrances, il remplit au pied de la lettre le programme qu’il fixait à Ana de Peñalosa, «Rien, rien, rien, jusqu’à laisser sa peau et le reste pour le Christ». Et le rayonnement qui l’accompagne dans tous les milieux qu’il traverse, quelles que soient les passions qui les déchirent, est une constante vérification de cette autre parole: «Là où il n’y a pas d’amour, mettez l’amour et vous extrairez l’amour.»
L’œuvre de saint Jean de la Croix, presque toute composée pendant ces treize dernières années de sa vie, révèle un tel sentiment de la nature qu’on cherche dans les lieux où il a vécu certains caractères de ce paysage tantôt abrupt et tantôt reposé, plein de musiques subtiles et de parfums pénétrants, à travers lequel nous conduisent ses poèmes. Ce n’est pas là vain souci d’historien, ou concession à un pittoresque facile. Jean de la Croix n’a pas été insensible à la beauté du monde extérieur, et il a vu en elle une invitation à s’élever jusqu’au Créateur1.
Habitué depuis son enfance aux terres ardentes de Vieille Castille, il se plonge, en descendant vers le Sud, dans le charme des verdures et des eaux courantes. Il vit au Calvario parmi les pins et les oliviers, tout à côté du Guadalquivir naissant, et invite ses religieux à faire oraison au milieu des arbres. La vie y est tellement simple, tellement proche de la nature, que la seule nourriture admise par la communauté est un peu d’herbe cuite.
Baeza, où il passe plus de deux ans, est une de ces petites villes pleines de charme, où l’art gothique et l’art musulman se côtoient sans se nuire. On aperçoit de loin, de l’autre côté du Guadalquivir, les sommets de la Sierra Magina, couverts de neige pendant l’hiver.
À Grenade, le couvent de «Los Mártires» domine la place du Genil avec, comme arrière-plan de montagnes, la Sierra Nevada. Dans le jardin, Jean de la Croix fait construire un aqueduc pour capter le trop-plein des eaux du Généralife. Il y goûte ce charme particulier de Grenade, qui est, selon les mots de Barrès, «d’avoir les plus beaux arbres du nord et des eaux vives sous un soleil africain». Des témoignages du procès de béatification nous disent que le saint aimait à longer le Genil et le Darro.
Au Carmel de Ségovie, le Libro de la Cosas nous a laissé une description très précise de la retraite qu’il affectionnait: «…une grotte à peine plus longue qu’un homme étendu. La nature la creusa dans la roche… De là, on découvre beaucoup de ciel, la cité et ses alcazars, ses temples, ses tours, les hautes Sierras et les champs qui s’allongent de Ségovie à Albe.»
C’est au milieu de cette nature qu’il a prié, souffert, qu’il a achevé, poli et commenté ses poèmes, et c’est parce qu’il a vécu si près des choses, si attentif, malgré tout, à leurs messages secrets, qu’il a créé ce symbolisme plein de suc dont une tradition longue et vivace lui fournissait maints éléments. En essayant de reconnaître sa dette envers cette tradition et de replacer ses poèmes dans le vaste courant mystique qui a soulevé toute l’Espagne du xvie siècle au-dessus d’elle-même, nous ne ferons que rendre plus éclatante la nouveauté de sa vision.
Comment la poésie peut-elle dire le divin ? Comment peut-elle par le langage exprimer une expérience mystique ? Il semblerait que les mots ne puissent jamais rendre le vrai sens de ce qui est indicible. Sommet de la poésie espagnole et l’une des références majeures de la mystique occidentale, saint Jean de la Croix a su avec les « mots de la tribu » dire l’ineffable par une écriture sobre et ardente. Et l’on sait à quel point, de Paul Valéry à Jean Genet, sa poésie a inspiré la littérature française du XXe siècle. Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix, accompagné d’une nouvelle traduction de ses poèmes, est le premier livre du grand critique et essayiste Max Milner. Max Milner (1923-2008), critique littéraire et essayiste, a été professeur à la Sorbonne et président de la Société des études romantiques dix-neuviémistes. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont : Le Diable dans la littérature française de Cazotte à Baudelaire, Corti, 1960, rééd. 2007 ; L’Imaginaire des drogues : de Thomas de Quincey à Henri Michaux, Gallimard, 2000 ; L’Envers du visible : essai sur l’ombre, Seuil, 2005 ; Rembrandt à Emmaüs, Corti, 2006.
Le préfacier Jean Baruzi (1881-1953), professeur au Collège de France, est l’auteur du fameux Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique en 1924 qui a bouleversé les études sanjuanistes.
Carlo Ossola, l’auteur de la postface, est professeur au Collège de France et membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei de Rome. Les Éditions du Félin publieront en 2011 ses deux prochains livres : Mots de glace et de neige et Le Continent intérieur.
Préface de Jean Baruzi Postface de Carlo Ossola