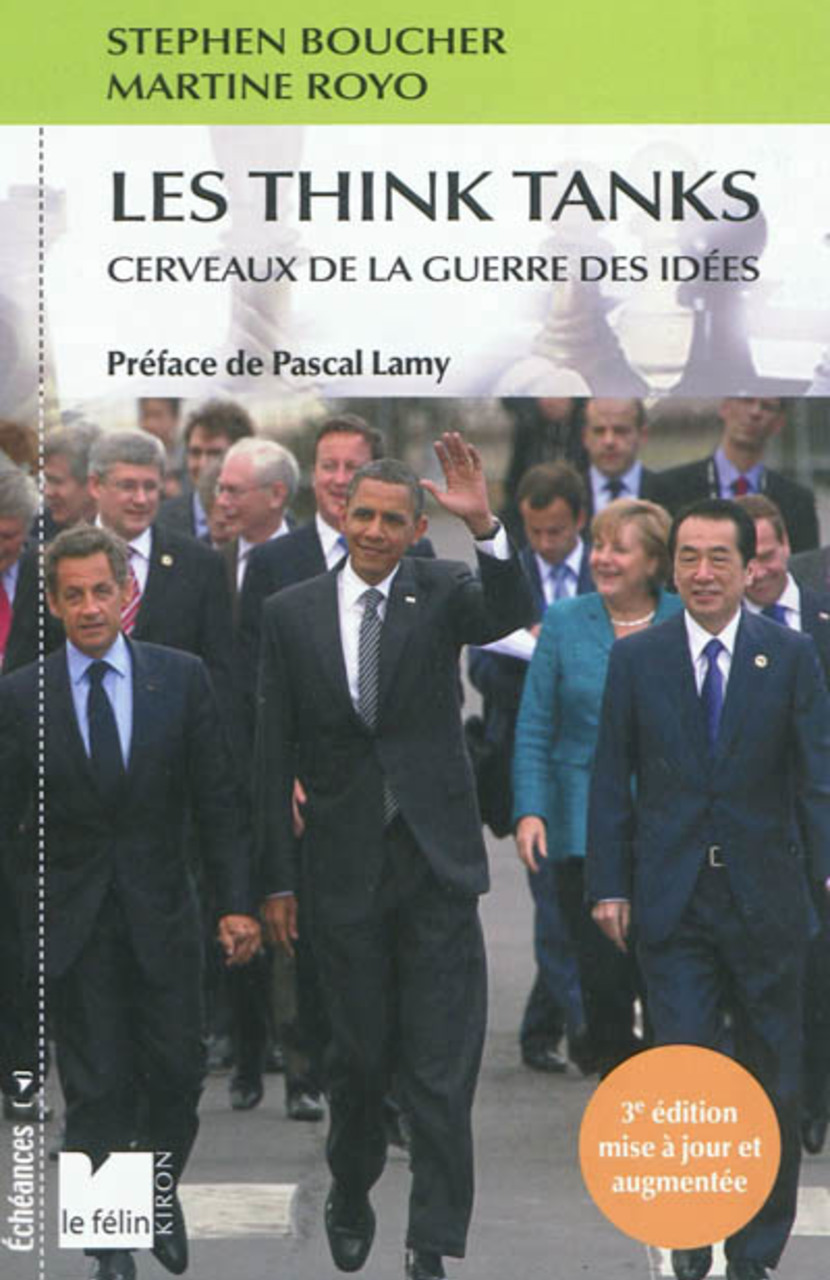
Les Thinks tanks
Préface
La France et l’Europe ne manquent pas d’idées, elles manquent de lieux où celles-ci peuvent circuler, où les dirigeants peuvent s’exposer à de nouvelles manières de penser et de gouverner.
On entend depuis quelque temps parler en France des « think tanks », mi-clubs politiques, mi-centres de recherche académique, où se rencontrent responsables politiques, universitaires, chefs d’entreprise et acteurs de la société civile. C’est une bonne chose. Mais la France tarde à se doter de ces « laboratoires à idées » capables de produire une réflexion politique alternative, et donc susceptibles d’enrichir le débat politique. Elle est à la traîne par rapport à Bruxelles où existent depuis une vingtaine d’années des organisations telles que le Centre for European Policy Studies ou le European Policy Institutes Network. Et Bruxelles est loin derrière Washington, où coexistent des organisations telles que la Brookings Institution, le Progressive Policy Institute, ou l’American Enterprise Institute, pour ne citer que trois organisations aux affinités politiques divergentes parmi des centaines d’organisations créatives, influentes et intégrées dans le processus de formation des politiques publiques des États-Unis.
Comme nous le rappelait Auguste Comte, ce sont pourtant les idées qui gouvernent le monde. Sans la vision des pères fondateurs de l’Union européenne, l’Europe n’aurait pas connu cinq décennies de paix, ni un tel degré de prospérité. Sans l’imagination et le dévouement de quelques personnes éclairées, des idées autrefois utopiques ou radicales le seraient restées : abolition de l’esclavage, fin de la peine de mort, autorisation de l’interruption volontaire de grossesse, revenu minimum pour les plus pauvres... On échange aujourd’hui des « permis de polluer » pour réduire les émissions polluantes. Aucun progrès social ou économique n’a vu le jour sans émerger d’abord dans l’esprit de quelques-uns pour être ensuite débattu largement.
Il est donc essentiel de se pencher sur les conditions dans lesquelles les idées politiques naissent et se diffusent, tant auprès de l’opinion que des autorités susceptibles de les mettre en œuvre. Les think tanks peuvent être un pont entre différentes formes de connaissance. Les meilleurs permettent d’analyser des problèmes complexes de manière transversale, en combinant diverses disciplines scientifiques, ce que les administrations ont par nature plus de difficulté à faire. Détachés de contraintes hiérarchiques, ils peuvent se montrer critiques et remettre en question le consensus dominant.
La notion de « think tank » suscite pourtant encore une certaine méfiance en France. On l’associe à cet autre concept sulfureux venu d’outre-Atlantique : le « lobbying », officiellement banni du vocabulaire institutionnel hexagonal. Pourtant, plus personne ne croit en France que nos élus politiques, armés d’une administration omnisciente, sont en mesure de déterminer l’intérêt général in abstracto, et que celui-ci ne serait aux États-Unis que le résultat de la compétition entre intérêts égoïstes. Cette opposition est simpliste. La réalité est qu’aucune démocratie ne peut fonctionner efficacement sans délibération collective riche et transparente entre les citoyens, les groupes intermédiaires, les administrations et les représentants élus. Et que la définition collective d’un projet de société accepté par la majorité ne tendra vers un réel progrès qu’alimentée par un débat de qualité, nourri d’une réflexion approfondie.
L’Europe et la France ont donc besoin de think tanks. Or, non seulement ceux-ci sont moins nombreux chez nous qu’aux États-Unis, mais la réflexion y est bien souvent insuffisante. Dans un contexte globalisé, cela peut laisser le champ libre à des idées, à des expertises ou à des influences dominatrices. Les think tanks ne doivent pas être craints, mais utilisés comme un complément désormais indispensable à d’autres formes de réflexion politique.
L’ouvrage de Stephen Boucher et Martine Royo, premier du genre en français, a le mérite de défricher le sujet, tout d’abord en apportant une définition claire de ce que sont les think tanks – y compris dans leurs limites et leurs dérives. Ensuite en invitant toutes les parties concernées – élus, citoyens, responsables d’entreprise, acteurs sociaux – à comprendre ce qui fait leur spécificité, et ainsi à les utiliser à bon escient. Enfin en attirant l’attention de tous sur la nécessité de s’impliquer dans le débat, pour éviter que d’autres déterminent les priorités politiques et les choix de société. Au-delà de l’outil utile que représentent les « laboratoires à idées », ce texte nous rappelle que la créativité en politique doit être l’affaire de tous.
Pascal LAMY
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce,
Ancien directeur du think tank Notre Europe,
Ancien commissaire européen au Commerce international.
Février 2005
Introduction
Et si les think tanks devenaient les amphétamines intellectuelles de nos décideurs politiques ? Quels sont les chefs d’État ou les ministres qui n’ont pas besoin, dans un environnement local et international de plus en plus complexe, d’être alimentés en réflexions, analyses ou propositions, pour gérer des problèmes comme la crise des banlieues, le chômage des jeunes, l’immigration clandestine ou les conséquences de la mondialisation ? Plus les problèmes s’aggravent, plus nos dirigeants semblent en panne de solutions. Il est vrai qu’ils n’ont pas le temps de réfléchir sur le long terme et que l’exercice du pouvoir et la succession rapide des échéances électorales ne facilitent pas la prise de risques, donc l’imagination. Rien de tel qu’un groupe de chercheurs imaginatifs et bardés de diplômes, issus d’horizons différents – politologues, économistes, sociologues, spécialistes en stratégie, scientifiques, etc. – pour élaborer des propositions originales. À condition qu’ils aient le loisir de réfléchir dans la durée et non l’obligation de produire une étude dans l’urgence.
Certes, ces « réservoirs de pensée » ou « laboratoires d’idées » ne sont pas une tradition française. Historiquement, les Français, férus de débats, ont préféré les clubs de réflexion dans le prolongement des salons des XVIIIe et XIXe siècles. Seul l’État a vu la nécessité de s’adjoindre des « apporteurs d’idées » pour remettre la France sur pied après la Seconde Guerre mondiale. Mais un cercle de réflexion financé exclusivement sur les deniers publics court le risque de perdre son indépendance, en tout cas dans les périodes où l’administration fragilisée cède à la tentation de reprendre les choses en main. En témoigne le sort subi par le Commissariat du Plan, reconverti à la fin de 2005 pour alimenter la machine politique du Premier ministre. L’idéal serait que ces « boîtes à idées » ne soient pas dépendantes d’un mais de plusieurs bailleurs de fonds, dont les velléités d’intervention dans leur travail s’annulent les unes les autres. Alors que les premiers think tanks privés ont fait leur apparition dans l’Hexagone il y a une vingtaine d’années, ils font partie du paysage politique depuis la fin du XIXe siècle au Royaume-Uni, depuis le début du XXe aux États-Unis. Bien plus qu’un phénomène de mode en France, l’Hexagone semble connaître une session de rattrapage trop longtemps attendue, imposée par la complexité croissante du monde qui nous entoure.
Les think tanks sont en effet, en théorie du moins, une arme de poids dans la guerre des idées qui sévit entre différentes conceptions du monde, entre les deux rives de l’Atlantique – à propos de l’OTAN, de l’Irak, des droits de l’homme, etc. –, au sein de l’Union européenne – à propos du modèle social européen ou de la libéralisation des services. Elle opposera peut-être bientôt les ambitions chinoises à l’hyperpuissance américaine. La diplomatie intellectuelle est aujourd’hui une composante essentielle de la stratégie des États, qui vont devoir s’appuyer de plus en plus sur ces réservoirs d’idées pour étayer leur politique.
Mais contrairement aux pionniers de la profession apparus surtout après la Première puis la Seconde Guerre mondiale, les think tanks qui ont été créés au cours des vingt dernières années ont tendance à s’inféoder à une cause politique ou économique au lieu de viser à l’intérêt général. Évolution dangereuse qui a peut-être atteint son apogée aux États-Unis avec le PNAC (Project for the New American Century), probablement le seul think tank de l’histoire à s’enorgueillir d’avoir entraîné son pays dans la guerre. Est-ce cela la réalité des think tanks (chap. 1) ?
L’image est caricaturale. Qui sont-ils vraiment et comment travaillent-ils ? À quoi peuvent-ils servir ? Qu’est-ce qui fait leur spécificité, leur utilité par rapport à d’autres modes de production intellectuelle (chap. 2) ?
Comment sont-ils apparus dans l’histoire ? Pourquoi de préférence dans les pays anglo-saxons ? On découvre que les think tanks sont nés le plus souvent après les grandes crises qui ont secoué l’Occident au XXe siècle. Et qu’ils s’épanouissent de préférence dans le terreau de la démocratie et du libéralisme. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’en existe pas dans le reste du monde. La Russie, la Chine aussi ont leurs think tanks, d’une nature différente mais conçus pour rendre les mêmes services (chap. 3).
L’Europe est-elle armée pour la guerre des idées ? Paradoxalement, les think tanks britanniques sont très influents auprès des institutions européennes. Rien d’étonnant à première vue, puisque c’est en Grande-Bretagne qu’est née la Fabian Society, doyenne des think tanks. Mais leur engagement européen est plus sujet à caution. Comment les pays de « la Vieille Europe », comme dirait Donald Rumsfeld en visant l’Allemagne et la France, peuvent-ils sauvegarder leur influence sur le continent, en perte de vitesse depuis les derniers élargissements ? La solution passe-t-elle par les think tanks (chap. 4) ?
Comment la France est-elle équipée en « creusets de pensée » ? Quelle est leur efficacité ? Pourquoi les think tanks privés sont-ils apparus si tard ? Quelles sont les institutions publiques françaises faisant office de think tanks ? Pourquoi l’État a-t-il le quasi-monopole de l’analyse ? Qui sont ces grands patrons français qui se lancent aujourd’hui dans l’aventure (chap. 5) ?
Instrument de renouveau de la démocratie pour les uns, menace pour les autres, comment imaginer l’avenir de ces cabinets intellectuels ? Si le propre des think tanks est non seulement de produire des idées originales mais aussi d’avoir de l’influence auprès des décideurs politiques pour voir leurs idées appliquées, comment peuvent-ils échapper aux pièges que leur tend de toutes parts notre société de la communication, avec ses médias qui ont le culte de l’instantané et de l’image choc, les acteurs politiques avides de solutions rapides, et leurs concurrents de plus en plus nombreux ? Avec le risque de perdre leur âme s’ils sacrifient le fond (la qualité de la recherche) aux paillettes de la notoriété (chap. 6).
Amphétamines ou simples vitamines politiques, les centres de réflexion politique sont le reflet de la vitalité de nos démocraties. S’intéresser aux think tanks, c’est s’interroger sur la santé de notre vie politique et notre capacité à affronter la guerre des idées.
1. DE LA GUERRE PRÉVENTIVE
AU LOBBYING DES IDÉES
Un think tank peut-il à lui seul changer le cours de l’histoire ? Animé par une même vision de la suprématie américaine dans le monde, mû par la même détermination, circulant dans les élites politiques américaines, un groupe d’activistes intellectuels a réussi au cours des années 1990 à rendre incontournable aux États-Unis – où le phénomène des think tanks s’est le plus développé – l’idée de l’intervention armée en Irak. Les think tanks ont donné un nouveau sens à la notion d’armes de destruction massive…
« Comment changer le monde ? Eh bien, il y a les voies évidentes, comme prendre le pouvoir, être monstrueusement riche ou suivre péniblement les processus électoraux. Et puis il y a les raccourcis, comme le terrorisme ou… les think tanks. » Qu’un éminent journaliste du Guardian à Londres, Steve Waters, classe ainsi poseurs de bombes et think tanks dans la même catégorie d’« esprits dangereux » témoigne de la mauvaise presse acquise par ceux-ci ces dernières années1. Si cette assimilation est volontairement caricaturale, considérons l’exemple du Project for the New American Century (PNAC). Six ans après sa création en 1997 par une poignée de néo-conservateurs*2, avec le soutien d’industriels de l’armement tels que Lockheed Martin, l’offensive américaine contre l’Irak de Saddam Hussein réalise son programme de « guerre préventive » contre les « États voyous ». Coïncidence ou causalité ? Dans une lettre au président Clinton en 1998, cet institut esquissait le plan d’une domination américaine sur le monde et se faisait l’avocat d’un changement radical d’attitude à l’égard des Nations unies et d’un renversement du régime de Saddam.
Néo-conservatisme : Les « nouveaux conservateurs » américains se distinguent des conservateurs traditionnels par leur approche interventionniste en politique étrangère, mais aussi par l’abandon des principes de réduction de l’appareil étatique et par la restriction des dépenses sociales. Apparu au début des années 1970, le mouvement n’a toutefois pas de corpus idéologique clairement défini et a accueilli de nombreux démocrates. Ses revues phares sont Commentary et The Weekly Standard.
UNE GUERRE INVENTÉE PAR UN THINK TANK
En remontant le fil des arguments mis en avant par l’administration Bush pour justifier l’intervention en Irak, on retrouve la vision de Paul Wolfowitz et Lewis Libby, cofondateurs en 1997 du PNAC, le Project for the New American Century.
Le PNAC aux origines de la guerre en Irak
On se perd aujourd’hui parmi les multiples justifications de la guerre en Irak. Il ne s’agissait pourtant pas d’une lubie de dernière minute. L’attaque de l’Irak par la coalition emmenée par les États-Unis est le fruit des cogitations de quelques têtes pensantes particulièrement actives, persévérantes… et disposant de solides réseaux personnels.
En 1992, deux fonctionnaires du ministère de la Défense, Paul Wolfowitz, sous-secrétaire pour la politique de défense, et Lewis « Scooter » Libby, imaginent une nouvelle vision de la défense américaine pour le secrétaire à la Défense, Dick Cheney. Il faut réinventer l’ordre mondial. La politique de dissuasion, expliquent-ils, n’a plus lieu d’être au sortir de la guerre froide. Elle doit être remplacée par une nouvelle stratégie mondiale qui préserve à tout prix le statut de superpuissance des États-Unis sur l’Europe, l’Asie, la Russie. Proposition décisive du rapport de 46 pages qui circule pendant quelques semaines au sein du département : « Notre objectif numéro un est d’éviter l’émergence d’un nouveau rival. » Tout concurrent potentiel doit être « dissuadé ne serait-ce que d’envisager d’avoir un rôle régional ou global plus important ». Une nation qui menacerait les États-Unis en acquérant des armes de destruction massive doit être attaquée de manière « préventive ». « Cela laissait penser que tout pays venant rivaliser avec la puissance américaine pourrait être jugé “hostile” si sa politique n’était pas alignée avec celle des États-Unis », résume James Mann dans son livre sur l’influence des néo-conservateurs, Rise of the Vulcans3. Quand le New York Times et le Washington Post se saisissent du document, la vision fait scandale, aux États-Unis et, surtout, en Europe et en Asie, identifiées comme « rivaux » potentiels.
À l’époque, leur doctrine paraît fantaisiste. Ce ne serait que fantasmes de faucons nostalgiques du combat reaganien contre l’ennemi soviétique en mal d’action politique. Dick Cheney est contraint de réécrire le document. Mais les jalons sont posés : domination américaine totale, armes de destruction massive prétextes aux attaques unilatérales non sanctionnées par les Nations unies, frappes préventives, alliances traditionnelles remplacées par des coalitions ad hoc.
On retrouve les mêmes hommes et les mêmes idées quelques années plus tard au sein du Project for the New American Century (PNAC). Ce think tank propose une nouvelle vision du « leadership global des États-Unis ». Sa doctrine, jusqu’à aujourd’hui, s’appuie sur deux principes : « Le leadership américain est bon pour les États-Unis et le reste du monde » ; « Un tel leadership nécessite la puissance militaire, l’énergie diplomatique, et l’adhésion à des principes moraux4. »
Les fantassins de la cause néo-conservatrice du PNAC veulent à la fois changer la politique internationale de leur pays et « redonner confiance » aux conservateurs en leur offrant « une vision stratégique du rôle de l’Amérique dans le monde ». Les Républicains, observent les fondateurs, ont « laissé leurs différends sur les tactiques obscurcir leur accord possible sur les grands objectifs stratégiques ».
« Une telle politique reaganienne de puissance militaire et de clarté morale n’est peut-être pas à la mode aujourd’hui », concèdent-ils… jusqu’à ce que leurs idées soient reprises par le candidat à la présidence George W. Bush. Leur premier intérêt est en effet de fournir un contrepoint radical à la politique « idéaliste », « hésitante » et au penchant multilatéraliste du président démocrate. Le 28 janvier 1998, l’équipe du PNAC soumet en effet au président Clinton une courte lettre pour lui suggérer un changement radical dans les relations des États-Unis avec l’Organisation des Nations unies et le renversement de Saddam Hussein. Du fait de l’inefficacité supposée des inspections des Nations unies, écrivent les dix-huit signataires de la lettre5, « notre capacité à nous assurer que Saddam Hussein n’est pas en train de produire des armes de destruction massive a diminué de manière substantielle ». « La politique américaine ne peut continuer à être handicapée par une insistance malavisée à rechercher l’unanimité aux Nations unies », insistent-ils. « La sécurité des troupes américaines dans la région, de nos amis et alliés tels qu’Israël et les États arabes modérés, et une portion significative des réserves mondiales de pétrole seront mises en danger. » Conclusion : « La seule stratégie acceptable est celle consistant à éliminer la possibilité que l’Irak soit en mesure d’avoir recours à – ou de menacer d’utiliser – des armes de destruction massive. À brève échéance, cela implique que l’on soit disposé à engager des actions militaires puisque la diplomatie échoue visiblement. À long terme, cela signifie le renversement de Saddam Hussein et de son régime. Ceci doit maintenant devenir l’objectif de la politique étrangère américaine. »
Les idées et leurs auteurs au pouvoir
Avec l’accession de George W. Bush à la présidence le 20 janvier 2001, le discours devient réalité. Quelques jours à peine après son entrée en fonctions, le nouveau président envoie un ordre – secret à l’époque – exigeant de l’armée de développer des scénarios pour une guerre en Irak. La « doctrine Bush » traduit dans les actes les idées de ses amis.
Depuis 1998, le PNAC avait d’ailleurs pris la peine de préciser sa vision. En septembre 2000, quelques semaines avant le début de l’administration Bush, le PNAC publie un rapport détaillé pour « La reconstruction des défenses américaines » qui vise « à maintenir la prééminence des États-Unis, à dissuader les puissances rivales, et à façonner le système de sécurité global selon les intérêts américains6 ». Les États-Unis, insistent les auteurs, doivent reconstruire leur bouclier antimissile afin de pouvoir mener plusieurs guerres de front. Résoudre le dilemme irakien reste essentiel, mais s’inscrit dans une stratégie plus vaste de contrôle du Golfe, qui devient la priorité ultime : « Indépendamment de la question du régime irakien, une présence américaine substantielle dans le Golfe est nécessaire. »
LES STRATÈGES DE W.
À peine Bush fils obtient-il les clefs de la Maison Blanche qu’il fait entrer les auteurs du rapport du PNAC et les signataires de la lettre de 1998 dans son équipe. Ils vont pouvoir réaliser eux-mêmes leur vision. Dick Cheney devient vice-président, avec Lewis Libby à ses côtés comme chef de cabinet. Peter Rodman est chargé des questions de sécurité internationale. Après avoir été vice-président de l’American Enterprise Institute, autre think tank conservateur, John Bolton est nommé secrétaire d’État pour le contrôle des armes (avant, paradoxalement, de devenir ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU en 2005). Richard Armitage est ministre adjoint des Affaires étrangères. Richard Perle, qui avait été ministre adjoint de la Défense de Reagan, préside le Conseil politique de défense du Pentagone (Defense Policy Board). Il est l’auteur de la théorie de la « destruction créatrice » pour transformer le Moyen-Orient, en commençant par l’Irak. William Kristol, fils du « père du néo-conservatisme » Irving Kristol, reste à la tête du PNAC et du magazine The Weekly Standard mais conseille régulièrement le président Bush. Zalmay Khalilzad, qui sera plus tard nommé ambassadeur en Irak, devient conseiller du secrétaire d’État à la Défense Donald Rumsfeld. Paul Wolfowitz, sous-secrétaire d’État à la Défense, est l’un des principaux architectes de la politique étrangère de George W. Bush. Il sera nommé à la tête de la Banque mondiale en janvier 2005. Au total, pas moins de seize collaborateurs directs du PNAC sont intégrés dans l’administration.
Les idées du PNAC sont dès lors entrées dans la place. Dans un discours remarqué à l’académie militaire de Westpoint en juin 2002, le président Bush définit la nouvelle stratégie nationale : il affirme le droit de son pays à utiliser la force « préventivement » contre des pays ou groupes terroristes considérés comme « près d’acquérir des armes de destruction massive ou des missiles à longue portée ». Il affirme que les États-Unis répondront « avec une force irrésistible » et « toutes les options » – rétablissant la possibilité de recourir à l’arme nucléaire – à toute attaque contre les troupes américaines utilisant des armes chimiques, biologiques, ou nucléaires.
En moins de dix ans, les concepts et leurs auteurs ont accédé au pouvoir. Une vision du monde initialement perçue comme le fruit de l’imagination d’individus isolés a fini par définir le programme politique national puis international, à convaincre la majorité de l’opinion publique américaine, et à changer le cours de l’histoire. Une vision du monde où « la force fait droit » (right is might). Où les Nations unies sont considérées comme un obstacle à la toute-puissance américaine : « Même si les États-Unis chercheront constamment le soutien de la communauté internationale, nous n’hésiterons pas à agir seuls, si nécessaire, pour exercer notre droit à l’autodéfense de manière préventive7. » L’intérêt américain a été redéfini. Armes de destruction massive, « changement de régime » (regime change), distorsion de la notion de légitime défense en l’absence de menace directe (« L’Amérique agira contre les menaces émergentes avant qu’elles ne se soient complètement formées… »), théorie de la destruction créatrice, respect à la carte du droit international et des règles de guerre en fonction des intérêts des États-Unis, mépris du consensus international, unilatéralisme assumé, projet de démocratisation du « Grand Moyen-Orient »… Il n’y a pas jusqu’au concept même de « guerre des idées » qui ne soit repris par la Maison Blanche. La carte mentale des décideurs, des médias et d’une large frange des citoyens américains a été reformatée.
Ces faits sont aujourd’hui bien prouvés. En réalité, ils n’ont jamais été secrets. Le PNAC et les think tanks favorables à sa vision agissent au grand jour, publient leurs propositions, les propagent sur Internet, et débattent avec d’autres think tanks. Mais « quelle est la légitimité, dénonce Steve Waters, chroniqueur pour The Guardian, de think tanks qui sont souvent le jouet d’individus passionnés qui peuvent tourner le dos à leurs erreurs et ne sont responsables que d’eux-mêmes ? »
LE RETOUR DES IDÉES OU DE L’IDÉOLOGIE ?
L’activité des think tanks aux États-Unis dépasse les seules questions de défense et d’affaires étrangères. Pas moins de 1 500 organisations s’efforcent d’enrichir le débat d’idées sur la scène politique américaine.
Les conservateurs dominent l’actualité politique
Reflet de la polarisation croissante de la politique américaine, la bataille d’arguments au sujet de l’intervention militaire en Irak a impliqué de nombreux centres de recherche, conservateurs et libéraux. Richard Perle, ancien directeur du Conseil de politique de défense du Pentagone et Douglas Feith, ancien conseiller de Perle, sont deux Républicains très à droite qui ont appuyé les efforts du PNAC au sein de l’American Enterprise Institute (AEI), l’un des plus influents think tanks américains. Dans un discours précédant la guerre en Irak, George W. Bush affirme en 2003 : « Vous faites un tellement bon travail que mon administration a emprunté vingt de vos têtes pensantes8. » La proximité n’est d’ailleurs pas seulement idéologique : l’AEI héberge le PNAC dans son immeuble. Les propositions se ressemblent. L’équipe du AEI pour le Moyen-Orient publie ainsi en 1996 un essai provocateur proposant à Benyamin Netanyahou « une refondation intellectuelle » : Richard Perle suggère qu’Israël, en s’alliant à la Jordanie et à la Turquie, renverse le régime de Saddam Hussein et restaure l’ancienne dynastie hachémite. L’AEI est aussi derrière la promotion d’Ahmed Chalabi comme interlocuteur privilégié de l’opposition irakienne de l’administration américaine9.
Les victoires idéologiques des think tanks de la droite américaine ne se limitent pas à la politique étrangère des États-Unis. Sur tous les fronts, les officines intellectuelles conservatrices ont insufflé des réformes radicales. En 1981, la fondation Heritage publie « un mandat pour le leadership », que Reagan adopte et applique scrupuleusement pendant sa présidence11. En 1988, la même fondation propose « un ordre du jour conservateur pour l’administration Bush » (père) de 2 000 pages. En 1995, c’est « un plan budgétaire pour construire l’Amérique » et « faire reculer l’État » qui est avancé. Ces programmes de gouvernement sont suivis en détail par les administrations républicaines. Heritage développe aussi de nouvelles techniques de marketing des idées. Dès qu’un dossier est soumis à la Chambre des représentants et au Sénat, elle envoie par fax des notes concises aux membres du Congrès. Elle est la première à consacrer plus d’un cinquième de son budget à la communication. Heritage a créé en 1994 un studio de radio ouvert à toute personnalité politique de passage à Washington. Son équipe de relations publiques comprend aujourd’hui une vingtaine de personnes. Ses experts apparaissent régulièrement dans les programmes TV des principales chaînes américaines. Ses conférences sont régulièrement retransmises par C-SPAN et Fox Network. Alors président de la Heritage Foundation, Edwin Feulner expliquait en 1993 : « Lorsque nous avons démarré [en 1973], on nous qualifiait d’“ultra-droite” ou d’“extrême droite”. Aujourd’hui, nos idées appartiennent au courant dominant12. »
Heritage est particulièrement influente et visible, mais d’autres organisations conservatrices prospèrent dans son sillage. Le Cato Institute, think tank « libertaire* », cherche à promouvoir les « principes traditionnels américains de gouvernement limité, de liberté individuelle, de marché libre et de paix ». Héritier idéologique de Milton Friedman, l’institut dispose d’un budget annuel d’environ 14 millions de dollars et d’une équipe d’une petite centaine de permanents. Opposé aux thèses interventionnistes des néo-conservateurs, Cato fait partie des conservateurs isolationnistes, plus proches de Bush père, et partant accusés par les néo-conservateurs d’antipatriotisme13.
Libertaire, en anglais « libertarian » : Aux États-Unis, les partisans du « libertarianisme », tels que l’institut Cato ou TechStation, n’admettent aucune limitation de la liberté individuelle en matière sociale et politique. Celle-ci, dans une vision maximaliste, doit être le fondement de toute organisation sociale. Adversaires de l’État, les libertaires croient notamment que la vie, la liberté, et la propriété sont les droits naturels de toute personne, et que s’attaquer à l’une compromet les autres. L’une de ses formes les plus radicales est l’anarcho-capitalisme.
L’institut Milken, basé à Los Angeles, serait, selon Le Monde, « le think tank le plus en vue sur l’évaluation du terrorisme », créé en 1991 afin de « sortir des sentiers battus pour créer des emplois et générer du capital pour les entrepreneurs localement et sur le plan mondial ». Le Discovery Institute, sous couvert de « rendre une vision positive du futur possible », travaille principalement à légitimer les thèses du « dessein intelligent », théorie créationniste concurrente du darwinisme.
Les exemples – les principaux centres étant repris dans le tableau
ci-dessous – peuvent être multipliés à l’envi. De fait, la stratégie a payé : à la fin des années 1990, les sondages révèlent que les trois quarts des membres du Congrès et de leurs équipes de conseillers personnels estiment que les think tanks conservateurs ont plus d’influence sur la politique américaine que leurs rivaux libéraux14.
Les libéraux* réagissent tardivement
Pendant de longues années, la gauche américaine n’a pas vu la menace monter ni la nécessité de disposer de ses propres think tanks, explique Alberto Mingardi, jeune directeur d’une officine conservatrice italienne, l’Istituto Bruno Leoni. « Ils ne pensaient pas qu’ils en avaient besoin, parce qu’ils avaient les universités. » Qui plus est, leurs sources traditionnelles de financement, telles que la fondation Ford, ont réduit leurs aides.
Aujourd’hui, les libéraux ont beaucoup de retard à rattraper. Pas moins des deux tiers des think tanks qui ne suivent pas une ligne indépendante des partis appartiendraient à la mouvance conservatrice. Au-delà du simple nombre, les think tanks conservateurs dépensent trois fois plus que leurs homologues de gauche. Tandis que ces derniers sont souvent spécialisés dans des domaines précis tels que les droits de la femme ou le logement social, les centres conservateurs couvrent une plus grande variété de sujets : à la fin des années 1990, parmi les think tanks nationaux se définissant comme libéraux, seulement 8 % étaient généralistes, contre 21 % des conservateurs. Cette tendance est encore plus marquée au niveau des États.
« Libéral » au sens américain : Aux États-Unis, les liberals sont des sociaux-démocrates et non forcément des personnes favorables au libéralisme économique, comme en Europe. Placés à gauche – voire à l’extrême gauche – de l’échiquier politique, ils mettent l’accent sur la liberté de mœurs et l’égalité (notamment raciale), considérant que la liberté économique constitue la norme admise.
Certains à gauche ont compris la leçon. « Ce n’est plus suffisant pour un progressiste de se plaindre et de geindre », dit Robert Boorstin, fondateur du Center for American Progress (CAP). « Nous devons mettre des idées sur la table. » Son président est John Podesta, secrétaire général de la Maison Blanche de Clinton. Le CAP, explique Boorstin, a été créé à l’été 2003 précisément pour contrer la vague néo-conservatrice et soutenir le candidat démocrate à l’élection présidentielle. Lancé avec « seulement » un million de dollars et huit personnes, le CAP comptait 106 personnes à la fin de 2005 et disposait d’un budget annuel de 20 millions de dollars. « Cela révèle le vide qui existait », reconnaît Boorstin, qui souligne que l’écart reste important puisque « les trois plus importants think tanks à droite dépenseront ensemble 120 millions de dollars en 2006 ». « Nous sommes financés par des gens riches… et en colère », explique-t-il, en l’occurrence le milliardaire George Soros qui s’était juré de faire battre Bush. Pendant la campagne présidentielle de 2003, l’équipe de Podesta a multiplié les argumentaires pour John Kerry. Depuis, Boorstin s’enorgueillit d’avoir élargi le débat sur l’Irak à gauche comme à droite en proposant un calendrier de « redéploiement stratégique » qui aurait facilité la discussion sur le retrait des troupes.
Le Progressive Policy Institute a contribué à définir la « troisième voie ». Chère à Bill Clinton et Tony Blair, cette approche considère que l’opposition entre conservatisme et social-démocratie est obsolète. L’institut, fondé par Al From, inspirateur de la doctrine, n’en reste pas moins considéré comme appartenant au centre gauche selon les références américaines. L’heure de gloire du PPI intervient en 1999, quand il réunit Bill Clinton, Tony Blair, Massimo D’Alema, Gerhard Schroeder et Wim Kok pour une conférence sur « La Troisième Voie : la gouvernance au XXIe siècle ». Certaines des idées du PPI, comme les charter schools, les écoles à chartes qui donnent plus de liberté aux parents d’organiser l’éducation de leurs enfants, ont été inspirées par le PPI et son allié politique, le Democratic Leadership Council.
Quant aux autres think tanks américains libéraux, ils semblent moins écoutés. On trouve parmi eux l’Institute for Policy Studies. Créé en 1963, il souhaite « transformer les idées en action pour la paix, la justice, et l’environnement ». Ses objectifs sont diamétralement opposés à ceux du PNAC : « IPS travaille aux États-Unis et dans diverses enceintes internationales pour promouvoir un nouveau type de multilatéralisme fondé sur les Nations unies, la démocratie et les citoyens. » Dirigé par la médiatique Phyllis Bennis, IPS lutte contre « l’unilatéralisme et l’interventionnisme militaire américains, surtout après les attaques terroristes du 11 septembre [2001] ». Aux États-Unis, IPS travaille avec le Centre pour les droits économiques et sociaux (Center for Economic & Social Rights). En Europe, il collabore avec le Transnational Institute, « une confrérie mondiale d’universitaires activistes engagés » basée à Amsterdam. L’IPS essaie de répondre sur le terrain des concepts du PNAC, en expliquant par exemple que l’administration ne cherche pas à « prévenir » des menaces prétendues imminentes, mais à « anticiper » toute menace, même distante, contrevenant ainsi clairement au droit international. Parmi les autres think tanks qui résistent à la vague néo-conservatrice, on trouve le World Policy Institute, d’inspiration libérale internationaliste. WPI publie le World Policy Journal depuis 1983 pour doubler sur la gauche son aînée, la fondation Carnegie, notamment en ouvrant ses tribunes à des auteurs plus jeunes, plus radicaux, moins soucieux de consensus et d’impartialité. On trouve aussi le Joint Center for Political and Economic Studies, « seul think tank noir de la nation ». Créé en 1970, le centre étudie les questions économiques pour « améliorer les conditions socio-économiques des Noirs américains et d’autres minorités, élargir leur participation effective aux débats politiques, et promouvoir des communications et relations interraciales et ethniques qui renforcent le caractère pluraliste de la nation ». Le Center for Responsive Politics étudie le financement des campagnes politiques pour limiter l’influence de l’argent sur le résultat des élections.
Le retour de balancier est amorcé, les « libéraux » s’organisent. Avril 2005, 70 millionnaires et milliardaires de sensibilité libérale sont réunis à Scottsdale, en Arizona. À l’initiative de Rob Stein, banquier et ancien de l’administration Clinton15, la réunion a trois objectifs clairs : soutenir les think tanks libéraux, les centres de formation de jeunes leaders démocrates et les médias favorables pour contenir la fondation Heritage, AEI, Fox News et le Leadership Institute. Sans que le détail des sommes convenues soit connu, la machine de coordination des financements démocrates est enclenchée. Sachant que George Soros a donné plus de 23 millions de dollars à des groupes prodémocrates en 2004, 70 millionnaires pourraient faire la différence. De plus, « la technologie pourrait nous permettre de réussir ce qui a nécessité quarante années à l’autre camp », déclarait un participant à la sortie de la réunion.
Tableau 1 : Les principaux think tanks américains, libéraux, centristes et conservateurs
La classification politique ci-dessus des think tanks américains et leur rang en termes d’influence ont été déterminés par enquête par deux économistes, Tim Groseclose et Jeff Milyo16. On notera à quel point les think tanks les mieux dotés et les plus influents sont au centre ou à droite dans la politique américaine.
UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE DE CONQUÊTE ET DE CONDUITE
DU POUVOIR ?
L’exemple des think tanks néo-conservateurs américains est l’illustration du rôle que peut jouer en politique l’alliance des idées – si bonnes ou mauvaises soient-elles – et de la détermination d’individus organisés.
Contre le « consensus mou17 », les néo-conservateurs disent avancer des « visions courageuses » sous-tendues par « la clarté morale ». La philosophie des néo-conservateurs, selon Robert Kagan, auteur du livre à succès La Puissance et la Faiblesse et associé de la fondation Carnegie, est explicite : il faut que « des hommes d’État argumentent avec force, persuasion, et persistance » pour aider le peuple à affronter les défis qui se présentent à lui. Cela permettra à terme « d’asseoir les fondations qui permettront le changement de politique nécessaire quand les problèmes émergeront et qu’il sera temps d’agir ». L’histoire, rappelle Kagan, montre que des idées défendues avec force peuvent être impopulaires à l’origine, mais acceptées comme inévitables quand un facteur déclenchant – tel que les attentats du 11 septembre 2001 – transforme la vision du monde d’une nation. Il ne s’agit plus dès lors de s’adapter aux exigences de l’opinion publique telles que les sondages les révèlent – ce qu’aurait fait Clinton –, mais de les façonner.
Pour Jean Stefancic et Richard Delgado, auteurs d’une étude sur le
fonctionnement des think tanks néo-conservateurs américains, il ne fait aucun doute que les laboratoires d’idées sont devenus une arme politique, utilisée stratégiquement sur le long terme. Dans leur ouvrage « Sans pitié : comment les think tanks et fondations conservateurs ont changé l’agenda social américain18 », ils démontrent que « les conservateurs ont compris que les libéraux avaient mené leur propre “guerre culturelle” dans le monde académique et gagné de nombreuses batailles. Les libéraux n’ont pas su, en revanche, donner à ces victoires la moindre traduction politique ». Le travail de reconquête des think tanks conservateurs remonte ainsi bien avant l’arrivée au pouvoir des administrations Bush et Reagan. Initiée à la fin des années 1960, la progression a été lente, mais inexorable. « Leurs préparations prudentes ont commencé à porter leurs fruits à partir de 1985. » Sujet après sujet, ils ont battu en brèche les doctrines prédominantes promues par l’aile progressiste des facultés : l’anglais politiquement correct, la réforme de l’immigration, la dénonciation des tests d’intelligence, du racisme et de l’eugénisme, la discrimination positive… Le genre de sujets que désapprouve The Economist : « les gauchistes ont pris le contrôle des universités dans les années 1960 et ont imposé leurs vues avec un enthousiasme stupéfiant, expurgeant les manuels de tout ce qui pourrait être considéré comme sexiste ou raciste, imposant des codes de parole et inventant des pseudo-matières comme les études féminines19. »
Les raisons du succès de la contre-révolution conservatrice ? Stefancic et Delgado identifient cinq facteurs, qu’ils invitent les libéraux à « essayer d’égaler ».
• D’abord la concentration sur un petit nombre d’idées centrales, et la progression systématique de l’une à l’autre, seulement après avoir atteint les objectifs définis pour chacune. La gauche en comparaison, indiquent-ils, est trop dispersée, trop complexe, insaisissable pour les médias et les citoyens.
• Ensuite la planification stratégique des thèmes abordés, en fonction de leur capacité à renforcer le mouvement par la suite : la cohérence idéologique des thématiques choisies est forte, et les petites victoires du début ont progressivement élargi le spectre des oppositions possibles.
• Sans conteste, les penseurs-activistes conservateurs ont eu accès à des financements plus importants, mais « ils ont aussi été plus déterminés pour lever des fonds ».
• Leur utilisation des médias s’est également montrée très efficace.
• Enfin, « ils ont fait un meilleur usage des cerveaux, de l’autorité et de l’expertise, en particulier en aidant les personnes du berceau à la tombe », par exemple en aidant les étudiants partisans de leur idéologie, de l’université souvent jusqu’à leur accession à des postes à responsabilité. The Economist confirme : « les conservateurs américains consacrent beaucoup d’énergie au recrutement des jeunes. » La fondation Heritage offre ainsi une centaine de stages par an. Un imprésario conservateur compare son travail à celui d’un caviste cultivant avec soin ses crus au fil des ans. Parmi ces jeunes poulains identifiés et soutenus par les think tanks conservateurs, on retrouve aujourd’hui les têtes pensantes et agissantes des conservateurs américains : Karl Rove, stratège de George W. Bush, et d’autres, moins connus en Europe mais influents, tels que Rich Lowry, éditeur du magazine National Review, ou Thad Viers, élu député à la Chambre de Caroline du Sud à vingt-quatre ans. Le Leadership Institute irrite particulièrement les libéraux : centre de formation allié aux think tanks, il s’est donné pour mission « d’identifier, former et placer les conservateurs en politique, dans l’administration et dans les médias ».
On peut suggérer un enseignement complémentaire à ceux de Stefancic et Delgado : s’il n’est pas facile de faire passer de nouvelles idées dans le débat politique, il semble parfois plus facile de promouvoir des idées en apparences « neuves » que de plus conventionnelles. La facilité à faire adopter ses idées ne dépend pas de leur conformité à une vision largement partagée de l’intérêt général. Peut-être même est-ce leur caractère décalé qui leur assure une certaine audience.
Ne nous laissons toutefois pas abuser par les discours de quelques intellectuels chanceux. Les idées seules ne suffisent pas, le PNAC est un cas hors norme. Pour des centaines de propositions utiles, fantaisistes ou néfastes, seules quelques-unes trouvent l’oreille des dirigeants. Dans le cas des think tanks néo-conservateurs, l’alignement « astral » était exceptionnel : un travail de préparation idéologique de longue haleine, un réseau de zélotes influents, l’arrivée au pouvoir d’une équipe prête à promouvoir tant les programmes que leurs concepteurs, puis un facteur déclenchant d’ampleur tellurique. Ce serait pécher par naïveté que d’attribuer un tel retournement du débat politique américain et mondial au seul travail idéologique d’un think tank. « Le volontarisme intellectuel d’une droite n’hésitant pas à invoquer les thèses du communiste italien Antonio Gramsci sur la nécessaire conquête de l’hégémonie culturelle n’a en effet atteint ses fins qu’en raison d’une modification du rapport de forces social et politique en sa faveur », suggère Serge Halimi, dans Le Monde diplomatique20.
Ne laissons pas non plus l’exemple des think tanks néo-conservateurs américains masquer la diversité des contributions des laboratoires d’idées à la conduite de la politique aux États-Unis et dans d’autres démocraties occidentales. Du Rocky Mountain Institute, qui propose des voies alternatives pour encourager le développement de l’hydrogène propre comme nouveau vecteur énergétique, à l’institut Freedom House qui encourage la démocratie en Europe centrale et d’autres régions du monde, le monde des think tanks est multiple et sa contribution variée. Les chapitres suivants explorent cette variété et l’utilité possible des think tanks pour un débat politique plus riche et une démocratie plus participative.
Moteur de la guerre des idées, les think tanks ont prouvé que leur influence peut être considérable. Le cas du PNAC montre la capacité d’une poignée de « penseurs » engagés à définir l’agenda politique, à modeler les concepts et visions du monde qui vont structurer l’action politique, à « élargir les paramètres du débat politique public », comme le revendique le Cato Institute. Au point de changer le destin d’un ou de plusieurs pays. Comment les think tanks peuvent-ils être mobilisés pour l’intérêt général ? Sont-ils une menace ou un ferment de renouveau ? Au-delà du cas de la « guerre préventive » irakienne, l’émergence des think tanks est un enjeu fondamental pour la démocratie moderne.
11. Steve Waters, « Dangerous Minds », The Guardian, 10 novembre 2004.
12. Dont Jeb Bush, frère du futur président et gouverneur de Floride ; Francis Fukuyama, auteur de l’article paru dans la revue National Interest pendant l’été 1989 « La Fin de l’histoire ? » après la fin de l’Empire soviétique ; Robert Kagan, associé à la fondation Carnegie et auteur du bestseller Of Paradise and Power : America and Europe in the New World Order ; Zalmay Khalilzad ; Lewis Libby ; Dan Quayle, ex-vice-président de Reagan ; Donald Rumsfeld ; et Paul Wolfowitz.
13. James Mann, Rise of the Vulcans : The History of Bush’s War Cabinet, Londres, Penguin, 2004.
14. Citation et suivantes tirées de www.newamericancentury.org
15. Elliott Abrams, Richard Armitage, William Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay Khalilzad, William Kristol, Richard Perle, Peter Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider, Vin Weber, Paul Wolfowitz, James Woolsey, Robert Zoellick.
16. PNAC, « Rebuilding America’s Defenses – Strategy, Forces, and Resources for a New Century », disponible sur www.newamericancentury.org
17. « The National Security Strategy of the United States of America », Washington D. C., 17 septembre 2002.
18. « President Discusses the Future of Iraq », 26 février 2003, www.whitehouse.gov/news/ releases/2003/02/20030226-11.html
19. Basé à Londres, Ahmed Chalabi, opposant irakien au régime de Saddam Hussein, avait été nommé par les États-Unis responsable du Conseil national irakien pour légitimer l’invasion de l’Irak. Il fut nommé vice-Premier ministre en 2005 dans le gouvernement irakien.
10. Manuel Fagnier, « Après la guerre d’Irak : les néo-conservateurs divisés ? » La République des Idées, mai 2003, www.repid.com
11. Heritage Foundation, « A Mandate for Leadership », 1980, www.heritage.org
12. Serge Halimi, « Des idées désormais jugées “naturelles”, quand la droite pensait l’impensable », Le Monde diplomatique, janvier 2002.
13. David Frum, « Unpatriotic Conservatives, A War Against America », National Review, 7 avril 2003.
14. Andrew Rich, « U. S. Think Tanks and the Intersection of Ideology, Advocacy and Influence », NIRA Review, hiver 2001, p. 54-59.
15. Hans Nichols, « Soros Says Be Patient », The Hill, 20 avril 2005.
16. Tim Groseclose, Jeff Milyo, « A measure of Media Bias », The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 120 (4), p. 1191-1237.
17. Robert Kagan, William Kristol, « The Tepid Consensus », Foreign Affairs, juillet-août 1996. Citations suivantes tirées du même article.
18. Jean Stefancic, Richard Delgado, No Mercy : How Conservative Think Tanks and Foundations Changed the American Social Agenda, Philadelphie, Temple University Press, 1996.
19. « Right Young Things, A Youthquake That is Helping George Bush », The Economist, 26 juin 2003.
20. Serge Halimi, « Des idées désormais jugées “naturelles”… », Le Monde diplomatique, janvier 2002.
En 1997, le Project for the New American Century, un institut néo-conservateur américain, présentait au président Clinton le projet d’une attaque contre Saddam Hussein pour détruire ses armes de destruction massive. Six ans plus tard, l’administration Bush adoptait l’idée et envahissait l’Irak.
Depuis les années 1980, les think tanks, ces « réservoirs d’idées » inspirés de modèles américains et britanniques, se multiplient et montent en puissance. Ces groupes, peu visibles malgré un intérêt récent des médias, sont plusieurs centaines au sein de l’Union européenne et façonnent les concepts sur lesquels seront fondés les projets politiques de demain grâce à leurs équipes de chercheurs et de communicateurs.
Qui sont-ils ? Quelles passerelles offrent-ils entre pouvoir, experts et entreprises privées ? Certains semblent véritablement indépendants, d’autres inféodés à des intérêts bien peu généraux… Proposent-ils des solutions politiques innovantes ou sont-ils de simples instruments de propagande idéologique ? Qui les finance ? La France est-elle en retard sur ce nouveau « marché des idées » ? L’Europe est-elle armée face aux États-Unis dans la course à la « diplomatie intellectuelle » ?
Cet ouvrage donne des clés pour comprendre comment sont forgées les solutions politiques de l’avenir.
Stephen Boucher co-dirige Notre Europe, think tank spécialisé dans les questions européennes fondé par Jacques Delors. Il a été conseiller auprès de la ministre belge des Transports, consultant en lobbying à Bruxelles et Londres, et maître de conférences à Sciences Po Paris.
Martine Royo, journaliste économique, a collaboré à l’AFP, au Nouvel Économiste et aux Échos comme chef de service étranger et grand reporter. Elle coordonne pour la section française d’Amnesty International les actions dans les Balkans.
Le préfacier, Pascal Lamy, est directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Conseiller au gouvernement Mauroy, il est devenu commissaire européen au Commerce international, et a présidé le think tank Notre Europe.
La collection « Échéances » fait le point sur les sujets d’actualité qui auront un impact certain sur notre avenir. Développement durable, nouvelles technologies, mondialisation, stratégie, débats européens : le lecteur accède à des informations synthétiques, claires, précises, présentées par des spécialistes.
La Presse : Les Echos, 4 mai 2006
Pascal Lamy le rappelle cruellement dans sa préface : "La France et l'Europe ne manquent pas d'idées, elles manquent de lieux où celles-ci peuvent circuler" pour enrichir le débat politique. Les "think tanks", ce terme aussi difficile à traduire en Français que le concept qu'il représente a du mal à s'inscrire dans nos traditions, en font incontestablement partie. "Laboratoires de pensées" ou "boîtes à idées", ils alimentent la réflexion politique depuis la fin du XIXe au Royaume-Uni, le début du XXe aux Etats-Unis. Et s'imposent désormais dans le paysage européen et français. Persuadés que ces "vitamines" jouent un rôle croissant dans la guerre des idées, cette "diplomatie intellectuelle" qui est devenue l'une des composantes de la stratégie des Etats, Stephen Boucher et Martine Royo nous entraînent à leur découverte dans un petit ouvrage aussi riche que didactique. Pas à pas, le coresponsable de Notre Europe, ce "think tank", créé par Jacques Delors, et la journaliste économique, dont "Les Echos" ont longtemps bénéficié du talent dévoilent au lecteur la réalité de ces réseaux d'influence multiformes. Leur origine comme leur pouvoir. Les retards accumulés par la France qui, en ce domaine, est à la traîne de Bruxelles... qui l'est de Washington. La nécessité d'y remedier pour éviter une grille de lecture uniquement anglo-saxonne d'une réalité de plus en plus complexe. En intervenant très en amont des décisions "pour alimenter le débat dans la durée". Sans doute faut-il encore introduire des critères d'évaluation et de transparence pour séparer le bon grain de l'ivraie, et "sortir les "think tanks" de leur tour d'ivoire". Un long cheminement. Au moins ce livre éclairé d'astucieux repères et tableaux, permet-il d'en comprendre les enjeux.
Le Monde Diplomatique, janvier 2007
"Il faut savoir gré à Stephen Boucher et à Martine Royo d’avoir répondu de manière concise et claire en adjoignant à leur propos une chronologie de la création des principaux instituts de recherche et quelques portraits de leurs inspirateurs en France (1). Mieux, les auteurs, loin de se satisfaire de compiler les sites Internet des think tanks et d’emmailloter l’ensemble de généralités relatives à la bataille des idées dans un monde « complexe », font un travail d’enquête qui confère son originalité à leur ouvrage."
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/01/HALIMI/14339
Préface de Pascal Lamy
Stephen Boucher co-dirige Notre Europe
www.notre-europe.asso.fr