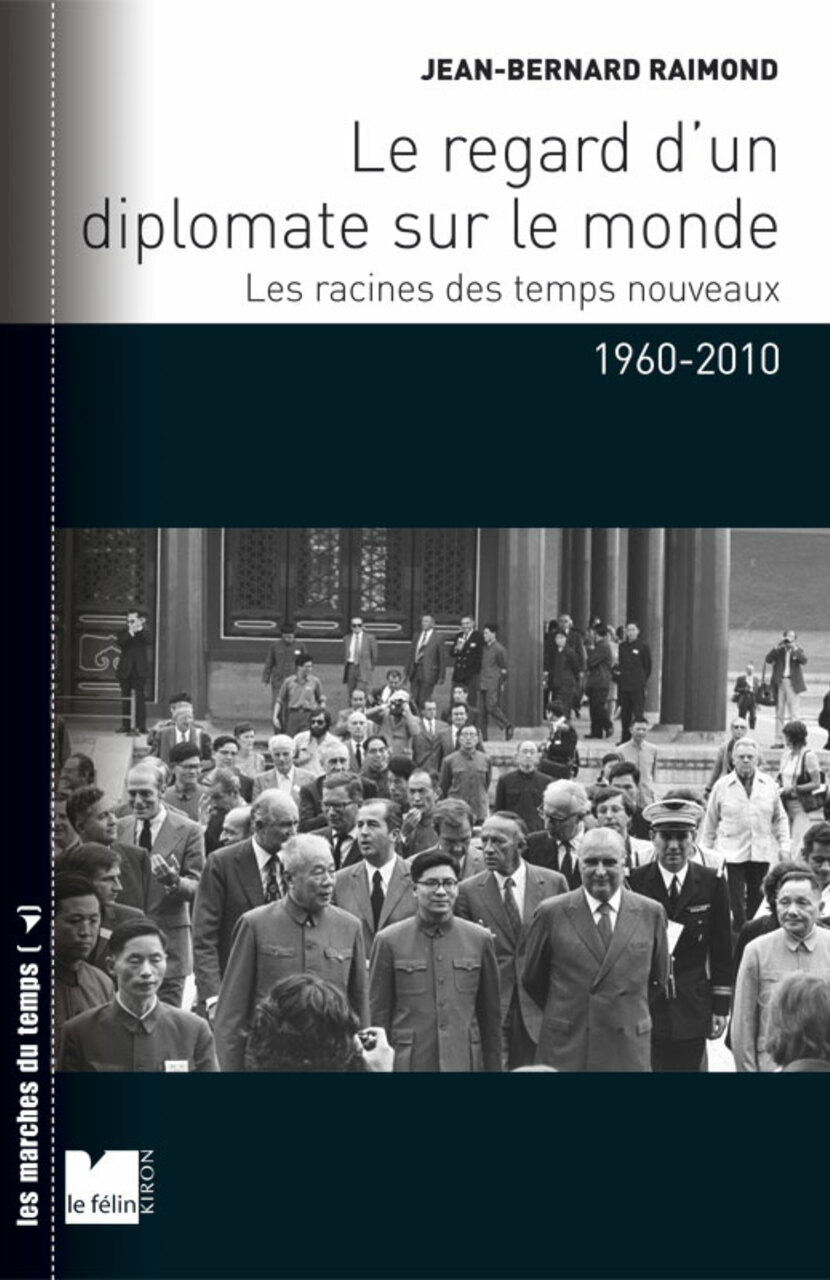
Le regard d'un diplomate sur le monde
Georges Pompidou:
l’homme derrière le personnage
Georges Pompidou laisse une trace paradoxale dans l’Histoire. Lorsqu’on évoque les présidents de la Ve République, on pense au général de Gaulle, à François Mitterrand, à Valéry Giscard d’Estaing et à Jacques Chirac plus spontanément qu’à Georges Pompidou. Une des raisons est, sans doute, la brièveté relative de son septennat (juin 1969-avril 1974) qui fut interrompu par la mort. Mais c’est sa longue présence aux deux postes les plus importants de l’exécutif qu’on oublie alors, puisque, avant d’être président de la République, il fut Premier ministre pendant six ans – d’avril 1962 à juillet 1968. L’homme que j’ai connu et dont j’ai été un proche collaborateur préférait agir et travailler sans bruit. Sa discrétion naturelle ne doit cependant pas masquer l’ampleur de ce qu’il a fait et qu’il nous a transmis.
Son parcours, il est vrai, fut un parcours singulier. Pendant longtemps, il ne disposa d’aucun mandat électif et, du jour où il devint député du Cantal en mars 1967, on ne le vit presque jamais siéger à l’Assemblée. Choisi comme Premier ministre par le général de Gaulle en avril 1962, il n’occupa son siège au Parlement que plus tard, en juillet 1968, lorsque le général de Gaulle l’eut démis de sa fonction exécutive au profit de Maurice Couve de Murville, mais pour un temps très court: le général de Gaulle quitta, en effet, le pouvoir en avril 1969 et Georges Pompidou lui succéda à la tête de l’État le 15 juin 1969.
La nomination de Georges Pompidou à Matignon en 1962 fut, à mon avis, un coup de génie du général de Gaulle. Elle témoigne de façon la plus spectaculaire de son attitude critique vis-à-vis des partis politiques. En 1958, il avait déjà nommé ministre des Affaires étrangères Maurice Couve de Murville, inspecteur des Finances et ambassadeur de France, puis, en 1960, il fit de Wilfrid Baumgartner un ministre des Finances, alors qu’aucun des deux n’avait de mandat électif. Maurice Couve de Murville, quant à lui, ne sollicita un mandat électoral qu’en 1967 dans le VIIe arrondissement, mais il échoua. S’il avait alors été élu, disait-on, le général de Gaulle l’aurait sans doute immédiatement nommé Premier ministre. En revanche, il ne fixa pas pareil préalable à la nomination de Georges Pompidou à Matignon.
En 1962, l’accueil que réservèrent les députés au nouveau Premier ministre fut tout sauf chaleureux. Ils exprimaient ainsi leur scepticisme envers un homme qui n’avait pas de carrière politique et qui, en outre, n’avait pas participé à la Résistance pendant la guerre. Sans doute avait-il, en 1944-1946, fait ses classes dans le cabinet du général de Gaulle qui, à son retour en 1958, lui en confia la direction. Entre-temps, il avait refusé la proposition du général de Gaulle d’être ministre des Finances. Finalement, sa déclaration d’investiture devant l’Assemblée nationale fut convaincante. Je fus, pour ma part, assez choqué par les réactions de mes collègues hauts fonctionnaires de l’époque qui avaient servi auprès de Michel Debré, quand il était Premier ministre (la plupart d’entre eux étaient d’ailleurs chez Jacques Foccart) et qui se lamentaient sur les dangers de voir lui succéder à Matignon un homme dont on pouvait mettre en doute la compétence. J’avais suivi, avec surprise, et non sans estime, le parcours de Michel Debré et n’oubliais pas que, dans l’affaire algérienne, il avait renié ses convictions les plus évidentes – ce qui relativisait les commentaires désobligeants de ceux qui laissaient entendre que Georges Pompidou n’avait pas la capacité de résister ou de réagir en s’appuyant sur son manque d’expérience en politique.
En 1968, après le départ de Maurice Couve de Murville pour le ministère des Finances, on me demanda de demeurer deux mois directeur adjoint du cabinet de son successeur au Quai d’Orsay, Michel Debré. Je découvris alors chez cet homme, que je n’avais jusque-là jamais rencontré personnellement, une chaleur humaine tout à fait exceptionnelle de la part d’un grand serviteur de l’État en même temps qu’un sens aigu du service public. Plus tard, entre 1968 et 1969, pendant les onze mois que Maurice Couve de Murville passa à Matignon, alors que j’occupais auprès de lui la fonction de conseiller technique pour l’Éducation nationale et les questions universitaires, je reçus souvent, dans une période très difficile compte tenu du comportement à la fois audacieux et indiscipliné d’Edgar Faure, un soutien indirect, mais qui me toucha beaucoup, de Michel Debré.
Pendant ses six années à Matignon de 1962 à 1968, Georges Pompidou fut le maître d’œuvre pour la politique intérieure. Dès les premiers mois il rencontra des difficultés. Je le revois encore à l’occasion d’une cérémonie aux côtés du général de Gaulle dans une voiture découverte alors que le maintien même du pouvoir était en suspens. Je me demandais comment il supportait les attaques de l’opposition. Pour ce qui est de l’industrialisation de la France, c’est lui qui fut responsable des grands choix dont nous bénéficions aujourd’hui encore, notamment dans le domaine du nucléaire militaire et civil, ce qui entraîna de sérieuses tensions dans les relations franco-américaines. En effet, en 1962 notamment, les Américains menèrent une politique de contestation tous azimuts contre le choix nucléaire de la France. Ils estimaient que l’équilibre international ne pouvait se maintenir que si eux seuls avaient la capacité de faire face aux menaces soviétiques. À leurs yeux, toute autre puissance, fût-ce la France, détentrice d’un pouvoir d’intervention dans le domaine de la dissuasion risquait de compromettre tout l’équilibre Est-Ouest sur le plan de la défense.
Rappelons que, dès son arrivée au pouvoir en 1958 et surtout pendant la crise de Berlin, le général de Gaulle fut en Occident le seul homme d’État qui manifesta la plus grande fermeté devant l’aventurisme de Nikita Khrouchtchev et l’expansion soviétique. Ce fut le cas pendant la négociation qui se tenait à Genève et qui réunissait les grandes puissances: l’Union soviétique, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et les deux Allemagnes. Ni Christian Herter, secrétaire d’État américain, ni Selwyn Lloyd, secrétaire au Foreign Office, n’eurent en présence d’Andreï Gromyko une fermeté aussi clairvoyante que celle qu’exprima Maurice Couve de Murville au nom du général de Gaulle. On ne pouvait pas demander non plus au professeur Wilhelm C. Grewe, représentant de l’Allemagne fédérale dont la position internationale était affaiblie à l’époque par la division de l’Allemagne qui s’était renforcée au cours des années précédentes, d’être le champion de la résistance aux projets soviétiques. Car ceux-ci, en fait, visaient, par la consolidation du statu quo européen, à neutraliser la République fédérale d’Allemagne.
En 1959, la situation des deux Allemagnes apparaissait dans la structure même de la salle de négociations. Pour éviter toute méprise en ce qui concernait la reconnaissance de l’Allemagne de l’Est, les délégations des deux Allemagnes n’étaient pas à la table des Grands: elles disposaient chacune – ce qui peut paraître dérisoire – d’une table séparée, mais adjacente, avec un léger espace par rapport à la table principale. Déjà à l’époque, même ce distinguo paraissait ridicule, ce qui conduit Maurice Couve de Murville, ironisant sur la formule habituelle utilisée pour parler de la République démocratique Allemande – la soi-disant RDA ou DDR –, à parler dans les réunions préparatoires occidentales du «soi-disant» docteur Lothar Bolz, ministre adjoint des Affaires étrangères qui représentait la RDA.
Aujourd’hui, dans le monde entièrement nouveau dans lequel nous vivons et qui a vu, au cours des années 90, l’Allemagne non seulement se réunifier, mais aussi entrer dans l’Alliance Atlantique, il est difficile de ne pas considérer comme dérisoire une négociation comme celle de Genève en 1959 qui aboutit à un échec total, alors que les Occidentaux avaient proposé un plan de paix somme toute assez complexe. Ce plan mêlait des concessions apparentes aux thèses soviétiques en Europe, et, en retour, des chances d’évolution à travers des propositions partielles d’élections. Ce genre de conduite, que l’on pourrait qualifier d’échec, était considéré dans le contexte de la guerre froide à l’Ouest comme un succès. Du reste, il fut rejeté par les Soviétiques. En fait, l’initiative appartenait souvent au monde communiste, car son idéologie, même si elle avait tendance à se dégrader, sinon à se fossiliser, restait un moteur d’expansion permanent et une dynamique à court terme. À l’inverse, comme on le vit à la fin des années 80, l’idéologie «implicite» des démocraties européennes ne devait l’emporter que sur le long terme. Avec le recul, on comprend également aujourd’hui que ces politiques occidentales sages, mais souvent impopulaires, ont retardé ou empêché de fausses solutions prosoviétiques et permis, au contraire, ce que l’on a appelé en 1989 – un peu vite peut-être – la fin de l’URSS.
En 1967, Georges Pompidou, en qualité de Premier ministre, fut invité à Moscou et à Leningrad. Étant moi-même directeur adjoint du cabinet de Maurice Couve de Murville, alors ministre des Affaires étrangères, j’accompagnai ce dernier dans ce voyage. Selon les habitudes de l’époque, il appartenait au chef de la délégation de prendre la parole sans en référer au ministre des Affaires étrangères. Et je pus constater alors que Georges Pompidou s’en sortait très bien. L’une des caractéristiques de l’homme politique Pompidou était d’avoir sur le plan intellectuel plusieurs cordes à son arc: la culture, l’économie (en grande partie grâce à son passage à la banque Rothschild) et la curiosité de l’étranger. C’est pourquoi, quand il fut élu à la présidence de la République en 1969, il prit d’emblée un certain nombre d’initiatives qui le démarquaient du général de Gaulle, ce qui surprit certains journalistes, auxquels je répondis en leur rappelant le pragmatisme même du général de Gaulle qui était passé de la fermeté en 1959 à la détente avec les Soviétiques. Les initiatives de Georges Pompidou, président de la République, eurent également le mérite d’être prises pour certaines et non des moindres, sous le regard du Général, silencieux à La Boisserie. Ainsi dès juillet 1969, son premier geste, en prévision du Conseil européen de La Haye, fut-il de renouer avec les autres Européens en renonçant à refuser l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Europe, refus qui avait été formulé brutalement et sans appel par le général de Gaulle, ce qui s’était traduit par un blocage des institutions.
Le changement fut tel que les Britanniques eux-mêmes n’y croyaient pas. Durant l’été, Michael Palliser, chargé d’affaires de l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris, vint me voir souvent à l’Élysée où j’étais devenu conseiller diplomatique du Président en me disant avec un sourire amusé que l’ambassade était convaincue de la sincérité de Georges Pompidou, mais qu’elle ne pouvait en convaincre le Foreign Office. Dès son arrivée à l’Élysée, Georges Pompidou noua une relation amicale avec Edward Heath qui fut certainement, de tous les responsables britanniques, le plus ardent partisan de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Europe. Nous allâmes souvent à la résidence du Premier ministre britannique. Georges Pompidou attacha par la suite une importance exceptionnelle à la négociation avec le Royaume-Uni. Il négocia pendant plusieurs jours à Paris directement avec Edward Heath avec le seul concours de deux interprètes: pour Georges Pompidou, ce fut Constantin Andronikov qui, du temps du général de Gaulle, était déjà interprète pour le russe et l’anglais; quant à Heath, il avait comme interprète un diplomate de haut rang qui n’était autre que Michael Palliser, gendre de Charles-Henri Spaak, et donc parfaitement bilingue. Cette négociation fut entourée du plus grand secret. Michael Palliser et moi-même, en lieu et place de Constantin Andronikov, nous fûmes chargés de comparer les deux comptes rendus français et britannique. Cela nous prit presque deux jours pour constater et confirmer qu’ils étaient bien identiques.
Du côté français, il n’y eut, sur le moment, aucune diffusion. Les ambassadeurs qui pouvaient y avoir accès devaient accepter de venir consulter le procès-verbal dans mon bureau. Ce fut le cas en particulier d’Hervé Alphand, alors secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et de Jean Sauvagnargues, ambassadeur à Bonn. Cela me changeait beaucoup. Du temps du Général, tous les comptes rendus sans exception étaient diffusés par le Quai d’Orsay (plus précisément par le directeur adjoint du cabinet du ministre) aux principaux grands postes: Londres, Washington, Moscou, Bonn, parfois New York-ONU, et à quelques grands directeurs de l’administration centrale du ministère. Je ne pense pas que cet excès de secret ait été la décision de Georges Pompidou. J’y verrais plutôt une manifestation du caractère jaloux de son autorité de Michel Jobert. Et je pense sincèrement que cette façon contestable de communiquer n’a pas rehaussé – bien injustement – l’image du Président.
J’aborderai plus loin les grands dossiers dont Georges Pompidou avait hérité du général de Gaulle et auxquels, une fois président de la République, il allait donner sa propre impulsion. Je voudrais m’attarder un instant sur la Chine telle qu’elle se présentait en 1969, car, dans le bilan de politique internationale de Georges Pompidou président, elle occupe une place à part.
Jusqu’en 1966, mes fonctions au Quai d’Orsay me laissaient une assez grande liberté pour m’intéresser à différents sujets de politique internationale. J’ignorais alors que cette expérience me servirait, plus tard, quand j’aurais à les traiter auprès de Maurice Couve de Murville, puis de Georges Pompidou. À cette époque-là, j’étais plus particulièrement chargé des relations Est-Ouest au sein desquelles je considérais que toute la dimension idéologique du communisme s’étendait bien au-delà de l’URSS et des Pays de l’Est. J’avais la conviction que l’Extrême-Orient n’était pas une donnée marginale de la politique étrangère, précisément la Chine que, du reste, le général de Gaulle avait reconnue, dès 1964, au grand dam des Américains, soit près de huit ans avant Richard Nixon.
Lors de la reconnaissance de la Chine, Bruno de Leusse, ministre conseiller à notre ambassade à Washington, et par conséquent chargé d’affaires en l’absence de l’ambassadeur, fut convoqué sur-le-champ au Département d’État. En sa qualité de sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques, Averell Harriman était présent à l’entretien. On laissa Bruno de Leusse debout le temps d’écouter la réaction brutale des États-Unis dans cette époque de guerre froide où le général de Gaulle apparaissait comme menant une politique de plus en plus indépendantiste. En termes diplomatiques, pareil traitement réservé au représentant d’un grand pays allié en disait long sur le choc qu’avaient ressenti les Américains et sur leur état d’esprit envers la France et sa politique en Asie. Et pourtant, la vision du Général était juste, d’autant qu’il connaissait, aussi bien sinon mieux que les Américains, la politique erratique qu’avaient menée les États-Unis vis-à-vis de la Chine d’après guerre.
Jusqu’en 1949, avec la victoire de Mao Zedong, les États-Unis ont tenté de maîtriser le basculement de la Chine dans un monde communiste avec d’intelligentes missions confiées à des militaires ou à des politiques américains. Ces hommes de bonne foi, avec des instructions clairvoyantes, n’ont pu empêcher l’effondrement du régime de Jiang Jieshi (Tchang kaï-chek) qui allait pendant plus de vingt ans représenter la Chine au Conseil de Sécurité. Je me souviens seulement que, selon moi, la France aurait pu, en 1964, au moment où elle allait rouvrir son ambassade à Pékin, être plus courtoise et généreuse avec ceux qui, avant la reconnaissance de Pékin, avaient représenté la Chine à Paris.
Le regard d’un diplomate sur le monde, 1960-2010, s’inscrit dans la lignée des trois premiers ouvrages de Jean-Bernard Raimond. Ce ne sont pas des mémoires, mais le récit des temps forts de l’histoire contemporaine qui ont contribué à transformer radicalement le monde dans lequel nous vivons: les événements de 1968, la révolution polonaise de Solidarnosc, la chute du mur commémorée le 9 novembre, la question des Balkans, au cœur de l’actualité, en raison même de l’espoir pour la Serbie et le Kosovo d’une stabilité retrouvée grâce à la progression des institutions européennes, les conséquences de la guerre d’Irak, les problématiques nouvelles d’une Chine en plein essor, éclairées par les mémoires secrets publiés en mai 2009 de Zhao Ziyang le dirigeant chinois inventeur de la réforme économique de Deng Xiaoping. Plusieurs acteurs du monde moderne occupent une place centrale dans ce livre: Georges Pompidou, qui a été et reste pour Jean-Bernard Raimond une des personnalités françaises les plus marquantes qu’il ait connues; Saddam Hussein que l’auteur a rencontré en 1996 avant que n’éclate la guerre recherchée depuis la première crise du Golfe par les milieux influents des États-Unis; François Mitterrand et Jacques Chirac, dont Jean-Bernard Raimond a été le ministre des Affaires étrangères sous la première cohabitation – qui fut confrontée à l’affaire des otages; enfin, Jean-Paul II et Mikhaïl Gorbatchev, sans lesquels notre monde contemporain ne serait pas tout à fait ce qu’il est. Au-delà des péripéties politiciennes de notre hexagone, le lecteur découvrira comme un livre ouvert les vraies questions du monde issu de 1989.
Ancien élève de la rue d’Ulm et de l’ENA, agrégé de lettres classiques, diplomate depuis 1956, Jean-Bernard Raimond, Ambassadeur de France, a été ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1988 et membre de l’Assemblée nationale de 1993 à 2002. Il a publié trois livres, Le Quai d’Orsay à l’épreuve de la cohabitation (Flammarion, 1989), Le Choix de Gorbatchev (Odile Jacob, 1992) et Jean-Paul II, un pape au cœur de l’histoire (Le Cherche Midi, 1999 et 2005).