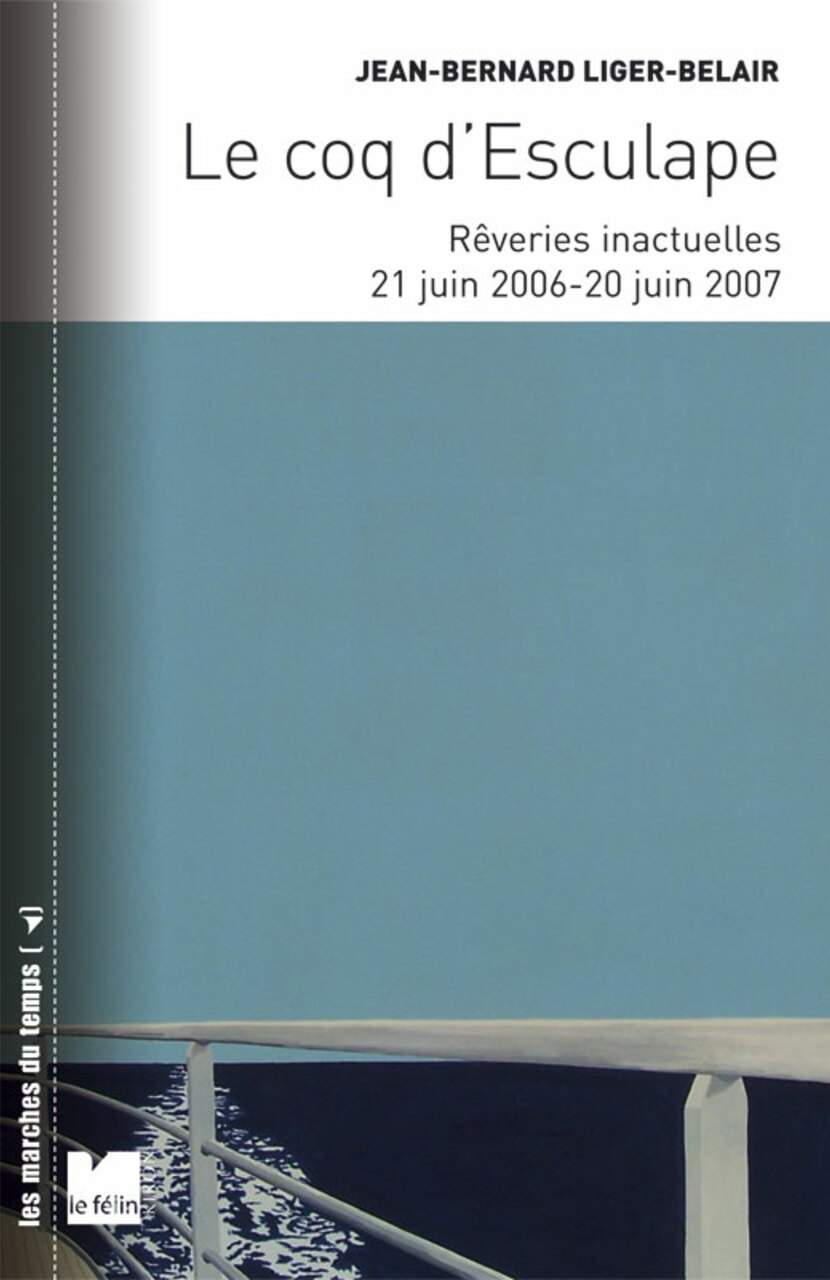
Le coq d'Esculape
Paris, mercredi 21 juin 2006
Hier je me suis couché tard.
J’ai dîné chez Geneviève avec Marylène. Cette dernière raconte une récente visite à La Montmarie, autrefois propriété des parents d’Irène, combien elle était impressionnée dans son adolescence par ces lieux. Déjà Geneviève m’avait dit, il y a des années de ça:
«Tu aurais vu monsieur de N. descendre le grand escalier à La Montmarie…»
Le château est fermé, plus ou moins à l’abandon, les volets dépenaillés, la terrasse qui le précède envahie de mauvaises herbes, le parc retourne à l’état de jungle.
Il y a longtemps que monsieur de N. ne descend plus le grand escalier, et qu’il est descendu dans la tombe.
Mais Marylène raconte aussi qu’elle connaît un endroit, dans la forêt de Compiègne près de chez elle, isolé, perdu, où pousse une végétation extravagante pour le lieu, des hortensias, des buis, des troènes, le tout mêlé à la flore naturelle, et ce sur une superficie approximativement équivalente à celle d’un parc, à celle d’un ancien parc qui ne s’effacerait pas.
Je leur raconte à mon tour comment j’avais été marqué à quatorze ans, à La Bergerie, propriété des grands-parents d’Anne-Catherine, par une photo encadrée qui se trouvait dans l’entrée. Ce petit village, La Londe, ne possédait pas de château. Il ne se composait que de quelques fermes et des castels de la bourgeoisie issue de la Révolution, et propriétaire des terres. Et pourtant cette photo, prise par un avion, du ciel, révélait, à la seule couleur de la végétation, la géométrie parfaitement ordonnée d’un important bâtiment, un corps central, des ailes, le tout situé au cœur d’un réseau d’allées en étoile, dont la plus longue, qui démarrait dans l’axe de ces traces, était aujourd’hui la route d’Elbeuf.
Je leur raconte encore mon passage à Douce-Amie à Biarritz, il y a quelques années. Il y avait trente ans que je n’y étais pas allé. La maison venait sans doute d’être vendue par les héritiers de ma marraine, elle était en plein travaux. Je revois, sur l’appui de la fenêtre du salon, cette curieuse coupelle taillée dans la pierre, avec son petit vidoir. Le riche acquéreur de Douce-Amie ne saurait jamais, comme je le sais, que la tante Camille, infirme à qui ses parents avaient offert cette folie arabisante vers 1880, faisait près de cette même fenêtre, immobilisée sur un fauteuil à roulettes dans le genre Thonet, dont la ruine traînait encore dans le grenier à l’époque de mon adolescence, rompue, des aquarelles. La coupelle taillée dans la pierre de l’appui était sa réserve d’eau, ainsi elle ne pouvait pas la renverser.
Disparaître, oui, mais comment?
Pensée du jour: «Un homme sain, à l’esprit sain, solidement posé, solide dans sa vie, n’écrit pas, ne penserait même pas à écrire.» Paul Léautaud.
Paris, jeudi 22 juin 2006
Disparaître: cette crainte date-t-elle de l’aube, ou du couchant, de la modernité, du jour où Galilée renia faussement et où Descartes douta vraiment, du jour où l’infini est venu remplacer l’enclos, du jour où le toujours plus loin d’un univers dont le silence effrayait Pascal s’est substitué au cosmos, à l’ordre calme d’une sphère sans extériorité? Du jour où le toujours plus d’une vie possiblement éternelle a remplacé le τό τί ἦν εἶναι (être ce qu’il a été donné d’être) d’une existence harmonieusement bouclée par sa fin, telle qu’en elle-même par son terme installée? Du jour où le parfait a été remplacé par le passé dit simple, lui-même rendu de plus en plus obsolète par l’imparfait triomphant? La promesse judéo-chrétienne d’une survie aurait tué la Grèce? Le Phédon la contenait déjà. Alors, où est passé le parfait ? Que celui qui l’a volé le rende, il ne l’emportera pas en paradis.
Pensée du jour: «On ne va pas attendre un improbable au-delà pour se branler bêtement avec les anges. L’éternité est inutile, c’est ici et fissa qu’il faut lutter.» Pierre Autin-Grenier.
Paris, vendredi 23 juin 2006
Georges, avec qui je dînais hier soir, me dit qu’il est athée. «Pour être athée il faut être bon théologien», lui réponds-je.
Il me dit aussi repenser souvent à ce propos que je lui avais tenu lors d’un de nos précédents dîner, qu’un univers sans personne pour le voir est quelque chose d’inconcevable, une absurdité.
Il faut se donner parfois beaucoup de mal pour rendre insomniaques ses meilleurs amis. Quant à moi, aucun problème, pas besoin d’eux pour ne pas dormir.
Le Barroux, mardi 27 juin 2006
Me voici rentré en Provence avec une grosse catastrophe sur la table: un projet de livre.
Micheline, à qui j’avais envoyé hier soir la nouvelle du permis de construire que je viens d’obtenir afin d’agrandir la maison (déjà trop grande pour ma modeste et solitaire personne), avec la photo du projet, le tout accompagné du commentaire: «Serons-nous plus heureux après, j’en doute», me répond ce matin:
«Bravo, mais la lucidité n’est-elle pas un vilain péché?»
Char disait: «La blessure la plus rapprochée du soleil.» D’où naîtrait le malheur, si ce n’était de la conscience? Tentation luciférienne: s’abîmer dans la conscience pure.
Pour me réveiller de ce mauvais rêve, je m’allume une cigarette.
Pensée du jour: «Il faut une considérable dose d’inconscience pour s’adonner sans arrière pensée à quoi que ce soit.» Cioran.
Le Barroux, mercredi 28 juin 2006
La fontaine, au bout de la piscine, déverse sa mélodie dans l’eau du bassin, enveloppant l’enclos d’une brume sonore que ne traversent, qu’étouffés, les bruits de l’extérieur. Les cigales cigalent, comme il se doit. J’ai placé le transat sous les oliviers. Les chiens, couchés à l’ombre, somnolent aux aguets. Ce soir, avec Jean-Mi, nous irons arroser au cabanon de Gilles, et y dînerons. Magret de canard grillé au feu de ceps de vigne et sa, comme disent les cartes de restaurants, sa fricassée de pêches au fumet de cannelle. Wine of Provence, of course. Que manque-t-il? «Ce qu’on ne peut pas dire, il faut le taire.»
Et, puisque le spectre de Wittgenstein vient de s’introduire dans la bulle (les chiens grognent, ils ne veulent absolument pas entendre que «Si les lions parlaient, nous ne les comprendrions pas»), ses derniers mots à sa logeuse, puisque ses amis, qu’elle avait appelés d’urgence, n’étaient pas arrivés:
«Vous leur direz que j’ai été très heureux.»
Ἐν εὐφημία χρὴ τελευτᾶν.
Le Barroux, jeudi 29 juin 2006
Gilles répond à son tour à l’envoi de mon permis de construire et au même commentaire.
«Pour le bonheur, écrit-il, l’important est de ne pas se couper les ailes… ou la queue.»
Autre registre, c’est le nid qui me semble en cause. Mais ce n’est pas ou, c’est et la queue qu’il faut dire: d’abord les ailes, puis, quand la copulation a produit son double fruit, progéniture et mère, le reste.
Jean-Mi me réveille ce matin à six heures, il part travailler, puis en week-end chez la sienne, de mère, dans le Gers. En guise d’adieu, je le retiens par le reste, triomphant, comme il se doit au réveil des petits garçons, en lui disant:
«Je garde ça.»
Il me répond:
«Qu’est-ce que tu en ferais si je n’étais pas au bout?»
Au bout, en effet, même dans ce qui se veut le plus crapuleux, il faut quelqu’un, ce mystère inexorablement opaque, pour que surgisse le désir.
Le Barroux, samedi 1er juillet 2006
Hier soir je dînais sur la terrasse. Devant moi, dans le lointain, les Monts du Vaucluse dépliaient au couchant leurs replis azurés. Rien ne bougeait, le village s’était tu, comme figé par le spectacle, ébloui par tant de splendeur. Je me souvins alors, comme si j’y étais, d’un même dîner (j’en sais encore la date, c’était un vingt et un juin) dans ma précédente maison, en Normandie, il y a trente ans (à partir d’un certain âge, l’unité de compte devient la décade). Devant ma table le bois étalait sur la colline en face le chatoyant contraste de ses feuillus et de ses conifères, dans la vivacité d’un même couchant. Pas un bruit, que le tintement de la rivière à cinquante mètres en contrebas. Jamais je n’y avais repensé. Dans ces deux couchants inopinément rapprochés, comme la petite madeleine, soudain s’imposait à moi hier soir cette évidence cartésienne que même Dieu ne peut pas faire que ce qui a été n’ait pas été. Experimur, écrit Spinoza, experimur : nous expérimentons, ce n’est pas rien ce mot, pas nous imaginons ou nous concevons, non, «Nous expérimentons que nous sommes éternels».
Auparavant j’avais pris un verre avec Martine, ma courageuse professeur de piano. Soit dit en passant, pour le piano l’éternité ne me sera pas de trop, je le ferais enterrer avec moi, trop lourd pour une ascension. Nous reparlions des tentatives de suicide d’une de ses amies:
«Mais c’est fini, maintenant elle aime la vie», me disait-elle.
Avant aussi, on ne se suicide pas parce qu’on aime la mort. Mais la vie absolue, qui n’est pas la vie, le clair-obscur, le temps qui dure longtemps et passe si vite, le misérable petit tas de souvenirs, la lente approche de l’apnée terminale. Il n’y a pas de Dieu, donc je suis Dieu, donc je me suicide, raisonne Kirilov dans Les Démons de Dostoïevski.
Et Lui, pourquoi ne se suicide-t-il pas? Question métaphysique intéressante, mais que je ne pourrais pas poser s’il le faisait.
Pensée du jour: «Comment les années peuvent-elles passer si vite avec des jours qui durent si longtemps?» Vladimir Jankélévitch.
Le Barroux, dimanche 2 juillet 2006
Je repense à cet incroyable experimur. On comprend que la synagogue ait viré ce brave Baruch. Le propos est chrétien, l’absolu vient expérimenter la nature au point d’en crever. Fin de la transcendance, fermez le ban. Εἶναι καὶ ἐνταῦθα θεούς, il y a aussi des dieux ici-bas, comme le dit le père Héraclite.
Je dîne hier soir chez Marie-Françoise. Elle me reparle de la vie sexuelle de pute que lui imposait son mari, officier de marine, quand il revenait: lingerie coquette et autres délices. Quelle solitude, cet homme, qui devait hanter les bordels de tous les ports du monde et qui, revenu à la maison, plantait le même décor de non-rencontre. Quelle solitude, le sexe. C’en est à se demander si, ruse de la nature, ce truc dont la fonction apparente est d’unir, n’a pas comme destination réelle de murer chacun dans le plus addictif des isolements. Comment ne pas croiser quelqu’un? Le baiser. N’est-ce pas le sens même du mot dans son acception la plus courante?
Pensée du jour: «Que d’histoires pour ne pas se faire baiser!» Simone de Beauvoir.
Le Barroux, lundi 3 juillet 2006
À partir de samedi, la maison étant louée, je pars m’installer pour une semaine dans le cabanon de Gilles à Crillon. Et je suis ravi. Bougeotte quand tu nous tiens! Je me retrouve dans quarante mètres carré, je perds la piscine, et je compte les jours. Certes je vais vivre en pleine nature au milieu des cigales, les chiens vont pouvoir courir (je supporte très facilement qu’ils ne le puissent pas, «On a toujours assez de courage pour supporter les malheurs des autres», selon La Rochefoucauld), mais quand même je ne peux pas m’empêcher de penser que les plantes, avec leurs racines, sont plus heureuses que nous. Aristote disait qu’elles ont la tête en bas, la bouche dans le sol. Je devrais essayer, mais je crains qu’il ne soit un peu tard, avec mon arthrose. Ça sera pour la prochaine fois, je m’y prendrais plus tôt, je veux être… un baobab. Pas à cause de la taille, mais parce que les premières lettres de l’alphabet semblent acquises. Je ne peux pas renoncer à savoir lire. Je veux qu’un vent favorable ait jeté la petite graine du gros arbre sur la tombe perdue du stagirite. Je serais un baobab qui se nourrit d’Aristote. Et qu’on ne me dise pas que je suis exigeant, pour Qui est capable de ressusciter, c’est un jeu (un je?) d’enfant.
Je (le même) rassure le lecteur éventuel, et improbable, je n’ai pas fumé la moquette. La preuve, hier soir, en me lavant les dents, je regardais le lavabo se vider. Chacun sait que l’eau tourne toujours dans le même sens, curieusement contraire à celui des aiguilles d’une montre (qui a choisi ce sens pour conter le temps?), et que ce sens est lié au mouvement de la terre, lequel agit tant sur celui des autres planètes que sur le soleil lui-même, lequel…, bref l’eau jetée de mon verre à dent était directement en relation avec la mécanique universelle. Un pendule de Foucault à domicile, et à usage privé, c’est vraiment très utile de se laver les dents. Allez nier devant pareil spectacle qu’il se passe effectivement quelque chose? Le rêve d’un papillon qui se demande s’il rêve? Il y a au moins du rêve.
Ai-je été convainquant, concernant la moquette? Je n’en suis pas sûr.
En tout cas, après ces petites réflexions, pour une fois j’ai dormi du sommeil du juste. Sans rêver.
Pensée du jour: «Quoique beaucoup de gens meurent en fous, très peu de fous meurent.» Baltasar Gracian.
Journal d’une année tranquille – ou presque – dans la vie d’un homme trop lucide pour être heureux et trop épicurien pour être malheureux. « Je ne compte que les heures claires », est-il souvent gravé sur les cadrans solaires. C’est vrai pour eux, pas pour nous. Ils comptent peut-être, mais ne savent pas conter. L’oiseau de Minerve, comme chacun sait, ne prend son vol qu’à la tombée de la nuit. Ici, le journal littéraire est un genre à part entière et c’est ce que nous restitue Jean-Bernard Liger-Belair, philosophe et romancier, avec l’âpreté et l’ironie qu’on lui connaît.
Jean-Bernard Liger-Belair est docteur en philosophie. Il a publié trois romans, Le Rôti (suivi de Le garçon qui disait Suis moi), Balland, 1999 ; Baisse tendancielle du taux de plaisir, Pauvert, 2002 ; L’agonie d’Agrippine, La Martinière, 2004 et un essai L’Ombre nécessaire paru en 1990 aux Éditions du Félin.