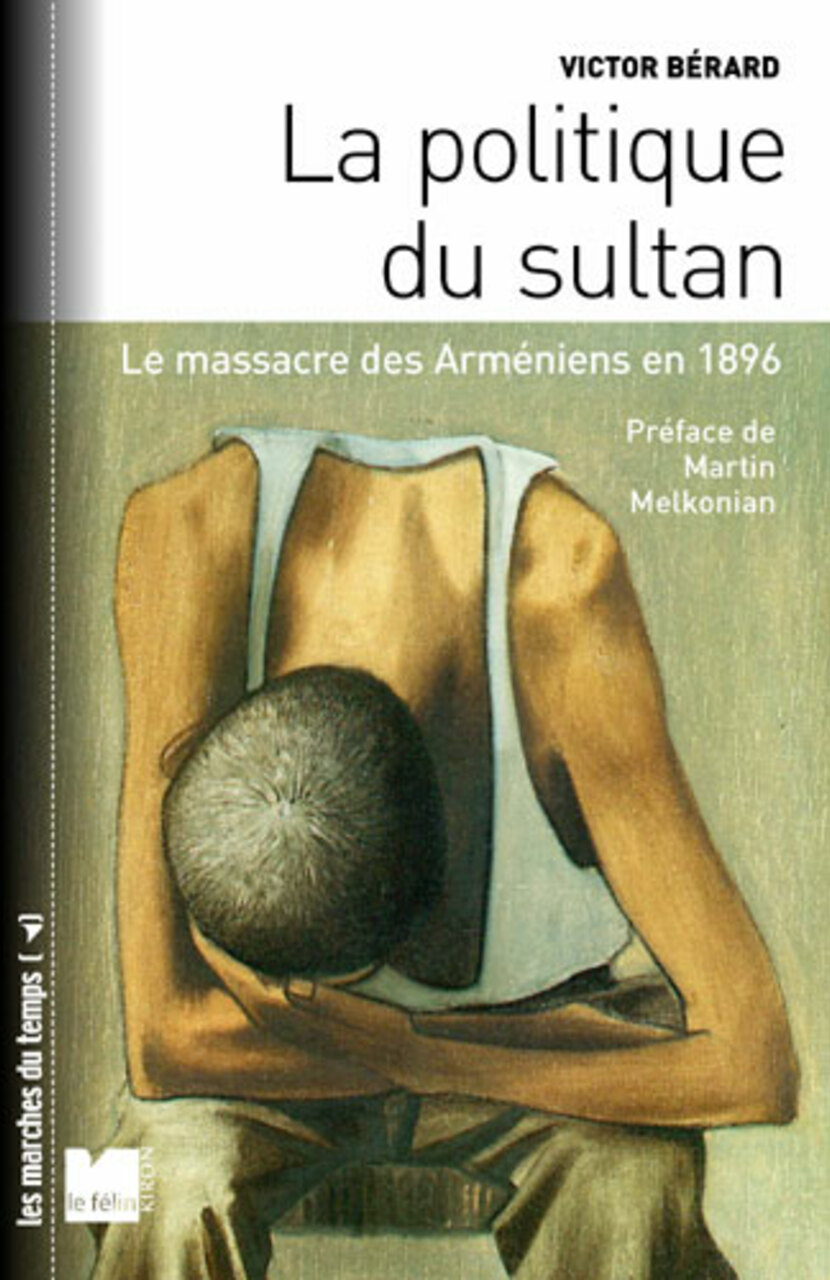
La Politique du Sultan
Les informations entre crochets carrés [ ] sont de la responsabilité de l’annotateur.
M.M.
CONSTANTINOPLE
I
Au fond de la Corne d’Or, en face des cyprès et de la sainte mosquée d’Eyup, Haskoy était un faubourg de Constantinople, habité surtout par des familles arméniennes. Haskoy, n’ayant aucun monument, n’était pas visité des touristes. Haskoy était presque inconnu des Européens, séparé de Galata et de Péra, quoique sur la même rive, par les arsenaux de Ters-Hané. Haskoy, d’ailleurs, ne se distinguait en rien des autres quartiers proprement turcs. C’étaient les mêmes ruelles en pente qu’à Stamboul, les mêmes petites maisons de bois, le même aspect de délabrement et de bâtisses provisoires, et la même absence de bruit et de mouvement. Le matin, seulement, quelques bandes d’hommes et de garçons descendaient à l’échelle des bateaux, pour venir au Grand-Pont ou traverser la Corne d’Or. Ils s’en allaient aux boutiques du bazar. Ils revenaient le soir, leur journée faite. Ils étaient artisans, tailleurs et cordonniers, gagnaient leur vie au jour le jour, et ne possédaient que les quatre murs de bois et le mobilier sommaire de leurs cases tout orientales. À Haskoy, pas de richesse étalée comme par les Grecs du Phanar ou les capitalistes de Péra ; pas d’exploitation du voisin en des métiers louches et des tripotages d’argent; pas de discussions politiques non plus: ils vivaient loin du Patriarcat et de Koum-Kapou, centre de la nation arménienne. Beaucoup avaient recueilli chez eux des femmes, des filles et des enfants échappés aux massacres d’Asie Mineure. Ils savaient quel sort les attendait au premier signe de mécontentement. Ils vivaient dans le calme, au bout de la ville, à la limite des champs et des cimetières, et, satisfaits de vivre, ils cherchaient à se faire oublier.
«Il faut aller à Haskoy, m’avait-on dit. Nous ne pouvons vous offrir aucun massacre en ce moment: il ne reste plus assez d’Arméniens. Mais revenez au printemps prochain: les Bulgares seront alors de la fête. En attendant, allez voir Haskoy.»
Nous débarquions à l’échelle1 d’Haskoy par cette matinée voilée d’octobre. Nous étions trois Français. Devant nous, descendirent des vitriers, chargés de vitres, et des menuisiers avec leurs outils; un homme de la police les attendait au débarcadère et les emmena. Derrière nous, un hamal (portefaix), chargé de couvertures et de lainages, précédait un drogman2 de l’ambassade de France qui venait porter des secours aux prêtres arméniens. À l’échelle, des portefaix et des soldats de marine travaillaient à emplir un chaland: tables boiteuses, chaises défoncées, portes, cadres de fenêtres, tiroirs de commodes, glaces éclatées, tapis souillés de larges taches noirâtres: «C’est du sang», dit l’un de nous en tâtant un grumeau de cheveux et de cervelle. Les portefaix et les soldats entassaient dans le chaland ce pêle-mêle de mobiliers en morceaux; depuis un mois, chaque jour, plusieurs barques ainsi chargées s’en vont à l’arsenal…
Les petits cafés grecs du bord de l’eau, avec leurs portraits du roi Georges et de la reine Olga, sont ouverts, mais vides. Rien n’a dérangé leurs fioles alignées, leurs cafetières de cuivre luisantes ni les toiles que, dans l’ombre des plafonds, filent leurs araignées. Inoccupés, devant leurs tonneaux de sardines et d’olives, les épiciers grecs lisent les journaux en activant de puantes fritures. Rien n’a troublé leurs discussions politiques. Pas un Grec, pas une maison grecque, pas une vitre grecque n’a été endommagée, et ce semble un pur miracle dans cette échelle d’Haskoy, où boutiques et maisons des Grecs et des Arméniens étaient confondues, indiscernables. Mais toutes les boutiques arméniennes, mises à sac, ont maintenant leurs auvents rabattus. Devant, sous les treilles dépouillées, autour de plateaux et de tasses, des ronds de soldats et de policiers fument. Un colonel, en grand uniforme, cravate toute neuve de commandeur au col (l’armée turque, depuis un mois, a reçu beaucoup de décorations), est venu à notre rencontre. Il nous a donné pour guide un homme de confiance, avec ordre de nous montrer dans le détail tout ce qu’a fait, pour soulager ces malheureux, la générosité de S. M. le Sultan.
À travers les rues désertes, le long des maisons closes aux fenêtres fraîchement revitrées, l’homme nous conduit à l’église, que rien ne laisse deviner derrière une haute muraille. Il faut frapper longtemps à la porte bardée de fer. L’église, bâtie sur une terrasse dallée, est assez grande, mais sans clocher et sans façade, et, à l’intérieur, sans luxe, sans une dorure, sans un cadre. C’est l’église d’une très pauvre communauté, comme on en peut voir dans nos paroisses de montagnes, proprette, avec un plancher de sapin, des bancs de sapin, des murs blanchis à la chaux et un autel de bois peint. Les Arméniens de ce quartier étant tous de petits artisans, leur église était pauvre. D’ici, sur une porte, on peut lire encore, au-dessous de deux lignes en arménien, cette note en français: « Ce ci est un cordognier. »
Les femmes sont accourues à la distribution de couvertures. Dans la chambre du prêtre, dix à vingt hommes – ce qui reste d’hommes arméniens dans ce quartier de cinq cents familles – sont assis. Ils ont échappé au massacre. L’un travaillait dans une maison européenne de Péra, et on l’y a gardé pendant les trois journées. Un autre était allé à Kadikoy et des Albanais musulmans l’ont caché.
« Et toi ?
– Moi, j’étais allé à Stamboul porter une paire de souliers, que je venais de finir; je suis cordonnier. C’était la veille de la fête de la Vierge (14 août1/26 août), et j’espérais être payé. Je revenais avec mon argent. Nous étions trois Arméniens dans un caïque, et deux Turcs qui ramaient. Les Turcs nous ont dit: “Il ne faut pas rentrer chez vous aujourd’hui; depuis une heure, on massacre à Haskoy.” Alors nous leur avons dit de nous mener à Eyup… »
Eyup, quartier musulman, sur l’autre rive de la Corne d’Or, passe, à Constantinople, pour le centre du fanatisme. Sa mosquée, impénétrable aux ghiaours2, contient l’épée du Prophète, que tout nouveau Sultan va ceindre au jour de son avènement. L’idée de ces Arméniens nous sembla donc étrange d’avoir choisi un pareil refuge en temps de massacre. Mais l’Arménien reprit:
« Nous allions à Eyup chez Fehmi-Pacha. C’est un vieillard très pieux, que le Sultan n’aime pas et qui veut finir à Eyup pour être enterré près de la mosquée. Depuis un an, Fehmi disait aux Arméniens – car, depuis un an, tout le monde savait qu’on nous tuerait: “Quand l’homme d’Yildiz (le Sultan) fera massacrer les chrétiens, venez chez moi et je vous sauverai.” Nous nous sommes donc réfugiés dans sa maison. Mais elle était petite et déjà pleine. Il nous a emmenés à la mosquée et il a dit au prêtre: “Prends ces hommes et sauve-les.” Le prêtre nous fit entrer dans la cour. Nous étions plus de cent. On nous a apporté des nattes et des cruches, et nous sommes restés là quatre jours; chaque matin et chaque soir, les Turcs du quartier nous donnaient à manger. Le second jour, les assommeurs sont arrivés avec des soldats et des hommes de la police. Ils voulaient pénétrer dans la cour, en disant: “Le Maître (le Sultan) permet de tuer les Arméniens.” Le prêtre, qui était devant la porte, leur répondit: “Je ne sais pas ce que le maître a permis. Mais le Prophète, qui ordonne de tuer les idolâtres, défend de tuer les nations du Livre. Ceux-ci sont chrétiens, et vous ne les tuerez pas”, et les softas et les autres prêtres les empêchaient d’entrer. Mais ils étaient innombrables, et ceux de derrière levaient leurs bâtons et criaient et poussaient les autres. Alors un homme de la police, qui était devant, en uniforme, leur a crié: “Iassak ! Iassak ! C’est défendu! C’est défendu!” et ils sont partis sans même piller les boutiques arméniennes qui se trouvaient sur leur chemin… »
Le drogman de l’ambassade, ayant terminé sa distribution de couvertures, est revenu près de nous: «Je connaissais tout le monde ici. En 1895 déjà, après les assommades de Stamboul, cent soixante hommes s’étaient réfugiés dans cette église et ne voulaient plus en sortir. L’ambassade m’envoya négocier avec eux: chaque ambassade s’était chargée d’un quartier arménien. Je parvins à les rassurer; mais ils me supplièrent de faire chasser d’Haskoy deux bouchers musulmans et un comptable de l’arsenal, qui s’étaient constitués en une sorte de comité pour le massacre et qui les menaçaient de mort. Malgré nos représentations, ces bandits ne furent pas inquiétés. Aussi, quand les assommeurs arrivèrent, la besogne était prête; les portes arméniennes avaient été marquées à la craie; je vous montrerai les inscriptions en turc, toutes de la même main. Ils arrivèrent par le bateau, le mercredi 26 août, vers cinq heures du soir, et toute la nuit, toute la journée du lendemain, durant trente heures, on travailla. Les premiers Arméniens, qu’ils trouvèrent à l’échelle, furent amenés chez les bouchers. Comme ils se débattaient, on leur trancha les deux mains sur l’étal, et le boucher criait: “Pieds de cochons à vendre!” Puis on les assommait, suivant le mode général de cette exécution bien organisée. Les bandes n’avaient pour armes que des bâtons, sopas, mais tous de même forme et de même longueur: on croit qu’ils avaient été fabriqués, spécialement pour cet usage, par les ateliers de la marine, et l’on sait que, plusieurs jours d’avance, ils avaient été distribués entre les différents postes de police, car l’autorité était prévenue et s’attendait à un coup de force des révolutionnaires arméniens… Les sopadjis1 jetaient donc l’Arménien à genoux ou à plat ventre, et lui tapaient sur la tête jusqu’à ce qu’elle fût réduite en bouillie ou séparée du tronc. La police cernait le quartier et rabattait les fuyards. Ils procédaient avec ordre, maison par maison, sans hâte: aucune maison arménienne ne fut oubliée; sans erreur: aucune maison grecque ne fut attaquée; sans excès: la consigne n’était que pour les hommes, et pas une femme ne fut même violée, bref, en ouvriers consciencieux et dociles. On saccageait tout. On cassait tout à coups de trique. On apportait le même soin à réduire la tête des hommes en pâtée pour les chiens, qui venaient boire aux ruisseaux de sang, et les mobiliers en poussière; il fallut trente heures à ces soixante ou quatre-vingts ouvriers.»
Nous montons les ruelles d’Haskoy. Les maisons, d’abord, ont leurs portes réparées, et leurs fenêtres, et leurs vitres. Mais une à peine sur dix est habitée, et seulement par de jeunes femmes qui, se penchant des étages supérieurs, semblent attendre une distribution de vivres. Après le pillage, c’est l’ambassade de France qui les a nourries: le correspondant du Temps, renseigné par un fuyard, était venu, et, pris d’épouvante et de pitié, avait couru à l’ambassade.
Les jeunes femmes, à l’arrivée des bandes, s’étaient sauvées dans la campagne ou cachées dans les caves, craignant surtout les soldats et leurs ordinaires familiarités. Mais les vieilles s’attachaient à leurs hommes, à leurs garçons, et se faisaient traîner pendues à eux. Elles ont tout vu et sont restées folles. En travers des rues, agenouillées, vautrées, elles grattent le sol de leurs ongles, s’emplissent de terre la bouche et les cheveux, hurlent comme des fauves: « Aman, aman, Tchelebi ! Pitié, pitié, Seigneur! », ou, silencieuses, balancent la tête et le buste, d’un geste stupide.
À mesure que nous montons, la solitude grandit. Plus une femme aux fenêtres sans rideaux. Plus une case habitée. Les chiens eux-mêmes, en quête de nourriture, ont déserté le haut quartier. Une chèvre et ses deux chevreaux, bêlant de porte en porte, sont notre seule rencontre. Ici les traces sont demeurées plus visibles. Les ruelles sont jonchées de verre cassé et de fer-blanc. Les vitres n’ont pas encore été remises. Les portes, malgré des grattages évidents, gardent les inscriptions dont parlait le drogman de l’ambassade. L’une d’elles même n’a pas été touchée ; en beaux caractères turcs, on peut lire, écrit à la craie : « Ici, Agop, Arménien. » L’écriture est très habile : l’an dernier, les Arméniens dénonçaient le comptable de l’arsenal comme le secrétaire des bouchers musulmans.
Voici la dernière maison, au bout du quartier, près du cimetière : une case de bois à un étage, qui ressemble à toutes les autres, toutes étant construites sur le même plan. Au rez-de-chaussée, trois chambres minuscules, où des estrades de bois, couvertes de tapis, servaient de lits ou de divans. Au sous-sol, une petite cuisine sans fourneau, avec deux réchauds. Au premier, trois autres petites chambres nues. Tout est en bois blanc, murs, plafonds et escaliers, en sapin à peine raboté. Le plancher disparaît sous une couche de détritus, papiers lacérés, verre en paillettes, fer-blanc haché, étoffes et tapis réduits en menus morceaux. Les bandes de Juifs de Balat et la canaille de Stamboul sont venues après les assommeurs, et, retournant et embouant ces loques, ont emporté le moindre objet de prix. Les robinets de cuivre ont été arrachés aux petites fontaines des cuisines; arrachés, les boutons de cuivre des placards et des portes, et les encadrements de cuivre des miroirs de deux sous. Seulement, dans les armoires, sur les rayons des chambres à coucher, il reste encore les journaux soigneusement étalés où la bonne ménagère empilait son linge et alignait ses fruits, et ces journaux sont La Mode illustrée, Les Annales politiques et littéraires et le Globe anglais. Ces Arméniens menaient une vie très simple. Les plus riches, très peu nombreux, avaient de petits lits de fer; les autres n’avaient pour couchettes que les tapis de leurs divans. Mais, le soir, dans la nuit tombée sur les cimetières voisins, ils rêvaient d’Europe et de civilisation; ils lisaient, comme nos petits ménages de province, Les Annales et La Mode illustrée.
Après une visite au cimetière, tout bossué de tombes récentes – combien ont été enterrés là, à la hâte, en secret? combien tirés par les pieds et jetés à la Corne d’Or ? pendant plusieurs semaines, personne à Constantinople ne mangea de poisson –, nous redescendons à l’échelle. Le clair soleil joue dans la brume d’automne, et là-bas, entre les cyprès, la Corne d’Or frissonne et rit. Haskoy retombe dans son calme, que le bruit de nos pas avait un instant troublé. On n’entend plus, au premier étage d’une maison, que le piaillement d’une école enfantine. Ce sont les petites filles, revenues à la classe – il faut bien reprendre la vie – qui répètent à haute voix et en chœur, à la mode orientale, la phrase lue tout haut par leur maîtresse. Et la maîtresse lit, en français, et les petites filles répètent, scandant les mots:
Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête.
Apprenez le français, petites Arméniennes. Vos pères l’avaient appris; quand le présent leur semblait trop dur, ils regardaient vers la France, et sans un mot, sans un geste de pitié, nous avons laissé assommer vos pères.
La Politique du Sultan de Victor Bérard (1864-1931) montre de quelle façon les abominations d’un jour enseignent les abominations de jours qui s’avéreront bien plus funestes. Pour parler cru, les massacres organisés par le sultan Abdul-Hamid II à la fin du XIXe siècle (avec reprises, au son du clairon, au tout début du XXe siècle !) ont chauffé le génocide de 1915-1916 perpétré par les Jeunes-Turcs sur des sujets ottomans : les Arméniens. L’écriture de La Politique du Sultan est dépouillée ; les analyses qui y sont consignées ne manquent jamais d’être aiguës. Bérard fait partie de ceux qui, comme Anatole France (« l’Arménie est unie à nous par des liens de famille, elle prolonge en Orient le génie latin »), comme Péguy, comme Jaurès, comme Durkheim, ont pour mission, dans les moments critiques de l’Histoire, d’éclairer leurs semblables. Bérard est aussi un collecteur de témoignages. C’est dire qu’il effectue, en même temps, un reportage sur les pratiques exterminatrices d’un Ubu turc. Abdul-Hamid II ? Une figure emblématique, quoique scélérate. Une figure inoubliable. M.M.
"Pour comprendre les fondements de la haine turque vis-à-vis des minorités chrétiennes, on se plongera avec grand profit dans la réédition de La Politique du Sultan , de Victor Bérard, célèbre traducteur de l'Odyssée, qui décrit calmement, froidement, le règne abject du "Sultan Rouge" Abdulhamid II (1842-1918). Portrait saisissant d'un tyran qui porte en permanence trois revolvers sur lui, vit dans une paranoia effrayante nourrie par une nuée d'indics et voue aux Arméniens une éxécration pathologique. Victor Bérard ne raconte que ce qu'il voit alors dans les rues de Constantinople, comme un prodigieux reporter d'images. C'est bref et accablant." L'Express, 25 Avril 2005
Préface de Martin Melkonian