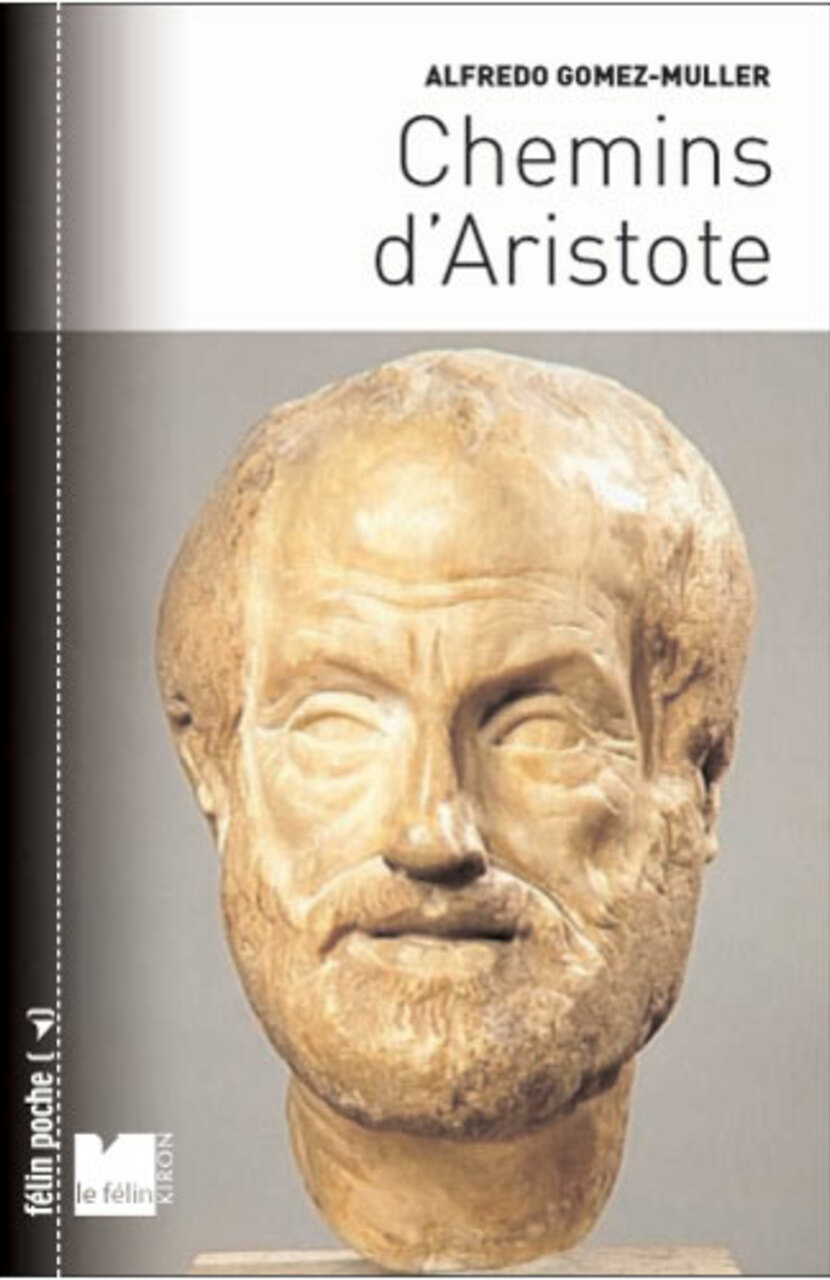
Chemins d'Aristote
L’éthique aristotélicienne de la vie bonne
Reprenant à son compte l’expérience pratique de la plupart de ses contemporains, Aristote comprend les termes --- (vie bonne), ---(bon daimon : bon destin, bonne divinité, «bonheur») et --- (action bonne, réussie) comme équivalents (EN1095 a19-20). Dans le jeu d’équivalences entre ces trois notions s’expriment les trois déterminations principales de la vie bonne aristotélicienne: a) l’orientation vers une certaine fin (téléologie et sens), b) la compréhension de l’humain comme l’œuvre de l’homme intégral (vertu), impliquant c) une certaine relation à soi (autonomie et rationalité) et à d) autrui (mémoire éthique de la communauté et amitié).
a) Téléologie et sens
Vivre signifie toujours, pour un sujet humain, tendre vers quelque chose qui est appréhendé comme manquant : nourriture, santé, savoir, plaisir, habileté, richesse, amitié, amour, vertu, etc. Dans la mesure où dans tout «tendre vers…» s’exprime une détermination et donc une négation (détermination positive de ce vers quoi il convient ou il est nécessaire de tendre, détermination négative de tous les autres objets), la vie humaine est toujours orientation dans le monde. Or, dans toute orientation, spatiale ou temporelle, cosmique ou mondaine, nous supposons une référence. Originairement, s’orienter veut dire: se tourner vers l’orient, déterminer sa position par rapport à la position du soleil levant. Dans les termes de la tradition grecque, la référence qui conditionne toute orientation dans le monde se nomme --- (fin). Le mot grec télos, comme le latin finis, désigne originairement le terme, le point ultime d’un état, d’un mouvement, d’une action, d’une production ou d’un être : dans ce sens, Aristote remarque que «la mort est appelée, par métaphore, du nom de fin, parce que l’une et l’autre sont des termes extrêmes» (Métaphysique, D 16,1021 b28). Or, cet exemple de la mort, fin d’un être vivant, révèle une deuxième signification primordiale du télos. Du point de vue du temps du vivant qui est mort, la fin signifie accomplissement : au moment de sa mort, le temps fini propre à ce vivant advient à sa plénitude : aucun temps nouveau ne peut être ajouté au temps accompli, car, par définition, il n’y a pas de temps qui manque au temps accompli. En signifiant l’avènement d’un état ou rien ne peut plus manquer à quelque chose (temps, mouvement, activité de production, objet produit…), le télos est téleios : accomplissement, plénitude d’être, être se suffisant à soi, totalisation, perfection (1021 b23-25). Dans ce sens, le télos équivaut au bien.
Le télos est le bien : affirmée dès les premières lignes de l’Éthique à Nicomaque, cette équivalence se rapporte à toute forme d’activité humaine : l’exercice des arts et des techniques, de la recherche théorique, de l’éthique et de la politique suppose toujours la détermination d’une fin, qui représente un bien particulier ou le bien général propre à chacune de ces formes de l’activité. Par exemple, dans la sphère de la production (poiesis) et de son mode de savoir correspondant, la tekhnè, le bien visé en tant que fin de l’activité est l’œuvre. L’œuvre, qui désigne tout produit de la technique, y compris la santé, recueille la double signification de terme et d’accomplissement : elle est le terme d’une activité, la production technique, qui cesse nécessairement lorsqu’il ne manque rien à la chose produite : la construction du navire (le télos) cesse quand celui-ci est achevé ou «parfait» (téleios), l’activité visant à se faire maigrir cesse quand l’amaigrissement est obtenu : on ne peut pas à la fois «apprendre et avoir appris, ni guérir et avoir été guéri… [ni] construire et avoir construit» (Métaphysique, Q 6, 1048 b15-35). L’être accompli (l’œuvre) surgit de l’«accomplissement» ou de la totalisation d’un temps spécifique, le temps de la production. Se détachant du temps de la production, c’est-à-dire ne dépendant plus de l’activité du producteur, l’œuvre accomplie se suffit à elle-même : dans ce sens, les fins techniques sont toujours extérieures au sujet humain qui les produit.
En tant que télos – «achèvement», dans le double sens de ce terme français – l’œuvre conditionne l’orientation de l’activité de production. En signifiant la totalité du temps de la production, elle unifie la multiplicité des «maintenant» qui correspondent à chaque opération particulière de la production ; elle donne, en d’autres termes, une unité à l’activité de production, qui se révèle, dès lors, comme totalisation. Pour désigner cette fonction synthétique de la fin, Aristote utilise le concept de cause finale. Indiquer la cause (aitia) de quelque chose, c’est indiquer son pourquoi (dioti), sa raison d’être : la cause est, de manière générale, le principe de l’intelligibilité des choses. Au niveau de l’activité productive, la fin, en tant que cause finale, fonde l’intelligibilité d’une multiplicité d’actes et d’objets, en leur donnant une unité synthétique. Par exemple, tel acte particulier (exercices, purgation, régime d’amaigrissement) ou tel objet particulier (remède, instrument), propre à la tekhnè médicale, acquiert un sens, et, par là même, une justification, dans la mesure où il apparaît relié à d’autres moyens médicaux, rassemblés sous l’unité de la cause finale spécifique à la médecine, la santé. Pour autant qu’elle est considérée comme une fin, c’est-à-dire comme un bien, la santé justifie l’activité du régime d’amaigrissement ou la fabrication d’instruments chirurgicaux, de même que la navigation justifie la construction de navires, l’équitation la production de selles et harnais, la guerre l’équitation, la victoire la guerre, la richesse l’économie (EN 1094 a11-13). Et, dans la mesure même où elle justifie, en tant que raison d’être de quelque chose, la cause finale apparaît aussi comme cause d’être, c’est-à-dire comme la source d’où provient quelque chose, acte ou objet : l’être tout entier de tel instrument chirurgical réside dans son statut de moyen orienté vers l’actualisation d’un bien spécifique, la santé : il n’existe qu’à partir de cette fin (Métaphysique, D 2,1013 b21 ; EN 1094 a8).
L’œuvre, la cause finale de la production, justifie dans la mesure où elle donne une unité synthétique à une multiplicité particulière d’activités, c’est-à-dire au temps spécifique à une production particulière. Or, il y a un moment où la fin technique ne justifie plus : c’est lorsque, réinsérée à l’horizon plus vaste de la pratique humaine, elle se découvre comme simple moyen. Le propre des fins techniques, note Aristote, est de ne jamais se suffire à elles-mêmes : le harnais, fin de l’activité du sellier, est un moyen pour la tekhnè de l’équitation, laquelle tekhnè, œuvre du cavalier en tant que tel, devient moyen pour la tekhnè militaire, etc. La non-suffisance à soi des fins de la production met en question la propre intelligibilité de l’activité productive : remonter sans cesse d’une fin technique à une autre équivaut, en effet, à se perdre dans l’indéfinition des fins et à rendre «tous nos désirs parfaitement stériles et vains» (EN 1094 a20). S’installer dans une vision technicienne du monde, c’est donc se condamner à l’absence de sens : par cette explicitation de la non-suffisance des fins techniques, Aristote préfigure une compréhension du sens de l’homme et de son agir qui se trouve, de nos jours, en conflit avec les formes dominantes de la culture morale et politique de la modernité : c’est la compréhension qui sous-tend l’actuelle prise de conscience d’une «perte de sens» ou d’une «éclipse des fins» dans les sociétés de la modernité contemporaine, liée à l’invasion des différentes sphères de l’activité humaine par une rationalité purement économique ou instrumentale1.
Retrouver le sens des fins techniques signifie, à partir du questionnement Aristote, relier ces fins entre elles et à d’autres fins, non techniques, de la vie humaine. À l’instar des opérations techniques, qui obtiennent une justification pour autant qu’elles se trouvent rassemblées sous l’unité d’une fin technique particulière, les fins techniques dans leur diversité acquièrent un sens dans la mesure où elles s’intègrent dans l’unité d’une fin non technique : une fin qui totalise non pas des activités particulières, mais l’activité comme telle ; qui unifie non pas des temps spécifiques, mais le temps de la vie. De même que, pour comprendre la réalité physique en général, «il faut s’arrêter» (Métaphysique, L, 3, 1070 a1-4 ; 8, 1074 a 25-30) à une connaissance de base, qu’Aristote nomme principe, de même, pour rendre intelligible l’activité humaine en général, nous devons partir d’une «cause finale» de base ou d’un bien fondamental -dont les contenus sont perpétuellement réélaborés. Pourquoi produisons-nous ? Pourquoi cherchons-nous la santé ? Bref, pourquoi vivons-nous ? À ces questions, le savoir technique ne peut pas apporter de réponse. Pour penser la fin de la production et, de manière générale, la «règle de la vie humaine» (EN 1094a22), il faut un autre mode du savoir, qui ne soit pas simplement instrumental. Aristote nomme ce savoir ---, terme que nous pourrions traduire par éthique-politique.
Le terme aristotélicien politikè, en effet, ne possède pas le même sens que le mot français «politique». D’après Aristote, la politique a pour objet le bonheur (EN 1095 a17), le beau et le juste (1094 b14), le plaisir et la peine, le bien et le mal en soi (1152 b1-3), l’âme humaine (1102 a23). On comprend, dès lors, pourquoi Aristote caractérise l’ouvrage que la tradition a intitulé Éthique à Nicomaque comme une recherche «en quelque sorte politique» (1094 b11). Loin de la dichotomie moderne qui sépare radicalement la sphère du «privé» (qui serait le domaine de l’«éthique») de la sphère «publique» (qui appartiendrait exclusivement à la «politique»), Aristote considère, comme nous le verrons, la participation à la vie politique comme une dimension constitutive de la vie bonne. «Éthique» et «politique» s’intègrent dans l’unité d’un seul et même savoir, le savoir pratique (Métaphysique, E, 1025b25), qui s’enquiert des conditions de l’unité de la vie humaine et qui voit, dans cette unité, la détermination primordiale de la vie bonne.
Tel est, en effet, le sens de l’équivalence, affirmée par Aristote, entre les notions de vie bonne et de bonheur («bon destin»). Car la détermination essentielle du bonheur est, de fait, la pleine suffisance à soi (autarkheia) : le bonheur est la seule fin exclusivement désirable pour elle-même, et donc la seule qui réalise pleinement l’essence du télos dans sa double signification fondamentale de terme et d’accomplissement. D’autres fins pratiques qui sont désirables pour elles-mêmes – comme le plaisir, l’intelligence et les vertus particulières – sont aussi désirables en vue du bonheur, «parce que nous croyons que tous ces avantages divers nous le peuvent assurer», tandis que le bonheur n’est jamais désiré en vue de quoi que ce soit d’autre que lui (1097 b1-7). Dans la mesure où il est déterminé, formellement, par la pleine suffisance à soi, le bonheur acquiert le statut de principe, c’est-à-dire de condition première de l’unité de l’activité et de la temporalité humaines. Aussi Aristote compare-t-il analogiquement le bonheur, principe de la pratique humaine en général, à la cible, principe de la pratique particulière de l’archer : le bonheur rassemble les différentes sphères (production, organisation de la cité, fête et loisir, amitié et amour, expression, contemplation) de l’activité individuelle et sociale, qui prennent alors sens par le jeu des rapports qui les relient, à l’image de la cible, qui, en unifiant la multiplicité des gestes et des mouvements de l’archer, donne à chaque geste et à chaque mouvement sa signification propre (EN 1094 a22-24). C’est parce qu’il donne sens à la diversité des fins relatives de l’activité humaine que le bonheur, fin finale de la vie humaine, «suffit à rendre la vie désirable, et fait qu’elle n’a plus besoin de quoi que ce soit» (EN 1097 b16).
En d’autres termes, ce qui détermine la valeur en soi de la fin finale réside dans le fait qu’elle donne sens à l’existence et à la coexistence humaines : dans l’eudaimonia, le daimon – « divinité », « destin », médiation entre les dieux et les hommes – est bon dans la mesure où, par son accompagnement, l’homme s’oriente dans le monde et peut, par là même, l’habiter. Ce qui revient à dire, dans les termes de l’équivalence entre l’eudaimonia et la vie bonne, que la bonté de la vie bonne réside dans son unité, qui est déterminée par le fait qu’elle est orientée finalement, c’est-à-dire, vers une fin qui se suffit à elle-même. L’eudaimonia équivaut à la vie bonne dans la mesure où, en tant que fin éthique, elle se rapporte à la praxis, et non pas à la production. En effet, le propre de la praxis est la non-séparation entre l’activité et sa fin : à la différence des fins techniques, dont la réalisation confère à l’activité productrice le statut de moyen, la fin praxique se déploie dans l’activité elle-même: de même que «voir» est en même temps un acte (energeia) et la fin de cet acte, de même «penser», «vivre» et « vivre bien » sont à la fois activité et fin (Métaphysique, Q, 6, 1048 b 15-35). Le bonheur est praxis, non pas béatitude ni ravissement. Vivre bien, c’est être eudaimôn, c’est-à-dire, «accompagné» de sens : déployer sa vie comme vie sensée. C’est pourquoi la vie bonne n’est pas nécessairement détruite par les mauvais revers de la fortune : douleur et tristesse peuvent aussi avoir du sens, du point de vue de la vertu – cette manière d’être qui rassemble le temps de la vie. Contrairement à la représentation subjectiviste du «bonheur», caractéristique de l’individualisme moderne, l’eudaimonia n’exclut pas nécessairement la tristesse ou la souffrance. C’est le non-sens, l’absurde, et non pas la souffrance, qui rend la vie nécessairement «mauvaise» et fondamentalement malheureuse ; la souffrance, quant à elle, ne la rend malheureuse que pour autant que, sous certaines formes, elle peut engendrer l’absurdité : ainsi le personnage biblique Job connaît-il l’intolérable seulement au moment où il ne trouve aucune réponse à la question : «pourquoi?» (Jb, XVII, 13-15). Mais il s’agit là du fond même de la souffrance, de ces «grands et nombreux malheurs» (EN 1101a10) qui peuvent briser l’unité de la vie, provisoirement ou définitivement. À partir de l’expérience de cette souffrance profonde, l’enjeu éthique est la reconstruction de l’unité de la vie – la reconstruction du sens, qui appartient déjà à la vie bonne.
b) La vertu: devenir humain de l’homme
La question de la vie bonne se trouve, du point de vue d’Aristote, indissolublement liée à la question de la vertu: la vie bonne, le style de vie qui vise à soigner l’essentielle vulnérabilité de l’humain, est la vie selon la vertu. À travers ce terme grec s’expriment deux déterminations primordiales de la vie bonne: d’une part, la vie bonne présuppose une conception de l’humain comme actualisation, et non pas comme être actualisé; d’une autre, elle implique le pouvoir effectif de juger et d’agir éthiquement.
La première de ces déterminations se rattache à la signification générale et initiale du terme aretè. D’après cette signification, la vertu désigne l’excellence, le mode d’être dans lequel un être actualise pleinement son être: la vertu de l’œil, par exemple, se déploie dans la vision excellente, de même que la vertu du cheval se déploie dans sa vitesse, résistance, souplesse, etc. (EN 1106 a15-21). À travers ces exemples, Aristote suggère que la vertu est une forme d’activité : l’excellence est, pour un être particulier, le déploiement de ses attributs propres ; de ce point de vue, on peut parler d’une «vertu» des êtres naturels, qui correspond à leur être-en-acte (énergeia et entélékheia). Ces deux termes, employés souvent par Aristote comme synonymes, désignent le degré supérieur d’actualisation de ce qui était seulement en puissance : dans ce sens, ils signifient son télos ou son bien : «l’acte est une fin, et c’est en vue de l’acte que la puissance est conçue» (Métaphysique, Q, 8, 1050 a8); dans cette perspective, «le bien est la fin de toute génération et de tout mouvement» (A, 3, 983 a32).
Au niveau des affaires humaines, la vertu conserve cette signification initiale: la vertu d’un être humain n’est ni un état ni une simple disposition, mais une forme d’activité : «l’activité de l’âme conforme à la vertu appartient à la vertu» (EN 1098 b32). Ainsi, de même qu’un homme fort qui ne participe pas au combat ne saurait être qualifié de bon athlète, de même un homme qui est disposé à la vertu mais n’agit pas ne peut être considéré comme vertueux (1099 a3-7). C’est dire que, pour l’athlète comme pour le sujet éthique, la vertu est toujours en jeu. Mais, tandis que la vertu de l’athlète comme tel se joue dans un temps spécifique – le temps de l’épreuve, des tournois – la vertu éthique, en tant que vertu de l’homme comme tel, se décide dans le temps de la vie. Être humain n’est pas un état, mais une tâche. Vivre humainement signifie assumer l’humain, dans l’ouverture du temps de la vie, comme projet d’être. L’excellence (vertu) d’une vie humaine ne désigne, par conséquent, ni un état ni un «idéal» de «perfection», mais le devenir humain de l’homme. C’est pourquoi l’utilisation, par le libéralisme individualiste, de l’étiquette de «perfectionnisme», pour caractériser l’éthique de la vertu, est essentiellement fallacieuse: en effet, elle présuppose une interprétation statique et atemporelle de l’humain, qui est érigée en détermination universelle et absolue. Pour pouvoir considérer la vertu comme un «idéal» de «perfection», il faut présupposer l’idée que les hommes sont a priori déjà pleinement humains, et qu’ils n’ont donc pas à le devenir : le devenir humain comme tel est assimilé à l’«idéal» purement privé d’un devenir humain particulier, exprimant une vision spécifique du monde ou une simple préférence subjective. Réduite au statut d’«idéal», la vertu ne serait donc qu’un surplus contingent, une sorte de luxe postulé par une élite et pour une élite: ainsi, d’après John Rawls, qui range Aristote à côté de Nietzsche, en le caractérisant, assez confusément, de perfectionniste «modéré», le perfectionnisme exprime un «idéal» particulier dans les domaines de l’art, de la science et de la culture : le perfectionnisme serait l’éthique privée des «grands» hommes2. Ainsi, en effaçant de la vertu tout contenu objectif et en la réduisant à un idéal purement privé, l’individualisme libéral, loin de protéger l’individu, tend à le faire disparaître sous une norme «moyenne» et définitive de l’humain : en déchargeant les sujets de la tâche de se faire, c’est-à-dire d’assumer leur devenir humain, la morale libérale individualiste les installe dans l’uniformité d’un conformisme profond, où l’«humain» peut avoir n’importe quel contenu et où toutes ses significations sont également équivalentes. Le relativisme des valeurs, inhérent à ce relativisme du sens de l’humain, est le corollaire de cette morale qui considère l’individu comme une totalité et non pas comme devenir de totalisation : c’est la totalité moyenne de l’homme médiocre3 ou du «On» décrit par Heidegger4. Ce n’est qu’à partir d’une telle morale «médiocratiste» et conformiste qu’on peut interpréter l’éthique de la vertu comme «perfectionniste».
La deuxième détermination primordiale de la vie bonne comme vie selon la vertu concerne les compétences effectives du sujet éthique. En effet, le terme aretè ne signifie pas seulement l’excellence ou l’actualisation propre à un étant particulier. En dehors de ce contenu général, qui peut s’appliquer aussi bien aux réalisations humaines qu’à des activités ou à des fonctions naturelles, l’aretè possède une signification strictement éthique : elle peut alors désigner, outre les vertus intellectuelles dont il sera question plus loin, la vertu du caractère, c’est-à-dire, de la manière d’être habituelle d’un sujet: «la vertu de caractère dérive des mœurs, et c’est du mot même de mœurs que, par un léger changement, elle a reçu son nom» (EN 1103 a17). Par cette manière d’être habituelle d’un sujet, il faut entendre avant tout sa disposition (hexis) à accomplir réellement des actions éthiques: les vertus de caractère qualifient les compétences effectives du sujet éthique. La théorie aristotélicienne des vertus de caractère éclaire le problème, essentiel en éthique, des conditions subjectives (motivation de la volonté) de l’action – problème qui s’inscrit dans la problématique plus générale, que la tradition libérale héritière de Kant tend, jusqu’à nos jours, à négliger, des conditions de l’application de la règle éthique générale dans la diversité des situations particulières.
La définition générale de la vertu de caractère comme disposition à accomplir des actions éthiques se rattache à une compréhension du désir et de l’affectivité comme des déterminations essentielles de la vie éthique. C’est que la réalité de la vie bonne ne dépend pas uniquement de la justesse du discernement réflexif : «la pensée, prise en elle-même, ne met rien en mouvement» (EN 1139 a35). Pour que les décisions à propos de l’action puissent devenir effectives, il faut que «la raison approuve d’une part les mêmes choses que d’autre part le désir poursuit» (1139 a25). Le discernement réflexif doit être accompagné de désir (---). Dérivant du verbe oregô (tendre vers…), l’orexis désigne, de manière générale, la causalité interne qui détermine un être vivant à se mettre en mouvement afin d’atteindre un certain objet du monde, considéré comme un objet qui conditionne sa possibilité de réaliser ou de préserver un certain état interne5. La multiplicité des affects ou des «passions» humaines, qui peuvent se ramener en dernier lieu à deux passions primordiales, le plaisir et la peine, définissent cet état interne vers lequel tend le désir (1105 b21): dans ce sens, le désir peut donc être caractérisé comme le principe qui détermine tout être animé à poursuive le plaisir et à fuir la peine (1139 a22). Or, les différentes vertus de caractère (courage, générosité, tempérance…), à la différence des vertus intellectuelles, se rapportent immédiatement au plaisir et à la peine (1104 b8, 1105 a12), et, par la médiation de ces derniers, à la multiplicité des passions et des actions (1106 b16, b24).
La vie éthique exige, dès lors, une certaine appropriation du désir, principe moteur de l’action. S’approprier éthiquement le désir signifie, dans cette perspective, ajuster ses formes multiples et parfois contradictoires selon l’unité du désir primordial de la vie bonne. Dans cet a-justement s’exprime la détermination principale du désir éthique: il s’agit d’un désir rapporté à la réflexion. Pour désigner ce désir spécifiquement éthique, et le distinguer du désir en général, Aristote utilise un terme difficile à traduire, prohairesis. Définie comme un «désir réfléchi et délibéré (orexis bouleutikè) des choses qui dépendent de nous seuls» (1113 a10, 1139 a22), la prohairesis exprime la synthèse pratique du désir et de la rationalité pratique – aussi Aristote la définit-il indifféremment comme désir éclairé par la pensée (orexis dianoètiké) ou comme intellect désirant (orektikos nous). Le rôle central de la prohairesis dans la vie éthique découle précisément de cette double appartenance au désir et à la raison : une raison sans désir serait impuissante, comme un désir sans raison serait aveugle. Il s’ensuit que la prohairesis est «l’élément le plus essentiel de la vertu de caractère» (1111 b5). Toutes les vertus de caractère impliquent nécessairement la prohairesis (1106 a3): plus précisément, la vertu de caractère se définit comme une «disposition capable de prohairesis (exis prohairetikè) (1139 a23). La possibilité, pour un sujet éthique, d’acquérir une telle disposition dépend, d’autre part, d’un certain exercice de la rationalité, et, d’une autre, de l’existence d’une tradition éthique.
c) Autonomie et rationalité
Le propre des vertus de caractère est de se rapporter avec justesse aux passions. Il s’agit, d’une part, de la justesse du désir spécifique (la prohairesis) qui détermine la réalisation de l’action vertueuse – par exemple, le désir de résister de telle manière dans telle ou telle situation, actualisant la vertu du courage – or, cette justesse du désir est relative ; d’autre part, à la justesse de l’évaluation des circonstances particulières dans lesquelles se manifeste la passion: par exemple, le courage se définit comme vertu, ainsi que la témérité et la lâcheté comme défauts, à partir d’une évaluation complexe de nos possibilités particulières d’action face à une menace, qui comprend l’estimation de la nature de la menace ou de la «cause» qui engendre la peur, l’appréciation de nos moyens d’action, la définition de la quantité et de la qualité des personnes et/ou des choses impliquées par la menace, la détermination du temps (opportunité), du lieu et du contenu spécifiques de l’action, etc. (1106 b20, 1109 a25). Cette opération complexe, qui semble suivre le tracé des catégories aristotéliciennes de l’être, relève non pas du désir, mais de la rationalité pratique.
La compréhension de la vie bonne comme vie réfléchie, impliquant un certain exercice de la raison, n’est pas une innovation aristotélicienne: elle était déjà présente, et de manière suffisamment articulée, dans la pensée éthique de Socrate et de Platon. L’apport d’Aristote apparaît plutôt (a) dans sa détermination de la rationalité pratique comme un mode spécifique de rationalité, distinct de la rationalité théorétique et technique et pouvant fonder un mode spécifique de vérité, ainsi que (b) dans sa définition des conditions et des modalités d’exercice de ce mode de rationalité (la «prudence»).
(a) L’anthropologie explicite qui sous-tend la compréhension aristotélicienne de la vertu et de la vie bonne distingue, parmi les divers pouvoirs de l’esprit humain (les «parties de l’âme»), le pouvoir rationnel d’évaluer les données contingentes qui déterminent l’action humaine dans le monde. Cette évaluation des données contingentes implique délibération (bouleusis) – seules les choses contingentes et les actions particulières sont susceptibles de délibération – et détermination de la mesure (logos) de l’action particulière: aussi Aristote caractérise-t-il ce pouvoir rationnel comme «pouvoir de délibérer» (to bouleutikon) ou comme «pouvoir de déterminer la mesure» (to logistikon) (1139 a13). Dans les termes de cette anthropologie, qui confère à l’éthique un caractère «réaliste» – par la définition et la mise en discussion des motivations et des possibilités réelles d’actualisation de la vertu6 –, ce pouvoir d’évaluation se rapporte exclusivement aux actions particulières de la vie bonne, et non pas à la vie bonne comme telle, c’est-à-dire au télos qui relie et confère un sens à la multiplicité des actions particulières. La délibération en général porte sur les meilleurs moyens, c’est-à-dire les meilleures actions particulières, en vue de réaliser certaines fins, et non pas sur les fins elles-mêmes: «l’homme d’État ne délibère pas pour savoir s’il doit faire de bonnes lois» (1112 b13). En d’autres termes, l’exercice de la rationalité pratique présuppose la détermination de fins, qui sont les principes spécifiques à ce mode de rationalité : on ne peut pas délibérer ni déterminer la mesure d’une action, sans présupposer une téléologie.
Déterminer la mesure d’une action, c’est définir sa valeur de «vérité». Mais y a-t-il une «vérité» tant soit peu stable dans le domaine de l’action, ce domaine qui se définit par la multiplicité des intérêts et des passions, autant que par la contingence des circonstances et des situations? Quel est le statut des «vérités» fondées par la rationalité délibérative-évaluative?
Aristote observe que le monde de l’action n’est pas absolument instable, ni absolument contingent. L’instabilité inhérente à l’écoulement du temps n’annule pas la cohérence du vécu (1098 a16-20); de même, l’intervention du hasard et de la fortune dans la vie humaine ne supprime pas pour autant toute régularité: les actions et les mœurs sont reliées par une certaine continuité, qui rend possible la détermination d’une certaine «mesure». Or, dans la mesure où la rationalité relative à la praxis particulière raisonne sur des faits qui sont «généralement mais non toujours vrais», la détermination de la bonne «mesure» de l’action (eupraxia) reste affectée d’un coefficient d’indétermination: les choses de la vie, qui font l’objet de l’éthique (1095 a3), n’admettent pas le même degré de nécessité des choses mathématiques. Ce serait une erreur de pensée que de vouloir juger la «vérité» pratique, qui porte sur le contingent, selon les critères de la vérité scientifique, dont l’objet est le nécessaire : «il ne faut pas exiger une détermination égale dans toutes les œuvres de l’esprit» (1094 b12). En disant cela, Aristote n’entend pas exclure la nécessité ni la rigueur du domaine de l’action: il suggère simplement que les vérités relatives aux actions particulières doivent être évaluées selon d’autres critères de nécessité, qui n’excluent pas la contingence: la délibération conclut que telle action est la bonne action (eupraxia), mais elle ne peut jamais conférer à ce jugement pratique une valeur absolue. En raison de cette marge d’indétermination, qui est inhérente à la liberté et à la subjectivité humaines, la vérité qui qualifie l’action particulière possède le statut d’opinion pratique : en effet, «l’opinion (doxa), ainsi que la prudence, s’applique à tout ce qui peut être autrement qu’il n’est, c’est-à-dire à tout ce qui est contingent» (1140 b25). Aussi le pouvoir rationnel de délibérer et de mesurer le degré d’adéquation de l’action peut-il être caractérisé également comme «pouvoir d’opiner» (to doxastikon). La doxa, appliquée à la praxis, n’a pas du tout le statut d’un savoir purement contingent, c’est-à-dire arbitraire et fondamentalement indémontrable – selon l’interprétation moderne libérale de l’«opinion». L’opinion pratique aristotélicienne est fondée sur de bonnes raisons, qui sont établies par la délibération: l’objectivité et la nécessité spécifiques à la vérité pratique sont délibératives: la rationalité pratique qui prend en charge l’action particulière est essentiellement délibérative. Par la rationalité délibérative, le sujet éthique déploie son pouvoir de se distancer du pur donné factuel, des déterminismes aveugles et des représentations préétablies de l’action : pour lui, les «choses de la vie» ne sont pas des déterminations purement extérieures, imposées du dehors, mais des circonstances vis-à-vis desquelles il a à se déterminer de manière autonome. À travers cette autodétermination de la mesure de son action particulière, le sujet éthique se découvre comme un être essentiellement libre, se suffisant à lui-même (autarkheia). L’homme non libre, l’esclave, se définit précisément par l’incapacité de délibérer (Politique, 1260 a12): son agir est dépendant de déterminations purement extérieures. Dans la même perspective, l’ignorance, et, en particulier, l’ignorance des circonstances particulières de l’action, apparaît comme une forme d’esclavage ou d’aliénation, source d’injustice au niveau des relations interhumaines (EN 1110 b17, 1111a). De ce point de vue, l’exercice de la rationalité pratique est une condition de l’autonomie (autarkheia) relative du sujet pratique, et, par voie de conséquence, une condition primordiale de la vie bonne: l’action bonne (eupraxia) équivaut à la vie bonne.
(b) Les conditions et les modalités d’exercice de la rationalité délibérative sont définies, dans l’éthique aristotélicienne, dans le cadre de l’analytique de la --- (phronèsis ). Ce terme grec, que le latin prudentia et le français «prudence» ne rendent que très imparfaitement, désigne, chez Aristote, une vertu «intellectuelle»: à l’instar de la sophia (savoir théorétique), et à la différence des vertus de caractère, la phronèsis se rattache immédiatement non pas au désir, mais à la raison. Mais, à la différence de la sophia, la phronèsis se rattache à la rationalité pratique – et donc aussi, médiatement, au désir. La phronèsis représente le mode excellent (la «vertu») du pouvoir rationnel qui porte sur les données contingentes de l’action ; de ce point de vue, elle apparaît comme le modèle des modalités d’exercice de la rationalité délibérative (EN 1139 b15-17 ; 1141 a3-6).
La phronèsis se définit essentiellement comme pouvoir de délibération: «l’objet principal de la prudence, c’est, à ce qu’il semble, de bien délibérer» (1141 b10). Le phronimos (l’homme «prudent») est, par là même, le bouleutikos (le «délibérateur»), l’homme qui sait évaluer, déterminer la juste mesure de son action (1140 a30). Toute délibération comporte trois caractères essentiels, qui découlent de la nature de son objet: d’après le premier, elle doit se rattacher aux choses qui sont en mon (ou notre) pouvoir, et non pas aux choses qui ne dépendent pas de nous ; d’après le deuxième, qui a déjà été évoqué plus haut, elle doit porter sur les meilleurs moyens d’actualisation des fins, et non pas sur les fins elles-mêmes; enfin, d’après le troisième, elle doit porter sur des réalités ambiguës, participant à la fois du stable et de l’instable, et non pas sur des choses nécessaires ni accidentelles, ni dépendant de la fortune: on délibère sur les choses qui «tout en étant soumises à des règles ordinaires, sont cependant obscures dans leur issue particulière, et pour lesquelles on ne peut rien préciser à l’avance» (1112 b8). La délibération pratique (éthique), porte sur les actions que requiert la vie bonne. La détermination de ces actions ou, plus précisément, de la meilleure action possible, étant donné telles circonstances particulières, telle fin subordonnée et telle fin finale (la vie bonne), constitue l’objet final de la délibération éthique, qui prend dès lors la forme d’un syllogisme pratique: à partir des prémisses établies par la délibération (détermination du bien général, du bien particulier et des circonstances dans lesquelles ce dernier doit être actualisé), je conclus à la validité de telle action. Or, le statut de cette conclusion, qui est toujours relative à un sujet particulier, n’est pas simplement idéel : la conclusion du raisonnement pratique n’est pas une simple décision, mais l’action elle-même7 : c’est dans ce sens qu’Aristote observe que l’objet de la délibération prudente est le même que celui de la prohairesis (le désir qui s’accorde à la délibération et donne naissance à l’action) (EN 1113 a3). La prohairesis, en tant que réalisation de la détermination (conclusion) élaborée par le raisonnement pratique, apparaît dès lors comme la forme achevée de la vérité pratique qui porte sur le contingent de la vie humaine: la justesse de la prohairesis détermine la justesse de l’action, et, par conséquent, celle des vertus de caractère: «la prohairesis est l’élément le plus essentiel de la vertu [de caractère]» (1111b5). Fin particulière de la phronèsis, la prohairesis est une condition fondamentale de la vie bonne: «être prudent signifie mener une vie bonne, et mener une vie bonne signifie (…) que l’on fait bien ses choix8 ».
Pourtant, la phronèsis, comme les vertus de caractère, représente seulement une condition nécessaire, mais non suffisante, de la vie bonne. En tant qu’appropriation de l’humain comme tel, la vie bonne comporte également une dimension théorétique, qui se rattache à l’exercice du pouvoir rationnel qu’a l’être humain de s’enquérir du pourquoi général des choses et de comprendre le cosmos. «Tous les hommes désirent naturellement savoir», note Aristote au début de sa Métaphysique (A, 1, 980 a21). Le savoir spécifique recherché par les hommes concerne la «cause» des choses, c’est-à-dire la connaissance du pourquoi qui préside à la multiplicité du donné sensible. Par la recherche de ce pourquoi, l’homme, l’animal qui désire savoir, déploie ses distances face au donné sensible et s’élève à l’universel, c’est-à-dire à intelligible, car c’est seulement l’universel qui «fait connaître la cause» (Seconds analytiques, 1, 31, 88 a5). Ainsi, la rationalité théorétique ouvre un nouvel espace d’autonomie pour l’homme: mettant en lumière les déterminations constantes qui régissent le monde naturel, découvrant la cause nécessaire du changement des choses, la theoria – le pouvoir de voir (theorein) le monde comme monde intelligible – fournit aux hommes une certaine maîtrise du cosmos, qui cesse d’apparaître comme une réalité purement fluctuante et insaisissable; de ce point de vue, elle constitue une ressource privilégiée de l’esprit humain face à la contingence – et donc face à l’instabilité et aux incertitudes de la vie. On comprend, dans cette perspective, la raison pour laquelle la recherche du pourquoi universel et nécessaire revêt, chez Aristote et dans la tradition philosophique dominante en Grèce, une dimension éthique, voire éthico-religieuse. La vie théorétique, la vie orientée vers le dévoilement de ce pourquoi fondamental, constitue le mode de vie le plus estimable, car, dans la theoria, les hommes entrouvrent la dimension du divin, en déployant le divin qui est en eux (EN 1177 a15, b30). La theoria ouvre une brèche au cœur du réel, attestant d’une dimension transcendante de l’humain.
La vie théorétique, néanmoins, ne suffit pas à elle seule à donner un sens à la vie bonne. L’émergence de la dimension spécifiquement humaine du sens – le sens de la vie – est conditionnée, nous l’avons vu, par la définition d’un télos, qui est un principe de nature éthico-politique, et non pas théorétique. C’est l’éthique-politique, et non pas la sophia – la vertu de la rationalité théorétique – qui donne au sujet la possibilité de s’orienter dans le monde, jour après jour: l’orientation éthico-politique se rapporte au monde, complexe des significations tissées par la pratique historique des hommes, et non au cosmos, l’univers physique. Dans la vie bonne, la vie théorétique et la vie éthico-politique ne s’opposent donc pas: dans le contexte grec classique, la vie politique représentait une dimension essentielle de l’homme libre et raisonnable. Constitué par la praxis et la parole, comme l’a souligné Hannah Arendt, le domaine de la polis était par excellence le domaine de la liberté: aussi, pour Aristote, la vie du citoyen était-elle constitutive de la vie bonne9. La vie bonne intègre la bios théoretikos et la bios politikos, car la recherche du bien propre est inséparable de la recherche du bien commun (EN 1142 a1-10).
d) La mémoire éthique communautaire et l’amitié
Les vertus de caractère, qui conditionnent, avec la phronèsis et la sophia, la possibilité de la vie bonne, relient le désir et la raison: par l’exercice de ces vertus, le sujet éthique exprime sa manière spécifique de se rapporter au plaisir et à la peine. À la différence de la prohairesis, la liaison qu’opère la vertu de caractère entre le désir et la raison ne s’effectue pas seulement au niveau de l’action, considérée dans sa particularité irréductible; elle s’effectue au niveau de la disposition habituelle du sujet à déterminer de manière autonome la juste mesure des passions et des actions en général. Comment une telle liaison est-elle possible?
La formation d’un éthos vertueux, capable de produire des actions adéquates aux circonstances, essentiellement contingentes, dans lesquelles le sujet éthique a à déployer son projet de vie bonne, est analogue à la formation de l’artiste ou du technicien: de même que le musicien devient musicien en faisant de la musique, de même l’homme juste et courageux devient tel en pratiquant la justice et le courage (1103b). Dès lors, deux conditions corrélatives, l’une temporelle, l’autre sociale, sous-tendent la formation d’un éthos capable d’assumer un projet de vie bonne:
– À l’instar de la formation technique-artistique, la formation éthique du caractère suppose la durée : le caractère éthique se forme par la réitération d’actes éthiques. Or, dans la mesure où elle porte sur le caractère, qui se forme dès la première enfance, la formation éthique exige une durée bien plus longue. En effet, la formation éthique sera d’autant plus précaire qu’elle sera tardive : ayant appris depuis l’enfance à associer tel objet au plaisir et tel autre à la peine, ou ayant fait du plaisir le seul repère de l’action, il nous sera ensuite «bien difficile de nous défaire d’un sentiment qui est entré si profondément dans notre vie» (1105 a1-4). Se projetant dans la longue durée, la formation éthique du caractère doit commencer dès l’enfance: «il faut, dès la première enfance, comme le dit si bien Platon, qu’on nous mène de manière à ce que nous placions nos joies et nos douleurs dans les choses où il convient de les placer; et c’est en cela que consiste la bonne éducation» (1104 b11). Or, une telle éducation sentimentale, à l’instar de toute autre forme d’éducation, ne peut pas être une entreprise isolée: dans la mesure où elle se joue dès l’enfance (1103 b25), la formation éthique du caractère suppose l’intervention d’autrui.
– À l’instar également de la formation technique-artistique, la formation éthique du caractère suppose donc un maître (1103 b10-15), c’est-à-dire l’existence d’un savoir institué, déterminé et transmis socialement à travers un système d’acteurs, d’institutions et de pratiques spécifiques (famille, communauté politique, éducation, législation…). La pratique de la transmission suppose, à son tour, l’existence d’une mémoire éthique de la communauté, dans laquelle se disent un télos et une orientation de l’activité individuelle et sociale. En effet, la signification de la fin de la vie humaine comme telle n’est pas une affaire purement privée: elle ne relève ni de la sophia ni de la phronèsis, toutes deux vertus intellectuelles, mais des vertus de caractère, dans lesquelles chaque sujet éthique actualise, selon ses propres circonstances particulières, la mémoire éthique de la communauté qui retotalise sans cesse son propre devenir humain. Le sujet éthique n’accomplit sa tâche propre que « …grâce à la prudence et à la vertu de caractère: la vertu de caractère fait que la fin qu’il poursuit est bonne, et la prudence fait que les moyens qui doivent y conduire le sont également» (1144 a7; 1151 a15-20). La fin, c’est-à-dire le bien que vise l’homme vertueux, n’est intelligible qu’à la lumière de la mémoire éthique de la communauté. L’éthos vertueux se constitue dans et par cette mémoire commune des fins, qui est donc la condition préalable à l’étude des principes de l’éthique-politique: «des mœurs et des sentiments honnêtes sont la préparation nécessaire de quiconque veut faire une étude féconde des principes de la vertu, de la justice, en un mot, des principes de la politique» (1095 b4). La capacité de se former une idée du bien et de vivre conformément à cette idée – ce que John Rawls décrit comme le pouvoir qu’a tout individu, dans une société libérale, d’être a priori «rationnel» – n’est pas innée ou spontanée: elle suppose une mémoire éthique, à partir de laquelle seulement le sujet peut être en mesure de penser les fins en général et de réélaborer les valeurs transmises en fonction des exigences du temps présent. Il y a donc une responsabilité sociale et politique à l’égard de l’«éducation sentimentale» – la formation éthique du caractère – du sujet pratique: le bon gouvernement se reconnaît par la volonté de maintenir vivante la mémoire éthique de la communauté (1103 b2-5) – ou, dans les conditions d’une modernité non individualiste, de maintenir vivantes les mémoires éthiques qui font de la société une communauté.
La relation à autrui, qui, avec la réflexion et l’expérience (la durée), conditionne la formation d’un éthos vertueux, apparaît, dès lors, comme une détermination essentielle de la vie bonne. La vie bonne n’est pas autarcique: l’interprétation individualiste d’après laquelle l’homme vertueux peut purement et simplement se passer d’autrui relève du contresens. Elle est en contradiction avec le principe de base de l’anthropologie aristotélicienne: l’homme est un être social et politique (zôon politikon), fait naturellement pour vivre avec autrui (1169 b18). Privé de ce lien avec autrui, l’individu humain se déshumanise ou, plus précisément, «s’infra-humanise» (Politique, 1253 a3). Le sujet de la vie bonne n’est pas soustrait à cette condition élémentaire d’humanité: l’autonomie, qui le définit comme sujet éthique, n’est pas synonyme d’autarcie. Le rôle essentiel de la relation à autrui dans la vie bonne est mis en évidence, d’une manière particulièrement forte, dans la pensée aristotélicienne de l’amitié. En elle-même, l’amitié est une vertu, c’est-à-dire une forme d’excellence qui qualifie l’excellence d’une vie humaine : une vie sans amitié serait une vie ratée. Cette corrélation essentielle entre la vie bonne et l’amitié dérive de la compréhension de la vie bonne comme un style de vie qui, prenant en charge l’essentielle vulnérabilité de la condition humaine, temporelle et contingente, vise à se constituer comme unité sensée et autonome par l’exercice de la réflexion propre à partir de la mémoire éthique de la communauté, en vue du bien propre et du bien commun. L’amitié conditionne nécessairement toute réponse aux exigences qui découlent de cette compréhension de la vie bonne et qui sont inhérentes à la propre condition de l’être humain – un être de besoin et de désir, mais aussi un être social et politique, un être moral et esthétique qui «désire savoir», et, enfin, un être pour qui le sens de l’existence est en question.
Du point de vue du besoin et du désir, deux déterminations qui traduisent l’essentielle vulnérabilité de la vie humaine, l’amitié est nécessaire (EN 1155 a28). Le sujet humain se trouve perpétuellement exposé à la négation de son être, de son œuvre et de son agir, par des facteurs naturels ou humains, prévisibles ou imprévisibles : face à la violence de certaines de ces négations, l’individu seul se trouve dépourvu. Pour soigner sa finitude – partager le poids des souffrances, atténuer des faiblesses, démultiplier les plaisirs –, le sujet humain a besoin de l’amitié d’autrui: les amis sont «le seul asile où nous puissions nous réfugier dans la misère et dans les revers de tous genres» (1155 a11). À la fragilité de la vieillesse, l’amitié apporte soin et secours; à celle de la jeunesse, conseil et éducation sentimentale ; à celle de la maisonnée (oikos), de l’aide pour la prise en charge des impératifs économiques liés à la survie (a9-13). Or, si elle est nécessaire, l’amitié ne peut pas se fonder sur la recherche du nécessaire: l’association purement utilitaire ou pragmatique – qui relève plutôt de l’alliance d’intérêts que de l’amitié – est par sa nature même précaire, et donc incapable de soigner la finitude humaine. Liée en vue de la simple nécessité, l’amitié s’autodétruit, laissant les individus dépourvus: l’entraide et la solidarité présupposent le désintéressement: elles figurent parmi les devoirs non écrits qui accompagnent, dans le contexte d’une culture de l’amitié, la relation à l’autre fondée sur l’amour ou l’estime de l’autre pour lui-même, et non pas pour les avantages qu’il peut nous apporter: la gratuité est la condition fondamentale de l’amitié authentique.
De même, la réalisation de l’humain comme être social et politique suppose l’amitié. En effet, la nature sociale et politique du sujet humain signifie que ce sujet existe essentiellement lié à d’autres sujets, excluant toute position d’autarcie; or, la réalisation (c’est-à-dire: l’actualisation excellente) de ce lien à autrui suppose l’accès à autre comme tel. Dans les termes d’Aristote, cet accès à l’autre en tant que tel s’exprime comme relation à l’autre en vue de l’autre et pour l’autre. Ces termes correspondent à la détermination de l’amitié proprement dite, distincte des liens affinitaires fondés sur l’intérêt propre – la simple recherche d’avantages pour soi-même. Seule l’amitié, dans sa forme privée ou publique, permet au sujet de sortir de soi et de découvir l’autre non plus comme un moyen assimilé à la sphère des finalités propres, mais comme un autre sujet: l’amitié réalise l’essence de la bienveillance, par laquelle le sujet pratique se décentre de son Moi (1156 a10, b10). Il y a donc une cohérence, au sein de la culture moderne individualiste, entre la disparition de l’amitié comme problématique éthique, d’une part, et la négation de la dimension originairement intersubjective («sociale et politique») du sujet humain, d’autre part. Pour la modernité individualiste, l’amitié n’est plus une condition de la vie éthique, réalisant l’être social du sujet, car celui-ci n’est plus compris comme une être originairement social : l’anthropologie individualiste comprend l’individu humain comme un être originairement souverain, délié de tout lien social, se suffisant a priori pleinement à soi: l’individu serait «humain» en soi, antérieurement au lien social, comme il serait liberté en soi, indépendamment de l’intersubjectivité. À partir de cette compréhension autarcique du sujet, la relation à autrui apparaît essentiellement négative, car elle vient limiter ma souveraineté: naturellement, « …les hommes ne retirent pas d’agrément (mais au contraire grand déplaisir) de la vie en compagnie», écrit Hobbes, au XVIIe siècle, dans Léviathan (chap. XIII); dans la même perspective, Kant soutient, au siècle suivant, qu’on ne peut pas aimer les hommes, et que le seul moyen de ne pas les haïr est de ne pas les fréquenter (Critique de la faculté de juger, § 29): l’association des hommes serait un fait purement contingent, déterminé par une contrainte extérieure, le manque d’espace (Doctrine du droit, § 13). L’amitié perd ici toute valeur éthique : fondée à présent sur un contrat visant à garantir les conditions de sécurité indispensables pour la poursuite de l’intérêt propre de chacun, elle n’a qu’une signification pragmatique ou utilitaire – ou purement abstraite : «j’aime l’homme, pas les hommes», déclarait le poète états-unien Emerson au siècle dernier10.
Être de besoin et de désir, être social et politique, le sujet de la vie bonne est aussi un être moral et sensible à la beauté, qui «désire savoir». Or, la possibilité qu’a un tel sujet d’assumer, de la meilleure manière possible, les exigences inhérentes à cette détermination de son être, présuppose l’amitié. L’éthicité de la vie bonne – c’est-à-dire son caractère «vertueux» – implique un certain niveau d’unité et d’autonomie, qui suppose, comme nous l’avons vu, une maîtrise relative de la discontinuité et de l’instabilité inhérentes aux affaires humaines. La vie du sujet éthique n’a pas la discontinuité du «caméléon» (1100 b6; 1101 a9) ni le perpétuel mouvement de flux et de reflux des «eaux d’un détroit» (1167 b6) : l’unité de son orientation dans le monde se maintient à travers la durée. Or, par l’amitié authentique, qui requiert en tant que conditions de possibilité la durée et l’habitude (1156 b26-32), le sujet tisse un lien stable avec autrui et avec le monde: l’amitié, qui est fidélité à un lien librement assumé, est par elle-même un défi à l’arbitraire de la fortune et à l’absurdité de la radicale contingence: l’amitié est enracinement dans le monde et, par là même, condition de la vie éthique. Or, du point de vue aristotélicien, la vie éthique rassemble les caractères du bien (agathon) et du beau (kalon): le bien, ce qui est bon pour soi-même, intègre nécessairement le beau (la justice envers autrui)11. Ce sont les actes à l’égard d’autrui qui sont dits beaux: il y a quelque chose de beau ou, comme dira Kant, de sublime, dans la relation authentiquement éthique envers autrui: comparable au beau ou au sublime de la nature, l’acte beau envers autrui «remue» quelque chose en nous. Par sa nature propre – relation avec autrui réalisant excellemment notre propre être-avec-autrui (notre dimension «sociale et politique») –, l’amitié rassemble le bien et le beau. Elle est source d’émotion esthétique :
Non seulement l’amitié est nécessaire ; mais, de plus, elle est belle et honorable. Nous louons ceux qui aiment leurs amis, parce que l’affection qu’on rend à ses amis nous paraît un des plus nobles sentiments que notre cœur puisse ressentir (EN 1155 a28).
Sensible à la beauté, le sujet humain est aussi un être qui désire savoir le pourquoi des choses. Or, la meilleure actualisation du style de vie qui prend en charge ce désir de savoir, la vie théorétique, dépend de la participation d’autrui – d’autres sujets qui désirent savoir. La vie théorétique, qui est, comme nous l’avons vu, une détermination particulière de la vie bonne, ne saurait être une vie privée d’amitié: dans l’affirmation de cette autarcie, «rien ne répond à la vérité (1169 b28). L’homme ou la femme qui pratique la théoria n’est pas au-dessus de l’humanité: il ou elle a besoin de la collaboration d’autrui, pour assurer à sa pratique une plus grande continuité et perfection (1170 a5), et donc un plus grand plaisir. Associé à d’autres, il ou elle pourra mieux pratiquer la théoria (1177 a35).
L’amitié conditionne la réalisation de ce qui a de la valeur pour l’être humain comme tel, c’est-à-dire pour un être déterminé dans son être par le besoin et le désir, le plaisir et la souffrance, la relation avec autrui, l’ouverture au bien, à la beauté et à la vérité relative au pourquoi des choses. Or, toutes ces déterminations de l’humain sont recueillies par une autre détermination fondamentale: l’être humain est l’être pour qui le sens de l’existence est en question – l’être par qui le sens advient comme question. Dans ce questionnement sur le pourquoi de la vie humaine, distinct de la recherche théorétique sur le pourquoi des choses, le sujet humain s’enquiert du sens et de la valeur de l’existence comme telle, et non pas seulement de ce qui en elle a de la valeur. Miguel de Unamuno nommait «faim de l’esprit» (hambre espiritual) le type de besoin qui sous-tend cette quête du sens et de la valeur – les «nourritures spirituelles» de l’être humain, qu’on ne devrait pas opposer dichotomiquement aux «nourritures terrestres». Dans la mesure où elle exprime cette faim de l’esprit, la question du sens ne relève pas de la «contemplation» ou de la spéculation gratuite: elle n’appartient pas à ce domaine de questions «scolastiques» décrites par Pierre Bourdieu, qui ne sont jamais posées « sous la pression de l’urgence12 » et qui n’ont d’autre fin qu’elles-mêmes. Ce serait avoir une conception dévaluée du symbolique de l’homme – de l’homme tout court – que d’assimiler l’interrogation sur le sens à une activité purement ludique, voire à un «luxe». Sur ce point, la perspective d’Unamuno semble plus équilibrée que celle de Bourdieu: tout en observant que la prise en charge des besoins symboliques présuppose la satisfaction des besoins «matériels» – et, chez l’homme, ces intérêts possèdent toujours une dimension symbolique –, Unamuno reconnaît que la sortie de la situation d’urgence économique – qui, dans toute société relativement bien ordonnée, ne pourrait être considérée comme la règle des situations humaines – implique l’avènement de l’urgence symbolique. Aussitôt qu’il s’est libéré du pressant besoin de pourvoir à ses besoins matériels, le sujet «en chair et en os» se trouve soumis au besoin non moins pressant de sens – question qu’Unamuno identifie à celle de la «survivance» (sobrevivencia): en supposant que le problème du pain fût résolu pour tous, le non-éclaircissement de la question du sens créerait encore de nouveaux antagonismes: le meurtre d’Abel par son frère Caïn « ne fut pas une lutte pour le pain, mais une lutte pour survivre en Dieu, dans la mémoire divine13 ».
Avec une force dont on ne trouve d’égal que chez Kierkegaard, Unamuno montre que le questionnement sur le sens n’a rien de gratuit: il est même l’activité la moins gratuite, car, du point de vue du sujet humain, il y va de l’orientation de sa vie en général. Quand ce questionnement n’est pas pris en charge, ou qu’il l’est mais de manière déficiente, le sujet – quelles que soient ses circonstances sociales et économiques – s’expose au risque d’être dirigé par des représentations précaires, voire aliénantes, du sens et de la valeur. La prise en charge des besoins de « nourriture nécessaire à la vie de l’âme14 » n’est donc pas un simple jeu, entendu comme divertissement. Et, s’il est un jeu, il s’agit en tout cas d’un jeu sérieux: mais le sérieux du jeu ne dépend pas ici de la volonté de « jouer sérieusement15 », mais du propre enjeu du jeu: le sens orientation et signification de la vie.
L’amitié conditionne la prise en charge de cette détermination essentielle de l’humain qu’est l’exigence de sens. Non seulement au sens où le monde (l’intersubjectivité) est le «lieu» spécifique à la question du sens de la vie humaine – de ce point de vue, le pouvoir de comprendre le sens de l’humain et de discerner le télos propre à une vie humaine suppose tant l’amitié publique (la mémoire et l’actualité de la ---, réalisation de l’amitié communautaire) que l’amitié des plus proches. À un niveau existentiel, et donc plus fondamental, l’amitié conditionne le sens même de la prise en charge du sens et des autres besoins humains: «personne n’accepterait de vivre sans amis, eût-il d’ailleurs tous les autres biens» (EN 1155 a5). Personne n’accepterait de vivre sans amis: c’est dire que la vie n’aurait pas de sens. Nul bien de l’économie, nulle vertu de caractère, nul savoir pratique ni théorétique ne saurait justifier à lui seul une vie humaine. Pensée abstraitement, en dehors de la relation effective avec autrui, la vertu du sujet perdrait tout son sens. À quoi bon l’autonomie, si nous vivons dans l’autarcie ?
Trois chemins, de forme et de contenu très différents, nous permettent d’accéder à la vie et à l’œuvre du grand philosophe grec. Le premier retrace le parcours de vie de l’homme Aristote dans la société grecque du IVe siècle avant l’ère chrétienne. Le deuxième a comme fil conducteur la signification aristotélicienne de l’acte de connaître. Il pénètre dans les domaines les plus importants de la pensée aristotélicienne : la métaphysique, l’ontologie, la théologie, la philosophie de la nature, la logique, la « technique », l’éthique et la politique. Le troisième chemin prend son départ chez Aristote et suit certaines traces que sa réflexion éthico-politique a laissées dans l’histoire de la pensée occidentale. Il s’agit d’une introduction à Aristote, mais introduire à une philosophie, c’est aussi établir un rapport critique avec un auteur et avec la tradition à laquelle il a donné naissance. Dans ce livre, les développements consacrés à la question de l’esclavage, à la détermination du concept de suffisance à soi et du caractère essentiellement théorico-pratique de la sagesse, ouvrent des pistes pour un tel rapport critique avec Aristote.
Alfredo Gomez-Muller est professeur à la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, où il dirige par ailleurs le Laboratoire de philosophie pratique et d’anthropologie philosophique, ainsi que le Groupe interdisciplinaire de recherches en éthique (GIRE). Il est notamment l’auteur des ouvrages : Sartre, de la nausée à l’engagement (Paris, 2005), Éthique, coexistence et sens (Paris, 1999), Alteridad y ética desde el descubrimiento de América (Madrid, 1997). Il est par ailleurs l’auteur de la préface et des notes à l’Éthique à Nicomaque d’Aristote, publiée au Livre de Poche en 1992, à la suite de la première édition de ces Chemins d’Aristote.