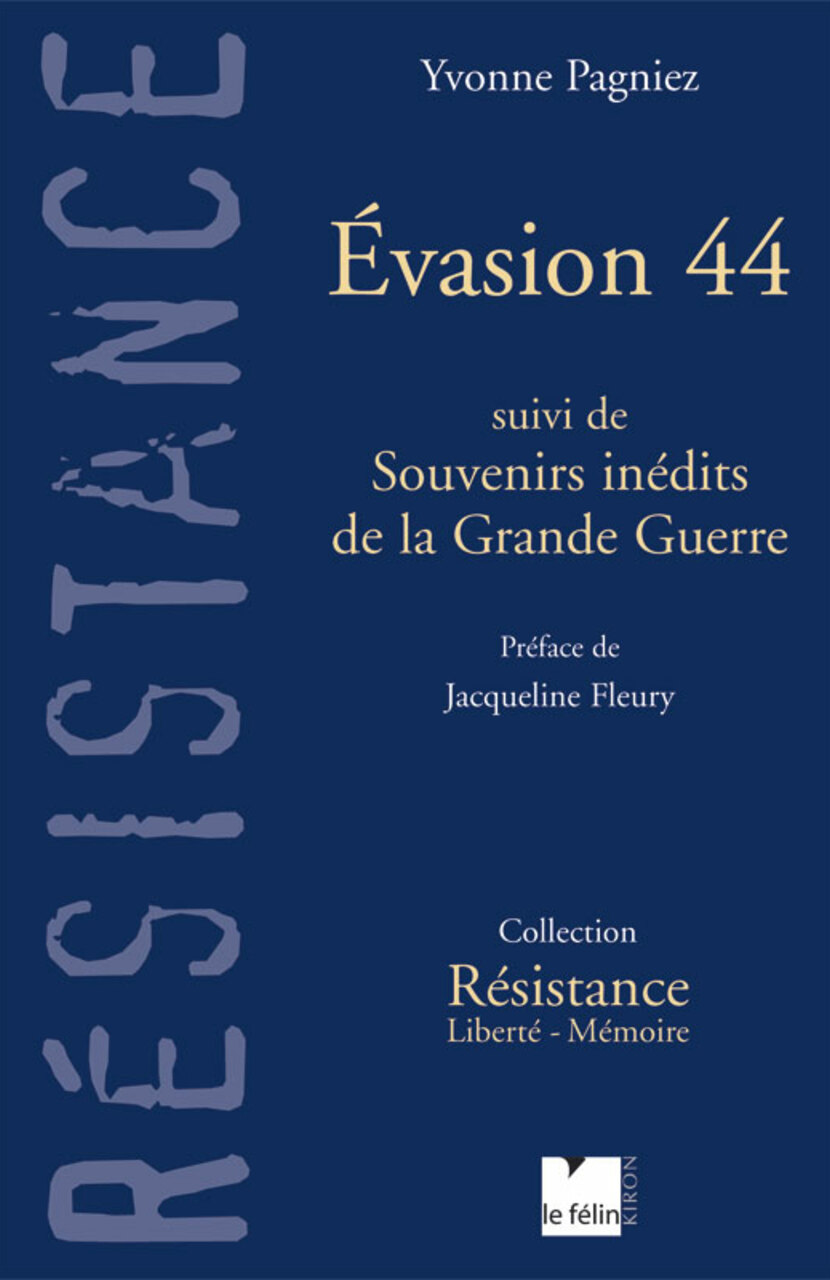
Évasion 44
Depuis plusieurs semaines, je cherchais le moyen de m’évader. Cette vie d’esclavage, l’humiliation de toutes les heures, et surtout l’ignorance totale où nous étions de ce qui se passait en France, de ce que devenaient, dans l’anxiété de notre absence, les êtres chers qu’une coupure brutale avait comme rejetés dans un trou noir où notre inquiétude en vain les cherchait, – ce complexe de tortures physiques et morales, je ne pouvais plus, à la lettre, le supporter. Plutôt risquer le pire que de tourner ainsi en cage en ruminant son angoisse !
Il y avait bien pour me retenir le souci des camarades, cette charité qui, nous penchant sur les autres, nous donnait à nous-mêmes la force de vivre. Mais je n’atteignais pas au degré d’abnégation qui rivait une Yvonne Baratte, une Nanouk à la chaîne des forçats pour aider les autres à traîner leur boulet. Et puis – cette pensée peut-être fallacieuse m’enlevait tout remords – est-ce qu’il ne fallait pas que quelqu’un s’échappât de cet enfer pour appeler à l’aide, pour faire éclater au jour un crime que nous avions la naïveté de croire enfoui dans les ténèbres, ignoré des sphères dirigeantes ? Ce sont les bourreaux auxquels nous sommes livrées, pensions-nous quelquefois, qui abusent cruellement de leur autorité. Il n’est pas possible qu’un gouvernement, même nazi, ordonne une si atroce extermination de femmes. Et je m’imaginais que si j’apportais en France la vérité sur notre bagne, une révolte du monde civilisé en ferait cesser l’horreur. Qui sait, à l’intérieur même de ces frontières, la Croix-Rouge avertie interviendrait peut-être…
Donc, j’étais résolue à m’enfuir. Pendant les cinq semaines que nous passâmes à Torgau, j’avais lentement, soigneusement, préparé un plan d’évasion. Ce kommando était bien moins fermé que le camp de Ravensbrück. Au lieu du haut mur bétonné, couronné d’une frise électrique, que coupait un seul portail gardé par des soldats et des chiens, nous avions ici pour clôture une double haie de barbelés, autour de laquelle tournait jour et nuit une sentinelle armée. Un autre gardien veillait, mitraillette à la main, en haut d’un mirador d’où son regard embrassait l’ensemble de notre campement.
Il était possible, par les nuits sans lune, de creuser peu à peu une tranchée avec les mains sous les barbelés, en s’aplatissant dans l’ombre quand passait la sentinelle, en cachant le jour sous des plaques de gazon le travail de sape. Une fois dehors, mon intention était de filer droit vers Leipzig, à cinquante kilomètres dans le sud-ouest. Par les prisonniers que je rencontrais en allant aux champs, avec qui j’échangeais secrètement quelques mots, j’avais des indications sur la route à suivre. La plus sûre cachette me paraissait une grande ville peuplée où je trouverais bien à me camoufler quelques jours, le temps de recueillir les renseignements, l’aide peut-être nécessaires à la poursuite de l’aventure.
Il valait mieux être deux pour affronter les risques de l’expédition. Après avoir longtemps balancé, étudié mes compagnes, je m’ouvris de mon projet à une solide Danoise avec qui je m’étais liée d’amitié. Une fille sportive, franche comme l’or, et qui n’avait pas froid aux yeux. Je parvins à la convaincre. Elle aussi préférait au collier les mille dangers de l’inconnu.
Décidément, le ciel nous aidait ! Un beau jour d’octobre, comme nous appartenions à la même équipe de travailleuses agricoles, nos amis les prisonniers nous glissèrent à chacune, derrière un silo de pommes de terre, un grand chandail que nous dissimulâmes sous nos robes, mais qui devait, endossé par-dessus la casaque de bagnarde, en cacher aux trois quarts les couleurs voyantes. Puis, il y eut ce miracle : Par une courageuse compagne embauchée à l’usine, nous entrâmes en possession d‘une paire de tenailles qu’elle avait dérobée et camouflée sous ses vêtements.
Des tenailles, c’était la possibilité de couper les fils, de se frayer un passage bien plus facile que ce tunnel qui n’en finissait pas, creusé à force d’ongles et de poings. Que de minutes émouvantes j’ai passées, la nuit, sous le prétexte – trop valable, hélas ! car nous avions toutes la dysenterie – d’aller aux toilettes au fond de la cour, que d’instants pleins de rêve, à examiner les barbelés pour choisir le point qu’on ferait sauter dès que la lune nouvelle plongerait le camp dans l’obscurité !
Je donnais rendez-vous à Sunny la Danoise dans la baraque puante où nous prenions deux places côte à côte ; et, tout bas, car plusieurs des vingt-cinq trous étaient constamment occupés, nous complotions… Le lourd bruit de bottes qui passait à intervalles égaux nous faisait bien un peu trembler. Mais si belle était la campagne inondée de lune, que nous regardions au sortir du cloaque, le nez collé contre les pointes rouillées de la clôture. Ah ! bondir libres dans cette plaine immense, si calme, que les premiers gels saupoudraient, dans la nocturne clarté, d’un givre bleu comme du verre !… Mais c’était le second quartier seulement. Deux semaines d’attente !
Et voici qu’avant même que la lune fût pleine, Badine1 annonça un matin, à l’appel, le départ imminent des cinq cents femmes qui composaient le kommando de travail de Torgau. Le convoi devait être partagé en deux portions égales. Une moitié irait vers le sud, en Thüringe, disait-on, pour être employée dans une usine d’aviation. L’autre moitié, à laquelle j’appartenais ainsi que Sunny, retournerait à Ravensbrück. Nous fûmes atterrées. Notre beau plan, si merveilleusement rêvé, préparé pendant des semaines, avec une minutie qui ne laissait rien à l’imprévu ! Tant de peine, tant d’espoirs devenus vains !
Nous vîmes partir, un matin, nos deux cent cinquante compagnes, dans une aube glacée où grelottait leur troupeau misérable, vêtues de minces robes, visages blafards dans la grise clarté qui filtrait d'un ciel encore noir. Je me souviens de ce départ lugubre. Plusieurs amies auxquelles je m’étais attachée s’en allaient ainsi vers l’inconnu. Zig et Puce me faisaient, de loin, des signes qui voulaient être gais. En queue de la colonne, je reconnaissais Germaine Huard, qui se retournait de temps en temps pour me sourire. Un pauvre sourire figé sur ses traits verdâtres. Elle avait si froid qu’elle tremblait toute ; et je songeais avec angoisse, la voyant si maigre, si pâle, aux cinq petits enfants qui l’attendaient à la maison, qui ne la reverraient peut-être jamais plus.
Nous qui restions, nous étions massées en un bloc au fond de la cour. Quand les premières partantes franchirent la porte, nous entonnâmes toutes en chœur le Chant des Adieux : « Ce n’est qu’un au revoir, mes sœurs… » ces strophes poignantes qui avaient accompagné déjà plusieurs séparations, et qu’aucune de nous ne peut plus entendre sans pleurer.
Est-ce notre refrain, bien pacifique pourtant, qui alluma la fureur de Badine ? Lesté d’alcool, selon sa coutume, dès le matin, il se précipita sur notre groupe, jurant, grondant, et de sa cravache, au hasard, frappa sauvagement. La pauvre petite Hélène P., tombée sous les coups, se roulait au sol, tandis que la brute s’acharnait sur elle. Nanouk, toujours généreuse, ayant imprudemment esquissé un geste de protestation, reçut en plein visage la baguette cinglante, qui laissa une trace de sang. Nous regardions, glacées d’épouvante. De l’autre côté des barbelés, une dizaine de soldats de la Wehrmacht, attendant le troupeau en jupons qu’ils étaient chargés d’escorter, ne purent retenir un mouvement d'indignation Mais pas un d’eux n’osa intervenir.
Nous devions partir nous-mêmes le lendemain matin. Ma résolution fut vite prise. À Ravensbrück, il ne pourrait guère être question de fuite. Je connaissais le sévère isolement du camp, sa ceinture de béton, de fer, d’humaine férocité. Trois jours me restaient pour courir ma chance. À tout prix, saisir la première occasion, la seule peut-être qui s’offrirait, en cours de route, de prendre le large. Ces lents voyages en chemin de fer se pouvaient prêter mieux du reste à une évasion que la vie réglée du camp. Je pris langue avec Sunny tandis que nous allions pour la dernière fois arracher côte à côte les pommes de terre des fermiers saxons.
Déception ! Sunny ne voulait plus s’évader. La ruine de notre plan l’avait découragée ; elle n’osait pas se risquer dans une entreprise tout entière imprévue. Et puis, son amie Cécile Goldet, l’infirmière du Vercors, venait d’être atteinte d’une grosse fièvre avec éruption qui faisait craindre la scarlatine. Sunny se sentait nécessaire, pendant le dur voyage, au chevet de la malade, que sa sollicitude en effet sauva d’une mort certaine.
Je demeurais isolée avec mon projet plein de rêve, plein de fièvre, auquel en aucun cas je ne voulais renoncer. L’accomplirais-je seule ? Ou trouverais-je d’ici demain matin une autre compagne d‘aventure ? Après quelques hésitations, et malgré l’inconvénient d’un attelage improvisé, je me rangeai à ce second parti. On risque moins à deux, l’une compensant les défaillances de l’autre. Toute la journée, je fis des travaux d’approche, sans démasquer mes batteries. J’appris enfin qu’une Suissesse que je ne connaissais pas du tout serait disposée, si l’occasion s’en présentait, à brûler la politesse à nos gardiens. On me la dit sûre. J’allai la trouver, le soir, dans sa couchette du troisième étage. Elle me fit bon accueil, et m’assura – condition, pensais-je, essentielle, – qu’elle parlait parfaitement l’allemand. Nous convînmes de nous glisser dans le même wagon, et, sans cesse aux aguets, de profiter de la moindre fissure dans la surveillance.
Je ne dormis guère cette nuit-là. Françoise non plus, ma nouvelle complice, qui, à la faveur d’un relâchement de discipline dû au départ d’une partie des gardiennes, put se procurer un bout de bougie, des ciseaux, une aiguille, et passer des heures à couper sa robe trop longue, à doubler avec les morceaux ces grands X appliqués sur nos vêtements devant et derrière, des épaules jusqu’en bas, et sous lesquels on taillait l’étoffe. Elle pourrait ainsi les découdre sans qu’apparut leur trace en creux. Sa robe était en tissu bayadère, les X s’y détachaient en vert. Cela faisait à la pauvre fille un vrai plumage de cacatoès ! Quant à moi j’avais la chance de posséder une toilette moins voyante : brune, avec une croix noire, et mon chandail en dissimulerait les trois quarts.
Vint le matin. Comme nos compagnes de la veille, nous partîmes dans le gris d’un petit jour glacial. Je m’étais faufilée dans la colonne aux côtés de Françoise, et nous attendîmes longtemps debout, grelottantes, tandis qu’on appelait devant nous, par paquets de vingt, les camarades dont les rangs s’amincissaient. Badine était plus calme. Il devait nous accompagner jusqu’à Ravensbrück, et je songeais sans plaisir à ce cerbère qui ne tolérerait aucun écart de discipline.
Sous ma robe, je cachais les tenailles. Je les serrais du bras gauche contre mon flanc, si fort que je les sentais s’imprimer dans ma chair. Ce n’était pas facile de les camoufler ; elles étaient énormes : grandes et grosses comme des pincettes à feu. Mais cet instrument pouvait nous être très utile, car je me souvenais qu’aux précédents voyages, les fenêtres de nos wagons à bestiaux étaient grillées de barbelés. Et c’est à cette issue précisément que je pensais. Je connaissais le trajet que nous allions faire, que nous avions fait déjà en sens contraire, quelques semaines auparavant. Notre train s’était arrêté des heures, la nuit, en gare de Berlin. Un grand espoir, aujourd’hui, me soulevait. Berlin n’était-il pas bombardé tous les jours ? Nous y avions subi, en septembre, une attaque nocturne, pendant laquelle nos gardiens avaient fui dans les abris, nous laissant enfermées entre les tôles des wagons, comme bêtes en cage. Si pareille aubaine pouvait nous échoir la nuit prochaine ! Avec les tenailles, ouverte la prison ; et profitant de la grande solitude qu’épandent les bombes sur la ville secouée par la mort, nous nous glisserions hors de la gare, irions nous perdre quelque part au profond de la capitale… Je priais Dieu dans mon cœur de diriger demain toute une nuée d’avions au-dessus de la grande cité prussienne, pendant que notre troupeau parqué stationnerait sur les voies de garage.
Pour l’instant, il s’agit de ne pas faire confisquer les tenailles. Cela pourrait me coûter cher, du reste ! Pourvu que l’Aufseherin ne remarque pas ma démarche guindée quand je passerai devant elle à mon tour, pour rendre ma couverture et ma gamelle !
Tout à coup, j’ai peur. Un petit groupe de nos compagnes revient du lieu d’embarquement, où elles ont été commandées de corvée pour répandre la paille dans les wagons. Elles ont vu monter la première colonne.
– Attention, – murmurent-elles, et le propos s’étend comme une traînée de poudre – attention, on fouille tout le monde à l’entrée des fourgons.
Que faire ? Je me sens trembler. Mes tenailles sont lourdes ; elles me paraissent grandir encore contre mon flanc, devenir gigantesques, sauter aux yeux. Vais-je m’en débarrasser dans les toilettes ? Mais c’est renoncer peut-être à la seule chance de salut. Non, je n’ai pas le courage de me priver de mon talisman. Advienne que pourra. Je risque. La fortune aide les audacieux.
J’ai remis ma couverture, ma gamelle. La gardienne n’a rien vu. Nous sortons maintenant par cinq de rang, vingt à la fois ; j’ai réussi à prendre place dans la dernière rangée, pour observer la manœuvre avant que vienne mon tour.
Le train stationne à cent mètres du camp, près de l’usine, sur ces voies où l’on déchargeait les vieilles douilles que nous devions décaper dans des bacs pleins d’acide. Comme il n’y a pas de quai, les wagons paraissent très haut perchés sur leurs roues. Au seuil de celui qu’on nous désigne, se tient une mégère en uniforme, vaste, criarde, robuste, une espèce de fille de ferme travestie en Walkyrie, que je connais bien pour avoir valsé sous ses ordres dans les champs de pommes de terre.
– Aufsteigen !
Elle saisit par les poignets une femme âgée que deux ou trois compagnes soulèvent par le postérieur. À quatre pattes, l’esclave à cheveux gris fait son entrée dans la cage. Une seconde suit, puis une troisième, hissées, poussées. Une quatrième saute lestement. Chacune, dès qu’elle met le pied sur le plancher, est palpée par la guerrière aux mains énormes, qui lève même les robes pour vérifier les haillons de linge, dont les plis pourraient cacher quelque objet suspect.
Quand nous ne sommes plus qu’une demi-douzaine, à la faveur d’un désordre facilement créé en bousculant à droite et à gauche les retardataires, je fonce au travers du groupe, bondis en m’agrippant d’une main à une barre de fer, tombe sur les genoux au seuil du wagon où je me traîne, preste, laissant glisser sous ma robe le lourd instrument que j’avais bien failli perdre dans mon élan, et qui vient tout naturellement s’enfouir dans la litière de paille. D’un revers de main, je le fais disparaître, tandis que l’Aufseherin m’empoigne par la peau du dos pour me fouiller. Je me retiens de rire, quand elle pose ses grosses pattes sur ma poitrine, sur mes hanches, et vide mon sac sur le plancher.
Nous restons plusieurs heures sur la voie de garage, à côté du camp vidé. Notre porte reste ouverte, et Badine fait les cent pas sur le ballast, escorté de son état-major, hommes et femmes sanglés dans la même tunique verdâtre, coiffés du même calot en virgule verte sur des têtes brutales.
Les deux fenêtres rectangulaires – une sur chaque face du wagon – sont fermées par des volets de fer serrés de lourdes vis. Je meurs d’envie de manœuvrer ces gros écrous. Sont-ils mobiles à la main ? Les tôles ne sont-elles pas rivées par une soudure ? Et sous le panneau, y a-t-il des barbelés, ou bien des barreaux scellés ? Le cœur me bat, mais il me faut réprimer mon impatience, pour ne pas attirer l’attention.
Ce n’est que vers midi, quand le train roule déjà depuis plus d’une heure, que négligemment je me lève. J’ai eu soin de choisir ma place juste au-dessous de la fenêtre, contre la paroi opposée à la porte. Françoise est accroupie auprès de moi. Deux soldats en armes, en plein centre du wagon, oscillent sur leur séant, aux cahots du train. Ils ont l’air tranquilles et bêtes, pas méchants au demeurant ; mais le fusil ne quitte pas leur épaule, et chacun d’eux porte une grenade à la ceinture.
Je me soulève, profitant du moment où la distribution du pain brasse vigoureusement l’habituelle salade de corps humains qu’est notre troupe en voyage. L’écrou. Il tourne tout seul ! Je soulève, avec peine parce qu’il est lourd, le couvercle de fer. Miracle ! L’ouverture, là-dessous, est libre. Pas le moindre grillage. Un rectangle de ciel bleu saute à mes yeux éblouis. Béni soit le Seigneur, qui ouvre sous d’aussi favorables auspices notre route d’aventure.
– Fermez, sacrebleu ! hurle une voix furieuse derrière moi.
– Elle s’en fout bien, si nous grelottons dans les courants d’air, grogne une autre voix. Est-ce que t’es matelassée, pour ne pas sentir le froid ?
Docilement, je rabats le panneau, je m’accroupis, le dos à la paroi, dans l’espèce de fumier qu’est déjà le mince tapis de paille, pétri par trop de pieds, de mains, de genoux et de postérieurs. Autour de moi, le grondement se répercute quelques instants. Mais je ne veux pas répondre. Car c’est un cri d’enthousiasme qui jaillirait de ma gorge si j’ouvrais seulement la bouche. Comment cacher cette joie qui fait chanter tout mon être, cette espérance qui carillonne dans ma tête ? À peine puis-je me pencher vers Françoise, lui murmurer à l’oreille :
– La fenêtre est libre !
C’est incroyable comme, en de graves conjonctures, de petites choses peuvent être décisives. D’avoir nargué la mégère en lui passant mes tenailles sous le nez, bien que ces tenailles s’avèrent à présent tout à fait inutiles ; surtout, de voir tomber comme les murailles de Jéricho le premier obstacle en travers d’une issue que je n’aurai peut-être jamais le loisir d’emprunter, – ce double succès, bien mince, m’a métamorphosée. Je ne sens plus mes membres brisés par les durs travaux, ni la faim qui, depuis des mois, jour et nuit, me torture, ni cette immense lassitude où l’on glisse tout doucement comme dans la mort, pieds et poings liés, incapable de réagir. Une force étrange m’habite. Il me semble que les circonstances vont se plier – elles le doivent – à cette énergie triomphante qui est en moi. Oui, dès l’instant où j’ai repris ma place, à croupetons, dans le fumier humain, sous la fenêtre refermée, j’eus la certitude que j’échapperais à cette prison, que je n’arriverais pas à Ravensbrück.
Une autre condition – minime croirait-on – décida de mon sort : Ce fut le temps splendide de cette journée d’automne. Le soleil, tard levé, avait dissipé la brume où notre cohorte grelottante ce matin s’immergeait. Il était apparu vers midi, déchirant les nuées, radieux dans un ciel aux limpides profondeurs. Et la température, si froide à l’aube, était devenue exceptionnellement douce.
Je me souviens de ces heures du milieu du jour, presque tièdes dans l’entassement du wagon. Nos gardes-chiourme, sans doute écœurés par la puanteur du lieu, avaient ouvert grande la porte à glissière, et se tenaient assis sur le seuil, jambes pendantes au dehors. Entre leurs silhouettes massives, au-dessus de leurs têtes en calot vert qui dodelinaient près de la pointe du fusil, nous apercevions du fond de notre antre, comme ces jardins d’été qu’on regarde à travers les persiennes, éclatants de parfums et de clarté, les immenses forêts de la Saxe que nous traversâmes tout l’après-midi, au train des chenilles.
Des bouffées d’air sylvestre venaient jusqu’à nous, qui sentaient la résine, l’herbe mouillée, et cette odeur grisante des feuilles qui pourrissent, en tapis brunissant, entre les troncs dégarnis. Sous nos yeux se déroulait, à la fois proche et lointaine, une houle d’un vert sombre, ou bien dorée jusqu’à l’incandescence, toute mouvante de reflets, tantôt très dense, épaissie de mystérieuses profondeurs, tantôt aérée de ciel bleu, étendue à l’infini, lente, éternelle eût-on dit. Noires sapinières où dansait du soleil parmi les ramures énormes. Panaches ruisselants des pins plus souples, lumineux comme des lanternes, et qui tremblaient à la brise. Vagues vivantes des hêtraies pourpres, des peupliers tout en or , des bois de bouleaux frissonnants de miroirs autour des longs fûts si pâles. La forêt vivait autour de nous. Des chemins couverts s’enfonçaient dans des épaisseurs de feuilles, et leur coulée, sous la voûte flamboyante, était une clarté de rêve, si pure, légère, comme si toutes choses y perdaient leur poids de matière. Au galop passaient des biches dans les sentiers ardents.
Il faut avoir vécu ces heures bouleversantes au fond d’un bagne roulant d’où l’on aperçoit toute la splendeur de vivre, pour comprendre le déchirement de tant de douceur entrevue qui s’en va pour jamais, le charme, prenant jusqu’au fond de l’être, de ces jardins interdits dont l’éblouissement vous atteint au travers des barrières. C’est la terre qui se révèle à ces déshéritées en un fulgurant adieu, si beau que le cœur vous rompt d’enthousiasme et de tristesse ; on en meurt, ou on brise les barreaux de la cage.
Je suis sûre que le soleil fut ce jour-là mon meilleur complice. À quoi tient la destinée ? Si ce mercredi d’octobre avait été pluvieux et gris, peut-être aurais-je, comme la plupart de mes compagnes, fini mes jours atrocement dans un camp d’extermination… Mais un bon génie me soufflait les gestes à faire.
Pour l’instant, tout en m’imprégnant de cette lumière qui incendiait les bois, de plus en plus dorée à mesure que venait le soir, une lumière calme dont le reflet seul se coulait en notre tanière, et qui versait en moi une sorte de lucidité, tranquillement, je préparais mon sac. La tranche de pain qu’on nous avait distribuée à midi, je ne voulais pas la manger, malgré ma fringale accrue par l’émotion. Elle constituerait ma maigre provision de route. Je gardais aussi – richesse précieuse – les rares friandises que Badine s’était décidé à nous partager l’avant-veille ; reliefs des dons généreux de nos amis les prisonniers de guerre, où nos gardiens avaient, pour leur propre compte, abondamment puisé. Je possédais pour ma part une demi-tablette de chocolat, une cuillerée de lait en poudre, un doigt de pâte de fruits, vingt-cinq ou trente grammes de margarine et une once de pâté ; le tout en vrac, formant une mixture étrange, bien appétissante cependant pour des affamés. Il fallait un courage surhumain pour ne pas l’engloutir tout de suite en trois bouchées.
Je me préoccupais aussi des suites de l’évasion. Après chaque arrêt un peu long, on nous comptait et recomptait dans chaque fourgon. Et il importait de ne de pas donner l’éveil trop vite, de nous laisser le temps de prendre du large. Je confiai donc mon projet à Yvonne Baratte, qui était chef de wagon. Je lui demandai même de partager notre fuite, ce qu’elle refusa pour continuer son apostolat de charité. Elle me promit qu’au premier dénombrement, elle créerait des remous susceptibles de jeter la confusion, et que deux de nos compagnes, par un tour de passe-passe, doubleraient leur présence. Ainsi pouvions-nous espérer que, jusqu’à Ravensbrück, c’est-à-dire pendant vingt-quatre heures, notre absence resterait inaperçue.
Vers trois heures de l’après-midi, le train s’était arrêté une première fois, en gare de Falkenberg. Quelques-unes d’entre nous avaient obtenu de descendre, sous le prétexte de besoins naturels des plus urgents. J’étais du nombre. Des soldats nous gardaient. Cependant, comme nous nous égaillions au revers d’un talus très embroussaillé qui descendait jusqu’au fond d’un ravin, j’aurais pu, me semble-t-il, me glisser dans un buisson, m’y tapir. Je ne le fis pas. L’endroit me paraissait peu propice, trop loin d’une grande ville. Et puis, Françoise, à qui j’avais recommandé de me suivre comme mon ombre, par une fausse manœuvre, s’était écartée. Quand nous remontâmes dans le wagon, j’en eus du regret.
«Comment était-il possible de s’évader lorsqu’on était esclave des nazis et ce fait rarissime ne se terminait-il pas toujours par l’arrestation, suivie de l’exécution du coupable? Et pourtant, Yvonne Pagniez nous a livré son témoignage, épisode singulier de sa propre histoire. Femme de caractère, d’un courage peu commun, elle apporte une grande précision dans la description d’événements vécus qui se déroulent dans une ambiance tragique qu’elle restitue d’une manière étonnante. C’est en effet au cours d’un transport en wagon à bestiaux que notre compagne s’est évadée. Suivra une longue errance dans les ruines de Berlin, souvent sous les bombardements, dans la brume glacée de l’automne. Sa parfaite connaissance de l’allemand est sa seule force et bien souvent, harassée et repérable, elle est étreinte par la peur car la Gestapo est omniprésente. Elle n’oublie pas les interrogatoires subis rue des Saussaies à Paris et la sinistre réputation du Strafblock de Ravensbrück.»
Extrait de la préface de Jacqueline Fleury
Yvonne Pagniez (1896-1981) est l’auteur avant guerre de Ouessant et Pêcheur de goémon, et après guerre – outre Évasion 44, grand prix du roman de l’Académie Française et considéré comme son ouvrage le plus marquant – de Scènes de la vie du Bagne et Ils ressusciteront d’entre les morts. Grande journaliste, elle a couvert l’Indochine comme correspondante de guerre. Ses articles seront publiés dans Études, le Journal de Genève et La Revue des deux mondes.
Préface de Jacqueline Fleury