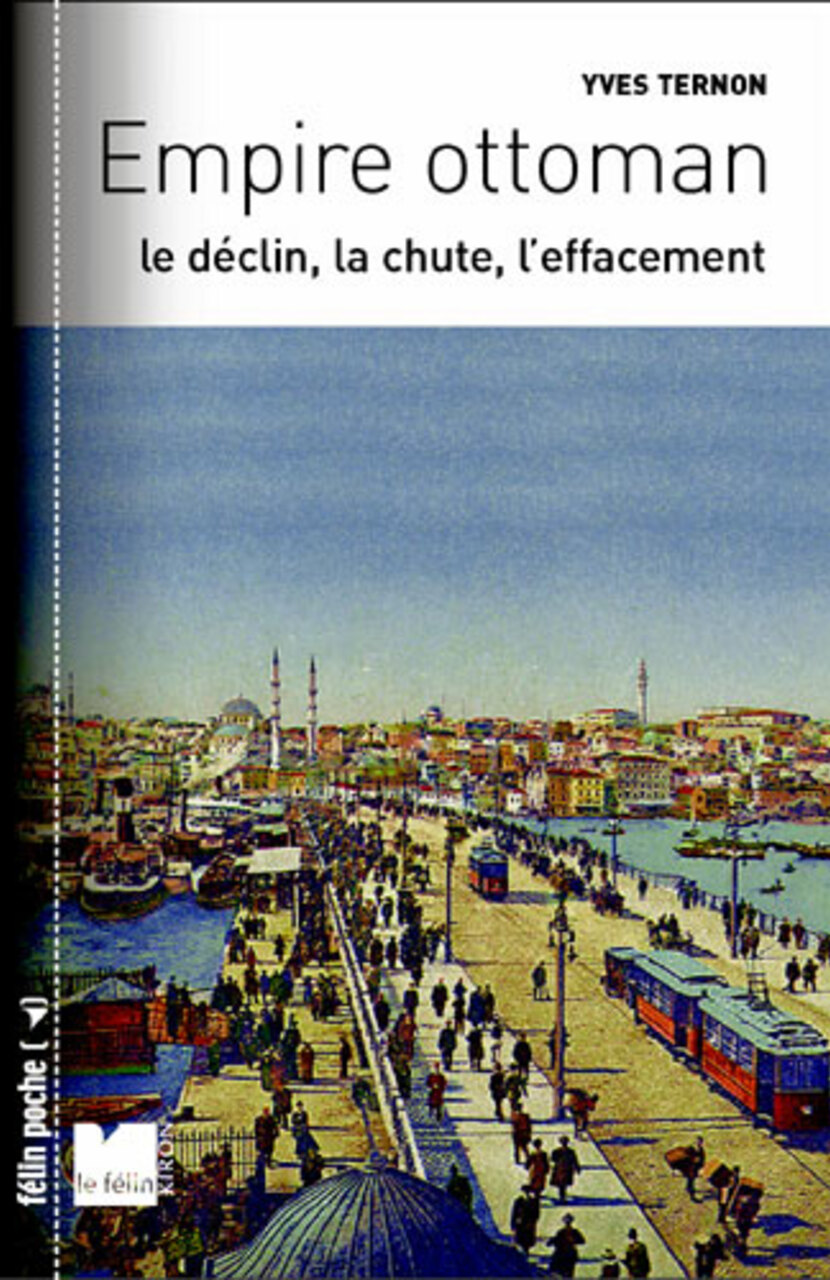
Empire ottoman
Cette histoire porte sur les quinze dernières années de l’Empire ottoman et les quinze premières années de ce que l’on convient d’appeler la Turquie moderne. Cependant, cette courte période n’est interprétable qu’au terme d’une analyse des causes et des circonstances d’un déclin qui s’étend sur un temps long d’au moins deux siècles et d’un rappel, aussi succinct soit-il, de l’élaboration et de la splendeur de cet empire qui dure six siècles et s’étend sur trois continents. Le récit commence donc par une vision panoramique puis resserre le champ de telle sorte que, à mesure qu’on se rapproche du moment de la chute, les détails deviennent plus perceptibles jusqu’à découvrir les actes d’un seul homme qui, par sa perception du passé, s’efforce d’effacer ce temps ottoman. Une telle présentation de l’histoire de l’Empire ottoman réclame quelques explications.
Avant d’entreprendre ce travail, j’ai fait mienne la déclaration par laquelle Éric Hobsbawn introduit ses trois ouvrages sur le XIXe siècle – ère des révolutions, ère du capitalisme, ère des empires : un historien qui embrasse des sujets aussi vastes ne peut espérer tout lire et tout connaître ; il s’appuie plus sur des informations de deuxième et de troisième main que sur des archives. Je me suis donc contenté de rassembler des éléments disparates pour les interpréter et j’ai dû accepter comme valables des travaux que je n’étais pas capable de juger, mais qui étaient suffisamment reconnus pour paraître authentiques. Il importait en fait surtout de travailler les dissonances en tentant de rétablir la juste tonalité. Je n’ai donc pas la prétention d’écrire une nouvelle histoire de l’Empire ottoman et de l’origine de la Turquie moderne, mais celle de démontrer qu’un historien peut, sans être un spécialiste de cette question, appréhender un ensemble aussi vaste et aussi complex! e, le rassembler en une synthèse et rendre compréhensibles des comportements individuels et collectifs contemporains en démontant des mythes et en interprétant les événements.
Multiethnique et multiconfessionnel, l’Empire ottoman s’est peu à peu démantelé, pièce par pièce, et ce démembrement fut opéré par les puissances européennes au cours d’un marathon diplomatique baptisé « question d’Orient », une question qui n’est pas encore résolue au début du XXIe siècle. Son histoire contemporaine s’écrit et se lit à travers le prisme des nationalismes, et ce prisme réfracte plus les humiliations et les frustrations que les apaisements. Il en résulte une contradiction : chaque nouvelle nation tient, pour marquer sa naissance, à rejeter son ancienne appartenance à la dynastie d’Osman ; pourtant chacune en garde l’empreinte : qu’elle récuse ou non le fait, elle fit partie intégrante de cet empire. Il en est de même du tronc qui se divise dans les dernières années de l’empire : chacune des deux parts – arabe et turque – tente de gommer ce passé impérial, si bien qu’au moment où l’empire s’engloutit il ne reste rien pour le rappeler. Devenus aujourd’hui des n! ations, les peuples qui ont été intégrés à cet empire ont un moment de leur histoire lié avec lui. Les nostalgiques de la bataille de Kosovo, comme ceux de la bataille de Manazkert (ou Manzikert) et de la prise de Constantinople, ne peuvent-ils se pencher sur le passé des autres afin d’admettre la vanité d’une quête identitaire fondée sur la rancœur et l’esprit de revanche ? Compenser par la vérité historique la déraison des masses soumises à une propagande nationaliste, parler de l’autre au lieu de regarder saigner son nombril, c’est là un préalable au dialogue et au compromis. C’est ce que j’ai tenté d’ébaucher.
J’ai rencontré à chaque étape de cette entreprise des obstacles nombreux, tous en rapport avec la profusion de la documentation : il fallait opérer un tri et un montage, tout en préservant l’interface. Aux longues énumérations chronologiques des sultans, de leurs vizirs, de leurs combats et de leurs œuvres, a succédé chez les historiens une vision plus analytique, mais celle-ci reste partagée selon deux angles de vue différents : l’histoire diplomatique ; celle des institutions et de la société. Les historiens de la question d’Orient ont, avant et après la Première Guerre mondiale, largement débordé le cadre de l’empire et de ses pièces démembrées pour étendre leur propos à l’histoire diplomatique de la planète au XIXe siècle. Ils ont apporté une réponse à ceux qui, voulant parler de la fin de l’Empire ottoman, s’interrogeaient sur le moment où commence cette fin. Même si l’on rejette, comme une référence éculée, l’image de l’homme malade, on revient toujours à la métaphore ! du vivant qui ne cesse, de sa naissance à son agonie, de porter des cellules mortes. La fin d’un empire s’amorce tôt, comme celle de l’homme, bien avant la fin de sa croissance. C’est pourquoi j’ai, pour en parler, retrouvé le langage du médecin qui, au chevet du patient, commence par retracer l’anamnèse avant d’examiner les symptômes.
Cette fin de vie de l’empire fut intense, brillante même, assez fascinante pour mobiliser des chercheurs sur les structures les plus fines du système politique et sur les moments les plus intimes de la société ottomane. Il fallait, pour la résumer, concilier les extrêmes, l’infiniment grand à l’échelle du monde et du siècle, l’infiniment petit à l’échelle des microsociétés, offrir une vision globale et une connaissance approfondie d’une culture multiple et néanmoins spécifique, sans provoquer les tirs croisés des spécialistes indignés par ce piétinement de leurs labours et de leurs semis. En fait, les deux perspectives sont complémentaires. La vision de l’Empire ottoman est binoculaire. Il a toujours été en relation avec l’Europe, qu’elle négocie, qu’elle demande ou qu’elle exige. On ne peut les dissocier.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à condition de régler les deux angles de vue – ici l’Europe, là l’empire –, il n’y a pour parler d’une seule voix d’autre problème que celui de l’identité ottomane. Il est difficile de ne pas reconnaître que tant de nations ont partagé l’histoire de ce vaste ensemble multiethnique et multiculturel. Il est aussi absurde d’appeler, comme l’ont fait par préjugé les historiens européens du passé, tous les Ottomans des Turcs, que d’amalgamer les Arabes, les Kurdes et les Albanais aux Turcs ou d’opposer en tous lieux les musulmans aux dhimmi. Quand l’empire s’est démembré, il est, par un simple jeu démographique, devenu de plus en plus turc et de plus en plus musulman. Quand il s’est désintégré et que, contre toute attente, le fragment anatolien a survécu, celui-ci s’est affirmé turc – ce qu’il était devenu – et il s’est délivré de la règle islamique qui avait, en retardant sa modernisation, contribué à sa destruction.
Pour compliquer la tâche de l’historien, la politique lui a joué un mauvais tour : l’histoire officielle de la République turque est un élément constituant de l’identité nationale. Pour façonner cette identité elle a mélangé le vrai et le faux. Elle a ajouté et retranché afin que le produit fini soit conforme à l’objet désiré. Il était vital pour les membres du rameau turc d’écrire à leur manière l’histoire de cette famille déchirée. Voilà pourquoi les historiens de l’Empire ottoman, tous rompus à la langue et aux usages, tous orientalistes, s’abstiennent de blesser la mémoire turque par la révélation des turpitudes d’un régime agonisant. Quand ils ne peuvent s’abstenir de les évoquer, ils les rapportent à la malignité de l’Occident, à la déchéance morale des sultans et à l’ingratitude des hôtes chrétiens hébergés par la tolérance ottomane. Le nationalisme turc est né avec les Jeunes-Turcs. Ce sont eux qui ont éveillé la conscience identitaire des Turcs. Dans le temps court ! de leur pouvoir, ils ont tout fait pour précipiter l’échéance : ni ordre, ni progrès, ni respect des cultures, un fanatisme brouillon et maladroit qui les pousse aux pires excès. Le Comité Union et Progrès a ouvert l’histoire criminelle du XXe siècle. Faut-il lui trouver des excuses parce qu’il a, par son idéologie, fourni les éléments d’une renaissance et mettre en avant ses aspects positifs afin de dissimuler cette évidence ? L’ampleur du crime – le génocide arménien – interdit toute indulgence envers ce comité. Il serait si simple de dire ce qui s’est passé sans nier ou déguiser les faits. Mais l’épisode jeune-turc est le gué entre l’Empire ottoman et la Turquie kémaliste. Dans son bronze est coulé le piédestal de la statue du Ghazi. Sans les Jeunes-Turcs, pas de turquisme, sans turquisme pas de Turquie moderne, une ambiguïté insurmontable qui exclut ceux qui tentent de l’éluder. Vaincus et humiliés, les Turcs n’avaient pas en 1919 les moyens de rompre avec leur passé sa! ns menacer leur identité culturelle.
Mustafa Kemal a pétri l’histoire turque. Il l’a tracée d’une main ferme afin qu’elle assure une continuité entre un temps mythique et son moderne avatar. Le discours nationaliste turc s’est, dès son origine, fondé sur l’histoire. L’Anatolie, sur laquelle s’ancre le radeau naufragé de l’empire, est le socle chtonien auquel l’histoire confère sa solidité. La patrie plonge ses racines dans un passé mythique pré-ottoman qui ne s’embarrasse pas d’exigences factuelles et dont les Turcs doivent être fiers. L’Empire ottoman dérange cette construction : il n’est pas un objet de fierté. Il fallut contourner l’obstacle, traiter le matériau dégradé sans fragiliser l’édifice. L’historien fut chargé de l’ouvrage ; il devint un serviteur de l’État, dit et écrivit ce qu’on lui ordonnait de dire et d’écrire. Il n’en demeurait pas moins un bon technicien qui savait où chercher, comment trouver et comment traiter ses découvertes en les polissant, en aménageant aux fins qu’on lui désignait une ! vérité qu’il connaissait sans pouvoir la révéler. Comme il avait le monopole du terrain et de ses failles, il sut modeler le matériau originel.
Ces contraintes conviennent mal à la discipline intellectuelle des chercheurs, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s’en libérer, sans pour autant s’attaquer aux tabous. Pour être entré dans ce domaine sacré en piétinant les idoles et en ignorant les tabous, je me trouve plus à l’aise pour remettre en place quelques objets que j’avais, par ignorance, déplacés. Si l’on veut laisser la mémoire vive, il faut dire la vérité et cerner les questions en suspens pour tenter, de bonne foi et de sources authentiques, de les résoudre sans sacrifier aux faux dieux du nationalisme et de l’intégrisme. C’est donc à une réécriture de cette part d’histoire aménagée pour les besoins d’une identité que sont conviés les historiens. Il est possible d’y parvenir dans la mesure où ils acceptent d’opérer une analyse des « espaces et des temps de la nation turque », pour reprendre la formule d’Étienne Copeaux.
J’ai abordé au rivage ottoman en étudiant le génocide arménien, un curieux accès d’un lieu si vaste et d’un temps si long que les spécialistes de cette histoire ont la modestie de s’associer pour la traiter – chacun son moment, chacun son territoire –, une histoire objet de tels affrontements que les plus téméraires ne s’y risquent pas sans une connaissance des langues vernaculaires. Ce préalable les engage. Ils pénètrent encadrés dans un cercle d’initiés qui impose ses règles. La corporation a ses non-dits. Prononcer certains mots, c’est s’exclure de la communauté des chercheurs. Le génocide arménien est le premier de ces tabous. Les spécialistes de l’histoire des génocides sont de drôles de gens, des oiseaux bariolés dans la volière universitaire. Ils ne manquent pas d’instruction, mais ils n’ont pas suivi les filières traditionnelles. Ils viennent d’ailleurs, d’autres sciences humaines. Ce sont des insolents qui ne cessent de poser des questions, à la mesure de la souffra! nce dont ils traitent et qu’ils partagent. Ces questions ne permettent pas de réponses détournées, pas d’échappatoires, ni bonnes excuses, ni politesse exquise. L’historien du génocide est un policier qui enquête, un juge qui instruit un procès. Peu importe quelle vérité il découvrira, pourvu qu’il la trouve.
Voilà pourquoi, s’il est quelqu’un qui ne devrait pas parler de l’Empire ottoman, une histoire pleine de subtilité et de détours, où le discours est velouté, où le manteau et les pierres précieuses cachent le poignard, c’est bien ce procureur brutal qui demande : pourquoi ce crime, pourquoi le dissimuler ? Je pense, au terme de trente années, avoir répondu à ces deux questions, sans pour autant avoir – on s’en doute – amorcé le dialogue avec les historiens de l’Empire ottoman et de la Turquie*.
Pendant six siècles la maison d’Osman imposa sa loi à des dizaines de peuples et de nations. À son apogée, au XVIe siècle, l’Empire ottoman s’étendait sur trois continents. Puis il amorça son déclin. Les sultans ne pouvaient moderniser l’empire en préservant les règles théologiques sur lesquelles il reposait. L’Empire ottoman subit les pressions divergentes des puissances européennes. La Russie convoitait ses territoires. L’Angleterre tenait à la préserver pour assurer sa route des Indes. Au XIXe siècle, miné par l’éveil des nationalismes, l’empire commença à se démembrer et perdit ses possessions européennes et africaines. En rêvant de reconstituer un ensemble turc asiatique, les Jeunes-Turcs précipitèrent son effondrement qui se produisit après la Première Guerre mondiale. La révolution kémaliste préserva l’empire d’une désintégration. Sur ses ruines, Mustafa Kemal édifia une République turque laïque et moderne. L’Empire ottoman fut un vaste ensemble multiethnique et multiconfessionnel. La Turquie n’est pas la seule héritière de cet empire. Aujourd’hui, plus de vingt États ont, dans leur histoire, un passé ottoman. En restituant à chacun la part de ce passé qui lui revient, ce livre contribue à apaiser des forces irrédentistes et des passions nationalistes toujours vives. Il fournit une grille de lecture nouvelle à l’histoire des Balkans et du Proche-Orient.
Yves Ternon est historien. Il a consacré l’essentiel de ses travaux à l’histoire des génocides du XXe siècle. Il est l’auteur de nombreux livres, en particulier Les Arméniens. Histoire d’un génocide (Seuil, 1996), L’État criminel, les génocides au XXe siècle (Seuil, 1995), et L’Innocence des victimes au siècle des génocides (Desclée De Brouwer, 2001).