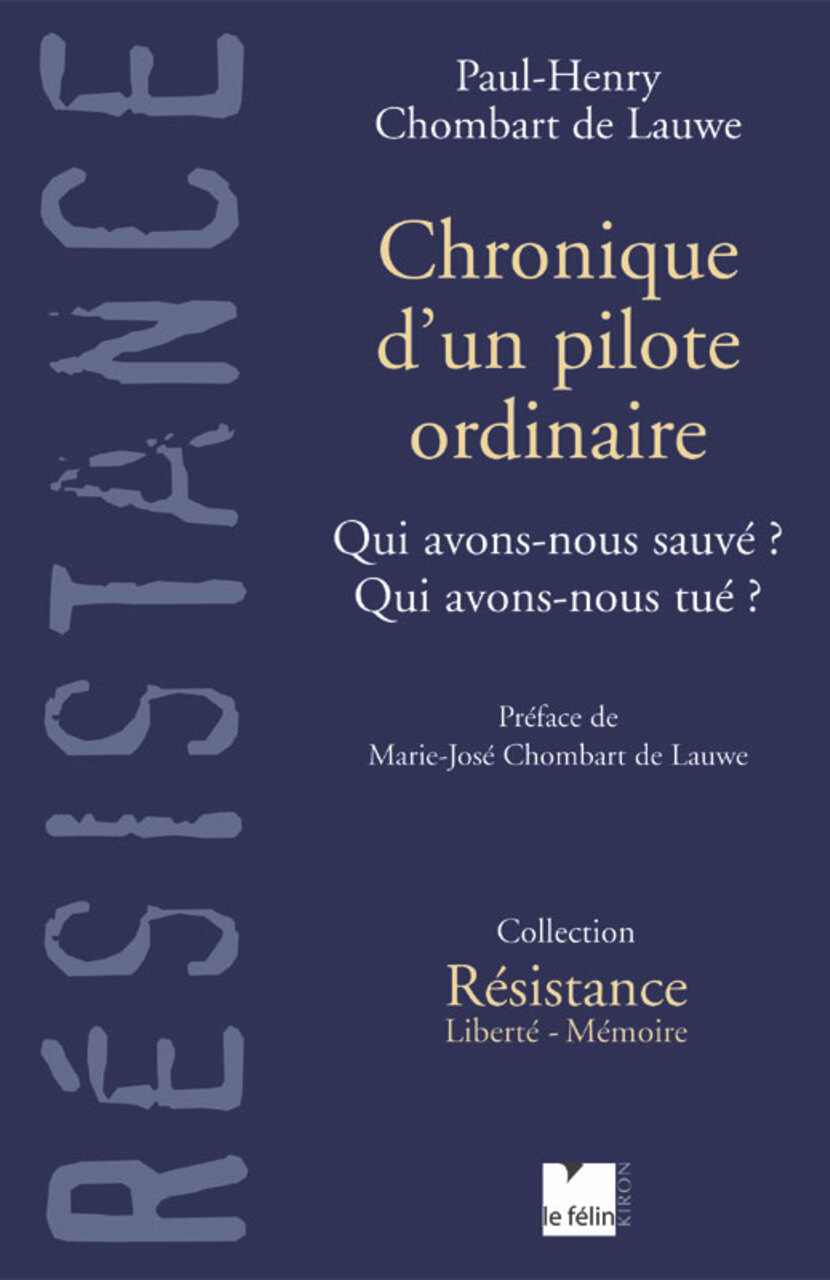
Chronique d'un pilote ordinaire
Ce nouvel ouvrage de Paul-Henry Chombart de Lauwe, habituellement présenté comme chercheur en sciences humaines, révèle un aspect inconnu de son histoire et de sa personnalité. Il avait lui-même élaboré ce récit à partir de ses carnets rédigés au cours de sa trajectoire de résistant et de pilote combattant durant la Seconde Guerre mondiale. Je n’ai pas partagé sa vie durant ces années, mais il m’en avait souvent entretenue, et les divers épisodes qu’il a alors traversés l’avaient profondément marqué.
J’ai rencontré Paul-Henry à Noël 1946 lors d’une conférence internationale sur la transformation des universités, à la Maison des étudiants de Combloux.
Paul-Henry y remplaçait le professeur Henri Wallon, auteur avec Paul Langevin d’un projet de réforme de l’enseignement, qui marqua la transformation de l’éducation de l’après-guerre. À la suite de la conférence de Paul-Henry, les participants se réunirent en ateliers. J’y effectuai une communication sur les universités populaires, qui intéressaient particulièrement le jeune chercheur. Nous nous sommes retrouvés à Paris. Libérée des camps de concentration, Ravensbrück et Mauthausen, j’avais rédigé un manuscrit sur mon expérience tragique depuis ma résistance, mon arrestation, mon internement et ma déportation, témoignage de l’horreur des crimes nazis. Je n’avais communiqué ce texte à personne. Sentant chez Paul-Henry une exceptionnelle empathie, je lui donnai à lire ce récit, que je n’ai accepté de laisser publier qu’en 1998, avec un chapitre complémentaire quant au regard que je porte sur cette expérience un demi-siècle plus tard.
Ainsi commença notre vie partagée: après plusieurs mois de découvertes réciproques, nous nous sommes mariés à l’automne 1947, et notre vie de couple a duré cinquante ans, jusqu’au décès de Paul-Henry, en janvier 1998. Avant 1946, nous ne nous étions donc pas connus mais les valeurs fondatrices de la Résistance – respect de tout être humain, justice, liberté – étaient ancrées en nous et nous ont fait réagir, jusqu’à en mourir s’il l’avait fallu. Elles ont aussi été à la base de nos engagements au cours de notre existence. Dans ses notes, Paul-Henry espérait la venue d’une femme: «Je pense à cette femme que je n’ai pas rencontrée mais qui est présente dans un futur que je ne connais pas.» J’ai incarné cette femme.
En revanche, j’ai partagé sa vie de chercheur, en particulier au Centre d’ethnologie sociale et de psychologie, laboratoire du CNRS et de l’EHESS, créé et dirigé par lui. Après la reprise de mes études, poussée et soutenue par Paul-Henry, entrée au centre, j’ai travaillé au début avec lui et j’ai été aussi intégrée dans certains de ses travaux collectifs, puis j’y ai créé un secteur autonome, car je ressentais de la difficulté à me trouver une collègue parmi les autres et une épouse.
Un préfacier décrit un personnage dans son histoire, il en dresse le portrait, le présente pour le lecteur qui le découvre. Il se fait donc témoin, mais un témoin participant dans le même contexte. Au-delà du présent récit de Paul-Henry, les images que ses collègues et ses amis donnent de lui éclairent les différentes dimensions de sa personnalité.
Pour fêter ses quatre-vingts ans, une quarantaine de chercheurs et de professeurs avaient décidé de lui offrir un livre d’hommages1. J’ai contribué à sa réalisation tout en refusant d’y inclure un texte personnel, étant donné mon double rôle. Louis-Vincent Thomas, professeur ami, m’a associée à ce travail: «Elle aurait dû être davantage évoquée dans ce livre: Paul-Henry Chombart de Lauwe lui doit tant et le centre de Montrouge sans elle aurait été vide.»
Paul-Henry a découvert cet ouvrage lors de sa remise, il me l’a alors dédicacé: «À Marie-Jo, présente partout dans ce livre, dans ma vie, dans notre vie, avec tous nos enfants et ce qui nous unit. Avec mon amour.» Là apparaît un versant de notre existence de couple, pour respecter son intimité, alors qu’il a été évoqué souvent dans son rôle social, professionnel, militant engagé.
Gilles Ferry, ami qui l’avait connu dès le début de la Résistance, a suivi les différentes étapes de sa vie. Il le situe comme «un témoin de notre époque». «À plus de cinquante ans de distance, c’est le même abord pour ceux qui l’approchent […]. Pour moi aussi, à chaque rencontre ce Chombart-là ne manque pas d’apparaître. Mais c’est Paul-Henry que je viens rejoindre, l’ami des éloignements et des proximités, l’ami de nos amis communs, le compagnon de Marie-Jo. Ensemble et séparément, nous avons sillonné les chemins du vingtième siècle […]. Paul-Henry, je pourrais le dire, selon les contextes et les circonstances, confiant et méfiant, spontané et circonspect, modeste et susceptible, hésitant, ambitieux […] mais en fin de compte fidèle à ses marques, assuré dans sa démarche éthique et intellectuelle et parvenant à la plus profonde cohérence.»
Plus jeune, Germain Solinis, son assistant à la fin de sa carrière, situe sa place dans la profession: «Ce chercheur, connu par ses textes fondateurs et l’originalité de ses approches, théorie et concepts dans le vaste champ de la recherche en sociologie urbaine française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale […] a aussi contribué à répandre la conception des rapports entre la culture et la dynamique sociale.» Il exprime sa reconnaissance «envers un homme qui tient pour pratique quotidienne le respect de l’autre, la défense des valeurs démocratiques et la lutte pour la justice».
Durant le déroulement de son existence, Paul-Henry a traversé des expériences très diverses, mais ses traits de caractère sont demeurés constants, tandis que son intérêt pour les hommes et leur cadre de vie s’est accru en fonction des nouveaux contextes. Quand il a préparé son évasion pour l’Espagne, sa méfiance lui a évité l’arrestation que beaucoup ont connue. Durant le trajet, il observait les modes de vie de ceux qui l’accueillaient tout en étant conscient des risques qu’ils encouraient pour la Résistance. À l’école des cadres d’Uriage, il avait déjà rédigé une brochure sur l’observation du milieu, à visée pédagogique pour les stagiaires, bénéficiant de sa formation d’ethnologue au musée de l’Homme. L’école était un lieu de réflexion sur la situation de la France avec la perspective de préparer sa reconstruction. Paul-Henry y avait appris, lors d’une conférence de l’abbé de Naurois, l’existence des camps de concentration et l’ampleur des crimes nazis qui resteront pour lui un objet d’angoisse.
Cherchant un moyen d’action plus direct, Paul-Henry a quitté Uriage pour participer au combat dans l’aviation, dont il avait une pratique sportive, et qui le passionnait. Pour devenir pilote de chasse, il a dû subir un entraînement très dur, avec une grande ténacité, sa santé fragile ne l’y prédisposant pas. Le vol, l’action contre l’ennemi l’épanouissaient; il méditait sur l’humanité comtemplée du ciel, tout en pensant avec inquiétude aux drames qui se déroulaient en France où il avait laissé des camarades luttant sur place. La mort frappait aussi l’escadrille, de nombreux pilotes ont été abattus durant les combats. Dans les attaques par les avions sur diverses cibles, Paul-Henry découvrait un monde en ruine, et se demandait «qui il avait tué».
L’inquiétude pour l’avenir de l’humanité et la volonté de secourir les plus défavorisés ainsi que les exploités orienteront toute la vie de Paul-Henry, dans sa recherche théorique participante, dans ses engagements militants et même dans son existence personnelle et nos conditions familiales. Nos enfants en ont ressenti parfois les difficultés, mais, devenus adultes, ils ont adhéré à nos valeurs communes, humanistes, et les transmettent à la «troisième génération».
Marie-José Chombart de Lauwe.
prélude
Pilote ordinaire dans la guerre puis la Résistance de 1939 à 1946, je raconte ici un itinéraire, une quête, une rupture, une découverte de soi et des autres, et surtout témoigne pour ceux qui n’ont pas connu cette période ou ceux qui n’ont pas pu ou souhaité dire ce qu’ils ont vécu.
Ce livre, écrit au présent, exprime aussi le drame personnel que j’ai vécu, pris entre deux systèmes de valeurs et deux conceptions du monde. En combattant le nazisme, le racisme, la violence, la domination totalitaire, j’ai été conduit à utiliser des armes meurtrières pour la défense des opprimés. Comment surmonter cette contradiction? Cette interrogation restera pour moi permanente: Qui ai-je sauvé? Qui ai-je tué?
Il est moins question ici de grands exploits que de la vie quotidienne dans un groupe de chasse pendant la guerre et dans la France occupée.
Tout était mêlé: la volonté de vaincre le nazisme et de reconquérir la liberté nationale, la joie du sport, l’émerveillement devant les passages découverts, la maîtrise de la machine, le goût de l’acrobatie aérienne (qui est une constante des pilotes de chasse), le travail d’équipe et la solidarité qui en découle.
Cette vie est exaltante, mais je pensais constamment à ceux qui étaient restés en France, aux victimes du nazisme, à la guerre qui se déroulait ailleurs. N’aurais-je pas dû lutter sur place au lieu de me laisser reprendre par l’avion? Dans mon groupe, mon action se situait au niveau du combattant de base. Mais l’ennemi que nous pourchassions était invisible. Il nous visait avec ses batteries antiaériennes; nous attaquions ses bateaux, ses réservoirs de carburant, ses dépôts de munitions sans avoir jamais la possibilité de voir des hommes. Les pannes de moteur au-dessus de la mer ont tué autant de pilotes que sa DCA. Nous nous battions contre une domination dont l’ombre s’étendait sur le monde mais qui, dans notre lutte quotidienne, n’avait pas de visage.
Ma formation universitaire, des expériences multiples me faisaient sans doute voir cette vie de pilote d’une façon qui n’était pas toujours celle de mes camarades. Je savais ce qu’était le nazisme, je connaissais la Résistance en France, ce que la plupart des pilotes mobilisés en Algérie imaginaient mal. Néanmoins, pour nous tous, le vol et l’expression dans un vol devenaient un besoin vital, où se mêlait à la communion et à la réalisation de soi un appel difficile que j’ai eu l’impression de retrouver plusieurs fois chez des pilotes qui ont écrit leurs mémoires.
Est-ce une sorte de fraternité humaine, de sentiments religieux ou autre chose? Comme l’a dit l’un d’eux, René Mouchotte, «je ne sais s’il y a lieu de parler de religion pour cela». Si des pilotes se référaient à une Église, si d’autres se forgeaient leur propre croyance, il y avait sans doute une forme particulière de spiritualité propre aux aviateurs: la vision aérienne tend à un élargissement, à un contact direct avec l’univers.
Ma participation à l’équipe d’Uriage, entre la débâcle de 1940 et mon départ pour l’Espagne, a profondément marqué ma vie. Je garde néanmoins de cette période une certaine amertume du double jeu manqué auquel, au début, nous avons cru. Nous avons été floués. La forme de résistance que nous avions adoptée aurait pu aboutir à des résultats plus rapides et plus importants si nous n’avions pas, dans les premiers temps, fait confiance à Pétain tout en nous jouant de Vichy. Ceux qui n’ont pas vécu en zone dite libre sous l’Occupation ne peuvent pas comprendre ces confusions.
Élevé très librement dans une famille aisée, j’ai toujours été marginal. Avec ma sœur aînée qui était peintre, j’avais fréquenté un milieu d’artistes juifs de Montparnasse. Tout en préparant une licence à la Sorbonne, j’étais élève dans un atelier de sculpture de l’École des beaux-arts. Passée ma licence, l’Institut d’ethnologie, puis le musée de l’Homme sont devenus le centre de mes activités, mais, après une mission en Afrique, j’ai dû pour des raisons de santé renoncer provisoirement à de nouveaux voyages d’étude.
Sensibilisé aux questions d’éducation, j’ai commencé à fréquenter les équipes sociales et à nouer des contacts avec le milieu ouvrier. Je voulais faire une thèse sur les jeunesses d’Europe, ce qui était inhabituel dans ma discipline. Ayant dû abandonner un voyage en URSS, encore pour raison de santé, j’ai commencé deux ans plus tard à étudier les jeunesses fascistes et nazies. J’avais aussi des projets de recherche en Angleterre, au Danemark et en Asie, mais la guerre a tout arrêté.
Ces diverses expériences m’ont appris à comprendre les comportements et les attitudes des hommes, à pénétrer dans différentes sphères, à me poser des questions sur la société, mais tout cela sans formation politique, ce qui me manquera au début de ma participation à la Résistance avec mes camarades d’Uriage.
Mon hobby pendant toute cette période était le pilotage.
Dès l’âge de dix-huit ans, j’avais passé les épreuves du brevet de tourisme et souhaitais obtenir un brevet de pilote de transport public, ce qui s’est révélé au-dessus de mes moyens financiers. Je restai sur ma soif. Pas longtemps.
En 1942, sans demander l’avis de personne, j’ai quitté la France pour rejoindre les armées alliées. On m’affecta à l’aviation. J’y ai retrouvé une vie d’équipe bien différente de ce que j’avais vécu auparavant. Une atmosphère où se mêlaient la simplicité, le jeu, la jeunesse, le dévouement, le don de soi, l’autorité, la tenue, l’intelligence et la poésie. Je peux encore donner le nom de celui, moniteur ou camarade, qui l’incarnait le mieux. Certes j’ai aussi éprouvé quelques désillusions mais j’ai beaucoup plus reçu que je n’ai été déçu.
Ce que j’ai connu dans l’aviation ne se reproduira plus. Le rapport de l’homme à la machine n’est plus le même. Le Spitfire, en particulier, n’a pas été seulement un instrument décisif pour sauver l’Angleterre, voire une partie du monde, de l’invasion nazie, il a offert aux pilotes une inégalable relation à la machine et à la nature. Dans les groupes de chasse en Méditerranée, trop rarement décrits, à travers un modeste rôle d’équipier, j’ai vécu une tout autre aventure intérieure dont le combat aérien n’était qu’un aspect. Écrire ce récit m’aidera peut-être à en découvrir les multiples dimensions.
Première partie
1
Mission dans les orages
J’ai toujours été fasciné par les orages. Mais je les avais vus jusqu’ici au-dessus de moi, lorsque j’étais au sol, ou parfois au-dessus au cours de vols en altitude. Aujourd’hui, je suis à l’intérieur.
En ce mois de novembre 1943, mon Spitfire est harcelé par des forces opposées. À travers des éclairs aveuglants, j’aperçois un spectacle aux dimensions de l’univers. En même temps, je suis obsédé par la mission. Un officier supérieur anglais est tombé à la mer. En pleine Méditerranée, avec un camarade de patrouille à bord d’un autre Spitfire, nous devions récupérer son dinghy1, minuscule point jaune sur la mer démontée. Je me demande ce que peut penser cet homme, seul dans un petit canot de caoutchouc, dont nous restons l’unique espoir. Avec lui nous formons un bien étrange trio.
Les orages succèdent aux orages. Tantôt au ras des vagues, tantôt entre deux couches de nuages, nous volons depuis une heure à la limite de nos possibilités techniques. Encore insuffisamment entraînés, nous ne pouvons pas nous permettre de naviguer aux instruments. Notre mission nous interdit d’ailleurs de quitter la mer des yeux. Nous sommes prisonniers entre ciel et…
La mer grise et verte est sillonnée de lignes d’écume qui, vues d’en haut, paraissent immobiles. Je n’y jette qu’un regard furtif car il me faut surveiller l’extrémité de l’aile de mon compagnon et le ciel de tous les côtés. Un éclair colore un nuage de reflets jaune vif, violets, orange. Aussitôt un autre lui succède sur la droite, si proche qu’un instant tout paraît blanc. Bientôt ces changements de lumière sont interrompus. Les deux avions hoquettent, comme secoués par un dieu méchant et inconnu. Tout craque, je me demande si je pourrai voler encore longtemps sans perdre l’autre avion ou sans heurter son aile.
Malgré la tension, resurgissent des souvenirs d’enfance: je nous vois, ma sœur et moi, courant sous la pluie d’orage en évitant les arbres que les éclairs transforment en fantômes blancs…
Nous volons au ras des vagues qui défilent silencieusement. Je ne peux plus contrôler le ciel, c’est au meneur de patrouille de regarder. Les deux avions balaient la zone dans laquelle nous sommes à la recherche du camarade perdu. Tous les deux kilomètres environ, nous virons, alors que le plus petit faux mouvement nous fait risquer de toucher la mer, ce qui équivaudrait à cette vitesse à heurter une pierre.
Les nuages sont maintenant un peu moins bas, le pilotage plus facile et l’observation plus efficace. Mais ne voyant toujours rien sur la mer, nous persistons: mieux qu’un principe ou une consigne, c’est une nécessité et pas seulement à l’égard de cet homme seul, happé par une mer dévorante. Pour lui, quelle est son espérance?
Et Rebière, mon compagnon, que je vois fonctionner comme une mécanique parfaitement réglée, est-il toujours aussi sûr de lui? Que se passe-t-il dans cette tête et dans cette carlingue, si proches de moi et si impénétrables?
D’un seul coup, sans transition, le soleil nous aveugle. La mer est toujours grosse mais, en l’air, le calme et la clarté ont succédé aux tourbillons.
Il nous reste peu de temps, peu de lumière du jour et peu de carburant mais une dernière patrouille pourrait encore prendre notre relève pour une courte mission avant la nuit. Je me demande ce que va décider Rebière.
Brusquement, au moment où nous commençons à amorcer un nouveau virage, j’aperçois une tache de couleur incertaine. Est-ce l’effet de la fatigue ou le dinghy du pilote anglais? J’ai peine à le croire. J’appelle Rebière: «Foresight 25. Foresight 26 appelle. Deux heures bas.
– Vu, c’est bon… Allô Green Tree, Foresight 25 appelle, m’entendez-vous?
– Allô Foresight 25. Vous entends cinq sur cinq. Objectif repéré. Envoyer relève. Prévenez Blue Bird.»
Foresight est notre indicatif de groupe et Green Tree celui de notre base de départ. Blue Bird est la base maritime qui doit envoyer une vedette de secours.
Nous continuons à voler autour du point minuscule sur l’eau, anxieux de le perdre, puis un appel se fait entendre: «Foresight_17 appelle. Foresight 25, m’entendez-vous?
– Vous entends cinq sur cinq.
– Foresight 25, vous pouvez rentrer. Objectif repéré.»
Nous reprenons la direction de la base, mais l’attente a été plus longue que prévue et nous sommes à la limite du carburant. Je sens mes limites, ma dépendance mais l’incertitude provoque plus d’excitation que de peur. J’attends la réaction de Rebière. «Allô, Green Tree, Foresight 25 appelle. Allô, Green Tree. Sommes limite carburant. Prévoir piste libre.
–_Foresight 25, bien reçu. Piste libre.»
Ces dernières minutes sont un défi. Cherchons-nous toujours l’impossible? Les Spit n’ont pas encore les réservoirs supplémentaires qu’ils recevront plus tard et leur rayon d’action plafonne à une heure trente de carburant. Les atterrissages forcés sur la route du retour constituent une menace constante. Nous le savons tous et c’est ce qui nous unit. Nos camarades sur la piste sont avec nous et nous sommes avec eux. Je ressens une curieuse impression de calme mêlée de fatalité. La nécessaire maîtrise de soi en vol donne une sorte d’insensibilité au risque.
La base apparaît. Sans perdre les précautions habituelles, Rebière se place directement dans l’axe de la piste et commence sa descente. Je reste à une distance minimale, juste de quoi permettre à son avion de dégager lorsque le mien touchera le sol. D’en haut, je vois les mécaniciens et les pilotes rassemblés, prêts à toute éventualité. Loin d’être abstraite, la chaleur de cette solidarité me monte aux épaules et au visage. Plus que jamais je contrôle mes gestes: le moindre écart serait d’autant plus irrattrapable que le niveau de carburant est maintenant tout à fait à zéro.
Prise de terrain réussie! Nous sommes tous deux au sol. Rebière a dégagé à temps. Je roule encore quelques instants et je viens me ranger à l’emplacement réservé à mon avion. Les mécaniciens se précipitent vers nous. Celui qui s’occupe de l’avion que je pilote aujourd’hui saute sur l’aile et se penche sur le tableau de bord: «À quel jeu vous jouez? C’est pour nous ficher la trouille? On y tient à ce taxi. Faut pas nous le casser.»
Sur la piste on dit «taxi», «zinc», «machine». Il faut des circonstances exceptionnelles pour parler d’avion: «Ça, c’est un avion!», dit-on avec admiration devant un nouvel appareil dont les qualités semblent s’imposer.
Nous sommes dans un groupe de chasse français intégré à la Royal Air Force, chargé de missions de protection de bateaux au large de la côte algérienne. Si le coastal command n’a pas le prestige des unités de combats aériens pour la défense de l’Angleterre, son travail quotidien implique des risques et des pertes, même si la rencontre avec les avions allemands est rare. C’est un groupe ordinaire dont je suis un pilote ordinaire.
Comment suis-je arrivé ici? Après la tension du vol, j’éprouve le besoin de revenir en arrière.
Voici les notes que Paul-Henry Chombart de Lauwe a rédigées de 1939 à 1945. Étudiant de Marcel Mauss, il suit en même temps une formation aux Beaux-Arts. Il participe ensuite à une mission de Marcel Griaule au nord Cameroun, qui sera à l’origine de ses travaux remarquables de sociologue à partir des années 1950. À l’époque pourtant il hésite entre une carrière d’ethnologue ou de sculpteur. Mais survint la guerre et l’Occupation. Chombart de Lauwe connaît le nazisme, il a fait un séjour en Allemagne. Après un passage à l’École de cadres d’Uriage, il organise son évasion par l’Espagne avec un camarade qui deviendra général. Le récit nous entraîne vers des personnes de milieux très différents, des compagnons solidaires. Ils échappent ainsi à l’arrestation et aux camps de Franco que beaucoup d’évadés ont connus : le regard de l’ethnologue accompagne une aventure où les agents du renseignement anglais jouent leur rôle. Les deux camarades arrivent enfin en Afrique du Nord, où l’auteur va subir le dur entraînement de pilote de chasse. Le lecteur découvre l’histoire d’une escadrille française de Spitfires qui se bat pour libérer la France, participant au débarquement en zone sud, remontant jusqu’en Allemagne. Les souvenirs de Paul-Henry Chombart de Lauwe ne sont pas ceux d’un « héros » de l’aviation, malgré 175 missions de guerre. Face au chaos, un homme médite sur l’existence, la mort, la liberté.
Préface de Marie-Jose Chombart de Lauwe