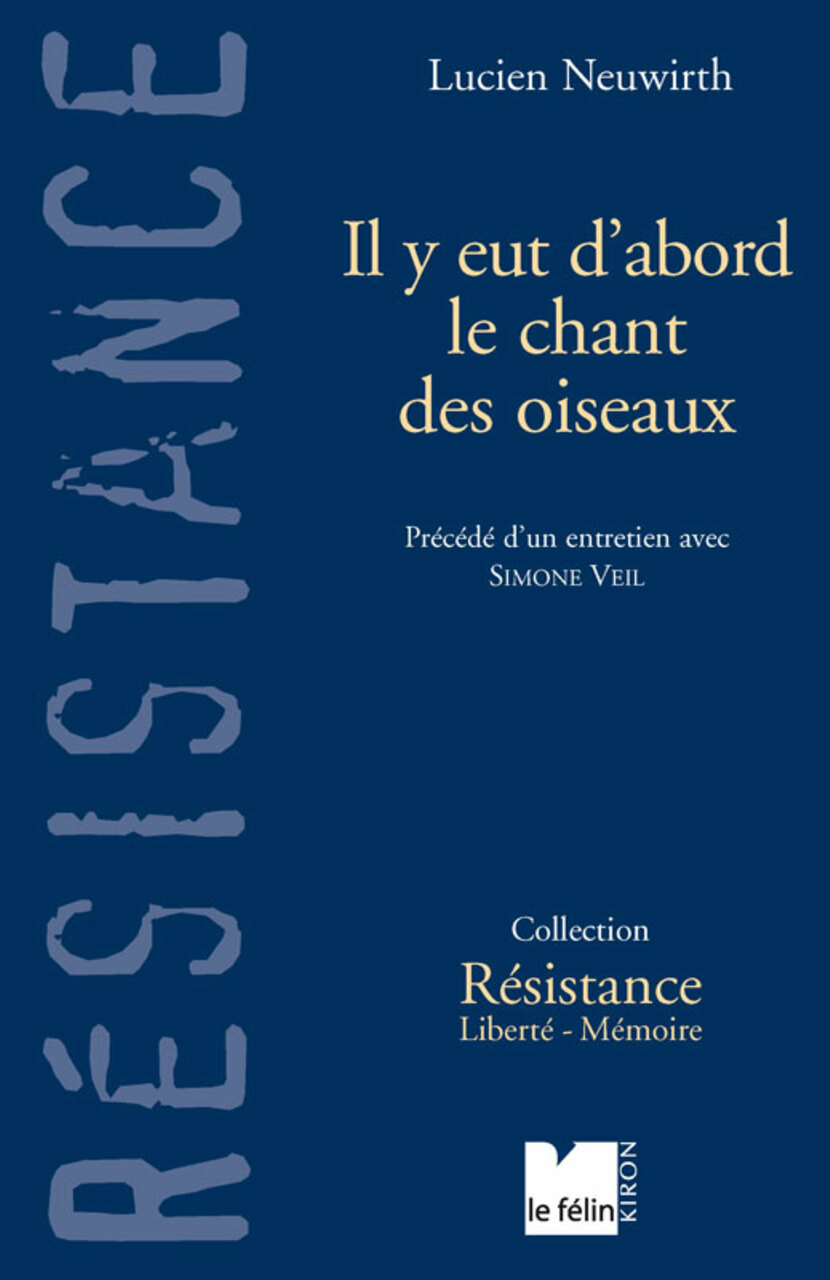
Il y eut d'abord le chant des oiseaux
– Tiens, petit, ton café.
Lucien immobilisa la lourde cuve d’acier du pétrin et d’un revers de bras essuya la sueur de son visage.
Il était fier de cette sueur; en quelque sorte, elle le consacrait comme adulte, utile aux autres hommes, car il fabriquait leur pain.
C’est qu’il en fallait du pain pour ces colonnes pitoyables de réfugiés qui en ces journées accablantes de juin 1940 traversaient le bourg d’Yssingeaux ! On les sentait arrivés au bout de leur courage, de leurs moyens, de leur parcours.
Avant tout, leur quête immédiate et pressante était pour du pain, de l’eau, du lait pour les enfants.
Du haut de ses seize ans, Lucien observait avec étonnement, incrédulité, ce monde insolite qui défilait sous ses yeux.
Des tronçons d’unités militaires totalement désorganisées s’intercalaient dans un flot hétéroclite composé de chariots tirés par des chevaux fourbus, d’automobiles et de camionnettes déformées par des chargements invraisemblables que couronnaient des matelas délavés. Au milieu on voyait, pitoyables, les piétons de l’exode poussant, tirant charrettes, voitures d’enfants et vélos brinquebalants, convois de misère à la fois dérisoires et bouleversants.
Spectateur attentif, Lucien était traversé par un torrent de sentiments heurtés: colère, pitié, étonnement, tout sauf l’indifférence. C’est pourquoi il s’était proposé au vieux boulanger voisin, le père Brun, en panne de commis, et débordé, qui fut trop heureux de trouver un mitron pour l’aider, la bonne volonté suppléant à l’inexpérience.
Lucien aimait l’odeur du fournil; torse nu, il apprenait à faire le pain, un peu comme on découvre un rite religieux.
Dans cette Haute-Loire prudente, la farine ne manquait pas, heureusement, car les fournées se succédaient pour répondre à des demandes incessantes et, peu à peu, le métier rentrait.
La mère Brun qui venait de lui apporter son café, toujours de noir vêtue, était une petite femme boulotte, renfermée, qui gardait pour elle ses pensées. Cependant, elle n’avait pas celé son étonnement de voir ce gosse de la ville proposer d’aider gratuitement son mari, d’où ses attentions inhabituelles. Il était difficile de donner un âge au père Brun, on savait qu’il avait la soixantaine bien sonnée, et qu’il était un brave homme. Lucien aimait l’entendre évoquer ses souvenirs des années 1900.
À chacun de ses rires qui découvraient deux rangées de dents jaunies et exagérément larges, le boulanger lui faisait penser irrésistiblement à un de ces vieux ânes qui font la joie des gosses dans les jardins publics.
C’est le 18 juin 1940 que le commis du père Brun vint reprendre sa place, une date banale ce matin-là…
Le boulanger tint à offrir un briquet à amadou à son mitron d’occasion, lequel pour montrer qu’il était un homme avait commencé à fumer.
Ce soir-là, désœuvré, Lucien tripotait son poste de TSF, comme on disait à l’époque. C’est ainsi que la Providence, ou le hasard, allait engager un destin en ce 18 juin qui, sans le savoir, entrait dans notre histoire.
«Ici Londres», un général inconnu parlait…
À mon petit-fils.
Mon petit Charles,
Tu es parvenu à un âge où tu commences à découvrir que le monde n’est pas seulement ce qu’il paraît être.
Tu devines que ceux qui t’entourent, que tu croises ont une vie propre que ne traduit pas leur seul aspect extérieur.
Le moment vient où tu apercevras que chaque être porte en lui une part de l’aventure humaine dont il est à la fois acteur et témoin.
C’est à ce témoin que je veux passer le relais.
À travers ce récit authentique, fruit de notes, de rapports officiels et de souvenirs encore vivaces parmi d’autres qui se sont estompés, c’est la tranche de vie la plus ardente de ton grand-père que tu vas découvrir.
Celle aussi d’une certaine jeunesse, d’une certaine époque et de l’épopée que connut avec lui l’équipage d’une Jeep tombée du ciel qui retrouve la France de la Libération avec ses élans, ses contradictions, ses misères, ses grandeurs et son immense fringale de liberté. C’est aussi le parcours des parachutistes SAS du 2e RCP en France, dans les Ardennes belges, en Hollande, et où chaque homme, quel que soit son rang, aura signé parfois de son sang la formidable saga des paras de la France libre.
Je te confie ce récit, il est à toi, il est sans concession, à l’image des temps que ma génération a traversés et qui ont fait que j’ai pris l’habitude de me dresser contre les soumissions et les conformismes du moment.
Tu n’es pas au bout de tes surprises.
Commence à imaginer ce que pouvaient bien être les pensées de ce jeune homme en ce 18 mai 1940, jour anniversaire de ses seize ans, qui apprenait les désastres de nos armées sans comprendre.
Un sentiment né au plus profond de lui le poussait à agir, sans trop savoir comment s’y prendre, sinon qu’il fallait faire quelque chose. Il est temps Charles que je te remette les clés qui te permettront de mieux me connaître, mais…, tu vas en apprendre de belles sur ton grand-père !
Allez ! En route ! Je vais te raconter…
Lucien Neuwirth.
Chapitre premier
Une profonde complicité a toujours existé entre ma mère et moi, tu as eu l’occasion de t’en apercevoir. Depuis ma naissance, Gabrielle occupe une place considérable dans mon existence. Au mur du salon, elle a accroché une pensée de Rudyard Kipling, agrémentée d’enluminures, qui définit sa pensée: «Avoir un fils c’est bien, en faire un homme c’est mieux.» Mon père, René, était ce qu’on appelait alors dans le monde de la fourrure «un fin couteau». Coupeur expérimenté, il avait appris son métier dans toutes les capitales européennes. C’est avec regret que le fondateur de Révillon le vit partir pour Saint-Étienne. Mobilisé lors du premier conflit mondial, c’est au cours d’une permission que, le 11 novembre 1918, il fait la connaissance de Gabrielle. Ils se marient. Mon père ouvre une boutique de fourrures dans le centre de la ville. Je nais, mon père travaille de l’aurore à la nuit et même le dimanche. Ma mère se charge de m’élever. C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui pour toi.
Ce jour-là, le 18 juin 1940, nous sommes, elle et moi, immobiles et subjugués devant le poste de radio à écouter cette voix lointaine et inconnue qui nous parle de sacrifices, de persévérance, d’espérance.
Pour moi, cet appel venu de Londres me confirme dans ce que je ressens au plus profond de moi, le sentiment que cette débâcle a quelque chose d’insolite, d’irréel, d’injuste, que ma France ne peut être ainsi battue. J’écoute ce général dont tout ce qu’il dit me paraît couler de source.
«Lucien, c’est lui qui a raison, c’est lui qu’il faut suivre.» Comme délivrée, ma mère s’est dressée, saisissant avec force mon poignet.
À ce moment précis, elle et moi venons d’entrer dans la guerre.
Dans les jours qui suivent, ma mère s’efforce de galvaniser le voisinage et d’insuffler une ardeur combative à une population accablée. Mais, dans cette sous-préfecture de la Haute-Loire, personne n’a entendu l’appel de Londres. Quant à moi, mon emploi du temps est simple: soit j’écoute les émissions en langue française de la BBC, soit je bricole et vérifie l’état de la moto de mon père, une 500 cm3 Peugeot. À seize ans, on ne doute de rien: sachant lire une carte routière, je me sens de taille à rallier l’Espagne avec l’engin paternel et à gagner la Grande-Bretagne.
Le samedi, lorsque mon père arrive de Saint-Étienne, il trouve une épouse résolue à ce que leur fils rejoigne le Général et un fils déterminé à se rendre à Londres. Joueur d’échecs émérite et habitué à affronter l’adversité, mon père sait toujours se maîtriser et conserver un calme olympien.
Il procède en deux temps:
Primo : «Ce que dit ce général – comment s’appelle-t-il? – est intéressant…»
Secundo : «Cependant, les Allemands ont déjà atteint les Pyrénées, de plus le maréchal Pétain est un patriote qui sait ce qu’il fait et l’écrasante majorité des Français l’approuve.»
Si effectivement, presque la totalité de la population pousse un soupir de soulagement quand le vieux vainqueur de Verdun signe l’armistice, ma mère éclate en sanglots en apprenant la nouvelle. Jamais, ni mon père ni moi ne l’avions vue pleurer. Pétain, connais pas…
L’héroïsme et les tueries de Verdun ont eu lieu avant que je sois né. Pour chaque adolescent, c’est bien connu, la vie du monde commence à sa naissance, et seule la vieillesse accepte la défaite. Je vois les choses ainsi. Cruauté de la jeunesse.
Chapitre 2
Le nouveau gouvernement est installé à Vichy.
La collaboration avec l’ennemi commence à bourgeonner. Début septembre, avec mes parents, nous regagnons Saint-Étienne. Après le lycée Claude-Fauriel, mon père m’inscrit à l’École de commerce de la rue des Frères-Chappe.
Chaque jour, j’écoute les informations diffusées par la radio de la France libre. Ma résolution de partir pour poursuivre la guerre n’a pas faibli.
De retour dans la ville natale, je recherche mes amis de la JEF – Jeunesse de l’Empire français – fondée par Jean Daladier, le fils de l’ancien président du Conseil, un radical qui a cosigné, en 1938, les funestes accords de Munich avec Chamberlain, Mussolini et Hitler. À leur origine, les membres des JEF devaient représenter fièrement un empire de cent millions d’âmes sur lequel le soleil ne se coucherait jamais… Depuis la débâcle, ils se dévouent pour aider les pitoyables cohortes de réfugiés. Nos familles se résignent à nos horaires extravagants: inlassablement, nous courons d’un centre d’hébergement à un autre pour secourir et consoler.
Malgré les efforts du gouvernement de Vichy qui s’efforce de nous attirer à lui en prônant la révolution nationale, en créant les Compagnons de France aux tenues rappelant celles des scouts, la jeunesse ne se résigne pas à la défaite.
Nos familles, en général, désapprouvent notre esprit belliqueux. Elles arguent du million et demi de soldats français prisonniers dans les stalags et qui servent d’otages au IIIe Reich. Et puis, un vieux sentiment fait de crainte et d’attentisme, issu des lointaines épreuves de notre histoire, incite une large majorité de la population à s’accommoder de la politique du Maréchal; lassés par les querelles de jadis des politiciens, marqués par l’effondrement de nos armées, les Français en ces temps de malheur aspirent à s’en remettre au vieil homme bardé de décorations et d’étoiles qui leur tient des propos rassurants. Filles et garçons sont priés fermement d’oublier la guerre, la défaite, la politique et de consacrer leurs pensées aux études.
Bien sûr on nous concède le style zazou qui fait fureur, Charles Trenet commence à faire rêver, le Hot Club de France replié en zone libre offre le refuge du jazz et dans les écoles on apprend gentiment à chanter: Maréchal nous voilà!
L’engouement de la jeunesse de la guerre pour le jazz est dû à un double phénomène, d’abord l’attrait que le rythme de cette musique a toujours eu sur les jeunes générations et aussi le message d’optimisme et d’espoir que le jazz d’outre-Atlantique apporte: Armstrong, Duke Ellington, Gershwin deviennent des chefs de file au moment même où Hitler mène la guerre aux nègres et aux juifs… dérision!
À Lyon le Hot Club de France fait un malheur, et l’étoile de Django Reinhardt commence à monter au firmament.
J’ai vite fait de découvrir que les choses ne sont jamais aussi simples qu’on peut le penser. Pour dire vrai, je nage complètement à contre-courant.
La froideur subite des parents de mes copains m’apprend à surveiller mes emballements et à ne livrer que prudemment mes pensées.
Un beau soir d’automne, alors que mes réflexions tournent au gris, une de mes petites copines apprentie coiffeuse m’apporte un de ces coups de pouce dont le destin se réserve toujours l’opportunité:
– Lucien, tu m’as bien parlé d’un général de Gaulle?
– Oui, pourquoi?
– Eh bien, cet après-midi une cliente est venue se faire coiffer au salon. Et la patronne m’a dit qu’elle était sa sœur !
– Tu es sûre?
– Mais oui. Et comme j’ai pensé que ça t’intéresserait, j’ai relevé son adresse sur le livre des rendez-vous…
Elle me tendit un papier griffonné, je lus un nom inconnu et une adresse proche.
Parole de fusillé, de miraculé : « Il y eut d’abord le chant des oiseaux, le chuintement du vent dans les branches », comme il le dit ici même à Simone Veil. Avec ses camarades, il avait été capturé par une patrouille allemande. Ils sont collés à un mur, ils sont mitraillés. Or, lui se relève, il se rend compte qu’il n’est que légèrement blessé. Des pièces de monnaie qu’il avait sur lui par hasard ont dévié les balles…
On est en avril 1945. Lucien Neuwirth a vingt ans. Il s’est engagé dans la Résistance dès juin 1940, et, en 1942, il a rejoint à Londres les Forces françaises libres. Parachuté en Bretagne, il attaque des convois allemands dans le Cher, puis gagne les Ardennes où fait rage la dernière grande offensive du Reich, et enfin la Hollande où donc il frôle la mort. Bien qu’il soit écrit sur un ton inimitable de simplicité, de modestie, d’oubli de soi, ce récit constitue une extraordinaire épopée. Après la guerre, Lucien Neuwirth a mené d’autres batailles, en particulier pour la contraception qu’il est parvenu à faire admettre en 1967, ayant l’oreille du général de Gaulle. Et il s’est naturellement retrouvé, dans la lutte pour la libéralisation de l’avortement, aux côtés de Simone Veil.