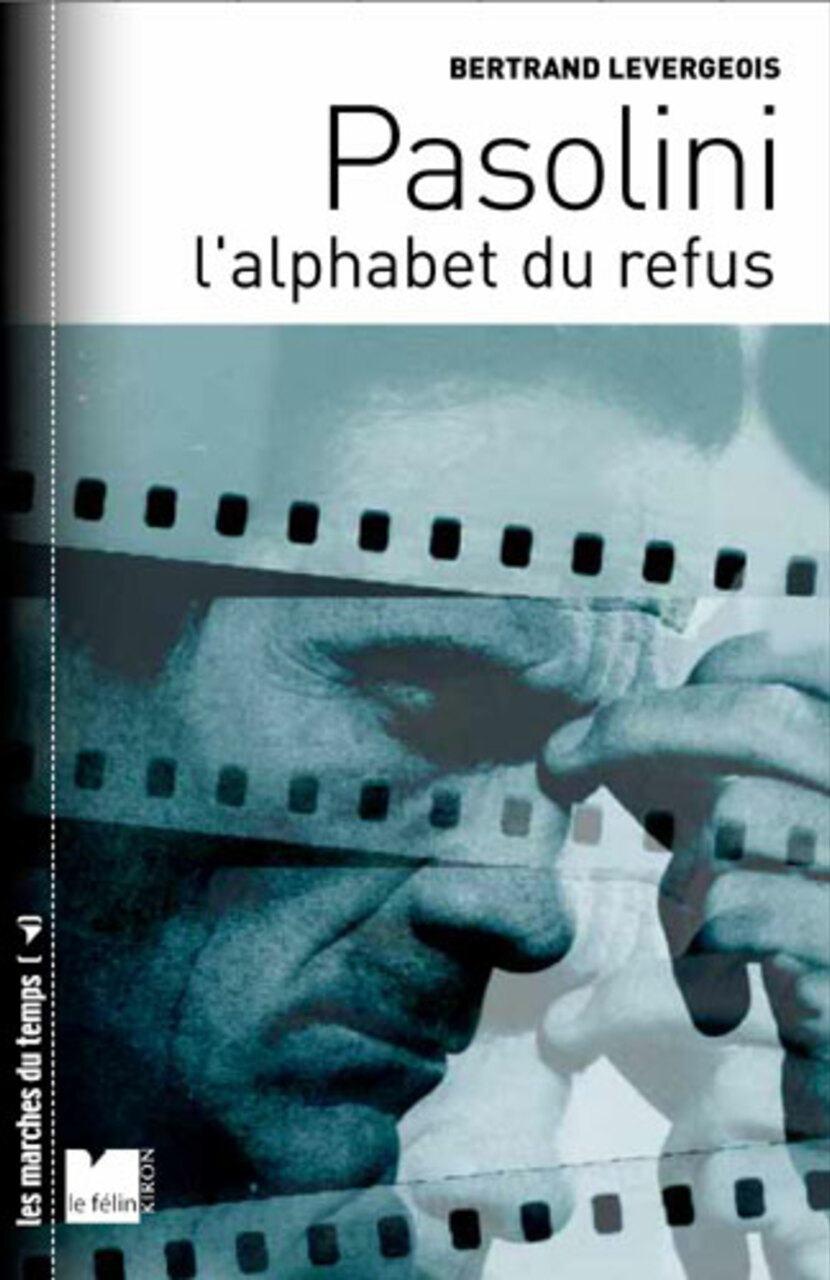
Pasolini
FRAGMENTS DE PANOPLIE
Depuis la nuit du 2 novembre 1975 où Pier Paolo Pasolini a été assassiné sur un terrain vague, tout a changé. À Berlin, le Mur est tombé. Moscou n’est plus le centre d’un empire et la Chine, elle, s’est bel et bien réveillée. À Rome, l’Église n’a cessé de s’adapter à toutes les évolutions. Des deux grandes forces italiennes de l’époque, le Parti communiste et la communauté catholique, Pasolini, s’il fêtait aujourd’hui ses quatre-vingt-trois ans, ne reconnaîtrait plus grand-chose. Envolées les années de plomb et du boom économique.
Voilà. Il ne pourrait rester de Pasolini que le souvenir de combats surannés. La Révolution, dit-on, n’est plus à l’ordre du jour. Le salut de l’humanité, lui, se mesure surtout là où la prospérité regorge. Quant à l’homosexualité de Pier Paolo, elle serait au mieux émouvante, puisque, dans son infortune, il eut le bonheur de ne pas connaître le temps du sida. Pourtant, des voix s’élèvent encore de l’Italie pour protester contre le massacre toujours mystérieux de Pasolini. Au printemps dernier, son assassin, Pino Pelosi, s’est rétracté pour accuser des inconnus, à l’en croire des anticommunistes et des homophobes. Voilà un mort qui ne passe pas.
Trente ans plus tard, ce qu’il était pour ses lecteurs, auditeurs et spectateurs d’hier demeure intact. Est-ce l’effet surtout de sa poésie ? De son cinéma ? Ou sa critique de plus en plus âpre du Pouvoir ? Sans doute. Pourtant, le déferlement de son œuvre généreuse, sa puissance de feu (dix volumes dans la « Pléiade » italienne !) n’ont cessé d’être en proie aux attaques. On a censuré ses livres, retardé le plus possible la sortie de ses films. Toute sa vie n’a été qu’un long procès à partir de son expulsion du Parti communiste pour homosexualité et de son exil à Rome. Les raisons d’un tel acharnement ? Son désir des garçons, sa défense des « sans-vie » à la marge, son offensive politique contre l’homologation et le néofascisme tous azimuts ? Ou, de manière plus surprenante, la liberté des formes mêmes qu’il a données à tout ce langage du monde ?
Dans l’un de ses poèmes, Pasolini se dit un Grand Alphabète1. Ailleurs, tenté par un alphabet à créer2. Du dialogue que la Réalité entretient avec elle-même, il s’est donc fait le Déchiffreur, digne successeur de deux autres grands tombeurs de masques : Giordano Bruno et Baltasar Gracián. À leur suite, il a lu ce qui devait l’être et, dans ce droit-fil, écrit, parlé et filmé, autant dire agi.
Il est clair que cette action passe de beaucoup l’intérêt de sa personne (Narcisse cependant si épanoui) ainsi que les limites de son temps. Car Pasolini a été moins de son époque que contre elle. Il s’est refusé comme on l’a refusé. Jamais il n’a cru que la Réalité devait aller de soi, jamais il n’a conclu au naturel de la nature. Non, celle-ci a toujours été pour lui la « nature artificieuse » de Léonard de Vinci. Une élaboration. Encore une fois un chiffrage à déchiffrer.
Refuser, c’est lire et écrire le monde. Car « le refus a toujours été un geste essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, le petit nombre de ceux qui ont fait l’histoire sont ceux qui ont dit non, et non les courtisans et les assistants des cardinaux. Le refus, pour fonctionner, doit être grand et non petit, total et non sur tel ou tel point, “absurde” et non de bon sens3 ».
Et si « la réalité est un alphabet » pour Luis García Montero, Pier Paolo fut son Grand Alphabète.
Mais qu’a-t-il déchiffré dans la Réalité, ou plutôt la Réalité elle-même par sa personne interposée ? Quel est son alphabet du refus ? Je donne ici de quoi répondre à la Cocteau – à mon estime.
Il ne s’agit que des fragments d’une panoplie à envisager : comme l’armure du chevalier Pier Paolo, lui qui n’avait d’armes que forgées par la pensée ; et comme le déguisement sous lequel il a joué diversement à être vrai. Il est moins question ici de l’existence, qui ne vient qu’après, avec ses ombres reposantes et lourdes. Mais d’une sorte d’hologramme, les parties se rapportant toutes à un tout – extérieur – qui ne peut se réduire à l’une ou l’autre d’entre elles.
« Trouver n’est rien. Le difficile est de s’ajouter ce qu’on trouve4. » Lesté de cet avis prométhéen de Paul Valéry, j’ose inviter qui le souhaite à déchiffrer à sa guise cette esquisse de panoplie. À l’épeler comme l’alphabet de Pasolini, et dans l’esprit auquel il exhortait en ouverture de ses Écrits corsaires : « C’est au lecteur de reconstruire ce livre ! À lui de réunir les fragments d’une œuvre dispersée et incomplète, à lui de faire se rejoindre des passages placés loin les uns des autres et qui pourtant se complètent ! À lui d’organiser les moments contradictoires en recherchant leur unité essentielle, à lui d’éliminer les éventuelles incohérences (hypothèses abandonnées ou de recherches) ! À lui de substituer aux répétitions leurs variantes éventuelles (ou alors d’accepter ces répétitions comme des anaphores passionnées)5. »
Paris, le 29 juin,
fête de Pierre et de Paul.
Note
FRAGMENTS DE PANOPLIE
Cet ouvrage peut se lire dans son enchaînement, dans la continuité des entrées de son alphabet, ou, par un effet de boomerang, en commençant par la biographie de Pasolini en fin de volume (« Une vitalité désespérée »). Ou bien dans son « déchaînement », en zigzaguant, en butinant d’une entrée à l’autre. Liberté que des renvois en bas de page (indiqués par le signe ) favorisent.
Pour ce qui est des références bibliographiques indiquées en note de bas de page, j’ai souvent choisi de renvoyer le lecteur, plutôt qu’à des traductions françaises dispersées, au texte original des dix volumes des Œuvres complètes de Pasolini, publiés dans l’équivalent italien de notre « Bibliothèque de la Pléiade » (Tutte le opere, sous la direction de Walter Siti, Milan, Mondadori, « I Meridiani », 1998-2003). Telles sont les abréviations utilisées en la matière :
PC1 P. P. PASOLINI, Per il cinema. I [Pour le cinéma, premier volume, éd. W. Siti et F. Zabagli, avec deux écrits de B. Bertolucci et M. Martone, et un essai introductif de V. Cerami, 2001].
PC2 P. P. PASOLINI, Per il cinema. II [Pour le cinéma, second volume, 2001].
T P. P. PASOLINI, Teatro [Théâtre, éd. W. Siti et S. De Laude, avec deux entretiens accordés par L. Ronconi et S. Nordey, 2001].
RR1 P. P. PASOLINI, Romanzi e racconti. 1946-1961 [Romans et récits, premier volume, éd. W. Siti et S. De Laude, avec deux essais de W. Siti, 1998].
RR2 P. P. PASOLINI, Romanzi e racconti. 1962-1975 [Romans et récits, second volume, éd. W. Siti et S. De Laude, 1998].
SLA1 P. P. PASOLINI, Saggi sulla letteratura e sull’arte. I [Essais sur la littérature et sur l’art. I, premier volume, éd. W. Siti et S. De Laude, avec un essai de C. Segre, 1999].
SLA2 P. P. PASOLINI, Saggi sulla letteratura e sull’arte. II [Essais sur la littérature et sur l’art. II, éd. W. Siti et S. De Laude, second volume, 1999].
SPS P. P. PASOLINI, Saggi sulla politica e sulla società [Essais sur la politique et sur la société, éd. W. Siti et S. De Laude, avec un essai de P. Bellochio, 1999].
TP1 P. P. PASOLINI, Tutte le poesie. I [Toutes les poésies. I, premier volume, éd. W. Siti, avec un écrit de W. Siti et un essai introductif de F. Bandini, 2003].
TP2 P. P. PASOLINI, Tutte le poesie. II [Toutes les poésies. II, second volume, 2003, N.B. : tous les premiers volumes ou volumes uniques de cet ensemble sont agrémentés d’une « Chronologie » de N. Naldini, le cousin et biographe de Pasolini].
De plus, une bibliographie figure aussi en fin de volume, qui permettra (le cas échéant) de retrouver sans difficulté tel ou tel texte dans sa version française. Un index facilite la recherche dans l’ouvrage.
Sauf indication, les traductions sont de ma main. Les illustrations, elles, rajeunissent le jauni de l’iconographie de La Divine Mimésis : mieux que sous l’angle de l’illustration, Pasolini y présentait la logique de ses photographies sous celui d’une « poésie visuelle », par ailleurs très lisible. Mon pastiche se compose d’images indirectement et librement rêvées, les yeux fermés.
I
ABJURATION
Tel le philosophe Giordano Bruno, si aimé par Pasolini, « si familier et si sublime » à ses yeux6, il y a ceux qui décident finalement de ne plus abjurer. Beaucoup, à ce mauvais jeu, ont tout perdu. Et, bon gré mal gré, il en est d’autres qui s’y
résolvent. Car il en va de l’abjuration comme de la fidélité : leur qualité ne se mesure qu’à leur contenu. Si on salue l’abjuration de Henri IV, qui mit fin aux guerres de Religion en se convertissant au catholicisme, tout le monde aujourd’hui, y compris l’Église de Rome, déplore celle de Galilée, puisqu’en renonçant à sa conception de l’univers centré sur le soleil il laissait libre cours aux obscurantistes.
Or, de Pasolini, personne ne saurait oublier les abjurations souvent tactiques, toujours viscérales. On l’avait connu communiste dans sa jeunesse, on devait le connaître par la suite très critique à l’égard du Parti. On l’avait cru catholique à lire ses poèmes du Frioul ou s’y rapportant après coup, son Évangile selon Matthieu en fit même pour certains un proche du pontife : on dut vite déchanter. Mais au fond, Pier Paolo avait surtout l’incroyable faculté de ne plus croire. Paru une semaine après son assassinat, un de ses articles discrédita ainsi d’outre-tombe le succès international dont il jouissait, une fois n’est pas coutume, auprès du public et de la critique.
Datant en réalité du 15 juin 1975, cette Abjuration de la « Trilogie de la vie » servit paradoxalement d’introduction à la publication des trois films auxquels le cinéaste renonçait : Le Décaméron, Les Contes de Canterbury et Les Mille et Une Nuits7. Pasolini infidèle à lui-même ? Dans son esprit, pareil abandon consistait d’abord, et ni plus ni moins, à opposer une abjuration à une autre : « Aucun centralisme fasciste, déclarait-il en effet un an et demi plus tôt, n’est parvenu à faire ce qu’a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle, réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières (paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières) continuaient imperturbablement à s’identifier à leurs modèles, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en paroles. De nos jours, au contraire, l’adhésion aux modèles imposés par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L’abjuration est accomplie8. »
Réactivant pour l’occasion le lexique de la théologie, Pasolini oppose l’intégrité de son autocritique au vide de l’acculturation forcée par le néofascisme9. Dans les années 1970, « l’hédonisme de masse » a, selon lui, plus ravagé que Mussolini. Car les sous-prolétaires se sont mis « à avoir honte de leur ignorance : ils ont abjuré leur modèle culturel », analphabète et grossier. À l’inverse, les petits-bourgeois, désireux de s’identifier aux stéréotypes télévisuels, se sont abrutis et désalphabétisés. « Si les sous-prolétaires se sont embourgeoisés, les bourgeois se sont sous-prolétarisés10. » L’Italie de l’après-boom serait-elle donc plus fasciste que sous le fascisme ? En réaction, les condamnations les plus vives n’ont pas manqué de pleuvoir sur Pasolini, et notamment depuis le camp communiste : Eduardo Sanguineti a stigmatisé sa « nostalgie du fascisme », son mythe de « l’analphabète heureux » ; d’autres lui ont reproché sa mythification d’un prétendu âge d’or, son catholicisme antimoderne ou l’irrationalité de son intellectualisme aristocratique. Et pourtant, comment ne pas constater alors, en ces années d’austérité et de crise (la guerre du Kippour, en 1973, multipliait par quatre le prix du pétrole), que le développement néocapitaliste se prenait déjà pour le progrès, condamnant le sous-prolétariat à cette nouvelle alternative : s’enrichir ou disparaître ?
L’abjuration de Pasolini pourrait bien avoir un arrière-goût galiléen : n’est-elle pas, elle aussi, plus subie que désirée ? Pier Paolo n’aurait-il pas été en effet contraint d’abjurer, faute de mieux ? En somme, son abjuration ne serait-elle pas en réalité un reniement imposé par la société italienne de 1975 ? À vrai dire, son cinéma a déjà prévenu ces questions. En 1962, dès son deuxième film, Mamma Roma la prostituée ne cherchait-elle pas coûte que coûte à sortir de sa condition pour accéder avec son fils au paradis de la petite-bourgeoisie, à la respectabilité : travail modeste mais honnête, HLM, bon voisinage, dimanches à l’église, etc. ? Quant à Accattone, sa première réalisation, souvenons-nous que le proxénète Franco Citti, dans le rôle-titre, s’efforce (une fois au moins) de travailler comme tout le monde11. Depuis ses débuts de cinéaste (mais des exemples issus de ses romans pourraient tout aussi bien l’attester), Pasolini a donc montré qu’une acculturation néofasciste est en cours, qu’une « homologation » culturelle sévit à tous les niveaux – et, si Accattone n’y prête pas attention, Mamma Roma, de son côté, y succombe. En ce sens, l’abjuration pasolinienne ne répond pas seulement à une conjoncture ; elle résulte surtout d’une expérience mûrie et d’une analyse d’une telle acuité qu’on l’a prise pour une prophétie. Lorsque, une dizaine d’années après ses premiers films sur le sous-prolétariat romain, il condamne à nouveau la déculturation dont l’Italie pâtit, il ne fait rien d’autre que traduire la prise de conscience d’un bouleversement social irréversible. D’où la nécessité d’une révolution non politique, mais d’ordre étymologique, c’est-à-dire d’un autre retour sur soi qui, sur le plan de la poésie, coïncide avec la récriture de La Meilleure Jeunesse12. Car si la vraie jeunesse est à trouver ailleurs qu’au Frioul de l’adolescence, s’il appartient désormais aux jeunes fascistes et non plus au poète Pier Paolo d’en célébrer le regain, le temps est venu pour lui, tout en assumant poétiquement cette crise, de ne plus craindre l’instrumentalisation qu’exerce l’acculturation dévastatrice13, ni les abjurations qu’elle appelle : s’il y va de la sincérité, du devoir, il s’agit avant tout de donner l’exemple, d’apprendre à ne pas rester captif de tel ou tel enseignement – d’apprendre à désapprendre. Tel est le sens de l’abjuration de la « Trilogie de la vie », désaveu par le cinéaste de ses trois films les plus commerciaux : Le Décaméron (1971), Les Contes de Canterbury (1973) et Les Mille et Une Nuits (1974). À l’abjuration infernale réplique ainsi une abjuration salvatrice.
À Galilée répond Henri IV. Mais à quelle croyance Pier Paolo le « luthérien » renonce-t-il ? Sa « Trilogie de la vie », comme il l’appelle, n’inaugurait rien de moins qu’un défi à relever de manière bien plus provocatrice que ne l’avait été celui de faire parler le monde en parlant de soi, comme dans la « Trilogie antique » : Œdipe roi (1967), Notes pour une Orestie africaine (1968-1969) et Médée (1969). Tout en continuant à faire fond sur la tradition littéraire (Boccace, Chaucer et l’un des chefs-d’œuvre de la culture orientale, après trois grandes figures de la tragédie grecque), mais s’appuyant cette fois sur le genre du conte et un pastiche du Moyen Âge, le cinéaste tenait à mettre en avant trois priorités : contribuer à la démocratisation du droit d’expression et à la libération sexuelle, y compris en recourant à un certain féminisme (d’où la collaboration de Dacia Maraini au scénario des Mille et Une Nuits) ; renforcer la lutte contre l’acculturation petite-bourgeoise des années de « cohabitation » politique14, toujours avec les armes d’un contre-modèle d’ingénuité ; enfin, manifester plus intimement sa fascination pour un érotisme mythique, dont la « napolétanité » est la clef15. Mais l’avènement d’un esprit de fausse tolérance inspiré par le pouvoir consumériste, la fétichisation par le marché des corps de l’innocence (dont témoigne l’essor des films pornographiques, en particulier en France16) ainsi qu’une forte désillusion amoureuse, sinon une tragédie personnelle sans précédent, fruit aux yeux de Pasolini de toute cette abjuration culturelle généralisée (1973 s’ouvre en effet sur le mariage de son Ninetto avec une jeune petite-bourgeoise17), ont tout instrumentalisé. D’où son abjuration de la « dégénération » des corps de la jeunesse italienne, à commencer par ceux du sous-prolétariat romain qui viennent rejoindre dans ce réquisitoire sans appel les garçons du Frioul désormais dénaturés, exempts de ce qui leur tenait lieu naguère de grâce. D’où, plus généralement, le rejet d’une Italie économiquement « miraculée » et sombrant dans l’enfer terroriste.
La naïveté des rires enfantins, l’ingénuité de l’interprétation des protagonistes de la « Trilogie de la vie », cette innocence presque arborée tant elle avait été incarnée à la manière de pantins par toute une succession de figures dont Ninetto restera pour toujours l’emblème, tout cela ne suffit donc plus pour éclairer les ténèbres d’une époque de violence et d’attentats. Pas plus ce « corps jeté dans la lutte » qu’est la personnification par le cinéaste d’un disciple de Giotto, puis de Chaucer18. Ni la nudité de « bons sauvages » à imiter, ni l’exposition de plus en plus insistante de Pier Paolo en poète marionnettiste n’ont raison de l’exploitation du sexe et de la célébrité. Comble de la fétichisation, de misérables contrefaçons tirent profit de l’énorme succès de l’érotisme pasolinien19 : apparaissent en 1972 un Décaméron n° 2, un n° 3, un n° 4, etc., la pornographie prenant ses quartiers dans l’Éden. Et personne n’y trouve rien à redire, Le Décaméron pâtissant pourtant du plus grand nombre de plaintes pour obscénité infligées à un film de Pasolini : quatre-vingts environ, en moins d’un an. En abjurant sa « Trilogie de la vie », le réalisateur dénonce toute récupération au nom de la permissivité (laquelle n’a rien à voir avec la liberté sexuelle) ainsi que toute imitation. Il refuse la déréalisation des corps des classes pauvres à laquelle il ne pourrait que contribuer s’il continuait d’exalter aux yeux du public leurs corps, leur nudité et leur sexualité : « Le désir conformiste d’être sexuellement libres, déclare-t-il, transforme les jeunes en de misérables érotomanes névrotiques, éternellement insatisfaits (précisément parce que leur liberté sexuelle est reçue, non conquise) et par conséquent malheureux. Ainsi le dernier endroit où habitait la réalité, c’est-à-dire le corps, ou encore le corps populaire, a lui aussi disparu. Dans leur corps, les jeunes du peuple vivent la même dissociation avilissante, pleine de fausses dignités et d’orgueils stupidement blessés que les jeunes de la bourgeoisie. Si je voulais continuer avec des films comme Le Décaméron, je ne pourrais plus le faire, parce que je ne trouverais plus en Italie – notamment parmi les jeunes – cette réalité physique (dont l’étendard est le sexe avec sa joie) qui est le contenu de ces films-là20. »
En définitive, Pasolini, selon l’heureuse formulation barthésienne, s’entête. Et, a expliqué Roland Barthes lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, « s’entêter veut dire en somme maintenir envers et contre tout la force d’une dérive et d’une attente. Et c’est précisément parce qu’elle s’entête que l’écriture est entraînée à se déplacer. Car le pouvoir s’empare de la jouissance pour la manipuler et en faire un produit grégaire, non pervers, de la même façon qu’il s’empare du produit génétique de la jouissance d’amour pour en faire, à son profit, des soldats et des militants. Se déplacer peut donc vouloir dire : se porter là où l’on ne vous attend pas, ou encore et plus radicalement, abjurer ce qu’on a écrit (mais non forcément ce qu’on a pensé), lorsque le pouvoir grégaire l’utilise et l’asservit. Pasolini a été ainsi amené à “abjurer” (le mot est de lui) sa “Trilogie de la vie”, parce qu’il a constaté que le pouvoir les utilisait – sans cependant regretter de les avoir écrits : “Je pense, dit-il dans un texte posthume, qu’avant l’action, on ne doit jamais, en aucun cas, craindre une annexion de la part du pouvoir et de sa culture. Il faut se comporter comme si cette dangereuse éventualité n’existait pas… Mais je pense aussi qu’après, il faut savoir se rendre compte à quel point on a été utilisé, éventuellement, par le pouvoir. Et alors, si notre sincérité, ou notre nécessité ont été asservies ou manipulées, je pense qu’il faut absolument avoir le courage d’abjurer21.” »
En se déplaçant ainsi à force de s’entêter, Pasolini met ici en pratique et de manière exemplaire une forme insolite d’abjuration. Une abjuration toujours disponible : l’abjuration hérétique.
À bon entendeur. Car cette abjuration n’est à confondre ni avec l’assimilation, ni avec l’oubli22. Il s’agit d’abord d’une abjuration cumulative, ce qui est renié ne faisant que se juxtaposer à ce qui ne l’est pas, toujours dans l’esprit d’un progrès critique. Nulle synthèse cependant. La Réalité, elle, peut très bien continuer de s’écrire ailleurs et autrement. Mais plus, en tout cas, sous l’espèce d’une irréalité ou d’un mensonge qui se prend ou veut se faire prendre pour la vérité. Avant de renoncer à l’esprit de sa « Trilogie de la vie », Pasolini s’était attaché à abjurer ce qui pouvait limiter l’expression de la Réalité : ainsi, tout recours systématique au dialecte, puisqu’il n’était pas question de ne privilégier qu’une seule langue et qu’il fallait bien en finir avec ce qui aurait pu être envisagé chez lui comme une forme d’esthétisme régionaliste. Le refus de la langue italienne ne l’avait nullement autorisé à ne s’alphabétiser qu’en frioulan. Pour autant, il n’avait jamais abandonné ce dialecte qui n’avait fait l’objet d’aucune appropriation dans la perspective de quelque monopole linguistique. De la poésie au roman, du frioulan au romain, de la littérature au cinéma, en passant par la peinture et le théâtre : abjurer consiste toujours dans l’œuvre de Pasolini à ne jamais réduire le dialogue de la Réalité avec elle-même, à ne jamais obéir à l’empire d’une seule langue ou d’une seule technique d’expression.
Quant au monde comme il ne va plus, celui qu’affronte Pier Paolo au moment où il abjure sa « Trilogie de la vie », il décide d’en jouer de plus en plus – oniriquement, ironiquement. Dans l’inachevé de son roman Pétrole, pour ne pas se réfugier dans un pur refus de la Réalité. Nul retrait du monde. Nulle ascèse. Il joue gros. À la fois sa personne et les choses. Quant à la Réalité, elle devient Néant. Là encore, la fidélité à soi impose de renoncer à ce qui n’est pas la Réalité, à ce qui n’est pas ce Néant. Aziza l’avouait à son infidèle amant Aziz, au cœur des Mille et Une Nuits : « La fidélité est un bien, mais la légèreté elle aussi en est un. » Dénégation du scénario qui lui faisait dire : « La fidélité est un bien, la légèreté est un mal23. » L’abjuration a sa gravité, le poids d’une légèreté qui refuse : « Il faut être léger comme l’oiseau, disait déjà Paul Valéry, non comme la plume24. » Légèreté dont l’autre nom est dérision25.
Les ultimes paroles du Décaméron souscrivaient aussi à l’urgence de suspendre son adhésion sans pour autant se désengager, le disciple de Giotto, alias l’auteur en personne, s’interrogeant : « Pourquoi créer une œuvre quand il est si beau de seulement la rêver26 ? » Et l’épigraphe de son film oriental louait d’emblée la multiplicité, nous vouant au labyrinthe pour nous en sortir : « La vérité ne se trouve pas dans un seul rêve, mais dans beaucoup de rêves. »
Le 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini est retrouvé mort à Ostie, près de Rome. Crime sexuel, politique ou crapuleux ? Trente ans plus tard, on s’interroge toujours alors que son assassin vient de se rétracter.
En attendant, il reste à faire vivre Pasolini puisque « la mort n’est pas de ne pas pouvoir communiquer, mais de ne plus pouvoir être compris ». Le comprendre, c’est redonner sens à son déchiffrement multiforme de la réalité. Car cette bête de style n’a cessé de sacraliser et démythifier la réalité par tous les langages : poésie, critique, théâtre, cinéma, peinture, philosophie, politique. Pédagogue de la subversion, il s’est sans cesse refusé à ce qui refuse la réalité comme langage.
Pasolini est un alphabet du refus.
Épelons-le.
Telle est l’invitation de Bertrand Levergeois qui passe en revue toute l’œuvre et la vie de Pasolini : de ses abjurations à sa lutte contre tous les fascismes, sans oublier la cause gay et le tiers monde. Essai où Pasolini prend la parole et presque comme jamais, l’essentiel des citations présentées demeurant inédit en langue française. Regard critique sur le monde actuel, cet essai dit l’essentiel : ce qui doit importer aujourd’hui pour nous grâce à Pier Paolo Pasolini.
Essayiste, auteur d’une thèse de doctorat sur « L’Encyclopédisme de la Renaissance », Bertrand Levergeois est connu pour ses biographies de figures hors norme comme le philosophe Bruno, mort sur le bûcher de l’Inquisition (Giordano Bruno, Fayard, 1995, 2000) ou encore le Fléau des Princes de la Renaissance (L’Arétin ou l’Insolence du plaisir, Fayard, 1999). Par ses traductions toujours agrémentées de riches présentations, il a aussi redonné vie à plusieurs chefs-d’œuvre dont Le Petit Trésor de Latini, le maître de Dante, et Le Petit Enfant de Pascoli, le poète auquel Pasolini se sentait lié « presque par une fraternité humaine ». Il est l’auteur de deux ouvrages sur le cinéaste Federico Fellini dont une biographie.
"Trente ans après sa mort survenue dans des circonstances qui, malgré les explications officielles, restent obscures, Pier Paolo pasolini ne cesse de fasciner. Ecrivain, poète, dramaturge, cinéaste, homme engagé politiquement... Il est plus que jamais inclassable. Et c'est justement ce qui rend cette biographie, chapitrée comme un abécédaire thématique et fragmentaire (Abjuration, Dante, Hérétique, Tiers-mondes...) à la fois pertinente et unique en son genre." Cine Live, Janvier 2006.