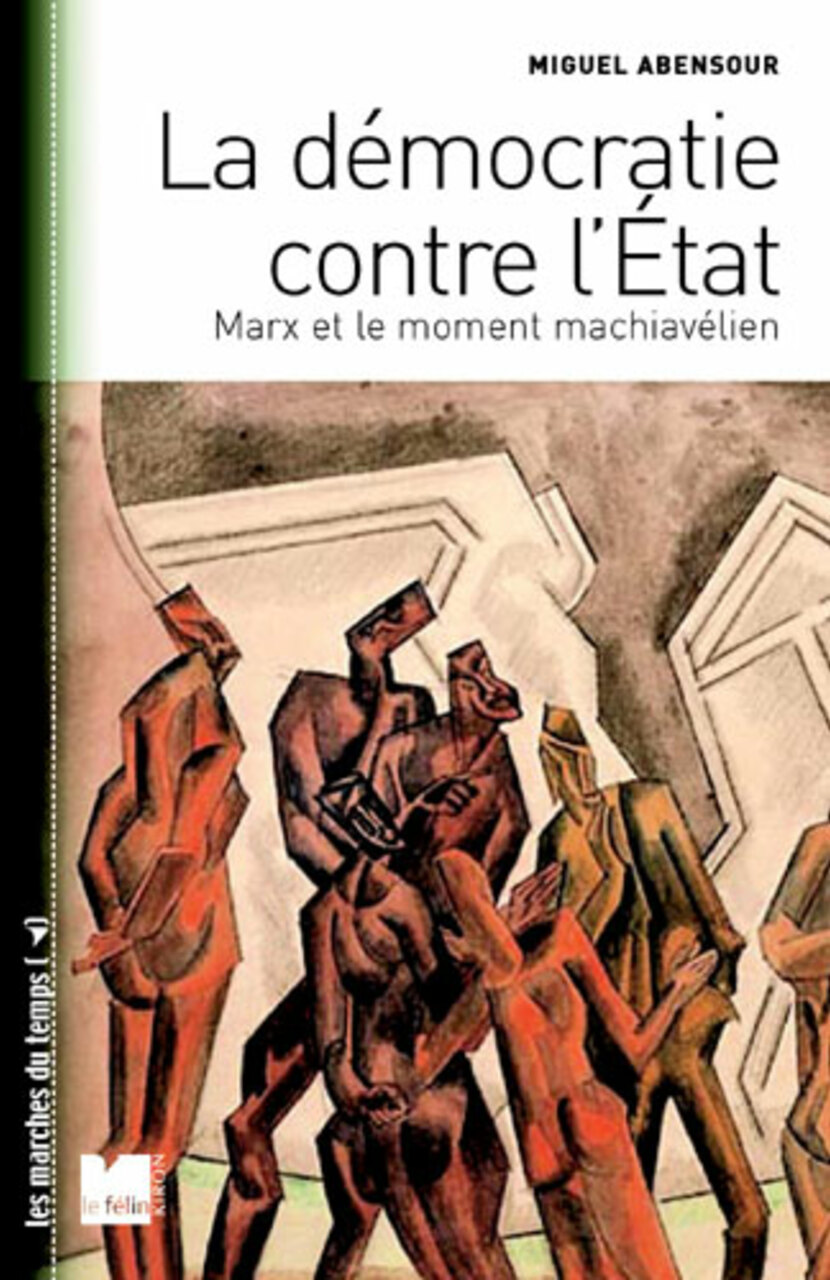
La démocratie contre l'Etat
L’UTOPIE DE L’ÉTAT RATIONNEL
En un premier abord, on peut apprécier les textes de Marx de 1842 et du début de 1843 (article sur les vignerons de la Moselle) comme une expression achevée et cohérente de la théorie de l’État rationnel et démocratique, sorte d’épitomé de la lutte pratique des courants démocrates pendant la Révolution française et de la lutte théorique des philosophes allemands, dans le sillage de ceux que W. Benjamin décrit comme les « Allemands de 1789 »1. Marx devenu journaliste radical en 1842 met donc en œuvre pour sa part un thème qui revient comme un leitmotiv dans le mouvement de la gauche hégélienne : le temps présent est – ou plutôt, doit être – celui de la politique. En 1841, A. Ruge salue le nouveau courant, principalement Bauer et Feuerbach, comme l’apparition du drapeau de la « Montagne » sur le sol allemand. Et dans les Deutsche Jahrbücher, en 1842, le même Ruge inaugure sa critique de la philosophie du droit de Hegel par une déclaration sur le caractère de l’époque : « Notre temps est politique et notre politique se donne pour but la liberté de ce monde. Désormais il ne s’agit plus d’établir les fondations de l’État ecclésiastique mais celles de l’État séculier ; à chaque respiration que les hommes font l’intérêt croît pour la question publique de la liberté dans l’État2. »
Aux yeux de Ruge, cette découverte de la politique, mieux, de l’élément politique est la manifestation d’une révolution spirituelle qui s’accomplit dans l’accès à une vie nouvelle, sous le signe de la vertu politique. C’est au nom de cette vie nouvelle qu’il critique les philosophes allemands, en l’occurrence, Kant et Hegel, et leur tendance au compromis diplomatique. « Leurs systèmes sont des systèmes de la raison et de la liberté au milieu de la déraison et du manque de liberté 1. » Aussi Ruge s’emploie-t-il à souligner les contradictions de Hegel : celui qui a su penser l’essence de l’État comme la réalisation de l’idée éthique, qui favorable à la praxis politique fustigea les Allemands pour leur néant politique, ne s’en est pas moins enfermé dans un point de vue unilatéralement théorique, aveugle à la relation de la théorie à l’existence et ne concevant la réconciliation que dans le champ de l’esprit sous forme d’une médiation spéculative. Au nouveau courant revient de dépasser ces contradictions en travaillant à la réalisation de la raison dans l’existence, en abandonnant un point de vue purement théorique pour se tourner vers la volonté des hommes. La nouvelle tendance critique – en cela elle appartient profondément à l’élément politique – se présente comme l’unité de la volonté et de la pensée et se propose de substituer une philosophie de la volonté et de l’action à une philosophie de l’esprit.
Sur un registre polémique, c’est contre cette véritable foi jeune-hégélienne que Stirner dirige en 1845 ses flèches critiques, dans L’Unique et sa propriété : « L’État ! l’État ! Ce fut un cri général et l’on ne chercha désormais plus que la bonne, la “meilleure constitution”, la meilleure forme d’État. L’idée d’État éveillait l’enthousiasme dans tous les cœurs ; servir ce dieu terrestre devint la nouvelle religion, le nouveau culte : l’âge proprement politique était né 2. » C’est donc légitimement qu’Arthur Rosenberg dans Histoire du bolchevisme discerne chez Marx une inspiration jacobine au sens général du terme. Entendons que pour Marx, rédacteur de la Gazette rhénane, il s’agissait d’importer en Allemagne le modèle français de l’État révolutionnaire, de construire l’État de la raison, de faire accéder ses compatriotes encore plongés dans le règne animal de l’esprit à la modernité politique, c’est-à-dire de les transformer en un peuple de citoyens. Annonçant en mars 1842 à Ruge son intention d’élaborer une critique du droit naturel de Hegel, notamment quant au régime intérieur, Marx écrit : « Le fond en est la réfutation de la monarchie constitutionnelle comme une chose bâtarde, contradictoire et qui se condamne elle-même. Res publica n’a pas d’équivalent en allemand 1. » Et, à l’épreuve de l’échec, peu avant de prendre à son tour la route de « Paris, capitale du XIXe siècle » où il publia en collaboration avec le même Ruge un numéro unique des Annales franco-allemandes, Marx avoue ainsi la vanité de ce projet dans l’Allemagne de Frédéric-Guillaume IV: « L’Allemagne s’est enfoncée dans le bourbier et s’y enfonce toujours plus. (…) On éprouve pourtant un sentiment de honte nationale même en Hollande. Comparé au plus grand Allemand, le moindre Hollandais est encore un citoyen 2. » Référence à la Hollande qui doit nous alerter, car elle n’est pas sans signification dans le cheminement de Marx ; la Hollande c’est d’abord le pays de Spinoza, auteur du Tractatus theologico-politicus auquel Marx a consacré un cahier important d’extraits en 1841 ; ce fut, en outre, au sein de l’Europe absolutiste, une des rares incarnations du modèle républicain, l’exception hollandaise qui permettait de considérer la république non plus comme une belle figure du passé, mais comme un destin possible du monde moderne.
Les contributions de Marx, journaliste politique, peuvent donc à un premier niveau s’analyser comme une conjonction harmonieuse du jacobinisme et de l’hégélianisme de gauche ; qui manifeste, à la fois, une volonté d’émanciper l’État de la religion par la création d’une communauté politique séculière et une volonté de détruire les formes politiques de l’Ancien Régime – structures hiérarchiques, règne des privilèges pour y substituer une république démocratique reposant sur l’égalité politique.
Mais une lecture de ces textes en termes seulement politiques, aussi exacte soit-elle, est notoirement insuffisante. Car les positions politiques qui s’y affirment sont en quelque sorte dérivées. En effet – et c’est ce qui autorise à voir dans ce nouveau courant l’émergence d’un moment machiavélien – on perçoit dans cette thématique politique, au-delà de l’opposition à l’État chrétien et aux formes politiques d’Ancien Régime, la réactivation, voire la répétition, d’un phénomène d’une tout autre ampleur – puisqu’il met en question l’être même du social, les rapports de la pensée et de l’action, du philosophique et du politique – que Claude Lefort a su découvrir comme conditionnant l’émergence d’une conception rationaliste et universaliste de la politique, en l’occurrence, dans le cas de l’humanisme florentin. Phénomène originaire, car il s’agirait « d’un changement radical qui affecte non seulement la pensée politique mais les catégories qui commandent la détermination du réel1 ». De par la rupture avec la représentation théologique du monde se dégagerait « pour la pensée un lieu de la politique, et par conséquent une visée du réel au lieu propre de la politique. Ce qui adviendrait ainsi, c’est le rapport à ce lieu, non pas un discours politique nouveau, mais le discours sur la politique comme tel2 ».
Pour établir la légitimité de cette lecture « maximale », appréhender la constitution du moment machiavélien, nous retiendrons deux textes, un de Feuerbach et un de Marx qui montrent au mieux comment le discours politique « en français moderne », tenu sur la scène allemande de 1841 à 1843, est bien l’effet dérivé d’un discours fondateur sur la politique, sur le lieu de la politique, tendu de part en part vers une reconquête de la dimension politique, dimension constitutive de l’humanité.
En 1842, dans Nécessité d’une réforme de la philosophie, Feuerbach appelle à une transformation de la philosophie et, pour bien marquer la radicalité et la nouveauté de son projet, il distingue deux types de réforme : une réforme interne à la philosophie, « enfant du besoin philosophique », et une réforme externe, c’est-à-dire qui renvoie à l’extériorité historique, hors du champ de la philosophie, et donc de nature à satisfaire un besoin de l’humanité. C’est à une réforme du second type que convie Feuerbach ; il en reconnaît la nécessité à deux signes conjoints qui marquent le temps présent, d’une part une transformation religieuse sous la forme d’une négation du christianisme, de l’autre, le surgissement d’un nouveau besoin de l’humanité, le besoin de liberté politique, ou encore, le besoin politique. Entendons qu’il existe une hostilité de principe entre le christianisme et le nouveau besoin fondamental de l’humanité, hostilité décrite en termes machiavéliens : « Les hommes se jettent aujourd’hui dans la politique parce qu’ils reconnaissent dans le christianisme une religion qui détruit l’énergie politique des hommes1. » Entendons que la politique a remplacé la religion. De cette conversion du regard des hommes tourné désormais vers la terre et non plus vers le ciel, Feuerbach déduit l’exigence de la réforme de la philosophie et la tendance de cette réforme. À la philosophie, en effet, revient la tâche de se transformer en religion, ou plutôt d’élaborer le « principe suprême » qui permette à la politique de se transformer en religion, c’est-à-dire de ne pas toucher seulement la tête, mais de pénétrer jusqu’au cœur de l’homme.
C’est donc bien le besoin politique, auquel est reconnu le statut de besoin d’une nouvelle période de l’histoire humaine, qui commande et exige la réforme de la philosophie. On remarquera, en outre, le véritable retournement qu’effectue Feuerbach au sein d’une démarche typiquement dialectique, puisque la négation de la religion est posée comme condition de possibilité de la réappropriation du politique : la désintrication du politique et du théologique, l’émancipation du politique par rapport au religieux vaut comme moment préparatoire à une transformation de la politique en religion, de par l’intervention de la philosophie. Davantage, cette nouvelle sacralisation de la politique informe de part en part le concept d’État tel qu’il est construit par Feuerbach.
Du point de vue de sa genèse, à suivre Feuerbach, l’État se déduit de la négation de la religion : c’est quand le lien religieux se brise ou se dissout que peut surgir la communauté politique, c’est quand le rapport à Dieu s’efface que peut s’instaurer le lien interhumain. Tel est le travail du nouveau principe suprême, sous sa forme négative, à savoir l’athéisme.
Du point de vue de sa constitution même – là où se fait le travail du principe suprême sous sa forme positive, à savoir le « réalisme » –, l’État connaît un processus complexe en deux temps embrayant l’un sur l’autre, comme si l’arrêt de la liaison religieuse donnait naissance à un éclatement, à une séparation, à une déliaison telle qu’une nouvelle liaison ait à advenir, la liaison politique, la liaison qui se constitue dans et par le politique. En effet, le théologico-politique est à la limite un mixte inconcevable puisqu’il prétend rassembler deux logiques qui travaillent en sens contraires. « La religion ordinaire est si peu le lien de l’État qu’elle en est plutôt la dissolution. » Poser Dieu comme père, pourvoyeur, « régent et seigneur de la monarchie mondiale », frappe d’inanité le lien interhumain propre au champ politique. « Aussi l’homme n’a-t-il pas besoin de l’homme… Il s’en remet à Dieu et non à l’homme ; (…) Aussi l’homme n’est-il lié à l’homme que par accident. » Ce n’est que l’effacement du lien religieux, moment de la séparation, qui rend possible la constitution du lien politique, moment de la nouvelle réunion. À considérer la genèse subjective de l’État, une relation apparaît entre la dissolution du religieux et la formation de l’État. « … les hommes s’assemblent pour la seule raison qu’ils ne croient en aucun Dieu, qu’ils nient… leurs croyances religieuses. Ce n’est pas la croyance en Dieu, mais la défiance de Dieu qui a fondé les États. C’est la croyance en l’homme comme Dieu de l’homme qui rend subjectivement compte de l’origine de l’État1. » La sortie du théologico-politique s’opère donc dans un mouvement d’éclatement et de réunion, de déliaison et de liaison qui, dans le même temps où il rend les sujets humains à leur finitude, ouvre une nouvelle séquence ascensionnelle, ouvre la voie au surgissement d’un nouveau sujet infini qui prend son envol sur le terrain de l’incomplétude des sujets finis. Remarquables sont les caractères prêtés à ce nouveau sujet qui émerge du rapport humain rendu à lui-même. L’État est posé comme un être infini, comme une totalité, comme activité pure, comme autodétermination, bref comme doté de tous les attributs de la divinité. « L’État est la somme de toutes les réalités, l’État est la providence de l’homme. Dans l’État, les hommes se représentent et se complètent l’un l’autre (…) je suis embrassé par un être universel, je suis membre d’un tout. L’État authentique est l’homme sans bornes, l’homme infini, vrai, achevé, divin. L’État, et lui seulement, est l’homme, l’État est l’homme se déterminant lui-même, l’homme se rapportant à soi, l’homme absolu. (…) L’État est le Dieu des hommes, aussi prétend-il justement au prédicat divin de la Majesté1. »
Texte fondamental pour notre propos :
– En effet, au-delà de la reconnaissance du besoin politique comme besoin spécifique de la modernité, s’y donne à lire, sur les ruines de la représentation théologique du monde, une institution philosophique du politique telle que le politique, ainsi haussé au niveau d’une mise en œuvre d’un principe philosophique nouveau, « le réalisme », soit le lieu enfin susceptible de penser et de résoudre la question qui ne cesse de hanter l’histoire, la venue à soi d’un sujet universel, pleinement transparent à lui-même et instituant dans la coïncidence à soi l’ère de la réconciliation terrestre. Élévation du politique très moderne où l’on peut reconnaître sans conteste le mouvement qui, selon J. Tarminiaux, caractérise la modernité, à savoir « un parti pris d’oblitération et même de forclusion de la finitude » et qui peut se faire jour même au sein d’une pensée qui fait aveu de la finitude – en l’occurrence chez Feuerbach par l’invocation faite au « cœur », source de l’affection, du besoin, du sensualisme2. Enfin ce texte nous paraît définir au mieux le climat spirituel dans lequel a commencé de penser et d’écrire le jeune Marx, comme si cette élévation du politique avait formé l’horizon – peut-être la matrice théorique – à partir duquel Marx a pensé successivement l’État moderne, la « vraie démocratie », le communisme, autant de noms qui entendent signifier que l’énigme de l’histoire est enfin résolue, que l’identité à soi est atteinte, ce que Feuerbach visait par le nom de réalisme : « L’unité immédiate avec nous-mêmes, avec le monde, avec la réalité1. » Aussi est-il légitime d’interpréter, à la lumière de cette réhabilitation du politique, le texte de Marx de 1842, L’article de tête n° 179 de la Kölnische Zeitung, qui prend figure d’un petit manifeste machiavélien-spinoziste, daté en outre du 14 juillet. Ne s’agit-il pas, en effet, pour Marx de répliquer à un article de tête inspiré par la logique de l’État chrétien et déniant en conséquence à la philosophie le droit de traiter des questions politiques, selon la raison, dans la presse ?
Manifeste machiavélien-spinoziste, car Marx, lecteur assidu de Spinoza, et plus particulièrement du Tractatus theologico-politicus au cours de l’année 1841, fonde toute l’argumentation de sa contre-attaque visant à reconnaître à la philosophie le droit de traiter des questions politiques, sur les principes dégagés par Spinoza qui fut l’un des premiers, comme l’on sait, à reconnaître en Machiavel l’amour de la liberté (Traité de l’autorité politique, chap. V)2. D’abord on y rencontre à plusieurs reprises une critique virulente de l’ignorance dont la puissance démoniaque cause dans l’histoire bien des tragédies. Mais surtout, Marx reprenant le thème spinoziste de la séparation de droit entre la théologie ou la foi et la philosophie, l’une ayant pour objet l’obéissance et la ferveur de la conduite, l’autre la vérité (Préface du Tractatus theologico-politicus, et chap. XV), en déduit la vocation de la philosophie à la connaissance du vrai, sur le modèle de la connaissance de la nature. « N’y a-t-il pas une nature humaine universelle, comme il y a une nature universelle des plantes et des astres ? La philosophie veut savoir ce qui est vrai et non ce qui est autorisé 3. » De là, la qualité propre reconnue au discours philosophique ; œuvre de la raison, il veut se faire entendre de la raison : « Vous parlez sans réflexion, elle (la philosophie) parle avec réflexion, vous vous adressez à l’affectivité, elle s’adresse à la raison 1. » Marx en déduit également le droit de la raison humaine, de la philosophie de s’occuper des choses humaines, de l’organisation de la cité, et ce « non dans le langage trouble de l’opinion privée » mais « dans le langage éclairant de l’esprit public ». « Les journaux ont non seulement le droit, mais l’obligation de discuter des sujets politiques. A priori, la philosophie, sagesse de ce monde-ci, paraît avoir plus de droit à se préoccuper du royaume de ce monde, de l’État, que la religion, sagesse de l’autre monde 2. » De Spinoza, Marx retient donc non seulement la thèse centrale du Tractatus theologico-politicus favorable à la liberté de philosopher, mais l’idée que, pour fonder la Res publica, il convient de détruire le nexus théologico-politique, ce mixte impur de foi, de croyance et de discours invitant à la soumission, cette alliance particulière du théologique et du politique (tel l’État chrétien contemporain de Marx) dans laquelle, par l’invocation de l’autorité divine, le théologique envahit la cité, réduit la communauté politique à l’esclavage, pis encore, en déséquilibre totalement l’ordonnance en superposant à sa logique propre une logique relevant d’un autre ordre.
Une ligne de continuité apparaît bien, qui va de Machiavel à Marx en passant par Spinoza, et qui consiste à libérer la communauté politique du despotisme théologique, afin de rendre au politique sa consistance propre et de permettre ainsi l’avènement d’un État rationnel ; avènement pour lequel il suffit, selon Marx, « de dériver l’État de la raison dans les rapports humains, œuvre que réalise la philosophie ». Il s’ensuit, écrit Marx, que « ce n’est pas d’après le christianisme, c’est d’après la nature même, d’après l’essence même de l’État qu’il vous faut déterminer le droit des constitutions politiques ; non d’après la nature de la société chrétienne, mais d’après la nature de la société humaine3 ».
L’interprète est d’autant plus autorisé à faire ressortir cette continuité que c’est très exactement la ligne de combat que choisit Marx dans son offensive contre les partisans de l’État chrétien. Il ne s’agit pas pour autant de la part de Marx d’occuper simplement une position stratégique, mais bien plutôt d’articuler sa propre interprétation de l’histoire de la philosophie politique, de définir ce qui constitue selon lui l’apport propre de la modernité à la pensée du politique. Retenons quelques formules remarquables qui confèrent à ce texte valeur de Manifeste ; le propos de Marx est, en effet, de circonscrire l’initium à partir duquel il est désormais possible de penser les choses politiques. Selon lui, c’est bien d’une véritable révolution copernicienne qu’il s’agit : « Aussitôt avant et après le moment où Copernic fit sa grande découverte du véritable système solaire, on découvrit en même temps la loi de la gravitation de l’État : on s’aperçut que son centre de gravité était en lui-même (…) Machiavel et Campanella d’abord, puis Spinoza, Hobbes, Hugo Grotius, et jusqu’à Rousseau, Fichte, Hegel se mirent à considérer l’État avec des yeux humains et à en exposer les lois naturelles, non d’après la théologie, mais d’après la raison et l’expérience1. » La légitimité du questionnement philosophique à propos du politique repose sur l’autonomie du politique. Inversement l’autonomie du concept d’État est à rapporter au travail critique de la philosophie, à son mouvement d’émancipation qui a permis la constitution d’un savoir mondain du politique centré sur lui-même. C’est à la constitution de ce savoir séculier du politique que Marx rattache la théorie moderne de la balance des pouvoirs. Aussi Marx insère-t-il la découverte du système politique dans le mouvement général d’émancipation des sciences à l’égard de la révélation et de la foi qu’il place sous le patronage de Bacon de Verulam, lequel sut, d’après lui, émanciper la physique de la théologie. Il convient cependant d’observer que, tout en reconnaissant la novation moderne, Marx insiste sur le rapport que cette dernière entretient avec la pensée politique classique, comme si la modernité avait sauté par-dessus le christianisme pour renouer avec la forme de questionnement propre à l’Antiquité. « La philosophie moderne n’a fait que poursuivre une tâche commencée autrefois par Héraclite et Aristote 2. » Socrate, Platon, Cicéron sont également cités comme symboles de sommets de la culture historique, de moments où l’apogée de la vie populaire allait de pair avec l’essor de la philosophie et le déclin de la religion. Ce rapport aux Anciens est important, car il marque bien la complexité, sinon l’ambiguïté, de ce texte où coexistent le rapport à la science moderne et, sous le nom de Machiavel, une redécouverte de l’autonomie du politique qui n’engage pas pour autant la pensée dans les voies de l’empirisme. Au contraire, même. En effet, l’idée de l’autonomie du concept d’État s’enrichit d’autres déterminations, ou plutôt connaît une extension de caractère spéculatif. Considérer l’État avec des yeux humains, découvrir la loi de gravitation de l’État, poser que le centre de gravité de l’État réside en lui-même, autant de propositions directrices qu’il faut entendre en un double sens, à savoir : 1/ que pour appréhender la logique de l’État, il faut se libérer du théologique ; 2/ que cette émancipation n’est pas seulement une libération sous forme de séparation, de négation, mais qu’elle doit se hausser au niveau d’une position, d’une liberté affirmative ; c’est dire que cette autonomie conquise, il faut se garder de rapporter cette logique de la politique à des ordres autres que le politique et de nature à livrer une genèse empirique de l’État, sous peine d’occulter aussitôt cette dimension que la pensée vient de recouvrer.
C’est pourquoi Marx prend, à dessein, ses distances à l’égard des théories modernes du droit naturel (Hobbes, Grotius, Kant) qui, en dépit de leurs divergences, ont en commun d’avoir élaboré une représentation de l’État à partir d’une genèse empirique de type socio-psychologique. « Autrefois les professeurs philosophes de droit public ont construit l’idée de l’État en partant des instincts, soit de l’ambition, soit de la sociabilité, ou parfois même de la raison, mais de la raison individuelle 1. » Marx, au contraire, choisit, à l’exemple de la philosophie la plus récente qui professe des « conceptions idéales et plus profondes » – sans aucun doute celle de Hegel –, de se tourner vers un concept spéculatif du politique.
L’État est conçu par Marx comme une totalité organique, comme un étant dont le mode d’être spécifique est le système. Aussi l’unification du multiple que réalise le système État, ou l’État comme système, n’est-elle pas à penser comme une unité-résultat qui proviendrait d’une association ou d’une liaison du multiple, soit harmonieuse, soit conflictuelle (point de vue empiriste), mais sur le modèle d’une unité de caractère organique. L’idée de l’État plus idéale, entendons spéculative, est construite en partant de l’idée du Tout, écrit Marx, ou encore de la « raison de la société ». Autre effet de cette conception spéculative de l’État : toute pensée d’une séparation, d’une extériorité, entre l’individu-citoyen et l’universalité de l’État est récusée au profit d’une intégration de la singularité à l’unité organique, ou plus exactement de la reconnaissance d’une adéquation parfaite entre la raison individuelle et la raison de l’institution étatique, elle-même mise en œuvre de la raison humaine1. Cette appartenance à une pensée spéculative de l’État mérite d’être mise en valeur, car ainsi on mesure au plus près la dimension à laquelle il convient de rapporter l’idée d’autonomie. Il convient d’entendre l’idée d’autonomie du concept d’État selon une double acception. Négativement, poser l’autonomie implique le refus d’une genèse empirique tout autant que le refus du modèle du contrat, ou d’une genèse à partir du concours des raisons individuelles. Positivement, penser l’État, selon son concept, comme forme première, comme forme intégratrice, organisatrice, exige de penser l’autonomie à son plus fort registre, de faire produire à ce concept toutes ses implications au point de reconnaître dans la communauté politique le pouvoir instituant du social. Affirmer de l’État qu’il est « le grand organisme », poser l’État au-delà de toute dérivation, c’est du même coup faire l’aveu de sa primauté et l’installer au lieu même de l’institution du social.
Le texte de Marx reste plus sobre que celui de Feuerbach. Chez l’un comme chez l’autre, on relève néanmoins que la lutte contre une représentation théologique du monde ouvre la voie à une redécouverte du politique, à « une visée du réel au lieu propre du politique », même si l’exigence énoncée explicitement par Feuerbach – « il faut que la politique devienne notre religion » – dévoile comme non réglée dans la modernité la question des liens du politique et du religieux.
À l’occasion d’un colloque de trois jours organisé par l'Unesco sur la pensée de Miguel Abensour en novembre 2004, les Éditions du Félin ont choisi de publier une nouvelle édition de La Démocratie contre l’État revue et augmentée par une préface inédite et un texte final : « Principe d’anarchie et démocratie sauvage ». Son propos est au centre du débat politique contemporain et remonte bel et bien à l’origine de 1789 : la démocratie est-elle entièrement incluse dans l'État, ou bien serait-elle, dans son essence même, en opposition avec lui ? Tradition jacobine, avec renforcement de l'État, ou tradition conseilliste brisant le pouvoir pour lui substituer une nouvelle forme de lien politique ? Or, ce débat se déroule tout au long de l'itinéraire philosophique de Marx. Ainsi, à partir de la lecture qu'il fit de Hegel en 1842 et 1843, Marx établit le fameux moment machiavélien en dégageant le politique du théologique-politique afin de définir les lois spécifiques au gouvernement de la Cité. Selon les principes du célèbre florentin et en méditant sur les couples opposés de servitude et de liberté, de dominants et de dominés il va élaborer sa conception de la « vraie démocratie ».
Miguel Abensour est professeur émérite de philosophie politique à l'université de Paris VII et directeur de la prestigieuse collection « Critique de la politique » chez Payot. Son œuvre, centrée sur la théorie politique, approche avec une grande précision les notions d'utopie, d'héroïsme et de démocratie. Il vient de publier les œuvres complètes de Saint-Just en « Folio » avec une longue préface qui suscite déjà de nombreuses réactions.