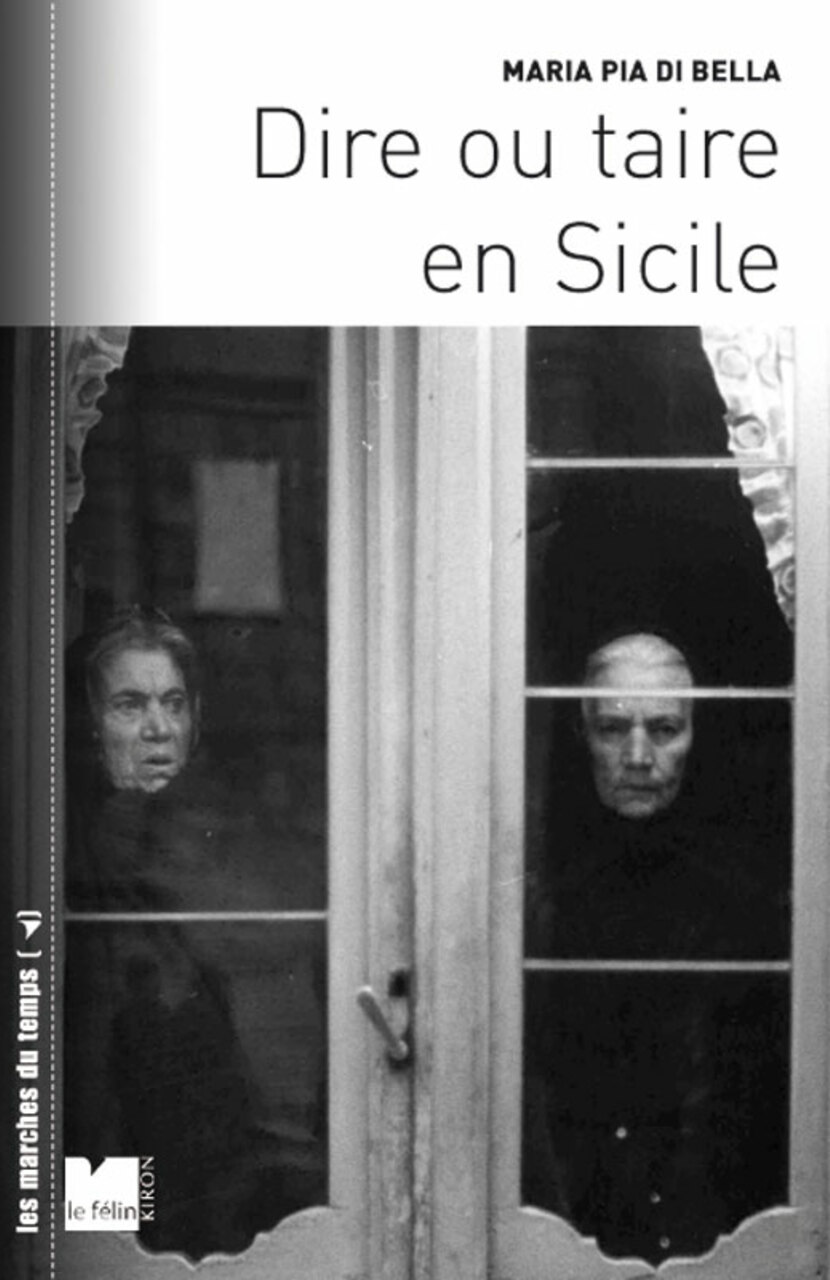
Dire ou taire en Sicile
occulter/dévoiler :
les stratégies de la parole
Parmi les affirmations qu’une personne est susceptible de faire, se trouve une série de croyances héritées qui déterminent son verbe et son action. Ce verbe et cette action changent lorsque l’individu ou le groupe dépassent la frontière établie par l’attente sociale pour aller vers un choix transgressif. Cette frontière se place aujourd’hui au centre de mes analyses qui se focaliseront sur l’utilisation de la parole dans des situations marginales à travers l’acte – conscient ou inconscient – d’occulter ou de dévoiler la parole1. C’est donc entre le non-dit ou le dit autrement, le silence (omertà) ou le «parler en langues» (glossolalie), le fait de révéler ou de dénoncer, de narrer ou de témoigner, de chanter ou de poétiser, de dire le faux ou le vrai que j’examinerai ces stratégies de la parole. Le terme «stratégie» semblerait avoir une connotation trop forte pour ces actes de parole souvent inconscients, ces choix dus au hasard ou aux circonstances de la vie, même si, du point de vue de l’observateur, le terme est approprié. Néanmoins, il s’agit véritablement de stratégies appliquées à la sphère de la communication et, en tant que telles, je souhaite les soumettre au lecteur.
Au début du xxe siècle, aux États-Unis, les différents réveils du protestantisme donnent naissance à de multiples groupes pentecôtistes qui, progressivement, au cours du siècle, se développeront sur chaque continent. C’est certainement le phénomène glossolalique, aboli par les principaux évêques d’Asie Mineure en 177 avec l’excommunion de Montanus et sa secte, qui va amener au pentecôtisme un nombre toujours croissant de fidèles tout en inspirant au sein de la communauté catholique, presque soixante ans plus tard, le mouvement charismatique.
C’est en 1907 qu’a lieu le premier contact de la colonie italienne avec le pentecôtisme nord-américain. L’année suivante, G. Lombardi, un des adhérents les plus connus, décide de se rendre à Rome pour y établir un premier cercle de convertis. En 1914, P. Ottolini et S. Arena quittent Chicago pour retourner en Italie en tant que missionnaires, le premier à Matera (Basilicate) et le second en Sicile, de façon à renforcer le prosélytisme naissant. Sans tenir compte du Concordat. Si l’on pouvait déjà énumérer cent quarante-neuf localités visitées par des missionnaires pentecôtistes en 1929, dont vingt-cinq devenues lieux de culte, les choses empireront pour les prosélytes après la signature des accords du Latran entre Mussolini et le pape et, surtout, après la campagne d’Afrique du Nord. En effet, la nouvelle orientation proallemande et antianglo-saxonne du régime fasciste entraînera une série de persécutions à l’encontre des pentecôtistes: les fameuses «circulaires» du ministre Guido Buffarini-Guidi (1935, 1939, 1940), qui interdisaient aux pentecôtistes l’exercice du culte ainsi que l’organisation de réunions, seront abolies seulement dix ans après la fin de la guerre.
Le conflit mondial terminé, des individus appartenant à la colonie italienne nord-américaine, convertis au pentecôtisme, décident de retourner au pays natal en tant que missionnaires pour convertir leurs familles. Ces initiatives personnelles devront faire face à l’ostracisme du clergé local et aux forces de l’ordre, et cela jusqu’au milieu des années 1950. Mais l’Église pentecôtiste concentrera surtout ses efforts dans les villes où il est nécessaire, pour apporter la nouvelle doctrine, d’aller de porte en porte dans les grands immeubles de banlieue, de distribuer des feuillets aux locataires et de discuter avec eux de théologie. L’existence de ces groupes dans un milieu catholique fortement conservateur pose problème et suscite un ample débat, avec des campagnes de presse très virulentes entre catholiques et laïcs pendant les années 1950 impliquant, d’un côté La Civiltà Cattolica et Fides et, de l’autre, Il Mondo, L’Espresso, Il Mulino et Il Ponte. Dans cette même période, Gaetano Salvemini fonde l’Associazione per la libertà religiosa in Italia (1954), la circulaire Buffarini-Guidi est révoquée (1955) et la presse catholique limite ses attaques aux seuls laïcs. À partir de cette date, l’établissement de la nouvelle foi pourra suivre sa route sans encombre.
La question est de savoir pour quelle raison, parmi les différents dons (glossolalie, traduction, prophétie, guérison, miracles) que le Saint-Esprit est supposé accorder au néophyte pour attester sa conversion au pentecôtisme, le plus fréquent est le don de glossolalie. Cette prédominance n’est pas seulement visible dans le Midi italien1 mais partout où le pentecôtisme s’est établi et est, de plus, la composante la plus importante dans le formidable développement du mouvement charismatique.
Rappelons la question que Ludwig Wittgenstein formule à ce propos:
La parole est-elle essentielle à la religion? Je puis fort bien m’imaginer une religion sans doctrine, et dans laquelle on ne parle donc pas. Manifestement la religion, dans son essence, ne peut être concernée par le fait qu’on y parle, ou plutôt: s’il y a parole, cela même est un élément constituant de l’action religieuse et n’est pas théorie. Donc il n’importe en rien que les paroles soient vraies, fausses ou ne fassent pas sens2.
Pour ce qui est du pentecôtisme, le parler, comme dit Wittgenstein, est «un élément constituant de l’action religieuse» dans laquelle «il n’importe en rien que les paroles soient vraies, fausses ou ne fassent pas sens». Au contraire, c’est le fait d’utiliser des «paroles qui ne font pas sens» (ou d’en avoir le désir) qui permet au néophyte d’outrepasser certaines limites pour se retrouver dans un nouveau contexte social. Comme nous le verrons dans le premier et le deuxième chapitre, l’insertion du néophyte dans un nouveau groupe – dans notre cas, le groupe de convertis au pentecôtisme qui, pour des raisons évidentes, se sépare du reste du village – ne signifie pas ipso facto sa pleine intégration. C’est le don de glossolalie qui permet de distinguer, mais cette fois-ci à l’intérieur du groupe, le vrai du faux croyant, celui dont on pourra dire avec certitude qu’il est sauvé pour l’éternité.
Les motivations individuelles et collectives dans les conversions au pentecôtisme, en Italie rurale du Sud, semblent être opposées à celles rencontrées aux États-Unis. Ici, la forte immigration de personnes aux multiples idiomes a permis aux nouveaux arrivés de voir, dans leurs conversions, un moyen de faire tomber les barrières linguistiques. Et ce, surtout grâce à la glossolalie, qui est une façon rapide de s’intégrer dans la société d’arrivée et d’abandonner la situation marginale dans laquelle ils se trouvaient, par la force des choses1. Dans le Mezzogiorno, au contraire, les motivations étaient essentiellement liées à l’attraction de l’image «millénariste» de l’Amérique2. Le néophyte se trouvait, de ce fait, marginalisé par rapport à sa communauté d’origine lorsqu’il décidait de quitter l’Église catholique (il devait sans doute également se sentir marginalisé par rapport à son nouveau groupe lorsqu’il apparaissait qu’il ne pouvait obtenir le don des «langues»).
La glossolalie est un des modèles dans les différentes stratégies de la parole dans lequel nous voyons l’acteur articuler des mots de façon subjective, sans utiliser les méthodes de contrôle que la grammaire ou la syntaxe promeuvent, ni se préoccuper du vocabulaire. La stratégie des membres de la Compagnia del Santissimo Crocifisso, dite des Bianchi (Palerme, 1541-1820), vis-à-vis des condamnés à mort à leur charge est tout autre, et produit des résultats différents sur les condamnés en question. À la Compagnie était confié le salut des âmes des condamnés, salut qu’ils devaient susciter en les assistant pendant les trois jours et trois nuits qui précédaient leur exécution. Pendant cette période liminale, le condamné devait écouter sept méditations1, se confesser et communier plusieurs fois, prier fréquemment dans l’oratoire devant la statue de l’Ecce Homo, assister à différentes messes, faire quatre fois l’exercice de l’échelle, autant de fois la discipline, et dicter une décharge de conscience s’il en ressentait le besoin. Ces trois journées liminales se passaient à préparer les condamnés à accepter pleinement leur sort, à les convaincre de mourir avec bravoure, étant donné que les souffrances terrestres que leur corps devait subir pendant la procession qui allait les mener de la prison à l’échafaud étaient la condition sine qua non de leur salut pour accéder à un au-delà qui, autrement, leur aurait fait défaut.
C’est donc en sachant qu’ils devront se présenter bientôt devant le «terrible tribunal de Dieu» que certains condamnés à mort demandent à dicter, la veille de leur exécution, une décharge de conscience. Ce que représente cette décharge pour les parties intéressées, c’est-à-dire les Bianchi, les condamnés eux-mêmes et peut-être les magistrats des cours devant lesquelles le condamné a été interrogé avant le procès, est particulier. Cette particularité dérive du fait que, dans leur discours, les condamnés profèrent la pure vérité2. La pure vérité se trouve dans une position prééminente par rapport à la vérité tirée de la bouche des accusés pendant les interrogatoires, avec des moyens de torture variés, que souvent les décharges illustrent1. Les deux niveaux sont donc séparés de façon nette: la première vérité est celle énoncée au niveau terrestre, tandis que la seconde l’est au niveau céleste. Les condamnés passent d’un niveau inférieur à un niveau supérieur, grâce à la direction des Bianchi. Stimulateurs de la conscience d’autrui, les Bianchi percevaient chaque décharge comme une preuve du succès atteint par leurs méditations dans le but de rétablir le salut des âmes.
La décharge, dictée par le condamné pendant son réconfort aux Bianchi présents, s’insère dans un «cadre» appelé forma ou formola. Le texte véritable est donc encadré par une formule initiale assez longue et par une autre, finale, plus brève. Le problème est de décider du degré de spontanéité de ces textes et, naturellement, d’en déterminer la paternité. Bien que toutes soient nominatives et beaucoup d’entre elles signées, le doute demeure qu’elles soient plus une œuvre chorale que singulière. On a parfois l’impression d’entendre un son différent, d’écouter, à travers un vécu particulier, une voix individuelle ou d’être face à des créations, des fictions de type littéraire2. Mais le moment, hautement dramatique, contribue à freiner la majorité des velléités et à canaliser le récit et l’expression dans des modèles préexistants et contrôlés.
Ces voix disent des choses différentes de celles des pentecôtistes qui, elles, «ne font pas sens». Ces voix dévoilent, elles offrent un témoignage précis et crédible aux personnes présentes dans l’espoir d’être «sauvées» une fois dans l’au-delà. En revanche, les pentecôtistes de la Daunia se savent sauvés justement en raison du non-sens de leur locution, qui leur donne la possibilité de se séparer de leur communauté d’origine sans dommage.
Les différentes méditations conduites par les Bianchi pendant cette période liminale, les différentes confessions et communions, les prières, les exercices, les décharges font partie d’un rituel qui est la condition nécessaire pour ensuite mettre en scène, dans les rues de Palerme, pendant la procession qui conduit le condamné de la prison à l’échafaud, un théâtre bâti sur le consentement public. C’est l’acceptation, de la part du condamné, de jouer à l’intérieur et à l’extérieur de la prison un rôle de facture christique dans lequel chacune de ses paroles est sévèrement contrôlée – pendant la procession, comme il l’a appris lors de l’exercice de l’échelle, il ne doit jamais s’exprimer oralement, doit porter un bandeau sur les yeux, doit baiser les pieds du bourreau en remerciement avant de monter les gradins du gibet, etc. – pour être réintégré dans la communauté urbaine, tandis que son sacrifice corporel le prépare à la «sanctification populaire». En effet, c’est à partir de 1799 que le culte est historiquement daté. Cela a lieu «avec l’enterrement des justiciés (giustiziati) dans le cimetière établi sur la rive droite du fleuve palermitain Oreto, appelé des “âmes des corps décollés” (anime dei corpi decollati), dont l’église [de la Madonna del Fiume] était fréquentée surtout le lundi du fait que les âmes des innocents, qui suite à l’erreur de la justice humaine furent sacrifiées à l’extrême supplice, sont crues dispensatrices de grâces et de miracles et de cette croyance font foi les innombrables ex-voto accrochés aux parois de l’église1 ».
La conversion ou la reconversion des condamnés leur permet d’acquérir un statut jamais possédé auparavant s’ils respectent les règles apprises pendant les trois journées liminales et s’ils expirent sur l’échafaud de la façon prescrite. Il leur sera donné la possibilité d’une réinsertion qui, de toute façon, reste symbolique étant donné qu’elle a lieu après leur mort. Le croyant pentecôtiste, au contraire, accède à une expression personnelle de ses sentiments religieux grâce au don du Saint-Esprit qui l’exclut, d’un côté, de toute communication avec sa communauté d’origine mais lui permet, de l’autre, de s’insérer dans le groupe d’arrivée.
Un autre modèle dans les différentes stratégies de la parole est, comme nous venons de le voir, celui utilisé par les Bianchi sur les condamnés à mort, surtout mis en valeur pendant deux moments très différents de l’itinéraire de ces derniers: celui de la dictée de leur décharge de conscience et celui de la procession vers l’échafaud. Chaque action des condamnés est guidée par les mêmes Bianchi et contrôlée par eux de façon à ce que tout se déroule selon leurs directives. Ce sont surtout les décharges de conscience dictées par les condamnés devant les Bianchi qui m’ont permis d’analyser, dans le chapitre iii – d’un point de vue historique – le code du silence (omertà), un des modèles forts de la «culture méditerranéenne», souvent incorporé au modèle plus connu de l’honneur qui se perpétue en anthropologie sociale1. Dans la tentative de démentir le stéréotype lié à ce terme (omertà), je fais en outre l’hypothèse de son origine aristocratique, de tradition pieuse, une espèce de contre-modèle par rapport à celui proposé par l’Inquisition ou par différentes cours palermitaines dans leur tentative de pousser l’accusé à la délation à travers l’utilisation de la torture. Il sera plusieurs fois question d’omertà dans ce volume: les chants des prisonniers siciliens (chapitre v) ainsi que les parità recueillies par Serafino Amabile Guastella en Sicile orientale (chapitre iv) serviront à démontrer que le terme omertà ne doit pas être seulement lié à une pratique de type mafieuse. En Sicile, on ne peut le nier, il y a eu un glissement du terme «honneur» – ainsi que d’omertà – vers celui de «mafia»; «homme d’honneur» ainsi que omu di panza désignent désormais le mafieux. Mais il est essentiel de souligner que, derrière cette image monolithique contemporaine, les réalités sociales qui recouvraient ces termes étaient multiples.
Dans ce contexte, nous nous trouvons devant une intention volontaire d’occulter la parole. Cela démontre que, dans certaines situations de type marginal, la parole est susceptible de ne pas être utilisée. Wittgenstein écrit: «La limite ne peut, par conséquent, être tracée que dans le langage, et ce qui se trouve de l’autre côté de la limite sera simplement du non-sens1 »; mais, dans notre cas, nous nous demandons si, au-delà de la limite, «il n’y aura que silence». Ou si, au contraire, le silence ne fait pas partie intégrante de la communication, comme cette autre proposition de Wittgenstein nous permet de le penser: «Tout ce qui peut être dit peut être dit clairement; et ce dont on ne peut parler on doit le taire2. » Dans ce cas, le «taire» deviendrait une des options, une des stratégies que le locuteur peut choisir, stratégie qui le maintiendrait néanmoins dans la sphère des échanges oraux du fait qu’un jour il pourrait (comme nous le verrons par la suite) l’abandonner sans remords. Tout cela me fait dire que cet autre modèle dans les différentes stratégies de la parole, celui du silence, est de facture ambiguë dans la mesure où il peut signifier le consentement ou le dissentiment et en outre peut, comme je l’ai signalé, glisser dans l’élocution.
Symptomatique est le fait que le choix du paysan sicilien au xixe siècle pour rompre le silence qui, par ailleurs, le maintient dans un état de passivité face à l’injustice dont il est victime, soit fait à travers l’utilisation de la poésie3. La vérité dont la poésie est porteuse chasse toute velléité individuelle et toute violence sociale, en rendant le poète actif et digne. C’est Jésus même qui indique au paysan le moyen de retrouver un statut social digne de sa conscience: devenir poète. Et nous avons ici un autre modèle dans les différentes stratégies de la parole, celui de la poésie : révélée par la parole divine, elle dit le vrai dans des formes symboliques et elle est voisine de la sphère de la justice. Pour cela, dans ce panthéon paysan, l’omertà et la poésie semblent se retrouver aux deux limites opposées de l’élocution. Cette symétrie n’a – peut-être – même pas été atteinte par la Mafia, étant donné le succès des poètes sur les places publiques dans les années 1980. Puis, comme nous le verrons, la vérité fera son apparition au tribunal.
C’est sur la désobéissance à certaines règles imposées par l’honneur que j’ai décidé de concentrer une partie de mes études, dans la mesure où il est souvent plus facile de percevoir les comportements transgressifs que les conformistes. Mais, naturellement, la compréhension des uns dépend de la connaissance des autres, et les deux étaient pour cela toujours présents à mon esprit au cours de l’enquête1. Le refus a été analysé à travers la façon dont la presse italienne en général a présenté le «cas Franca Viola», surnommée la ragazza che disse di no (chapitre x). Une enquête sémiotique m’a permis de déchiffrer les différents niveaux de lecture du fait-divers en contribuant, je l’espère, à faire percevoir dans les comportements des principaux acteurs (Franca Viola et le père) les stratégies et les moments hautement dramatiques de rupture du type de modèle de l’honneur dans lequel, à Alcamo (Sicile), on essayait par tous les moyens de les enfermer.
Le personnage de Franca Viola est devenu, avec le temps, représentatif de ce courage, de ce choix transgressif que la presse a parfaitement identifié dans l’adverbe «non». Franca Viola a parlé, elle a en effet dit quelque chose, mais c’est seulement un «non». Une récusation. Un simple «non» sera ainsi suffisant pour l’identifier. Cette jeune femme qui n’a jamais pris la parole devant les médias, étant trop craintive pour le faire, a quand même su, aidée par un père responsable et intelligent, rester dans l’histoire contemporaine sicilienne à cause de ce refus.
Si la Mafia pouvait reléguer l’acte courageux de Franca Viola dans une brisure du code de l’honneur au niveau de la sphère privée ou, pis, sexuelle, elle ne pouvait pas avoir la même attitude face à la première prise de parole publique dans un tribunal palermitain (10 février 1986), amplement «médiatisée»: celle du fameux mafieux Tommaso Buscetta qui, pendant qu’il dénonçait ses pairs, soulignait en même temps la victoire de l’État sur l’omertà. L’acte courageux de Tommaso Buscetta était aussi un cri de refus du système qui l’avait opprimé après avoir opprimé un grand nombre des siens. Reste que, si les différentes interventions des «repentis» dans les multiples procès de Mafia qui se sont succédé après cette première prise de parole sont pertinentes pour ma démonstration, elles débouchent vers d’autre types de problématiques que je ne souhaite pas reprendre ici (mais je renvoie le lecteur au chapitre xii de ce volume).
De toute façon, Buscetta a parlé. Et après lui Salvatore Contorno et Francesco Marino Mannoia. Et après Contorno et Mannoia d’autres, dans les années 1990, comme par exemple Antonino Calderone1. Il me semble évident que les premiers «repentis» avaient une relation privilégiée avec deux magistrats – Giovanni Falcone et Paolo Borsellino (morts en 1992 dans des attentats différents), les fameux «passeurs» de ces témoins à charge qu’ils aidaient à aller de l’omertà à la prise de parole publique – étant donné que plusieurs éventuels «repentis» ne passaient à l’acte que s’ils étaient interrogés par eux. Rappelons-nous la très jeune Rita Atria qui avait raconté à Borsellino tout ce qu’elle savait sur les cosche de Partanna après l’assassinat de son père et de son frère et qui, exilée à Rome pour des raisons de sécurité, se suicide une semaine après la mort du magistrat (19 juillet 1992). En effet, « “ses” repentis l’adoraient: des mafieux que lui-même découvrait dans les prisons et qui ne racontaient les secrets et les méfaits de Cosa nostra qu’à lui seul. Ces mêmes repentis qui, une fois les interrogatoires terminés, envoyés dans des lieux sûrs à l’extérieur de la Sicile, continuaient de lui téléphoner avec mille excuses1 ».
Il n’est pas simple d’analyser ces divers comportements – d’un côté Viola, de l’autre Buscetta: on peut le faire d’un point de vue «positif» ou «négatif», et les deux analyses peuvent paraître pertinentes. Ces prises de parole ou ces dénonciations peuvent être vues comme des réactions qui dérivent d’une forte croyance dans la période glorieuse du phénomène ou de la règle, celle de sa fondation (rappelons-nous que la plus grande partie de ces nouveaux groupes religieux ou sectes est souvent attirée par le «mythe des origines», même le pentecôtisme à ses débuts avait comme référence les premiers chrétiens). Ainsi, les dénonciations de Buscetta, Contorno, Mannoia, etc. peuvent être perçues comme émanant de «mafieux» contre Cosa nostra, c’est-à-dire contre un groupe, celui des Corleonesi, qui avait anéanti ce qui restait de la «vieille» Mafia pour en faire, comme dit le titre d’un livre de Pino Arlacchi, une «Mafia entrepreneuriale2 ». Ou au contraire on peut, comme dans le cas de Rita Atria, lire dans ce besoin de témoigner publiquement une aspiration vers un monde sans Mafia que les figures hautement morales de Falcone et Borsellino rendaient possible. De toute façon, ceci est un énième modèle dans les différentes stratégies de la parole, celui de la prise de parole publique. Avec ce modèle, nous nous éloignons du respect du code de l’honneur, du blocage dans des situations marginales ou ambiguës pour entrer dans la sphère de l’autonomie où les limites sont franchies et où la parole transmet des informations précises, témoigne, raconte les événements passés à un large public et aux médias. Suite à ce comportement, le locuteur est formellement réintégré dans la société. Souvent, cette réintégration se produit de façon dramatique (rappelons-nous des difficultés quotidiennes de Franca Viola après son procès, constamment prise d’assaut par les photographes et boycottée par son milieu) ou provoque une nouvelle marginalité (les «repentis» les plus connus doivent se cacher, se protéger, changer de nom ou de visage).
Les différentes motivations personnelles derrière chaque comportement ne diminuent pas sa portée. Certaines normes sociales peuvent changer à la suite des multiples témoignages publics axés sur des expériences personnelles. En effet, l’histoire du mouvement féministe est, depuis sa naissance, parsemée de ces genres de narrations. Ce sont aussi ces comptes rendus de «vies vécues» qui restructureront les rapports du couple ou de la famille en Italie, ou bien les lois, à partir du milieu des années 1970. D’autres témoignages étofferont par la suite les innombrables enquêtes qui enregistrent dans les campagnes ou dans les villes les «histoires de vie1 ». Pour de nombreuses femmes, parler de sa propre vie – le fait de raconter sa propre expérience sexuelle ou sa maladie – constitue une action sociale transgressive. C’est visiblement le silence qui pesait (et pèse encore) sur elles, dans les régions géographiques contrôlées par le code de l’honneur, mais pas seulement, qui rend, à leurs yeux, chaque prise de parole publique subversive. Si en plus cette prise de parole se focalise sur les relations sexuelles ou sur des maladies qui touchent à des sphères corporelles surveillées par la «modestie sexuelle», la subversion verbale devient, à la longue, délicate à gérer pour la société. Et ce en raison, surtout, de ses potentialités transmutatrices dans la mesure où la limite de ce que l’on peut dire en public ne fera que reculer. Comme nous le savons, c’est à partir des années 1990 que les femmes du monde occidental escaladent un échelon supplémentaire en allant au tribunal pour protester contre le «harcèlement sexuel2 ».
Mais la limite n’est pas toujours franchie et la transgression consommée. Il n’est d’ailleurs pas toujours possible de le faire. De plus, le fait de suivre les normes ne signifie pas qu’on le fait passivement et, si au contraire on le fait passivement, rien n’indique que l’acteur en soit conscient. Dans le chapitre vi sur le discours et la récitation de la vendetta, j’ai essayé de montrer que les observateurs donnent du phénomène une vision qui ne correspond pas toujours au vécu.
Il me semble évident que dans la stratégie choisie – celle de raconter publiquement le déroulement d’une vendetta à partir de la phase initiale, avec l’assassinat d’une «victime», jusqu’à la phase finale, avec l’homicide du coupable par un «justicier», c’est-à-dire de se représenter toujours comme la «victime» qui doit «se faire justice» – il existe une composante qui ne se trouve guère dans les récits des observateurs, plus intéressés par le déroulement d’une praxis que par l’observation de la manière dont les acteurs transforment un devoir en passion.
Cette incapacité est encore plus évidente dans le cas illustré au chapitre vii concernant l’Anglais George Cockburn qui vint en Sicile en 1810-1811, et où l’on voit à quel point les stéréotypes empêchent certains voyageurs d’entendre vraiment ce qu’ils écoutaient. Je souligne également comment ressort de façon pertinente, dans le récit de Cockburn, l’utilisation de la métaphore au sein de la société palermitaine de l’époque, métaphore qui permettait à chaque groupe social de communiquer et d’agir sans jamais se déséquilibrer. Et c’est à l’aide du mensonge que j’essaie de dérouler l’épisode fascinant présenté dans le Voyage.
Nous avons déjà remarqué que l’omertà et la poésie (vérité) se retrouvent aux deux limites opposées de l’élocution. Le mensonge fait ici son apparition à l’autre limite, grâce à la métaphore. N’étant pas poète, l’homme quelconque doit adapter sa stratégie – comme le montre l’épisode raconté par G. Cockburn – aux personnes qui lui font face et aux événements. Le message est clairement perçu par chaque auditeur, mais chacun ayant des stratégies différentes, la métaphore sera acceptée ou refusée. Il est donc clair que la métaphore est un autre modèle dans les différentes stratégies de la parole: le discours allusif, ambigu, qui suscite d’innombrables interprétations et actions.
Aucun lecteur ne peut ignorer les multiples termes employés dans ce texte qui rappellent le théâtre, ce laboratoire des situations sociales limites où les stratégies de la parole sont soulignées. En hommage au théâtre, j’ai inclus un chapitre (le neuvième) sur le drame écrit par Giovanni Verga, La Louve, représenté pour la première fois le 26 janvier 1896, au théâtre Gerbino de Turin1. Dès les premières répliques de son œuvre, Verga indique le contenu du thème à venir: il s’agit «d’une Magicienne qui, d’un coup de baguette, transforme les hommes en animaux». L’opposition nature/culture, les innombrables métaphores, surtout celles autour du «manger», abondent dans ce texte où la relation sexuelle entre la gnà Pina et son gendre, Nanni Lasca, n’est jamais explicitement nommée. En effet, l’interdiction sexuelle entre mère et gendre, due au parentato et à saint Jean, est seulement suggérée à travers des métaphores, comme si le fait de la mentionner était tabou.
Comme nous l’avons déjà vu, le tabou verbal ne concernait pas que les interdictions sexuelles mais la sphère sexuelle dans son ensemble. Dans ce drame, nous nous trouvons déjà dans un espace intermédiaire: Verga n’hésite pas à montrer au public des choses qui, en principe, ne peuvent ni se faire ni se dire, en respectant, en même temps, l’interdiction verbale qui, à l’époque, existait sur l’argument. Et c’est après la Seconde Guerre mondiale que les femmes rompront ce silence pour prendre la parole, une parole qui rendra visible ce qui, jusqu’alors, était resté occulté.
Six modèles ont été présentés dans cette introduction: le modèle de la glossolalie, des Bianchi, du silence, de la poésie, de la prise de parole publique et de la métaphore. Dans tous ces modèles nous avons pu remarquer, chez les acteurs, une aspiration au parler et un besoin de se confronter à la vérité2.
Le premier aspect concerne la parole, visiblement perçue, dans mes exemples, comme un don qui libère (glossolalie) ; comme un contrôle ou une imposition (Bianchi) ; un refus (omertà) ; un besoin d’émancipation (Buscetta); une libération dans la mesure où elle transgresse (Franca Viola, les femmes). Mais la décision de parler – de ne pas se taire – ne se retrouve pas dans chaque acte de parole. Comme nous l’avons vu, les condamnés à mort réconfortés par les Bianchi n’ont pas la possibilité, pendant la procession, de prendre la parole, mais seulement celle de répéter, sans ajouts, les quelques mots qu’ils ont l’obligation de prononcer. Le sens de la parole n’est pas toujours transmis: en effet, dans la phrase glossolalique, le sens est transmis du fait que les croyants articulent, mais non pas à travers la signification sémantique de leur discours.
Tout autre chose se passe lorsqu’on déclame une poésie: c’est une véritable prise de parole, dont la forme est la condition de l’atteinte de l’autonomie que le poète ambitionne. Pendant que Buscetta (surnommé «gorge profonde») et les autres repentis prennent la parole librement, sans se préoccuper de la prose utilisée, seulement du contenu, Franca Viola et les femmes qui racontent leur propre vécu refusent un rôle qu’on leur impose depuis trop longtemps, et ce refus est rendu explicite par la parole même (le «non» de Franca Viola): dans leur cas, le sens est communiqué par les paroles prononcées. Mais pour ceux qui utilisent la prose l’autonomie à atteindre se fait au prix d’un dévoilement progressif de leur propre biographie. C’est comme si un impératif1 était imposé à ces personnages (le poète, les pentecôtistes, Viola, les femmes, Buscetta): prendre la parole et révéler leur propre expérience, leur propre vécu, faisant en sorte que cette prise de parole leur donne accès à un nouveau statut1.
Le deuxième aspect est le besoin des acteurs de se confronter à la vérité. Même si le terme ou l’idée de vérité ne sont pas toujours explicites, il me semble évident que dans beaucoup des exemples rapportés nous sommes interpellés par la vérité. Certainement dans la glossolalie, qui distingue, dans le groupe des pentecôtistes, le «vrai» croyant; dans la dictée de la décharge de conscience faite par le condamné à mort profondément convaincu, et ce par l’enseignement des Bianchi, qu’il doit dire la pure vérité pour accéder dans l’au-delà à la présence divine; dans la poésie où le fait de déclamer la vérité semble être sa vraie raison d’être; dans l’omertà, où la vérité est tue puisqu’on pourrait mourir en l’énonçant; dans la revendication, de la part de Franca Viola et des femmes, d’un vécu différent; dans la reconnaissance qui en a été faite par Buscetta et les repentis; dans la nécessité de la masquer avec des procédures variées (métaphores) comme le montre le récit de Cockburn.
L’omertà ou loi du silence a toujours beaucoup intéressé le public qui croyait y voir une spécificité sicilienne surtout liée à la Mafia. Pour contrecarrer cette opinion, Maria Pia Di Bella dévoile les différents plans (religieux, politique, culturel) de l’art du « dire » ou du « taire » en Sicile. Elle présente plusieurs de ses facettes et la richesse de ses gradations. Pour dire ce que l’on ne peut en principe dire, l’emploi des métaphores est roi, et cet emploi est si subtil qu’il échappe à tout étranger ; pour dénoncer publiquement l’injustice, seul le poète y accède sans s’exposer à la violence ; pour s’asseoir un jour à la droite de Dieu, le condamné à mort dicte une « décharge de conscience » aux membres de la confrérie qui s’occupent de lui et dans laquelle il dira la « pure vérité » afin d’effacer la vérité extorquée sous la torture ; pour être « sauvé », le parler en langues (glossolalie) devient signe d’un don du Saint-Esprit qui permet au fidèle un statut supérieur au sein de son Église ; pour leurs prises de parole publique, les femmes siciliennes se réfèrent à l’une d’entre elles, Franca Viola, admirée parce qu’elle a su prononcer un simple « non ».
Maria Pia Di Bella est anthropologue au CNRS et membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux à l’EHESS. Elle a mené une première recherche dans les Pouilles sur les conversions au pentecôtisme en milieu rural, puis une autre en Sicile sur les représentations de la justice, notamment à travers les condamnés à mort de Palerme (1541-1820). Elle a publié La Pura verità. Discarichi di conscienza intesi dai Bianchi (Sellerio, 1999) et dirigé Vols et sanctions en Méditerranée (Éd. Archives contemporaines, 1998). Elle travaille actuellement aux États-Unis sur les associations de victimes de crimes, leurs narrations et leurs mémoriaux (musées, jardins).