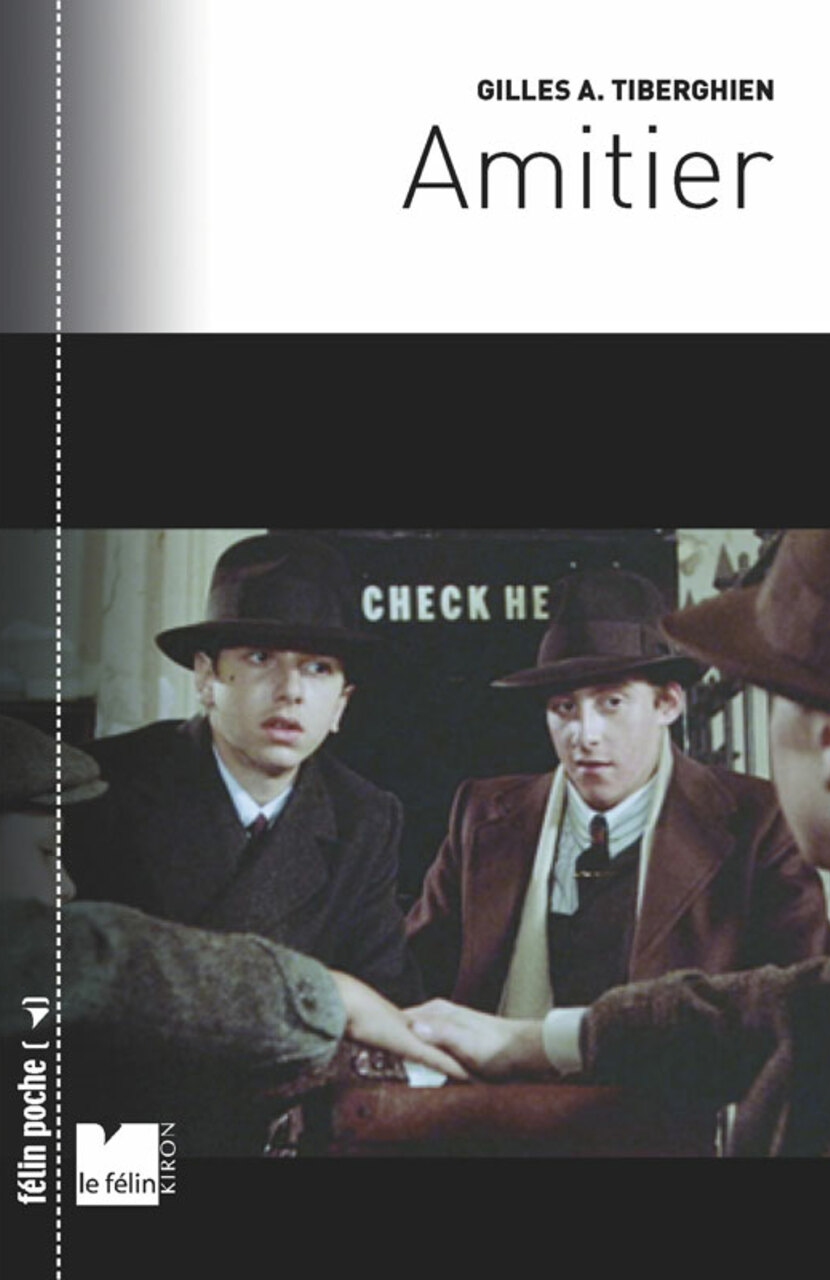
Amitier
« Comme l’a relevé un jour Jean-Paul, écrit Sloterdijk, les livres sont de grosses lettres adressées à des amis1. » Peut-être est-ce plus vrai encore des livres de philosophie, de l’activité philosophique elle-même qui postule toujours, implicite ou réelle, connue ou imaginée, l’existence d’un ami auquel on adresse ses pensées. C’est peut-être même le propre de cette activité solitaire que de faire fond sur l’amitié, de l’entretenir comme une condition de son exercice. « La question est importante, écrit Deleuze dans son introduction à Qu’est-ce que la philosophie ?, puisque l’ami tel qu’il apparaît dans la philosophie ne désigne plus un personnage extrinsèque, un exemple ou une circonstance empirique, mais une présence intrinsèque à la pensée, une condition de possibilité de la pensée même, une catégorie vivante, un vécu transcendantal2. »
Cela étant, si l’ami dans l’Antiquité devient, comme le disent encore Deleuze et Guattari, « un personnage conceptuel », ce phénomène est aussi lié à la société grecque, au statut anthropologique de l’ami, aux conséquences morales et politiques de l’amitié que permet ce genre de société. Il est clair, par exemple, que si parler d’égalité entre amis comme le fait Aristote a, nous le verrons, une réelle résonance pour nous, il ne faut pas oublier qu’une telle égalité est fondée sur une discrimination profonde qui caractérise le monde antique et marque une différence de nature entre l’homme et la femme, mais aussi entre certains hommes, ceux qui sont libres et ceux qui sont esclaves.
L’amitié antique est gouvernée par le discours, le logos ; elle est considérée comme une vertu, c’est-à-dire précisément une « disposition à agir » en suivant une règle, avec cette mesure propre aux hommes prudents et justes, capables de peser et d’évaluer leurs actions et celles des autres. Or toute la philosophie grecque, et la philosophie politique en particulier, suppose une communauté de pensée possible, une koiné fondée sur l’usage d’une raison capable de maîtriser les désirs pour parvenir au bien. Dans cette optique, celui-ci ne peut être conçu que commun, partagé par chacun et pour le profit de tous en vue du bonheur.
Chez les Modernes en revanche, depuis Machiavel et Hobbes, la raison ne fonde plus le politique. Que ce soit la peur de la mort (Hobbes) ou la compassion (Rousseau), les ciments du lien social ont cessé d’être rationnels. La société n’est plus le garant de la modération et de la justice au nom de la raison qui la gouverne. Au contraire, elle est le creuset des passions qu’elle suscite en même temps qu’elle doit les canaliser. L’amitié n’est pas dès lors considérée comme une vertu pour les Modernes et doit compter avec cette nouvelle situation. Personne dans ce contexte, et contrairement à ce qu’affirmait Aristote, ne peut désormais partager le bonheur de son meilleur ami sans l’envier. Les sentiments moraux ne sont plus à l’abri des passions et c’est ainsi que le thème de l’amour va se mêler à celui de l’amitié.
Évoquant les divers sens que le terme d’amitié a pu avoir de l’Antiquité à nos jours, la façon dont la philia grecque s’est transformée en l’amicitia latine et dont l’un et l’autre terme sont traduits aujourd’hui en nos diverses langues actuelles par amitié, friendship ou Freundschaft, Jean-Claude Fraisse en conclut que « ces difficultés rendent totalement illusoire la prétention de rapprocher Anciens et Modernes du point de vue de la philosophia perennis, et imposent le rejet de toute méthode qui ne soit pas purement historique1 ». Or, sans pour autant faire fi de l’histoire et des contextes de pensées qui ont déterminé l’occurrence de certains termes philosophiques et plus particulièrement ici celui d’amitié, il me semble que l’on a tout à gagner à repenser ces termes dans le contexte intellectuel, social et politique qui est le nôtre pour comprendre en quoi il est possible de les transposer. Peut-être cela a-t-il à voir avec une certaine vision du monde liée à des valeurs qui ont dominé pendant plusieurs siècles et dont la disparition nous renvoie à l’examen de notre humaine condition. Ainsi, comme l’écrit Paul Veyne dans son avant-propos aux œuvres de Sénèque, « il demeure que nous avons le droit de rêver sur d’antiques pensées que nous remployons à la manière des hommes de la Renaissance qui remployaient dans une église quelques colonnes tirées des ruines d’un temple païen ». Et de montrer comment la conception antique du moi peut trouver une résonance pour un esprit moderne : « Le paradoxe est qu’un point de détail de la doctrine stoïcienne, à savoir l’autonomie du moi et la possibilité d’un travail de soi sur soi, devienne pour nous un moyen de survivre malgré la disparition de tout ce dont le stoïcisme affirmait l’existence : la nature, le dieu, l’unité du moi1. »
Pour revenir à la précision terminologique, elle est soulignée dès le Lysis de Platon, qui manifeste tout de suite ce que ce terme de philia peut avoir de vague selon que l’on conçoit l’amitié comme amour actif, passif ou réciproque. La philia grecque a une extension beaucoup plus large que l’amitié au sens où nous l’entendons aujourd’hui et n’est pas loin de ce que nous comprenons généralement par amour. « Si l’amitié est prise pour type de toutes les affections, c’est qu’elle est, dans les mœurs de la Grèce, l’affection la plus forte et la plus développée : elle éclipse l’amour, elle a des racines plus profondes que le sentiment de la famille, elle est chantée par les poètes. […] L’amitié est, dans le monde antique, ce qu’est l’amour dans le monde chevaleresque et chrétien2 », écrit L. Dugas. D’où la difficulté dans laquelle nous nous trouvons parfois lorsque nous lisons les textes grecs qui évoquent des sentiments qui, tels des instruments mal accordés ou appartenant à une autre gamme, ne correspondent guère à ce que nous entendons aujourd’hui sous les mêmes vocables. Déjà, dans le monde antique, la philia elle-même est passée d’un sens qui, chez Homère, appartenait davantage au vocabulaire du droit, et indiquait la possession, à un certain type de relation affective fondée sur une estime réciproque, et cela au prix d’une série de glissements sémantiques. Ainsi, note Pierre Macherey, « toujours, chez Homère, le terme qui désigne le rapport affectif entre deux personnes que nous désignons aujourd’hui en nous servant du terme “amitié” est, non pas philos, mais hétairos : le compagnon, celui dont on est inséparable1 ». C’est dans les textes d’Aristote et de Cicéron, chez les épicuriens et chez Sénèque, que la philia grecque trouvera son expression la plus accomplie.
Dans la préface de leur anthologie, Sagesses de l’amitié, Jacques Follon et James McEvoy notent que le grec néotestamentaire a fait un usage très sélectif, et considérablement orienté dans le sens de la nouvelle doctrine (chrétienne), des termes grecs signifiant l’amour. Eran et son substantif eros sont systématiquement écartés, tandis que sterguein qui signifie l’affection familiale est pratiquement inutilisé2. Philein, trop chargé théoriquement, trop marqué par les doctrines païennes antiques, « n’est appliqué qu’aux rapports que Jésus entretenait avec Pierre, Lazare et “le disciple qu’il aimait” ». Dès lors agapan et agapê, « parce que beaucoup plus marginaux, servirent pour dire l’amour. […] Il en est résulté que, écrivent nos auteurs, dans le vocabulaire de toutes nos langues occidentales, le mot “amour” a pris (par le biais des expressions “amour de Dieu” et “amour du prochain”) une place tout à fait centrale et que le mot “amitié” a été relégué au second rang. Plus précisément, l’incontestable primauté que le terme philia avait dans le grec des époques classique et hellénistique fut renversée au profit du terme agapê, de la même façon qu’en latin amicitia dut en quelque sorte céder la première place à amor et à caritas1 ».
La charité comme amour universel du prochain a pris le pas sur toutes les autres formes d’amour, reléguant l’amitié à une relation privilégiée entre deux ou plusieurs individus dont l’expérience est essentiellement privée. L’inscription de cette expérience dans la sphère du public est d’ailleurs une question déjà débattue par les Anciens, mais dans un contexte où les conflits d’intérêts appartenaient à la même sphère – publique – et opposaient la vertu à la gloire ou à la puissance sans qu’aucune relève du seul domaine privé (bien au contraire puisque l’économie domestique, les affaires du foyer n’avaient que peu à voir avec l’amitié, même si Aristote a pu parler dans certaines conditions de rapports amicaux au sein de la famille). L’amitié a d’abord été pensée dans un monde païen : Aristote plus que tout autre a donné à cette notion les traits que nous lui reconnaissons encore aujourd’hui, parmi lesquels une égalité (de vertu) et une réciprocité d’action dans une intimité partagée. Or ce modèle a été vite combattu par la conception universelle de l’amour véhiculée par le christianisme pour lequel l’humanité compte d’abord à travers chaque homme. C’est la charité qui fonde la communauté des chrétiens, pas l’amitié, et celle-là, à la différence de celle-ci, n’exige pas de réciprocité. Les rapports électifs qui rapprochent les amis contredisent de surcroît la qualité indifférente de tout prochain que l’Église commande d’aimer comme soi-même.
Reste aujourd’hui une situation complexe fondée sur cet héritage et qui fait de l’amitié un sujet philosophiquement trouble et généralement négligé. La sympathie, pensée par Rousseau comme base de notre rapport à autrui, était méprisée par l’Antiquité comme quelque chose dont la nature affective nous dépasse et qui tombe hors du contrôle de la raison. Discourir était sans doute l’essence de l’amitié pour les Grecs, alors que pour nous c’est souvent un vain « bavardage », philosophiquement stigmatisé comme une forme inauthentique d’être au monde. Or, comme le dit Hannah Arendt pour la philosophie antique, « avec le dialogue se manifeste l’importance politique de l’amitié, et de son humanité propre. […] Car le monde n’est pas humain pour avoir été fait par les hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu’il est devenu objet de dialogue1 ».
On voit dès lors que l’amitié n’a pas l’évidence qu’on lui prête en général. Avoir des amis nous semble la chose du monde la plus naturelle ou la mieux culturellement partagée. Pourtant l’amitié correspond, en son sens premier, à des pratiques et à des valeurs qui sont pour nous désormais quelque chose du passé – pour reprendre une formule célèbre de Hegel. Les conditions sociales et intellectuelles de son exercice ont changé dans un monde où, du moins en Occident, l’individualisme l’emporte sur toute autre valeur ; et pourtant nous continuons d’une certaine façon à faire comme si de rien n’était. Comme si nous avions encore besoin de croire à l’amitié en dépit des difficultés croissantes que nous rencontrons pour vivre avec nos amis. Car telle était pour les Grecs une condition essentielle de l’amitié : la vie commune. D’où l’importance de la communauté des amis qui s’appuyait plus généralement sur la communauté politique qu’elle rendait en même temps possible. Cette question est complexe et nous ne l’abordons ici que dans le cadre étroit déjà posé par Aristote, dans Éthique à Nicomaque en particulier1. C’est à lui d’ailleurs que nous revenons le plus souvent tout au long de ce livre, car il est le premier à avoir véritablement théorisé l’amitié et il est – je l’ai dit – celui dont nous tenons l’essentiel de ce que nous entendons aujourd’hui par ce mot, sans mesurer combien parfois, et dans le même mouvement, nous lui tournons radicalement le dos.
On aime ses amis, mais on ne les aime pas du même amour que l’être aimé, qu’il soit par ailleurs mari, femme ou enfant. On aime, mais quelle sorte d’amour est-ce là ? Nous n’avons pas de mot pour le dire, pour le spécifier : nous avons perdu la diversité de ces termes qui faisaient la richesse du vocabulaire grec et disaient non seulement l’amitié, mais pouvaient même en différencier les modes, rendant compte en même temps d’une réalité sociale et d’usages aujourd’hui pour partie oubliés. Que nous ne disposions plus d’un verbe pour dire l’amitié en train de s’exercer et que nous ayons recours à un autre vocabulaire montre bien la conscience relativement confuse que nous en avons. Avec le mot, avons-nous perdu ce qu’il désigne ?
Il me semble plutôt que, sans être tout à fait perdue, l’amitié est à réinventer dans un monde qui en manifeste d’autant plus le besoin que, paradoxalement, il en rend la réalité de plus en plus problématique, de plus en plus difficile à vivre, dans la mesure où, pour le dire vite, il a transformé les communautés humaines en institutions (« la Communauté européenne »), en agglomérations – comme les ensembles du même nom appelés aussi parfois indûment « cités » –, ou en chapelles religieuses ou idéologiques1. Comment vivons-nous encore avec nos amis ? Nos projets nous rassemblent quelquefois, mais nous éloignent en fait le plus souvent, nous permettant certes de nous créer de nouvelles amitiés mais non d’en prolonger l’existence, qui tient au temps du travail commun et se perd celui-ci accompli, faute d’autres repères, d’autres valeurs qui fondent ainsi ces pratiques sociales.
C’est pourquoi j’ai cherché un verbe qui soit à l’amitié ce que le verbe aimer est à l’amour, dans l’idée que ce livre devait porter non sur un état mais sur une action dont il s’emploierait à analyser diverses modalités pour en donner, au bout du compte, une image dynamique, un portrait mobile mais capable de restituer sur le plan du discours et de la pensée quelque chose de ce qu’est l’amitié vécue aujourd’hui. Quand bien même ce verbe existerait, sa fonction serait plutôt ici celle d’un verbe sans sujets spécifiés. Mais en admettant ce néologisme, il faut bien voir que c’est un verbe que l’on ne conjugue pas ; tout juste est-il ici une injonction. À la différence des défectifs dont la conjugaison est incomplète et qui sont progressivement condamnés à disparaître – comme « férir » qui ne s’emploie plus qu’à l’infinitif –, amitier est en puissance un verbe « à toutes les personnes ». Amitier ne se peut sans amis, mais c’est lui qui, en même temps, les rend possibles.
Ce livre donc n’est pas un traité de l’amitié, pas une philosophie de l’amitié qui dirait ce qu’elle est ou ce qu’elle doit être – encore moins une étude psycho-sociologique de la chose –, mais un essai philosophique qui cherche à rendre compte de sa réalité contrastée. Pour cela, j’ai fait appel aux expériences de chacun afin d’en dégager certains invariants, tout en ayant recours aux différentes tentatives de théorisations que l’histoire de la philosophie et de la pensée en général a pu nous en proposer, sans négliger non plus certaines figurations de l’amitié par l’art.
Le livre est construit comme une « suite » de courts textes qui se renvoient les uns les autres comme autant de facettes d’une même pierre, de sorte qu’un thème évoqué dans un chapitre peut être traité sous un angle différent dans un autre, cette entre expression des parties – pour parler comme Leibniz – construisant ainsi une totalité qui n’est jamais vraiment totalisée ou qui ne peut l’être que dans l’esprit de chaque lecteur. L’ensemble dans son organisation m’a semblé conforme à son objet, car c’est la pierre qui rend possible sa taille et non l’inverse. Ce n’est pas un livre nostalgique d’un monde disparu : il dit seulement qu’amitier n’a pas l’évidence que l’on croit et, plutôt que de décrire une réalité présente qui se montrerait à nous, il indique – sans bien sûr dire comment – un monde avenir à (ré) inventer.
Aussi ancien que soit le sentiment de l’amitié, celui-ci n’en demeure pas moins conceptuellement flou. Qu’entendons-nous par là ? Qui sont pour nous ceux que nous appelons des amis ? À partir de la description de ce que peut être l’amitié aujourd’hui – tout en prenant appui sur des exemples empruntés surtout à la littérature et au cinéma – ce livre cherche à en décrire l’expérience problématique. Pour les Grecs, la philia ne recouvrait pas la même chose que l’amitié pour nous et pourtant, à travers Aristote en particulier, elle est restée le modèle de ce que nous entendons par ce mot. Or nous n’avons pas de verbe qui soit à l’amitié ce qu’aimer est à l’amour de sorte que la spécificité de cette relation s’est progressivement perdue. Dans un monde qui ne la favorise en rien, l’amitié est une relation à réinventer. Le verbe amitier dans son étrangeté même dit l’opération de mise à distance rendue ainsi nécessaire pour lui redonner un sens. Ce livre montre le décalage existant entre certaines valeurs cristallisées autour d’une idée que nous nous faisons de l’amitié et les pratiques dont nous nous réclamons au nom de l’amitié : il est construit comme une « suite » de courts textes qui se renvoient les uns les autres comme autant de facettes d’un même ensemble.
Gilles A. Tiberghien est philosophe, il enseigne l’esthétique à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a publié entre autres, Land art, éditions Carré, 1993, Nature, Art, Paysage, Actes-Sud/ENSP, 2001, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses, Le Félin, 2005, Emmanuel Hocquard, Seghers, 2006, Finis terrae, Bayard, 2007 et Courts-Circuits, Le Félin, 2008.